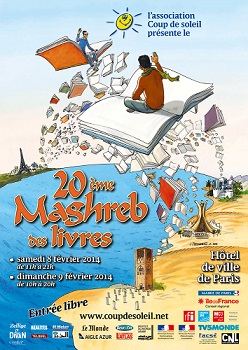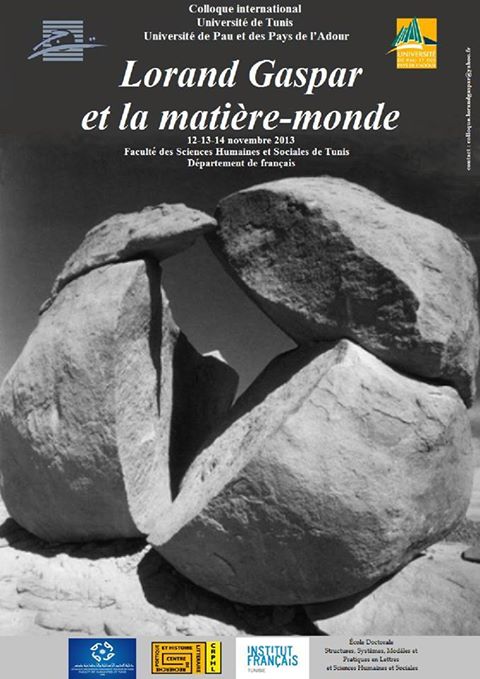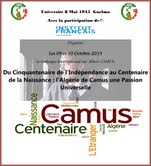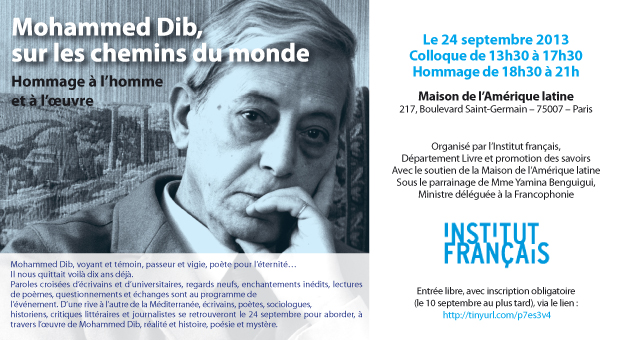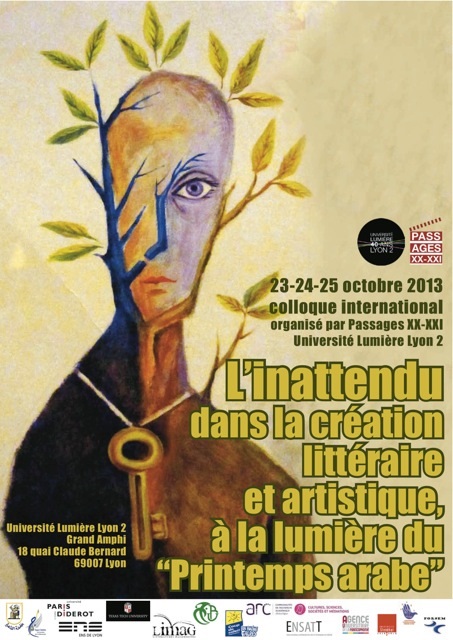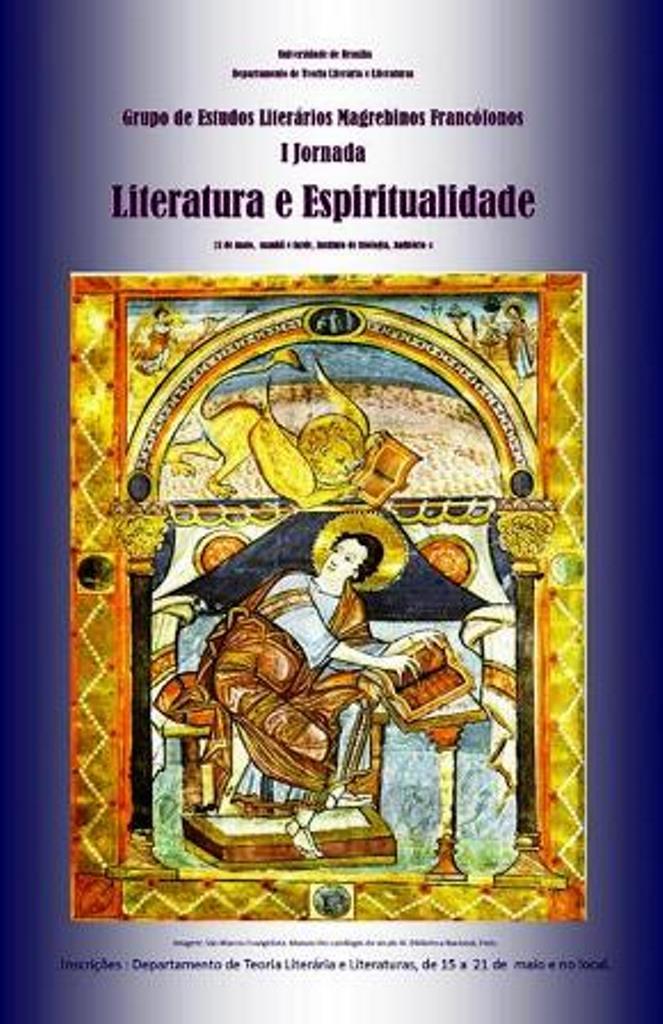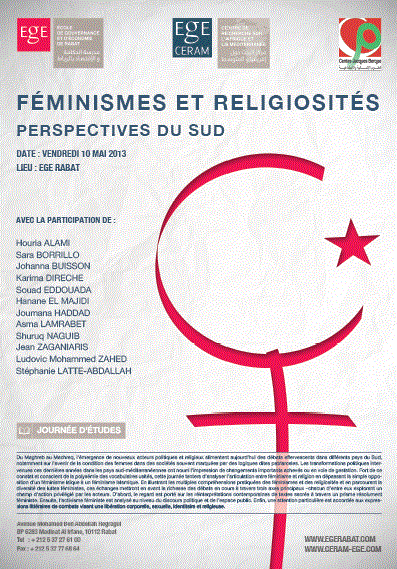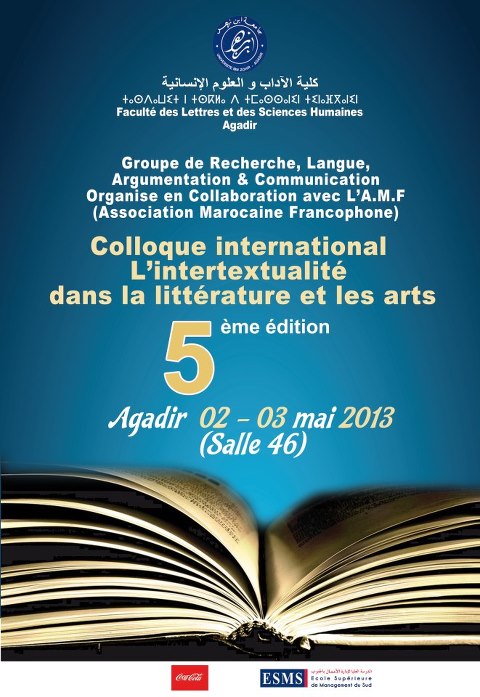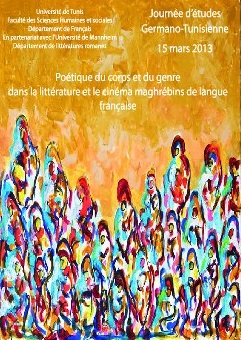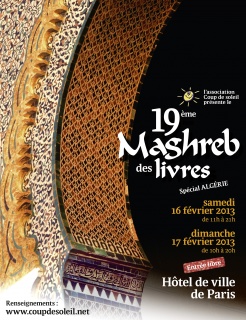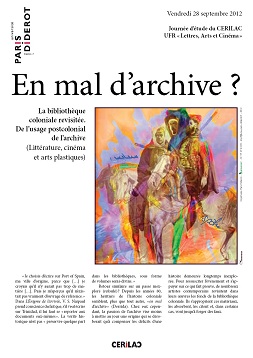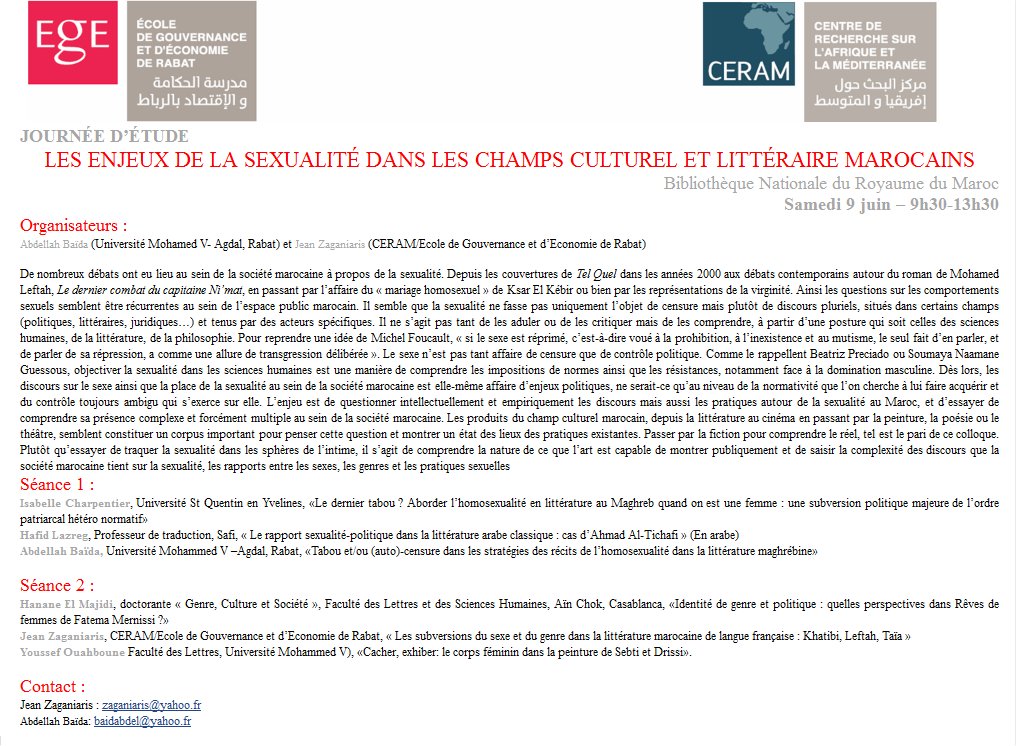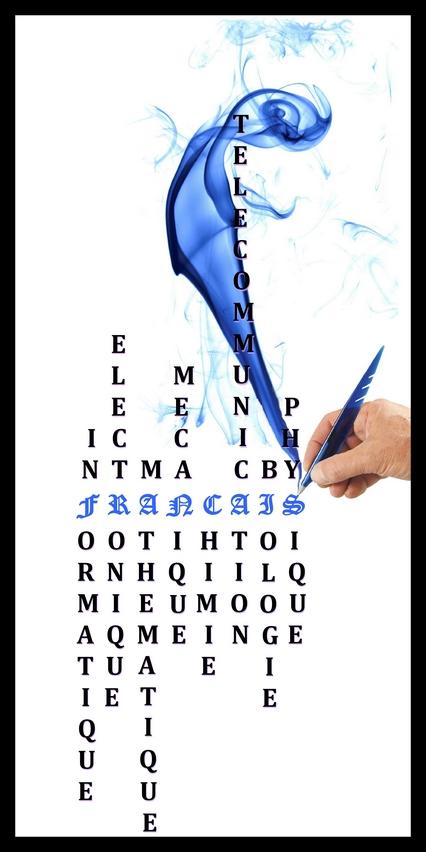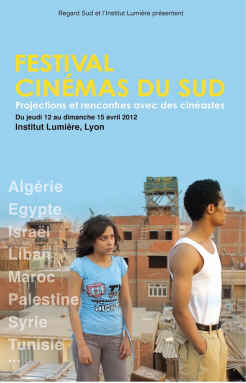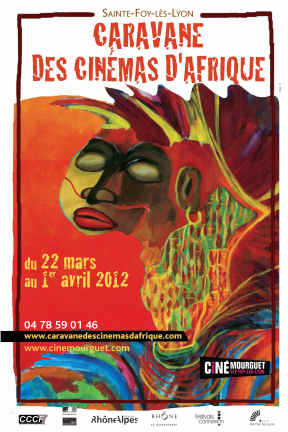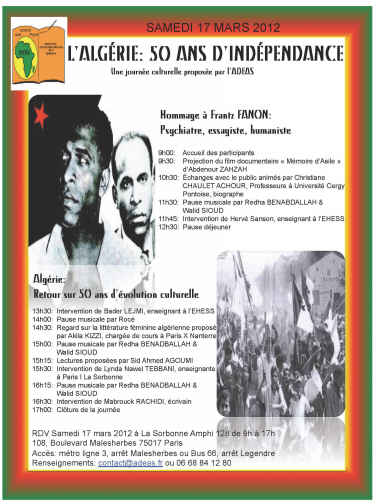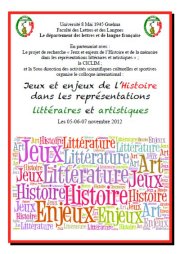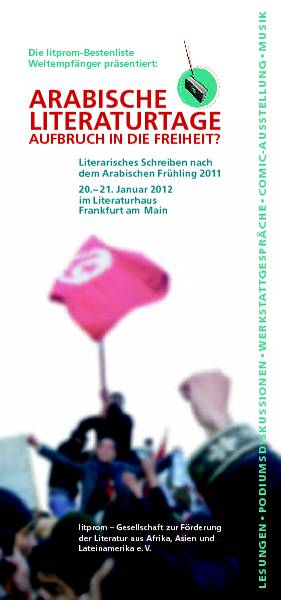|
|

|
Colloques,
manifestations et événements,
signalés par les utilisateurs et classés par ordre chronologique
|
Aucune manifestation future ou en coursListe des manifestations terminées
Du 02 au 03 Mai 2023 :
.docx) |
La littérature maghrébine francophone de l’entre-deux-guerres : une forme de littérature subalterne ou un prélude à une revendication identitaire? Djelfa (Algérie) - Université Ziane Achour -Djelfa Contact : benderahbaya@yahoo.fr |
Du 02 au 03 Mars 2019 :
| |
La recherche en langue et littérature françaises dansle contexte universitaire algérien: État des lieux, actualité et perspectives Setif (Algerie) - Universite Mohamed Lamine Debaghine Setif2 colloque international Contact : oumraheema@yahoo.com |
Du 27 au 28 Novembre 2018 :
| |
Chlef (Algèrie) - Université Hassiba Ben Bouali de chlef Colloque international sur l’évaluation et innovation dans l’enseignement des langues étrangères
Le laboratoire Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement des langues et Traduction (TICELET/ Code C0882600) en Collaboration avec le Centre d’Enseignement I... [Afficher la suite] Colloque international sur l’évaluation et innovation dans l’enseignement des langues étrangères
Le laboratoire Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement des langues et Traduction (TICELET/ Code C0882600) en Collaboration avec le Centre d’Enseignement Intensif des Langues CEIL organise un colloque international le 28/29 Novembre 2018. [Réduire] Contact : l.boussena@univ-chlef.dz |
Du 21 au 22 Novembre 2018 :
| |
Colloque international:Albert Camus et la question des genres littéraires : respect ou transgression(s) ? Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines Nous proposons quelques axes de réflexion à titre indicatif :
- Albert Camus et les genres littéraires
- Signifiance et déclinaison thématique d’un genre à l’autre.
- La question de l'hybridité générique dans l'œuvre d'Albert Camus
- La question de l'hybridité transgénérique da... [Afficher la suite] Nous proposons quelques axes de réflexion à titre indicatif :
- Albert Camus et les genres littéraires
- Signifiance et déclinaison thématique d’un genre à l’autre.
- La question de l'hybridité générique dans l'œuvre d'Albert Camus
- La question de l'hybridité transgénérique dans l'œuvre d'Albert Camus
- Hybridité et style
- Interaction générique et réception [Réduire] |
Du 03 au 04 Decembre 2018 :
 |
Littérature et mobilité(s) Safi (Maroc) - Faculté Polydisciplinaire de safi Le rapport entre la littérature et les différentes mobilités : exil, voyage, errance, multilinguisme... Contact : a.amraoui@uca.ac.ma |
Du 19 au 20 Decembre 2018 :
| |
Colloque international : Le jeu ... des enjeux en perspective Casablanca (Maroc) - FLSH Ben M'sik Casablanca Le jeu est une constante culturelle présente dans toutes les sociétés humaines et à travers les aires civilisationnelles.
L’ethnologie et la sociologie se sont très tôt intéressées à l’universalité de cette activité qui constitue un élément intrinsèque à la condition humaine.
... [Afficher la suite] Le jeu est une constante culturelle présente dans toutes les sociétés humaines et à travers les aires civilisationnelles.
L’ethnologie et la sociologie se sont très tôt intéressées à l’universalité de cette activité qui constitue un élément intrinsèque à la condition humaine.
Du jeu de bascule au jeu d’entreprise, l’homme ainsi que l’enfant aussi, ont su inventer des activités ludiques pour créer une passerelle entre l’imaginaire et la réalité. Souvent opposé à la rigidité, et donnant accès au sens de la liberté et au plaisir, le jeu inscrit les relations humaines dans une dynamique sociale qui produit des phénomènes culturels que nous sommes appelés ici à lire et à interpréter. [Réduire] Contact : Lahcen Ouasmi |
Du 23 au 25 Avril 2018 :
 |
RATEM : Roman Algérien Entre Tradition et Modernité:« Les écritures féminines algériennes de la post-indépendance: Tradition ou modernité ?» Bechar (Algérie) - Université Tahri Mohammed La littérature algérienne produite par les femmes est une littérature qui a vu le jour il y a quelques décennies. En effet, l’ascension de la littérature féminine fut progressive depuis la publication en 1958 du premier roman d’Assia Djebar : La soif car les algériennes se sont exprimées... [Afficher la suite] La littérature algérienne produite par les femmes est une littérature qui a vu le jour il y a quelques décennies. En effet, l’ascension de la littérature féminine fut progressive depuis la publication en 1958 du premier roman d’Assia Djebar : La soif car les algériennes se sont exprimées et se sont ‘dévoilées’. Les femmes algériennes emploient un style d’écriture qui emprunte un autre cheminement narratif, dans un espace différent que celui décrit par les hommes. Notre problématique pour ce colloque international est de décrire le style de la femme algérienne dans son écriture féminine et d’essayer de comprendre comment ou à quel moment cette forme d’écriture est celle de la quête d’un territoire favorable aux inspirations féminines et à l’épanouissement personnel détachés de ceux de l’homme. En effet, les femmes sont nombreuses à avoir franchi les barrières du silence, à avoir pris la plume comme Maïssa Bey, Malika Mokeddem, Ahlam Mostaghanemi, Nina Bouraoui, et bien d’autres. Elles ont levé « l’encre» pour s’aventurer dans un espace encore méconnu qu’est l’écriture. A travers cette manifestation scientifique, nous voulons leur rendre hommage, ces femmes à la quête du bonheur de la liberté. [Réduire] Contact : 0668279635 |
Du 12 au 13 Février 2019 :
| |
Le premier colloque international sur la traduction et la typologie des textes Sur le thème La traduction littéraire : de la traduction à la créativité Marrakech (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Marrakech En collaboration avec le Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité de l’Université Cadi Ayyad et le Département de Langue Arabe et de Traduction de l’Université de Leuven, le Centre Al Kindi de Traduction et de Formation organisera une série de colloques internationaux qui s’intéress... [Afficher la suite] En collaboration avec le Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité de l’Université Cadi Ayyad et le Département de Langue Arabe et de Traduction de l’Université de Leuven, le Centre Al Kindi de Traduction et de Formation organisera une série de colloques internationaux qui s’intéressent à la réflexion sur « la traduction et la typologie des textes ». La première édition portera notamment sur le thème : La traduction littéraire : de la traduction à la créativité. Ces colloques, outre ceux sur la traduction des sens du Coran, s’inscrivent dans la belle tradition, instaurée par le Centre Al Kindi en collaboration avec le Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité, d’organiser une série de colloques annuels sur une problématique liée à la traduction, avec, à chaque fois, une thématique précise. [Réduire] Contact : alkindiconference07@gmail.com |
Du 05 au 06 Mars 2018 :
| |
Regards croisés sur les transformations du statut de la femme au XXIème siècle dans le monde: « PARCOURS DE FEMMES : DE L'OMBRE A LA LUMIERE » Meknès (Maroc) - Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Organisé pour la quatrième année consécutive, ce colloque international se propose d’établir quelques parcours de femmes ayant réussi dans leur domaine à s’affranchir de la sclérose sociétale. Il s’agira de faire sortir de l’ombre vers la lumière des voies féminines venues de dive... [Afficher la suite] Organisé pour la quatrième année consécutive, ce colloque international se propose d’établir quelques parcours de femmes ayant réussi dans leur domaine à s’affranchir de la sclérose sociétale. Il s’agira de faire sortir de l’ombre vers la lumière des voies féminines venues de divers horizons ce qui sera, non seulement un hommage à ces femmes mais aussi une occasion de relater une expérience féminine. Pour cause, l'objectif du colloque, en sa quatrième édition, est d'apporter par les communications un souffle et une réelle motivation à toutes les femmes qui assisteront pendant deux journées à des expériences de réussite; ce qui sera un référentiel pour tous et toutes. [Réduire] Contact : Fatima Zohra BENSALAH |
Du 13 au 14 Decembre 2017 :
| |
L’esthétique malehienne à l’épreuve de la contemporanéité KENITRA (MAROC) - FACULTE DES LETTRES UNIVERSITE IBN TOFAIL L’esthétique malehienne
à l’épreuve de la contemporanéité
(Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017, Faculté des lettres, Kénitra, Maroc)
Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance d’Edmond Amran El Maleh, le laboratoire Didactique, Littérature, Langage, Arts et T... [Afficher la suite] L’esthétique malehienne
à l’épreuve de la contemporanéité
(Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017, Faculté des lettres, Kénitra, Maroc)
Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance d’Edmond Amran El Maleh, le laboratoire Didactique, Littérature, Langage, Arts et TICE de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université Ibn Tofail de Kénitra (Maroc) et la Fondation Edmond Amran El Maleh organisent un colloque international sous le titre : L’esthétique malehienne à l’épreuve de la contemporanéité. L’événement entreprendra la dimension esthétique dans la pensée et l’œuvre de cet écrivain pluriel. Il vient clôturer l’ensemble des activités scientifiques et culturelles qui ont meublé cette année 2017. Le SIEL de Casablanca, le Salon du Livre de Paris et Essaouira ont constitué des étapes importantes dans la célébration de la pensée malehienne en portant sur un aspect particulier de sa pensée prospective. « Peinture et écriture », « E. A. El Maleh : l’écrivain et le philosophe », « E. A. El Maleh : valeurs et universalité » telles étaient respectivement les thématiques des trois rencontres que nous pensons promouvoir dans un esprit de contemporanéité.
Plus vivant que jamais, Edmond Amran El Maleh (1917-2010) aurait fêté son centième anniversaire le 30 mars 1917. Il lègue une œuvre considérable qui aujourd’hui ouvre des perspectives nouvelles, alors même que la figure marquante qu’il incarne semble, en apparence seulement, s’éloigner dans le temps. Or, l’auteur de Parcours immobile, l’œuvre fondatrice (1980), est des plus actuels. La célébration du centenaire de la naissance d’El Maleh nous offre en effet l’opportunité de montrer l’actualité de son œuvre et son apport décisif à la production littéraire, artistique et culturelle marocaine. Ainsi, le choix de l’esthétique comme étape ultime de ces activités constituera une belle perspective en vue d’un hommage intégral redu à El Maleh, l’homme, l’écrivain, le philosophe et l’esthète. En effet, l’esthétique est le lieu de capitalisation mais aussi d’harmonisation de l’esprit malehien qui nous permet d’accéder, à plusieurs niveaux, à la pensée plurielle de l’auteur.
Selon le philosophe allemand Alexander Gottlieb Baumgarten dans son ouvrage Aesthetica, paru en 1750, l’esthétique est « la science du mode de connaissance et d’exposition sensible ». Baumgarten considère l’idée du beau comme une perception confuse ou un sentiment, et de ce fait, comme une forme inférieure de connaissance, d’où l’usage du mot esthétique qui s’oppose, pour une grande partie, à la logique. Cette acception de l’esthétique, étant moderne, voire contemporaine, est en partie partagée par Edmond Amran El Maleh pour qui l’esthétique est une seconde nature que permet et promeut la culture. C’est autant une manière d’être dans le monde que celle d’agir sur lui. Son intérêt pictural est l’aboutissement d’une carrière philosophique, journalistique et d’écriture sur l’art depuis 1965 qui se capitalise progressivement à travers une œuvre esthétique et littéraire imposante. Ses écrits sur l’art pictural développent une interrogation permanente sur la condition humaine et le sort imprévisible de l’être avec une quête inachevée sur le corps, la matière et leur poétique plastique commune. Lesquels questionnements engendreront un entretien particulier entre la matérialité de l’homme, sa métaphysique et sa spiritualité.
Dans ce sens, l’introspection scripturale malehienne célèbrera l’esthétique d’une existence marocaine et le multiculturalisme d'un Maroc pluriel, fier de ses origines arabe, berbère et juif, synonymes de richesse et de diversité humaine productive. Son œuvre protéiforme traduit, selon Abdallah Mdarhri Alaoui, l’exercice d’une identité multiple, ouverte sur l’universel. Elle est une action interminable de coupures, de nomadisme, de diaspora et de rencontres réitérées qui marquent sa trajectoire de Marocain cosmopolite.
La scripturalité d’El Maleh chemine allégoriquement entre la peinture et l’écriture en s’inventant un destin picto-littéraire insolite. L’immixtion réussie de ces deux modes de représentation et de création sera le gage d’une écriture poétique, voire « plastique » qui investit les vertus inexplorées du langage et ses symboles jusque dans les sentiers de la kabbale et de la mystique. Son usages singuliers des signes et, par conséquent, celui de la logique linguistique, est à interpréter dans ses connexions esthétiques entre le domaine de la narratologie, de la sémiotique et de l’esthétique.
L’intérêt d’El Maleh pour l’expression artistique au Maroc ou ailleurs implique une étude approfondie de son œuvre afin d’apprécier sa prise en charge littéraire et esthétique des arts plastiques et de leur promotion socioculturelle. En effet, à rassembler les écrits d’Edmond Amran El Maleh sur l’art, on s’aperçoit aussitôt qu’on est devant un patrimoine artistique et littéraire inestimable. Son écriture plastique fait office d’une anthologie intégrale de l’art musulman, arabe et parfois occidental, mais en particulier marocain qui fête la naissance d’une création artistique nationale et retrace ses contours culturels. Les textes malehiens sur l’art sont d’une variété étonnante, s’étalant sur une durée importante et parcourant tous les domaines de la création artistique, allant de la peinture jusqu’à l’art de la tapisserie en passant par la sculpture, la gravure, l’architecture et s’engendrant, par extension, dans des postures modernes et futuristes de l’art contemporain, comme dans l’installation, la performance, le muralisme, la photographie, le graffiti, la vidéo, le cinéma, la musique, les arts du spectacle, etc. La posture d’El Maleh vis-à-vis de l’art, de son intellection et de son écriture est d’une utilité méthodologique capitale dans la compréhension de sa pensée et de sa production intégrale. Une position qui éclairera davantage son rapport éthique et esthétique à l’art et ses prospections philosophiques inachevées entre l’écriture, l’histoire, la philosophie, l’essai et la critique artistiques.
Ainsi un certain nombre d’interrogations interpellent les chercheurs qui se penchent sur cette problématique. De ces interrogations et de ces constats naissent les axes que nous suggérons ici à titre indicatif :
• L’esthétique d’El Maleh à l’épreuve de la contemporanéité
• L’écriture malehienne à l’épreuve de l’esthétique
• Esthétique et éthique malehiennes : arts et littérature
• El Maleh face à l’éthique de la mémoire et l’esthétique de l’oubli
• El Maleh : historien, écrivain, philosophe, essayiste ou critique d’art ?
• El Maleh : un homme qui a fait de sa vie une œuvre et de son œuvres une vie.
• Rôle de la critique dans la détermination de la valeur chez El Maleh.
• Le transfert des valeurs esthétiques dans le texte malehien.
• Censure et autocensure chez Edmond Amran El Maleh.
• El Maleh et la restitution des arts au Maroc.
• Témoignages de peintres amis d’Edmond Amran El Maleh.
D’autres axes de réflexion pourraient enrichir ces indications.
Les propositions de communications doivent nous parvenir avant le 30 septembre 2017. Elles seront composées d’un résumé d’une dizaine de lignes et d’une notice bio/bibliographique ne dépassant pas ½ page. A envoyer par email au coordonnateur du colloque Zouhir ZIGHIGHI (zighighi_zouhir@yahoo.fr)
Le comité scientifique donnera une réponse aux auteurs le 20 octobre 2017.
La durée de la présentation de chaque communication sera de 20 minutes.
Comité scientifique : Sanae GHOUATI, Abderrahmane TENKOUL, Zouhir ZIGHIGHI, Anouar BENMSILA, Karima YATRIBI.
Responsables scientifiques: Sanae GHOUATI et Zouhir ZIGHIGHI
Laboratoire DILILARTICE, Département de langue et de littérature françaises –Faculté des Lettres - Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc. [Réduire] Contact : ZOUHIR ZIGHIGHI |
Du 19 au 20 Février 2018 :
| |
Les références judéo-chrétiennes dans les traductions des sens du Coran Marrakech (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Cinquième colloque international sur la traduction des sens du Coran |
Le 16 Mai 2017 :
.jpg) |
Perspectives de recherche en Sciences du Langage Mostaganem (Algérie) - Université de Mostaganem, site: Ex: ITA, salle de conférences Cette journée d’étude intitulée : « Perspectives de recherche en Sciences du Langage » a pour objectif de présenter quelques aspects de l’état de l’art sur des problématiques inhérentes aux champs disciplinaires de la sociolinguistique et de la sociodidactique. La phase d’accumulati... [Afficher la suite] Cette journée d’étude intitulée : « Perspectives de recherche en Sciences du Langage » a pour objectif de présenter quelques aspects de l’état de l’art sur des problématiques inhérentes aux champs disciplinaires de la sociolinguistique et de la sociodidactique. La phase d’accumulation des travaux produits ou en cours de réalisation sur la question des langues est importante dans tous les travaux de recherche. C’est là où intervient un travail de synthèse diachronique et séquentiel pertinent des productions les plus importantes sur un sujet donné. Cette étape consiste en un travail réflexif que commande la dimension épistémologique devant caractériser toute entreprise de recherche dont l’objectif est de faire avancer la connaissance dans un champ d’étude donné. Les activités de cette journée d’étude visent à montrer l’importance de ce travail réflexif et d’explorer quelques uns des aspects de la littérature en rapport avec le traitement du plurilinguisme en contexte algérien, et ce à partir des points de vue théoriques de la sociolinguistique générale, de la sociodidactique et de la sociolinguistique urbaine. [Réduire] |
Du 15 au 16 Novembre 2017 :
| |
colloque interdisciplinaire:''L'Utopie au présent'' Tunis (Tunisie) - Académie Beit-el-Hekma,Carthage La notion autour de laquelle nous voudrions placer les actes du colloque touche à des lieux de création et de réflexion qui favorisent la rencontre de sensibilités et de compétences d’horizons divers et qui suscitent un questionnement et un dialogue nourris sur l’utopie comme discou... [Afficher la suite] La notion autour de laquelle nous voudrions placer les actes du colloque touche à des lieux de création et de réflexion qui favorisent la rencontre de sensibilités et de compétences d’horizons divers et qui suscitent un questionnement et un dialogue nourris sur l’utopie comme discours (musical, pictural, littéraire, idéologique,etc.) ayant son vocabulaire, sa syntaxe et sa stratégie, comme figures de l’imaginaire, comme territoires où se logerait l’altérité, comme construction concrète, comme symptôme et comme fantasme ou fantaisie. Il convient de considérer, à ce propos, la confiscation des utopies et leur dévaluation par différentes instances. La vocation de l’art, imbu de ses pouvoirs d’anticipation, n’est-elle pas de nous mettre à la limite des possibilités actuelles du monde, à nous donner à voir les lieux de ce qui n’est pas encore ?Plutôt que de dresser un catalogue des utopies contemporaines ou des projets « futuristes » actuels, l’ambition de ces rencontres est de réfléchir à la question de la survivance, aujourd’hui, sous quelles formes et à quelles fins, de la pensée utopique. Au-delà des différentes représentations et autres transpositions sémiotiques de la notion, la réflexion portera sur le devenir même du concept d’utopie. favorisent la rencontre de sensibilités et de compétences d’horizons divers et qui suscitent un questionnement et un dialogue nourris sur l’utopie comme discours (musical, pictural, littéraire, idéologique,etc.) ayant son vocabulaire, sa syntaxe et sa stratégie, comme figures de l’imaginaire, comme territoires où se logerait l’altérité, comme construction concrète, comme symptôme et comme fantasme ou fantaisie.
Le meilleur des mondes peut couver son gène schizophrénique et connaitre une imparable sclérose.
La vocation de l’art, imbu de ses pouvoirs d’anticipation, n’est-elle pas de nous mettre à la limite des possibilités actuelles du monde, à nous donner à voir les lieux de ce qui n’est pas encore ?Plutôt que de dresser un catalogue des utopies contemporaines ou des projets « futuristes » actuels, l’ambition de ces rencontres est de réfléchir à la question de la survivance, aujourd’hui, sous quelles formes et à quelles fins, de la pensée utopique. Au-delà des différentes représentations et autres transpositions sémiotiques de la notion, la réflexion portera sur le devenir même du concept d’utopie. [Réduire] Contact : bechir ben aissa |
Du 07 au 08 Mars 2018 :
| |
EXPRESSIONS FRANCOPHONES EN EUROPE ET AU MONDE ARABE : SINGULARITES ET LIEUX DE PARTAGE En hommage à Abdelwahab Meddeb Kénitra (Maroc) - Université ibn Tofail Faculté des Lettres Contact : ghousana@yahoo.fr |
Du 27 au 28 Novembre 2018 :
| |
Questions autour de l'oral : de l'interdisciplinarité à la complexité Blida (Algérie) - Université de Blida 2 Ce colloque international ce veut interdisciplinaire puisque qu'il liera autour de l'oral plusieurs champs de recherches : la littérature, la sociolinguistique, la didactique des langues et des cultures. Contact : ouardia.aci@gmail.com |
Du 17 au 18 Mai 2017 :
 |
EXPRESSIONS FRANCOPHONES EN EUROPE ET AU MONDE ARABE : SINGULARITES ET LIEUX DE PARTAGE En hommage à Abdelwahab Meddeb Kénitra (Maroc) - Université Ibn Tofail Contact : Sanae Ghouati |
Du 28 au 30 Mars 2017 :
 |
Le Déterreur - Théâtre I Texte de Mohammed Khaïr Eddine Paris 20 (France) - Le Tarmac - La scène internationale francophone Dans le cadre des Traversées du monde arabe, le Tarmac programme le spectacle Le Déterreur, d'après l'oeuvre de Mohammed Khaïr-Eddine, mise en scène et adaptation Cédric Gourmelon, du 29 au 31 mars :
Mohammed Khaïr-Eddine est un poète visionnaire, un rêveur errant qui a intégré dans s... [Afficher la suite] Dans le cadre des Traversées du monde arabe, le Tarmac programme le spectacle Le Déterreur, d'après l'oeuvre de Mohammed Khaïr-Eddine, mise en scène et adaptation Cédric Gourmelon, du 29 au 31 mars :
Mohammed Khaïr-Eddine est un poète visionnaire, un rêveur errant qui a intégré dans son œuvre les mythes fondateurs de la culture marocaine et qui fustige à tout-va toutes les figures de l’autorité. Cédric Gourmelon fait entendre la voix et les mots dressés de l’écrivain rebelle. Le propos est là, cru et nu, comme la poésie qui le porte. Un séisme dont la beauté vénéneuse semble renaître du sordide. [Réduire] Contact : Amélie Coquerelle |
Du 20 au 22 Mars 2017 :
 |
Paris (France) - Le Tarmac - La scène internationale francophone Le Tarmac à Paris 20ème organise un temps fort intitulé "Les Traversées du monde arabe" qui se déroule du 21 février au 31 mars 2017. Ces Traversées sont une invitation à jouer à saute-frontières, passer d’un bord à l’autre, tout simplement changer de côté le temps d’un ... [Afficher la suite] Le Tarmac à Paris 20ème organise un temps fort intitulé "Les Traversées du monde arabe" qui se déroule du 21 février au 31 mars 2017. Ces Traversées sont une invitation à jouer à saute-frontières, passer d’un bord à l’autre, tout simplement changer de côté le temps d’un spectacle.
Amer, texte d’Amine Adjina et mise en scène d’Amine Adjina et d’Azyadé Bascunana, du 21 au 23 mars :
http://bit.ly/2lbgnxn
L’appel à la prière, les taxis jaunes, la palmeraie, la première cigarette, les confidences, le désert, les mouettes et la musique de la mer… Amer débusque les souvenirs lovés, au creux de l’intime, dans les interstices de la mémoire d’une jeune fille qui a fait la promesse de retourner en Algérie enterrer les cendres de sa grand-mère. Depuis l’enfance, elle narre son histoire et regarde sa grand-mère comme son pays, avec une tendre connivence et un sourire complice. [Réduire] Contact : Amélie Coquerelle |
Le 22 Mars 2017 :
| |
L’écrit en classe de langue au 21ème siècle » MEKNES (MAROC) - Ecole Normale Supèrieure Une journée d'étude Contact : m.sadiqui@ens.umi.ac.ma |
Du 15 au 16 Novembre 2017 :
 |
L'oralité : de la production à l'interprétation Casablanca (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik Casablanca Colloque international consacré à "L'oralité : de la production à l'interprétation". Contact : Pr Lahcen OUASMI, Directeur du Laboratoire de Langues, Littératures et Communication |
Du 26 Avril 2017 au 27 Avril 2016 :
| |
Identité et Mutations en Langue et en Littérature : Approches transversales Tunis (Tunisie) - Institut Supérieur des Langues de Tunis, Rue Ibn Maja cité el khadra L’Unité de recherche « Approches Transversales en Langue et Littérature »
a le plaisir d’annoncer la tenue d’un colloque international ayant pour
titre « Identité et Mutations en Langue et en Littérature : Approches
transversales », qui se déroulera les 27 et 28 avril 2017 à l’I... [Afficher la suite] L’Unité de recherche « Approches Transversales en Langue et Littérature »
a le plaisir d’annoncer la tenue d’un colloque international ayant pour
titre « Identité et Mutations en Langue et en Littérature : Approches
transversales », qui se déroulera les 27 et 28 avril 2017 à l’Institut
Supérieur des Langues de Tunis, Tunisie. [Réduire] Contact : colloque.hybridation@gmail.com |
Du 02 au 05 Avril 2017 :
 |
Colloque international / Driss Chraïbi : LECTURES ET RELECTURES Casablanca (Maroc) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Ben M'sik / ENS Casablanca Bientôt dix ans que Driss Chraïbi (1926-2007) nous a quittés. Cela justifie pleinement de prendre le temps d’un regard rétrospectif sur l’œuvre et l’homme. Un colloque international que nous ambitionnons marquant se déroulera du 3 au 6 avril à Casablanca (ville où Chraïbi a passé son... [Afficher la suite] Bientôt dix ans que Driss Chraïbi (1926-2007) nous a quittés. Cela justifie pleinement de prendre le temps d’un regard rétrospectif sur l’œuvre et l’homme. Un colloque international que nous ambitionnons marquant se déroulera du 3 au 6 avril à Casablanca (ville où Chraïbi a passé son adolescence, et ville où se déploie l’action du Passé simple), sous l’égide de plusieurs établissements de l’Université Hassan II de Casablanca (Facultés de Lettres et Sciences Humaines Ben M’sik et Ecole Normale Supérieure de Casablanca).
A l’occasion de cette commémoration, nous prendrons la mesure d’un champ de recherche auctorial peu à peu constitué par les très nombreuses études effectuées par des chercheurs de tous les horizons, et de l’instituer en tant que tel pour cumuler ses apports et l’ouvrir à de nouveaux questionnements.
Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur, des plus connus aux plus méconnus, et sa production radiophonique : de mettre en relief et en perspective les lectures/analyses qui en ont été faites en les contextualisant, mais aussi de les discuter et de les enrichir par des relectures d'aujourd’hui. [Réduire] Contact : kbasfao@etude.univcasa.ma; colloquechraibi@gmail.com |
Du 25 Juin au 13 Juillet 2017 :
| |
NEH Summer Institute "Algeria, Morocco, Tunisia: The Voices of Women in Literature, Cinema and Other Arts since Independence" Corvallis (Etats-Unis) - Oregon Because to date no comprehensive assessment has been attempted of post-colonial Algeria, Morocco and Tunisia from the perspective of the region’s cultural artistic vitality, the intent of this institute is to shed light on the significance of North African artistic expressions today. Expressions i... [Afficher la suite] Because to date no comprehensive assessment has been attempted of post-colonial Algeria, Morocco and Tunisia from the perspective of the region’s cultural artistic vitality, the intent of this institute is to shed light on the significance of North African artistic expressions today. Expressions in the literary, visual and musical arts with origins in Berber, Arabic and European idioms; expressions that have adapted to modernity, postcolonialism, the reality of globalism and advances of social media. The institute will bring together leading scholars in North African studies and twenty-five college and university teachers wishing to expand their coursework or research on contemporary North Africa. [Réduire] Contact : Nabil Boudraa |
Le 18 Octobre 2016 :
 |
Les cinémas berbères : de la méconnaissance aux festivals nationaux. Comparaisons africaines Paris (France) - INALCO, 2 rue de Lille Les cinémas berbères : de la méconnaissance aux festivals nationaux. Comparaisons africaines.
Les mutations survenues dans le contexte socio/culturel ont grandement contribué au renouvellement de l´espace littéraire et artistique amazigh (berbère) et à l’émergence de nouvelles formes do... [Afficher la suite] Les cinémas berbères : de la méconnaissance aux festivals nationaux. Comparaisons africaines.
Les mutations survenues dans le contexte socio/culturel ont grandement contribué au renouvellement de l´espace littéraire et artistique amazigh (berbère) et à l’émergence de nouvelles formes dont les produc-tions cinématographiques. Ainsi, depuis quelques années, les festivals du cinéma berbère se multiplient, on pense par exemple au Festival National du Film Amazigh à Ouarzazate, au Festival culturel national du film amazigh à Tizi-Ouzou, et au Festival International du Film Berbère à Paris entre autres.
Constatant le peu d’attention accordé aux films dans les études berbères, nous nous proposons d’organiser une journée d’étude dans le but d’explorer cette forme de renouvellement artistique berbère dans une perspective interdisciplinaire et ouverte aux réflexions et résultats des études déjà bien avancées sur la cinématographie africaine.
Malgré les grandes difficultés de financement, de production et de diffusion, des réalisateurs comme Ab-derrahmane Bouguermouh, Belkacem Hadjadj et Azzedine Meddour en Algérie et Ahmed Badoui, Lhous-saine Bonizakam, Ahmed Larbi et Agouram Salout au Maroc ont mis en scène dans les années 1990 au moins une cinquantaine de films dans des supports divers (35mm et cassettes vidéo). Au fil des années, la production en berbère s’est élargie, aussi grâce au format numérique, et est passée de la marginalité à la participation aux arènes artistiques nationales et internationales. Le cinéma semble répondre à une de-mande diffusée entre plusieurs couches de la population berbère : les films ont reçu un accueil enthousiaste dans le monde des mouvements associatifs culturels comme par le public urbain et rural amazighophone (Merolla 2005, 2012). Dans leur réception, les films berbères semblent se rapprocher du « Nollywhood » nigérian plus que de la production cinématographique maghrébine qui, elle, a plus de difficultés à trouver son public local.
Au premier regard, l’on peut cerner des modalités diverses d’expression filmique. Les premiers films chleuh (Maroc) sont presque des « soaps » ruraux, donnant dans la farce plutôt que dans le drame, et se différen-cient de la production des premiers films du cinéma en kabyle (Algérie) dont la réalisation est le résultat de la coopération de plusieurs partenaires, de différentes sources de financement et de longues années de persévérance de la part des réalisateurs et acteurs. Les productions numériques les plus récentes, en ka-byle, en chleuh et en rifain, semblent conjuguer l’attention accordée aux formes « engagées » et « populai-res » de l’art filmique (par les genres de la comédie, du policier et de la science-fiction) avec une bonne qua-lité technique de la narration et de la photographie.
L’objectif sera à la fois d’établir un premier état de lieux et d’explorer quelques-unes des modalités du lan-gage filmique berbère (langue, narration, images et aussi sous-titrage et doublage), tout en replaçant celles-ci dans une réflexion plus générale portant sur le rapport entre la production cinématographique, la littéra-ture, et le contexte sociopolitique et linguistique. Le questionnement portera aussi sur les possibles interac-tions du cinéma berbère avec le cinéma africain et international.
Le comité d’organisation envisage la publication des articles et la mise en œuvre d’un réseau de recherche.
• Daniela Merolla daniela.merolla@inalco.fr
• Amar Ameziane amar.ameziane@inalco.fr et amar_ameziane2002@yahoo.fr
• Kamal Naït-Zerrad kamal.naitzerrad@inalco.fr
La journée d'études sera organisé dans le le cadre des activités du LACNAD, Langues et Cultures du Nord de l’Afrique et Diasporas, INALCO, Paris. [Réduire] Contact : Daniela Merolla |
Du 11 au 12 Decembre 2016 :
| |
Images de "soi" et de "l'autre" dans le discours Annaba (Algérie) - Faculté des Lettres, Siences humaines et sociales colloque national Contact : Dr. Hazar Maïche |
Le 09 Octobre 2016 :
| |
POUR UNE APPROCHE SOCIODIDACTIQUE DES CONTEXTES D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS EN ALGÉRIE : VERS L’INTÉGRATION DU PLURILINGUISME À L’ÉCOLE ALGÉRIENNE. Blida (Algérie) - Université de Blida 2 Contact : Ouardia ACI |
Du 05 au 07 Avril 2017 :
| |
Le mythe dans la pensée contemporaine Sousse (Tunisie) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse Colloque pluridisciplinaire organisé par le Département de Français et le Centre d'Anthropologie de la Faculté des Lettres de Sousse. Il cherche à cerner les multiples définitions et approches du mythe à travers l'Histoire et leur impact sur la pensée contemporaine. Contact : colloquemythe@gmx.com |
Du 21 au 23 Mars 2017 :
| |
COLLOQUE INTERNATIONAL: Diversité linguistique, diversité culturelle : Quel avenir pour le français en Afrique et ailleurs ?2e EDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE : Education-Linguistique-Didactique & Cultures ACCRA, LEGON (GHANA) - UNIVERSITY OF GHANA, LEGON DEPARTMENT OF FRENCH 1- ARGUMENTAIRE
Le débat autour de la coexistence du français et des autres langues dans l’espace francophone est un débat récurrent qui fait encore surface de nos jours. Ce débat est d’une si brûlante actualité qu’il nécessite, aussi bien de la part des chercheurs que des « usagers ... [Afficher la suite] 1- ARGUMENTAIRE
Le débat autour de la coexistence du français et des autres langues dans l’espace francophone est un débat récurrent qui fait encore surface de nos jours. Ce débat est d’une si brûlante actualité qu’il nécessite, aussi bien de la part des chercheurs que des « usagers » de cette langue, une attention bien particulière.
Cinquième (5e) langue la plus parlée du monde, le français compte aujourd’hui près de 274 millions de locuteurs à travers cinq continents. Selon un récent rapport de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), « la langue de Voltaire se porte bien et s’enracine progressivement en Afrique ». Le rapport précise que ses locuteurs seront au nombre de 767 millions d’ici à 2060, avec 85% de ses effectifs en Afrique. Parallèlement, au contact des différents parlers de l’espace francophone en général, et de l’espace africain en particulier, le français est en train de se renouveler et de se transformer, en devenant ainsi une langue véritablement métisse et universelle. Elle tend à devenir, en Afrique, « une langue africaine » selon Pierre Dumont (1997) ; ce qui confirme, dans la dynamique des rapports linguistiques qui s’opèrent, les influences qu’elle exerce sur les langues africaines et que celles-ci exercent en retour sur elle.
Le rapport périodique de l’OIF sur l’état de la langue française dans le monde publié en 2014, reconnait que le français et son épanouissement dans un monde marqué par la diversité des langues et des cultures, demeurent le socle de la francophonie sociolinguistique. Ce rapport de l’OIF mentionne également que c’est en Afrique que la progression est la plus forte avec une augmentation de locuteurs de 15% en moyenne en Afrique subsaharienne qui atteint même 30% au Sénégal. Dans le domaine du français langue étrangère aussi, toujours selon les chiffres de l’OIF, l’Afrique est en avance avec une augmentation moyenne de ses effectifs d'apprenants de 44%, suivie de près par l’Asie avec + 43%.
Au regard de tous ces chiffres, l’avenir du français en Afrique parait donc prometteur et rassurant. Cependant, s'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste sur l’avenir du français, il y a aussi beaucoup de raisons de douter de cet optimisme car les zones d’ombre ne manquent pas. L’Afrique est un continent multilingue et la diversité de ses langues, parlers et cultures est chose indéniable. On dénombre en Afrique près de deux mille langues différentes. Bernd Heine et Derek Nurse (2000) précisent que l’Afrique compte 2035 langues, soit un tiers des langues parlées dans le monde. Ainsi, avec plus de deux mille langues, l’Afrique offre une variété linguistique impressionnante même si les spécialistes des langues les regroupent en quatre grandes familles. C’est dire que le paysage linguistique africain est abondamment riche et diversifié. L’Unesco a, de ce fait, inscrit l’Afrique en 1991 dans sa Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Selon cette déclaration de l’Unesco "La richesse culturelle du monde, c’est sa diversité en dialogue". Or on sait tous que toute situation de dialogue conduit au contact avec une tierce personne, donc avec sa culture qui ne peut se transmettre qu’au travers de la langue.
Considérant cette déclaration de l’Unesco, on peut admettre, sans d’autres formes de procès, que la richesse culturelle du monde réside donc en Afrique puisqu’elle se présente comme un damier linguistique.
De plus, en dehors de cette diversité linguistique endogène qu’on lui reconnait naturellement, le continent africain compte également un certain nombre de langues étrangères qui viennent se greffer à un tissu linguistique déjà pluriel. Il s’agit entre autre des langues indo-européennes telles le français, l’anglais, l’allemand, le portugais, l’espagnol…« imposées » à l’Afrique par la colonisation et qui ont été, dans la plupart des cas, adoptées comme langues officielles dans les pays africains. A ces langues européennes viennent s’adjoindre, de nos jours, plusieurs autres langues étrangères. En effet, l’arabe, le russe et tout récemment le chinois gagnent eux-aussi du terrain sur le continent noir. L’Afrique se trouve donc être un continent d’une densité linguistique sans pareille et un « terrain concurrentiel » entre les différentes langues en présence. C’est dans un tel contexte que le français évolue et, paradoxalement, son avenir selon l’OIF est plutôt prometteur.
A toute cette « concurrence » à laquelle le français doit faire face en Afrique, s’ajoutent d’autres défis notamment la faible qualité des enseignements de cette langue et la non prise en compte effective des langues nationales en Afrique (Maurer, 2010). Tout ceci fragilise les perspectives de progression du français sur le continent noir ou ailleurs dans le monde.
Le présent colloque développera une thématique brûlante avec des regards pluriels sur l’avenir du français en Afrique.
Ce colloque international sera également l’occasion de porter sur les fonts baptismaux le Centre de Recherche, de Perfectionnement Linguistique et d’Action Culturelle (IRPLAC) nouvellement créé à Accra (Ghana), de célébrer la semaine de la langue française édition 2017 au Ghana et de procéder au lancement du 1er Numéro de la Revue inter-universitaire DELLA du Département de Français de l’Université de Legon.
Quatre domaines principaux de recherches sont à l’honneur : Education, Linguistique, Cultures et Didactique des langues. En d’autres termes, ce colloque s’adresse à la communauté des chercheurs en éducation, en linguistique et en didactique, en relation avec un large spectre de sensibilités scientifiques : histoire, sociologie, psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, droit, politique.
2- OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES
L’objectif principal de ce colloque est de donner l’occasion aux chercheurs de se plancher sur des questions relatives aux rapports entre le français et les langues africaines. Une attention particulière sera également accordée aux rapports entre le français et les autres langues étrangères qui se partagent l’univers linguistique africain. Ces questions ont rapport avec les différents domaines sociaux et constitueront pour les chercheurs, une occasion de porter un regard scientifique sur l’avenir du français en Afrique, plus particulièrement sur les contextes d’apprentissage/enseignement de cette langue ici ou ailleurs.
En outre, ce colloque a pour objectif de créer un cadre de rencontres nationales et internationales entre différents chercheurs. Ainsi, il se veut un espace approprié où enseignants, chercheurs et autres acteurs sociaux, Sud-Sud d’une part et Nord-Sud d’autre part, pourront partager leur vision. Il verra la participation non seulement des chercheurs mais aussi des décideurs politiques, de la société civile et des enseignants.
D’un point de vue spécifique, ce colloque a pour objectifs de :
- rassembler les enseignants de langues et chercheurs en éducation
- discuter et mener des réflexions sur la cohabitation entre le français et les autres langues présente en Afrique,
- échanger sur les différentes expériences faites çà et là dans l’enseignement du français en milieu bi-plurilingue,
- porter un regard critique sur les rapports prometteurs de l’OIF au sujet du français en Afrique,
- porter et recueillir des regards sur la progression et/ou la régression du français en dehors de l’Afrique.
En d’autres termes, ce colloque doit contribuer à clarifier et à approfondir les connaissances sur les dynamiques de la langue française (celles qui l’affectent et celles auxquelles elle contribue) dans l’espace africain comme ailleurs.
3- DES AXES PLURIDISCIPLINAIRES
Le présent colloque va réunir les linguistes, les sociolinguistes, les didacticiens, les littéraires, les acteurs du monde culturel, les pédagogues, les spécialistes des sciences politiques, les juristes et les anthropologues ; autour des axes de recherche suivants :
AXE 1 : La Francophonie, la France et l’Afrique
AXE 2 : Le français face aux autres langues étrangères en Afrique et/ou ailleurs
AXE 3 : Le français en contexte multilingue africain
AXE 4 : Le français comme médium d’enseignement en milieu plurilingue
AXE 5 : Le français langue seconde/ le français langue étrangère en Afrique
AXE 6 : Diversité linguistique, diversité culturelle : quelles cultures d’enseignement du français?
AXE 7 : Convergence et interaction des compétences dans les pratiques pédagogiques (FLE/FLS)
AXE 8 : Défis de l’enseignement du français à l’ère du numérique
AXE 9 : Droits linguistiques et medium d’enseignement en milieu francophone
AXE 10 : Le français hors d’Afrique : Regards croisés et pluriels
Axe 11 : Usage de la langue française et littératie en Afrique
4- DATES, LIEU ET LANGUES DU COLLOQUE
Dates: 22, 23 et 24 mars 2017
Lieu : Université du GHANA, LEGON (Accra). [Réduire] Contact : Laboratoire DELLA, Dept. of French, University of Ghana, Legon PO BOX LG 204 Accra Ghana |
Le 06 Novembre 2016 :
| |
Production et réception des discours mascara (Algérie) - Université de mascara Contact : semimascara.2016@gmail.com |
Du 19 au 21 Octobre 2016 :
 |
Tunis (Tunisie) - Institut Supérieur des sciences Humaines Le colloque pluridisciplinaire que l’Unité de recherche Intermédialité, Lettres et Langages organise les 20, 21 et 22 octobre 2016, à l’ISSHT - Tunis, envisage d’examiner une base conceptuelle privilégiée pour aborder les pratiques d’« intermédiation » à partir de la question de la... [Afficher la suite] Le colloque pluridisciplinaire que l’Unité de recherche Intermédialité, Lettres et Langages organise les 20, 21 et 22 octobre 2016, à l’ISSHT - Tunis, envisage d’examiner une base conceptuelle privilégiée pour aborder les pratiques d’« intermédiation » à partir de la question de la Reliance, en ambitionnant de contribuer à l’exploration de cette notion complexe et en engageant la réflexion autour de la richesse et de la polymorphie de ses dimensions, de ses implications et de ses portées. [Réduire] Contact : Nesrine Boukédi : boukadi.nesrine@yahoo.fr |
Du 08 au 09 Avril 2017 :
| |
Colloque national interdisciplinaire sur autrui Tizi-Ouzou (Algérie) - Université Mouloud Mammeri Contact : Ahmed Boualili |
Le 01 Janvier 1970 :
| |
Casablanca (Maroc) - Facultés des Lettres et des Sciences Humaines Littérature et nouvelles technologies de l'information et de la communication Contact : Khalid Rizk |
Du 24 au 25 Mars 2016 :
 |
Supports en classe de langue divesites des approches MEKNES (MAROC) - Ecole Normale Supérieure Contact : Pr.Mina SADIQUI |
Du 02 au 03 Novembre 2016 :
.pdf) |
Forum : Enseigner les mondes musulmans. Langues, histoires, sociétés Lyon (France) - Université de Lyon - ENS de Lyon, voir document PDF Contact : voir doc |
Du 13 au 14 Novembre 2016 :
| |
4ème Colloque International sur la Littérature Maghrébine d'Expression Française 14 & 15 NOVEMBRE 2016 Batna (Algérie) - Université de Batna Champ scriptural de créativité, de retour aux sources, d’affectivité, de spontanéité, et
d’investissements symboliques, la littérature maghrébine d’expression française dévoile
superbement la dynamique de ses possibles, brave ses détracteurs et s’impose aujourd’hui en
sujet : ... [Afficher la suite] Champ scriptural de créativité, de retour aux sources, d’affectivité, de spontanéité, et
d’investissements symboliques, la littérature maghrébine d’expression française dévoile
superbement la dynamique de ses possibles, brave ses détracteurs et s’impose aujourd’hui en
sujet : celui de la manifestation par excellence du poids des signes et des mentalités fortement
imprégnés d’une hybridité féconde qui crée si justement sa propre communication légitimée.
Ainsi, la rencontre de deux systèmes linguistiques au cœur battant de deux aires culturelles
entraîne irrémédiablement des effets et des conséquences sur la pensée artistique et l’activité
créatrice.
Dans les faits, la production littéraire maghrébine apparait ouverte à toutes les écritures,
truffée d’expressions, de combinaisons linguistiques, de collages, de néologismes d’une
remarquable sensibilité maghrébine vagabonde, ravageuse de la langue d’écriture. De là,
mettre l’accent sur la dimension dynamique de l’hybridité consiste non seulement à mettre en
exergue cette étrange spécificité qui s’emploie à restituer et promouvoir une part de l’identité
maghrébine occulte/occultée et sacrificielle/sacrifiée, mais d’en rendre compte afin de la
positiver en interrogeant la référentialité des signes criants ou discrets dans les interstices
mêmes des œuvres littéraires ; extraire les significations sous-jacentes d’un esprit éclairé et
pluriel qui produit à la fois de l’identité et de l’altérité.
C’est dans cette perspective que la problématique du colloque relevant de la
(sur)conscience linguistique et culturelle des écrivains maghrébins ; problématique qui ouvre
des champs d’étude en matière de «bilinguisme», de la «bi-langue», de «l’interlangue», des
«emprunts», du «culturel», de «l’interculturel», de « l’identité », de «l’altérité», de la
«différence», de la «diversité», de la «polyphonie», de « l’oralité ». Immanquablement, il
s’agira d’une production fatalement au carrefour des signes, d’un univers littéraire qui
transcende les limites des langues et des cultures.
Mais au-delà de la question de l’autocensure de la culture, au-delà aussi de ce que
Jacques Derrida appelle ‘’le trouble de l’identité’’, la littérature maghrébine d’expression
française s’épanouit dans une inépuisable hybridité qui permet une exploration différentielle,
demande un effort interprétatif et édifie les jalons d’une littérarité maghrébine qui sert, selon
Jonathan Culier: «à attirer l’attention sur les structures qui seraient essentielles dans les œuvres
[...] et [la] concentrer [...] sur l’emploi de certaines stratégies verbales» témoignant écriture
agissante et esprit hospitalier conscient de la force de l’échange des spécificités.
Indubitablement, c’est cette hybridité où s’embrassent des signes et murmurent des voix
3
multiples qui : «fait éclater en [cette littérature] une différence, fait apparaitre qu’elle est autre
qu’elle n’est».
De là, elle est par excellence l’un des lieux essentiels de la communication dialogique, du
ruissellement de la culture, de la recherche de l’équilibre et de la création/re-création de la
sensibilité de l’écrivain maghrébin pris dans les «rets du double langage» par notamment ces
retours aux sources multiples qu’elle réalise par la fusion et l’interpénétration des signes
énergétiques et des investissements symboliques, à l’origine contraires mais qui se complètent
et s’harmonisent ici pour dire l’indispensable de l’âme dans la libération du signe pour refuser
l’immobilisme de l’esprit, échapper à la solitude et communiquer en toute responsabilité, toute
profondeur, toute richesse et toute puissance.
Orienter la problématique du colloque de la sorte, c’est :
 Admettre l’hybridité comme marque de pensée imprimant à la ‘’langue épousée’’ la
sensibilité maghrébine ;
 Pointer les particularités spécifiques et les différences responsables de la démarcation de
la littérature maghrébine de la littérature française et des autres littératures
francophones ;
 Montrer que les clins d’œil des écrivains maghrébins à la langue et la culture d’origines
sont un signe de maturité, d’une conscience sécurisée et sécurisante ;
 Découvrir que cette hybridité linguistique, cette autocensure de la culture sont, pour
l’auteur, une force tranquille, pour le lecteur une source de jouissance intellectuelle,
pour la littérature une originalité esthétique, une valeur ajoutée ;
 Prouver que la littérature est censée se nourrir hors de ses bases, que l’artiste n’échappe
pas à son identité ;
 Repérer les signes qui rendent le sens des œuvres littéraires maghrébines supérieur à la
somme des significations des énoncés qui les composent.
De ces soucis, la question de l’hybridité linguistique, une autocensure de la culture renvoi à
la cohérence des œuvres et de la pensée des écrivains maghrébins. De surcroit, elle est la force
pérenne de l’équilibre même de ces auteurs confrontés aux fortes sollicitations culturelles de
l’islamité, l’arabité, l’amazighité et l’occidentalité.
De même, c’est dans le ‘’brouillard sémique’’, dans les références croisées, dans la
mosaïque des signes, dans la capacité de parcourir les différences, dans l’écriture hospitalière,
dans les voies qu’elle emprunte et ouvre, les voix qui circulent, qu’elle écoute et qu’elle fait
entendre qu’on s’aperçoit ‘’de la force de frappe’’ expressive et des enjeux esthétiques de
l’hybridité, du pouvoir des écrivains maghrébins d’enjamber les frontières, d’interroger des
littératures, des langues et des cultures dans une littérature et d’agir dans une perspective à la
fois spécifique et universelle. C’est donc la créativité dans l’hybridité qui fait naître en cette
littérature sa modernité propre faisant d’elle une école et des écrivains maghrébins des
citoyens du monde sans perte d’identité.
AXES
 Rénovation technique de l’écriture littéraire ;
 Littérarité maghrébine ;
 Polyphonie et dialogisme ;
4
 Bi-langue, interlangue, emprunts et néologismes ;
 Interculturalité ;
 Poétique de l’oralité.
Modalités des propositions de participation
- Nom et Prénom du communicant, grade, université, pays
- Titre de la proposition
- Axe d’intervention
- Un résumé de 3000 signes au plus (espaces compris) - Document Word 97-2003
- Notice bibliographique du communicant
A adresser à : selnomcolloque04@gmail.com
CHRONOGRAMME
 Date limite de réception des résumés : 01 aout 2016
 Notification d'acceptation : 01 septembre 2016
 Réception des communications : 01 octobre 2016
PRÉSIDENTS D’HONNEUR
 Dr. Tayeb BOUZID – Recteur de l’Université de Batna 2- Algérie
 Pr. Omar GHOUAR – Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues Etrangères
PRÉSIDENTS DU SÉMINAIRE
 Pr. Saïd KHADRAOUI – Directeur du laboratoire: SELNoM
 Pr. Samir ABDELHAMID – Responsable réseau LaFEF et président du comité scientifique
du département de français
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Pr. Samir ABDELHAMID-Université de Batna 2, Pr. Saïd KHADRAOUI-Université de Batna 2, Pr.
Saddek AOUADI-Université d’Annaba, Pr. Zoubida BELAGHOUEG-Université de Constantine, Pr.
Gaouaou MANAA-Université de Batna 2, Pr. Driss ABLALI- Université de Lorraine-France, Pr.
Foudil DAHOU-Université d’Ouargla, Pr. Bachir BENSALAH-Université de Biskra, Pr. Fouzia
BENDJELID-Université d’Oran 2, Pr. Abdelouaheb DAKHIA-Université de Biskra, Pr. Nacer Idrissi
ABDELFETTAH-Université d'Agadir, Maroc, Pr. Ali AOUN-Université de Sousse, Tunisie, Pr. Hafed
DJEDIDI-Université de Sousse, Tunisie, Pr. Rachid RAISSI –Université d’Ouargla, Dr. Med El Kamel
METATHA-Université de Batna 2, Dr. Tarek BENZEROUAL- Université de Batna 2, Dr. Mohamed
BOUDJADJA-Université de Sétif 2, Dr. Salah KHENNOUR - Université d’Ouargla. Dr. Saïd SAIDI, Dr.
Lakhdar KHARCHI-Université de M’sila.
COMITÉ D’ORGANISATION
Ammar ZERGUINE- Abdelkader BOUHIDEL- Mohamed DOUHI - Shiraz AGGOUN - Faten BENTAHAR Radhia AISSI- Samia BERKANE- Nassima KHANDOUDI - Roiya KHIREDDINE- Samia MOUFFOK – Assia
BOUSAAD- Sami CHAIB – Fatima-Zohra KHADRAOUI- Thiziri AIT MOHAND – Leila SMAIHI- Fouzia SMAIHIAicha-Lilia CHENNOUF- Souad DJOUDI.
CHARGES DE L’EDITIONS ET DE LA COMMUNICATION
 Redha GUERFI, Éditeur
 Rachid HAMATOU, journaliste [Réduire] Contact : Khadraoui Said |
Du 09 au 11 Novembre 2016 :
| |
Ecriture de soi, invention de soi dans les littératures française et d'expression française contemporaines Tunis (Tunisie) - Tunis Dans Formes et Significations, Jean Rousset aboutissait à la conclusion que l’on écrit toujours au fond « pour se dire », assertion qui reflète le lien tissé entre fiction et écriture de soi. Le héros d’un roman est souvent le porte-parole de l’écrivain quand il n’est pas son double... [Afficher la suite] Dans Formes et Significations, Jean Rousset aboutissait à la conclusion que l’on écrit toujours au fond « pour se dire », assertion qui reflète le lien tissé entre fiction et écriture de soi. Le héros d’un roman est souvent le porte-parole de l’écrivain quand il n’est pas son double imaginaire. Un récit de vie s’inspire de même, peu ou prou, du vécu de l’auteur.
Réciproquement, une autobiographie n’est jamais fidèle au réel et il arrive fréquemment que les fluctuations de la mémoire, les « trous noirs » selon l’expression de Patrick Modiano, soient comblés par l’imaginaire. Sans oublier les « souvenirs écrans », souvenirs fabriqués mis en avant par Freud, ou encore les souvenirs rapportés qui ne sont pas ceux de l’écrivain mais qui remplissent les pages blanches d’une œuvre comme celle de Georges Perec.
Quant à l’autofiction, elle semble avoir essayé de dépasser le clivage entre vérité et mensonge, privilégiant le « comment se dire ». Néanmoins, le procès de l’autofiction n’en finit pas et la notion paraît être devenue synonyme de « roman autobiographique ».
Ce colloque se propose de réfléchir non sur les genres, mais sur la question du « moi » dans les littératures française et d’expression française contemporaines, plus précisément sur le rapport entre « le dire » et « se dire », sur le « comment se dire » aussi bien dans l’autobiographie, dans la fiction, dans l’autofiction, ou le biographique, forme scripturaire qui tend à s’imposer actuellement sur la scène littéraire. En effet, ces sortes de récits de « vie » pratiqués aussi bien par Patrick Modiano, Pascal Quignard, Pierre Michon ou Jean Echenoz, peuvent être définies comme des « formes biographoïdes les plus variées , allant de l’autofiction pure à la biographie conventionnelle en passant par le roman historique », ainsi que l’écrit Alexandre Gefen dans son essai Inventer une vie, la fabrique littéraire de l’individu (Paris, Les Impressions nouvelles, 2015, p.13).
De fait, les écritures de soi, au-delà des formes qu’elles revêtent, posent toute la question de l’identité de l’écrivain. C’est pourquoi, au cours de ce colloque, nous essaierons non de distinguer, différencier, classer les genres auto/bio/graphiques, mais de mettre l’accent sur la richesse et le renouvellement des formes scripturaires mettant le moi au cœur des textes littéraires. Car, la mise en mots du « moi » de l’auteur n’a plus pour finalité la quête de la vérité ou la volonté de dresser une image intemporelle et éternelle de soi, et ce face à un public-juge comme le suggéraient Chateaubriand et Rousseau.
Les écritures de soi se conjuguent désormais au pluriel, constituant des modes d’écriture indissociables de l’écrivain, mais plus que tout de la notion d’individu. Il s’agit pour l’écrivain de dire qui il est mais aussi de dire quelle est sa place dans le monde et dans l’Histoire. Bref, de dire son histoire ou de se raconter à travers la vie d’autrui, en se situant dans ou en dehors de l’histoire collective.
Les axes que nous proposons sont les suivants :
Récits de vie autobiographiques
Récits de vie biographiques
Autobiographie et autofiction
Biographie et fiction biographique
Raconter sa vie/ raconter la vie d’autrui
Ecrire son histoire/ Ecrire l’Histoire
L’invention de soi
Les formes scripturaires des écritures de soi
Les approches stylistiques des écritures de soi
Autobiographies et champs littéraires d’application. [Réduire] Contact : jamil.chaker@topnet.tn ; emnabeltaief@hotmail.fr |
Du 30 Novembre au 02 Decembre 2016 :
| |
L’auteur en observateur et commentateur de son discours : la question du métadiscours Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax Ce colloque a pour objectif d’explorer les multiples potentialités de recherche et d’analyse qu’offre la notion du métadiscours qui est encore aujourd’hui de nature polymorphe et floue bien qu’elle soit incontournable dans l’analyse textuelle. C’est pourquoi elle interpelle à la fo... [Afficher la suite] Ce colloque a pour objectif d’explorer les multiples potentialités de recherche et d’analyse qu’offre la notion du métadiscours qui est encore aujourd’hui de nature polymorphe et floue bien qu’elle soit incontournable dans l’analyse textuelle. C’est pourquoi elle interpelle à la fois les linguistes, les stylisticiens, les littéraires et les sémioticiens. Une telle réflexion suscitera, nous l’espérons, des études qui portent sur les axes suivants :
• Métadiscours et métalangage.
• Indices de manifestation du métadiscours (guillemets, parenthèses, italiques, énoncés comportant un élément métalinguistique…)
• Métadiscours et genres littéraires.
• Métadiscours et réception du texte.
• Métadiscours, parodie et ironie.
• Métadiscours et paratexte (préface, épigraphe, incipit, clausule…) [Réduire] Contact : arselenebenfarhat@gmail.com |
Du 16 au 17 Octobre 2016 :
| |
L'écriture théâtrale dans les récits d'Albert Camus Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax Nous voulons nous interroger dans ces journées d’études sur la spécificité du discours théâtral de Camus dans ses récits. Nous pouvons nous demander si le mode de représentation mimétique est une force d’unification et d’homogénéisation des récits ou une force de déstabilisation ... [Afficher la suite] Nous voulons nous interroger dans ces journées d’études sur la spécificité du discours théâtral de Camus dans ses récits. Nous pouvons nous demander si le mode de représentation mimétique est une force d’unification et d’homogénéisation des récits ou une force de déstabilisation et d’éclatement de l’univers romanesque. Pourquoi Camus éprouve-t-il le besoin d’emprunter au théâtre certains procédés qu’il exploite dans ses nouvelles et ses romans ? Quel est l’impact de l’écriture théâtrale sur le discours narratif et sur les lecteurs ? Le théâtral n’est-il pas la marque d’ironie du narrateur signalant la distance de Camus par rapport à ses personnages ? [Réduire] Contact : laila.euchi@yahoo.com |
Le 02 Mai 2016 :
| |
Quelle didactique intégrée des langues en Algérie ? Alger (Algérie) - ENS de Bouzaréah - Alger Journée d'étude dédiée à la problématique de l'enseignement des langues en milieu plurilingue (Algérie). Quatre axes sont proposés:
Axe 1 : Discussion autour des notions de « convergence », « intégration », « adaptation » et contextualisation en didactique des langues.
Axe 2 : Plac... [Afficher la suite] Journée d'étude dédiée à la problématique de l'enseignement des langues en milieu plurilingue (Algérie). Quatre axes sont proposés:
Axe 1 : Discussion autour des notions de « convergence », « intégration », « adaptation » et contextualisation en didactique des langues.
Axe 2 : Place du plurilinguisme et du pluriculturalisme dans la politique linguistico-éducative en Algérie : des textes officiels à la pratique de classe en tenant compte des représentations sociolinguistiques.
Axe 3 : Place de la didactique intégrée des langues au plan des méthodologies sous-tendant l’enseignement/apprentissage du français en Algérie : analyse des programmes, des guides d’accompagnement, des manuels scolaires, etc.
Axe 4 : Place de la didactique intégrée des langues au plan des pratiques enseignantes dans le système scolaire algérien : observations de classe, entretiens, questionnaires, etc. [Réduire] |
Du 18 au 20 Octobre 2016 :
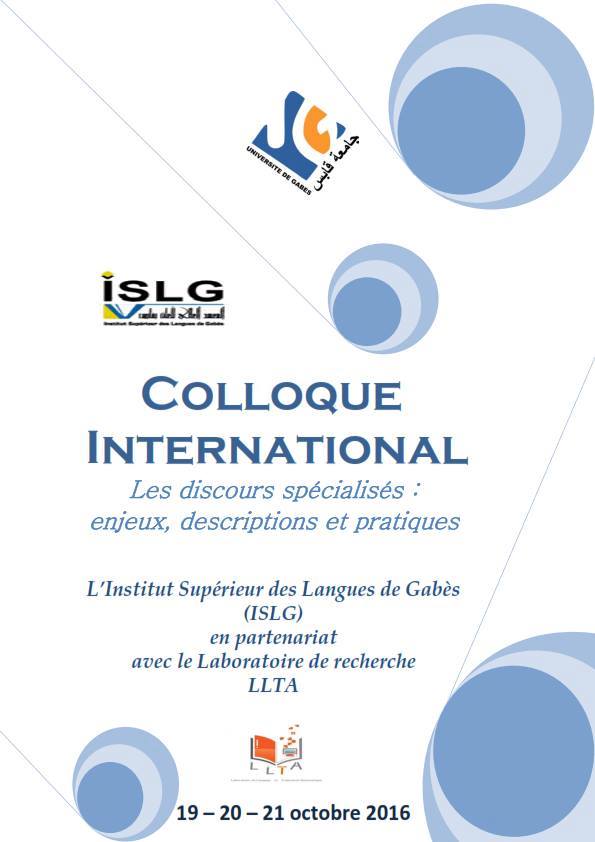 |
Les Discours spécialisés : enjeux, descriptions et pratiques Gabès (Tunisie) Colloque international - Appel à communications
Les Discours Spécialisés : enjeux, descriptions et pratiques
19, 20 et 21 octobre 2016
À l’Institut Supérieur des Langues de Gabès (Tunisie), en partenariat avec le Laboratoire LLTA Contact : Saloua Kammoun |
Le 19 Juin 2016 :
 |
La migration, au miroir des Arts, et des questions d'Ethiques Poitiers (France) - MMSH, MIGRINTER Le Réseau Migrations a le plaisir de vous informer de l’appel à communication qu’il lance pour son troisième Séminaire Annuel qu’il organise à la M.S.H.S. de Poitiers, accueilli par le laboratoire MIGRINTER de l’Université de Poitiers, France, le 20 Juin 2016. Contact : organisationreseaumig@googlegroups.com |
Du 12 au 13 Mai 2016 :
| |
Monastir (Tunisie) - Palais des sciences Loin d’être une rencontre sur l’écriture du terroir, ce colloque propose de réfléchir sur les interactions et les problématiques qui naissent au seuil du texte et des territoires qui en constituent la (les) trame(s). Le terroir des ancêtres ne pouvant plus être conçu comme un espace ferm... [Afficher la suite] Loin d’être une rencontre sur l’écriture du terroir, ce colloque propose de réfléchir sur les interactions et les problématiques qui naissent au seuil du texte et des territoires qui en constituent la (les) trame(s). Le terroir des ancêtres ne pouvant plus être conçu comme un espace fermé (à l’autre), les imaginaires et les horizons qui s’ouvrent aux marges du terroir ancestral étendent l’écrit comme lieu d’utopie(s) et de conjonctions des images et des cultures du monde. [Réduire] Contact : habib.salha@yahoo.fr |
Du 11 au 14 Avril 2017 :
| |
Deuxième Congrès Mondial de Brachylogie: La Nouvelle Brachylogie à la croisée des sciences et des cultures Hammamet (Tunisie) Deuxième Congrès Mondial de Brachylogie: La Nouvelle Brachylogie à la croisée des sciences et des cultures
(Hammamet-Tunisie, 12-15 avril 2017)
L’UNIVERSITE TUNIS EL MANAR, la Coordination Internationale des Recherches et des Études Brachylogiques (CIREB à Paris), l’Institut Supérie... [Afficher la suite] Deuxième Congrès Mondial de Brachylogie: La Nouvelle Brachylogie à la croisée des sciences et des cultures
(Hammamet-Tunisie, 12-15 avril 2017)
L’UNIVERSITE TUNIS EL MANAR, la Coordination Internationale des Recherches et des Études Brachylogiques (CIREB à Paris), l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (ISSHT), le Laboratoire des Recherches et des Etudes Brachylogiques (L@REB) et l’association Brachylogia-Tunisie, en partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Tunisie ainsi que d’autres établissements publics tunisiens, avec des structures de recherche (CR ; LR ; UR) en Tunisie et dans d’autres pays, avec l’AUF et autres représentations et organismes internationaux, avec des acteurs-médias et des entreprises économiques, organisent du 12 au 15 avril 2017 à Hammamet (Tunisie), le Deuxième Congrès Mondial de Brachylogie sous le titre :
La Nouvelle Brachylogie à la croisée des sciences et des cultures
A faire le bilan des rencontres et des publications portant sur les études brachylogiques, on constate une grande diversité des orientations analytiques et des approches interprétatives ayant trait à ce champ de réflexion. Cela confirmerait l’intuition de la portée pluridimensionnelle de la brachylogie, entendue dans son sens moderne, et celle de l’étendue pluridisciplinaire de son appréhension en tant que concept nouveau, inspiré d’une notion antique.
On a eu droit alors, de façon soulignée, à des travaux sur les littératures, sur la littérature générale, sur la poétique, au sens large où l’on pourrait intégrer la rhétorique, la stylistique et la pragmatique, sur la linguistique fondamentale et comparée, sur la logique du discours, sur la philosophie, sur les arts, sur l’histoire, sur la communication, sur l’économie, sur la sociologie, sur la microbiologie, etc. Tous ces travaux ont constitué la matière d’une sorte de prolégomènes à des recherches pouvant se faire avec la rigueur qui se doit mais aussi avec un potentiel de liberté rendu possible, avec les amers et les repères de base mais aussi avec l’audace et l’aventure qui accompagnent les aspirations prospectives et les interrogations futuristes. On allait donc de la définition des termes employés jusqu’à la construction de pensées et de lectures en découlant, toujours dans ce cadre nouveau de la recherche, « les études brachylogiques », et autour du concept central du projet, « la Nouvelle Brachylogie », celle-ci ayant fait l’objet d’un livre de son initiateur, Mansour M’henni : Le Retour de Socrate. Introduction à la Nouvelle Brachylogie, dont l’auteur souligne le rôle itératif plutôt que conclusif, suggestif plutôt que coercitif, conversationnel plutôt que directif – tout dans le pur esprit de la Nouvelle Brachylogie.
Il est à rappeler que dans cet esprit, il y a comme un souci de relire Socrate autrement, lui qui nous parvient avec deux faces : celle du philosophe qui a bien existé sans laisser de trace écrite, et celle de l’image fictive qui nous est parvenue de lui à travers certains textes de témoignage et d’autres de pure création fictionnelle. Certes, relire Socrate alors à partir de ce qui nous avons de lui, concrètement, mais aussi à partir de tout ce qu’il a laissé ouvert à l’interrogation renouvelée, à la pensée renaissant de ses cendres et à la part de (sur-)vie qui couve sous l’image de la mort, pour réapparaître plus vivace dans son feu créateur et dans ses Lumières reluisantes.
Dans cet esprit, il est autorisé de croire que Socrate a été condamné essentiellement pour un argument implicite, sa philosophie brachylogique, sa conception de la brachylogie comme philosophie intégrale plutôt que comme un procédé de style ou une figure du discours monnayable à merci pour toute manipulation persuasive ou séductrice comme la rhétorique sait magistralement en user. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a posé la brachylogie comme un contrepoids de la rhétorique et l’esprit de conversation comme un antidote des discours fleuves de l’endoctrinement et du pouvoir pernicieux de la parole. Sans doute verrait-on là une autre façon de voir et de concevoir la démocratie, autrement que ne la voulait Athènes à la naissance du IVème siècle avant Jésus-Christ. Il fallait donc, en ce temps-là, éclipser Socrate ; il se laissa faire, mais de la manière qui inscrivait au bout de son procès les points de suspension qui restaient à interroger et à essayer de déchiffrer.
De là naissait le besoin ou l’opportunité de réinterroger l’idée de brièveté telle que perçue par le Père des Philosophes, avant qu’elle ne soit de nouveau coulée dans le moule procédural des sophistes, puis dans le nouvel habit de la brevitas et l’ancienne toge de l’ellipse. En effet, à la faveur d’un regain d’intérêt pour les formes brèves du discours et d’une propension des questions posées à la notion de petitesse et de minorité, à l’intelligence des microstructures et aux signaux envoyés par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, la notion de brachylogie comme philosophie parut pouvoir renaître de ses cendres et se libérer du sarcophage usé où la rhétorique classique et peut-être aussi la stylistique semblaient l’inhumer. C’est de cet appel que naquit la Nouvelle Brachylogie et le projet des études brachylogiques qui la porte.
Désormais, l’étape de première appréhension (au double sens du terme) de ce concept nouveau, construit sur une idée ou une notion antique, est franchie avec des acquis certains qui débordent les publications disponibles ou en cours sur la question : déjà plus d’une dizaine de séminaires organisés dans plusieurs pays de trois continents et un Premier Congrès Mondial de Brachylogie au Maroc en avril 2015 ; plusieurs structures et associations de recherche dans ces pays, avec une Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques à Paris (CIREB) ; une revue spécialisée, Conversations, ouverte aux contributions dans toutes les langues, etc.
Ce nouveau champ d’exploration scientifique, artistique et culturelle, un grand chantier en l’occurrence, entend asseoir solidement ses méthodes de travail et faire la part du spécifique et de l’interactionnel des différentes disciplines interpelées, sans doute aussi avec le souci d’une fédération philosophique autour d’un projet encyclopédique dont la réalisation serait jalonnée d’abord par des bréviaires, puis par un dictionnaire. Telle est l’ambition du Deuxième Congrès Mondial de Brachylogie qui se tiendra dans la ville de Hammamet, en Tunisie, du 12 au 15 avril 2017, sous le titre générique : La Nouvelle Brachylogie à la croisée des sciences et des cultures.
Plusieurs panels sont envisagés avec des conférences en plénières données par des invités de marque, des sommités des disciplines programmées. Voici une liste indicative et ouverte (avec des titres génériques) de certains panels proposés ou en construction :
Panel 1 : Philosophie et brachylogie
Panel 2 : Brachylogie, Histoire et société
Panel 3 : Brachylogie et pédagogie
Panel 4 : Brachylogie et nouvelles technologies
Panel 5 : Brachylogie des sciences exactes
Panel 6 : Brachylogie des arts
Panel 7 : Brachylogie, langage et communication
Panel 8 : Brachylogie, discursivité et textualité
Panel 9 : Brachylogie, politique et économie
Panel 10 : Brachylogie de la culture populaire
Le Congrès se tiendra dans un espace touristique fermé (à Hammamet-Sud, au Cap Bon tunisien), les frais d’inscription sont de 60 euros et ne couvrent que les droits de participation ou d’intervention, ainsi que les documents, programme, affiche et prospectus. Pour ceux qui le désirent, l’adhésion à la CIREB est de 20 euros et donne le droit de participer au vote de sa deuxième assemblée générale élective, en marge du congrès, à ceux qui se seront acquittés de l’adhésion de 2016 (l’éligibilité est conditionnée par l’adhésion au moins pour 2015 et 2016). Des tarifs préférentiels seront négociés par les organisateurs et seront communiqués aux participants, avec les coordonnées nécessaires, pour une réservation directe.
Les travaux du congrès seront publiés dans un ouvrage de référence et de qualité éditoriale garantie.
Un programme culturel est prévu en marge du congrès et des excursions touristiques sont envisageables sur la demande préalable des participants.
Premiers responsables :
Président du comité scientifique : M. Mansour M’HENNI
Président du comité d’administration : M. Taoufik ALOUI
Coordinateur du comité d’organisation : M. Othman BEN TALEB
Contacts : mansourmhenni50@gmail.com
Sites : www.cireb-brachylogie.org
www.brachylogia.com [Réduire] Contact : mansourmhenni50@gmail.com |
Du 13 au 14 Decembre 2016 :
.pdf) |
Colloque international: Littérature et réalité : regards croisés. Safi (Maroc) - Faculté Polydisciplinaire La littérature, comme art dont la chair est faite de mots, ne peut se départir des problématiques relatives à la langue. Elle met en évidence, avec acuité, le rapport que nous entretenons avec les mondes intérieur et extérieur. Dans ce sens, Littérature et Réalité de Roland Barthes, Leo ... [Afficher la suite] La littérature, comme art dont la chair est faite de mots, ne peut se départir des problématiques relatives à la langue. Elle met en évidence, avec acuité, le rapport que nous entretenons avec les mondes intérieur et extérieur. Dans ce sens, Littérature et Réalité de Roland Barthes, Leo Bersani, Philippe Hamon, Michael Riffaterre, Ian Watt, a été et reste une référence phare dans le monde de la critique littéraire. Nombreuses suggestions ont été proposées afin de contourner ce rapport originel entre la littérature et la réalité. D’ailleurs Auerbach , en pur érudit, dans sa Mimesis, a conclu à la non-possibilité d’éluder la réalité et sa représentation dans la forme narrative de l’Antiquité à nos jours. Il paraît difficile de raconter sans qu’on ne recoure à la mémoire et donc au monde qui l’entoure, à telle enseigne que, pour certains, l’une ne peut se concevoir sans l’autre dans un rapport dialectique, tel que le déclare Gao Xingjian : «La vie est la source de la littérature et la littérature doit être fidèle à la vie. » . Ceci dit, les exemples d’identification ne manquent pas. Ils peuvent même occasionner des drames comme l’ont magistralement démontré Don Quichotte de Cervantès et Madame Bovary de Flaubert. La littérature semble, peu à peu, redéfinir ses assises et redessiner ses contours. La fiction se « réalise » tout en gardant en filigrane le rapport, aussi ancien que l’humanité, qu’elle a toujours eu avec le monde vivant. [Réduire] Contact : a.amraoui@uca.ac.ma |
Du 21 au 22 Novembre 2016 :
| |
Greimas aujourd’hui. Du sens et des langages Méknès (Maroc) - Faculté des Lettres Equipe de Recherche Langages, Textes, Discours
Département de Langue et de Littérature Françaises
Appel à communications
Colloque international
« Greimas aujourd’hui. Du sens et des langages »
(22 et 23 novembre 2016... [Afficher la suite] Equipe de Recherche Langages, Textes, Discours
Département de Langue et de Littérature Françaises
Appel à communications
Colloque international
« Greimas aujourd’hui. Du sens et des langages »
(22 et 23 novembre 2016 - Faculté des Lettres de Meknès (Maroc))
Algirdas Julien Greimas (1917, Tula – 1992, Paris/Kaunas, Lithuanie), fondateur, avec Roland Barthes, de la sémiotique (ou sémiologie) française et initiateur d’un courant de recherches sur le sens et la signification dit « Ecole sémiotique de Paris », n’a pas cessé, en compagnie d’une pléiade de chercheurs d’horizons divers, de scruter les manifestations discursives et les arcanes langagiers de la sémiosis. En effet, depuis 1966, date de parution de Sémantique structurale, ouvrage inaugural et fondamental, jusqu’en 1991, où fut publiée Sémiotique des passions, livre ambitieux et visionnaire, en passant par le Maupassant (1976), Du sens, tomes I et II (1970-1983), De l’imperfection (1987)..., A. J. Greimas a, en dehors des modes intellectuelles, patiemment et passionnément travaillé à l’élaboration de modèles théoriques et de méthodologies d’approche permettant la description et l’analyse des phénomènes de signification et de communication. Littérature, image, médias, musique, architecture, figures du corps et modes de vie constituent autant de langages et de discours pris en charge par l’approche rationnelle et reproductible du sémioticien rejetant tout dogmatisme et se voulant à l’écoute des démentis des faits. Comme le dit joliment Umberto Eco, la « maîtrise » d’A. J. Greimas, à la différence de celle de son ami Roland Barthes, consiste à élaborer des modèles d’analyse dont l’applicabilité est indépendante de la « génialité individuelle » de celui qui les applique.
En se fixant pour fondements certains des présupposés théoriques de la linguistique saussuro-hjelmslévienne, et en se proposant d’étudier les conditions immanentes de la production et de la saisie de la signification, A. J. Greimas et ses compagnons ont œuvré à la large diffusion de ce projet sémiotique original et innovant. Ainsi, au Maroc, par exemple, lieu de l’organisation de ce colloque, pays préoccupé depuis des années par la réforme optimale de l’enseignement, la sémiotique greimassienne fait partie intégrante de la formation universitaire. Il arrive même qu’elle soit enseignée au lycée, et fructueusement. C’est que cette sémiotique a vocation à s’investir dans la pratique pédagogique dans la mesure où elle contribue à l’acquisition par l’apprenant d’une compétence réelle (savoir-faire) de lecture des textes et discours, en proposant une démarche méthodologique appropriée au traitement didactique de ces formes signifiantes.
Il est donc normal d’initier au Maroc une rencontre scientifique autour de l’œuvre d’A. J. Greimas, d’autant plus que l’année 2016 marque le cinquantenaire de la parution de Sémantique structurale. (Tout un colloque sera consacré à ce maître livre en octobre 2016 à l’Université d’Istanbul.) Ajoutons à cela que le mois de novembre 2016, c’est aussi, ou presque (à trois mois et demi près), le centenaire de la naissance de l’illustre sémioticien. (Greimas sera le sujet d’un Congrès en 2017 sous les auspices de l’UNESCO.) La conjonction de ces deux événements, l’un biographique, l’autre bibliographique, nous a incités à organiser ce colloque autour de l’œuvre fondatrice d’A. J. Greimas afin d’en montrer l’apport décisif et la place qu’elle mérite non seulement dans les sciences du langage, mais aussi dans les sciences humaines. Cette œuvre, si elle s’entretient avec l’anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss et avec la mythologie comparée de Georges Dumézil, tisse également des liens étroits, et en profondeur, avec la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty. Et c’est justement le sédiment phénoménologique, déjà en puissance (potentialisé) dans Sémantique structurale, qui fera surface, qui reviendra en force (réalisé) dans Sémiotique des passions - Jacques Fontanille en est coauteur. Cet ouvrage, avec De l’imperfection, orientera en effet la recherche en la matière dès lors fondée sur le « sensible du sens » et replacée dans le cadre générique de la sémiotique passionnelle. Ainsi, au terme d’un parcours, commence un autre, ouvrant vers un nouveau départ. Nous invitons donc les participants à examiner et à commenter la pensée sémiotique d’A. J. Greimas aussi bien dans ses fondements que dans son actualité et son devenir.
C’est dans ce sens que nous proposons les axes de réflexion suivants :
I – Fondements et confrontations théoriques et épistémologiques :
- Greimas et la linguistique – Greimas et l’anthropologie - Greimas et la phénoménologie - Greimas, Barthes, Eco - Greimas et la « French Theory » (Kristeva, Derrida, Foucault, Lacan).
II - La sémiotique greimassienne : Le parcours génératif du sens - Narrativité, discursivité, « énonciativité » - Sens et langages verbal (littérature orale et littérature écrite, textes sacrés), visuel (iconographie, cinéma, architecture...), sonore (musique).
III – Champs sémiotiques ouverts : L’approche rationnelle de l’imaginaire - Sémiotique et analyse de discours politique, esthétique, médiatique, didactique...
IV – Retombées et applications didactiques et pédagogiques : Approche des textes - Etudes des procédés de communication orale et écrite - Approche et évaluation sémiotiques des différentes tendances didactiques.
V – Greimas et le tournant sémiotique : « Sens sensible » - « Passionnalité » - Tensivité – Esthésie – Ethique et altérité.
Modalités de participation et de soumission des communications :
Les propositions de communication auront la forme d’un résumé de 500 mots au maximum en format word, qui sera assorti de 5 mots clés et d’une bibliographie de 5 références au maximum. Le fichier de la proposition comportera aussi les coordonnées de l’auteur de la communication (nom, prénom(s), statut professionnel, établissement, adresse électronique). Chaque proposition de communication, « anonymisée », fera l’objet d’une double expertise.
La durée de la communication est de 20 minutes.
Le séjour (hôtel et restauration) des participants durant le colloque sera pris en charge par la Faculté des Lettres de Meknès et ses partenaires. Suivant la tradition de notre Faculté, les participants sont exemptés des frais d’inscription.
Calendrier : Les résumés des communications pourront être envoyés à l’adresse suivante : collmeknes16gr@gmail.com
Le 30 avril 2016 : date limite de soumission des propositions – Le 30 juin 2016 : notification aux auteurs de la décision du comité scientifique – Les 22 et 23 novembre 2016 : tenue du colloque – Le 31 janvier 2017 : réception des textes pour la publication des actes.
Comité d’organisation : Noraddine Bari, Anouar Ben Msila, Malika Bezzaa, Abdeljalil El Kadim, Ahmed Kharbouch, Zohra Lhioui, Karima Ziamari
Comité scientifique : Driss Ablali, El Mostafa Abouhassani, Guy Achard-Bayle, Semir Badir, Anouar Ben Msila, Denis Bertrand, Saida Bougrine, Ayoub Bouhouhou, El Mostafa Chadli, Amal Chekrouni, M’hamed Dahi, Ivan Darrault –Harris, Dominique Ducard, Ali Fallous, Jacques Fontanille, Tijania Hidass, Mehdi Kaddouri, Eric Landowski, Fouad Mehdi, Djoa Johnson Manda, Hassan Moustir, Duygu Oztin Passerat, André Petitjean
Contact et coordination : Anouar Ben Msila : anouarbenmsila@gmail.com
GSM : +212 6 62 09 27 42 [Réduire] Contact : anouarbenmsila@gmail.com |
Du 19 Novembre 2015 au 30 Octobre 2016 :
| |
Prix Mohamed Dib 5ème session (2015-16) - Algérie Tlemcen (ALGERIE) - El Mechouar Le prix littéraire Mohammed Dib est né en même temps que l'association culturelle « La Grande Maison » en 2001. Ce prix récompense les créations récentes des jeunes écrivains algériens. Lors de la première édition du prix. Le jury du prix est un jury international composé des plus grand... [Afficher la suite] Le prix littéraire Mohammed Dib est né en même temps que l'association culturelle « La Grande Maison » en 2001. Ce prix récompense les créations récentes des jeunes écrivains algériens. Lors de la première édition du prix. Le jury du prix est un jury international composé des plus grand noms de l'écriture et de la critique littéraire. [Réduire] Contact : contact@lagrandemaisondedib.com |
Le 15 Novembre 2016 :
| |
Géopolitique des langues dans le monde arabe Casablanca (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik Casablanca C’est un sujet très ancien, qui a passionné les gestionnaires de l'empire ottoman et les puissances coloniales européennes, mais que les pays arabes ont un peu négligé ensuite pour des raisons d'unité nationale, voire religieuses ou de crainte d'un néocolonialisme.
En se limitant aux prin... [Afficher la suite] C’est un sujet très ancien, qui a passionné les gestionnaires de l'empire ottoman et les puissances coloniales européennes, mais que les pays arabes ont un peu négligé ensuite pour des raisons d'unité nationale, voire religieuses ou de crainte d'un néocolonialisme.
En se limitant aux principales langues en jeu, il s'agit de la géographie et du rôle économique et social des langues locales : l'arabe et ses différentes variétés dialectales, les langues berbères ou amazighs et, plus accessoirement l'araméen ou le somali, voire le swahili qui n'est pas parlé dans le monde arabe mais est lié à son histoire. Il s'agit également du rôle des deux principales langues étrangères «ex-coloniales», le français et l’anglais, et, accessoirement, de l'italien et de l'espagnol. [Réduire] Contact : Lahcen Ouasmi |
Du 10 au 11 Mai 2016 :
.pdf) |
Colloque international "Cinéma et musique Safi (Maroc) - Faculté Polydisciplinaire de Safi Colloque international « le Cinéma et la Musique »
12 - 13 mai 2016
Equipe de recherches Littérature, Culture et Imaginaire
Faculté Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi Ayyad, Safi, Maroc Contact : amraouia@hotmail.com et rachid.naim@gmail.com |
Du 01 au 03 Mai 2016 :
| |
Colloque international « Du colonial et du postcolonial en littératures francophones : Articulations et créations d’imaginaires » Taroudant (Maroc) - Faculté Polydisciplinaire de Taroudant (Université Ibn Zohr) Colloque international
« Du colonial et du postcolonial en littératures francophones :
Articulations et créations d’imaginaires »
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant
Taroudant du 2 au 4 mai 2016
A la suite des travaux de traduction de W. Benjamin dont il s’inspire en reprenant le... [Afficher la suite] Colloque international
« Du colonial et du postcolonial en littératures francophones :
Articulations et créations d’imaginaires »
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant
Taroudant du 2 au 4 mai 2016
A la suite des travaux de traduction de W. Benjamin dont il s’inspire en reprenant les concepts de relativisme et d’universalisme culturels, H Bhabha considère la production culturelle comme "une traduction culturelle" dans la mesure où elle permet, pense-t-il, de montrer «en quoi chaque forme de culture est liée à toutes les autres». De ce point de vue, la culture est pour lui «une activité symbolique ou signifiante » (Bhabha, 98) au sens où, comme en traduction, elle «peut être copiée, transférée, modifiée, transformée en simulacre». Cette analogie est d’autant plus pertinente que, dans le cas de la culture, « "l’original" est toujours susceptible de traduction, en sorte qu’on ne peut jamais lui assigner un moment antérieur de totalité d’être ou de sens, autrement dit une essence » (Bhabha, 99). Selon l’approche de Bhabha, la production de cultures « revient à dire que les cultures ne se constituent que dans cette altérité de production de symboles qui en fait des structures décentrées (Bhabha, 99).
Dans cette perspective, le concept de " déplacement" qui s’opère sur celui de "liminalité", entendu comme cet espace d’intersection dynamique dans la production des cultures. Depuis la rencontre des cultures françaises, arabes et africaines aussi bien en Afrique du Nord qu’en Afrique subsaharienne, on note une constante production de cultures. Ainsi donc s’ouvrent des possibles d’articulations de pratiques culturelles, comprises à la fois comme modes d’interpellations et en tant que systèmes producteurs de symboles et constitutifs du sujet.
Partant de ce présupposé théorique, il conviendra, dans le cadre de ce colloque, de réfléchir sur les articulations, les ambivalences, les dédoublements, les dissimulations et les négociations qui se font entre les diverses cultures qui transcendent les productions littéraires et cinématographiques francophones. En examinant les tensions idéologiques, les contradictions ainsi que les imaginaires qui en résultent en termes de reformulations, de transgression et de subversion, il s’agira d’en déceler les significations et de voir comment ces négociations génèrent de nouvelles productions d’être, de penser et de projection en terme de produits culturels.
Les propositions de communications et d'ateliers, incluant vos coordonnées, affiliation et domaine de spécialisation, devront être acheminées au plus tard le 31 janvier 2016, par courriel à l'une des adresses suivantes :
Professeure Lamia Benjelloun
Université Ibn Zohr
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant
Hay Lastah BP 271
Taroudant 83000
Maroc
lamia.benjelloun@yahoo.fr
Professeur Driss Aissaoui
Département d’études françaises
Université Dalhousie
3106-6135 University Ave
Halifax, Nouvelle-Écosse B3H 4R2
Canada
aissaoui@dal.ca [Réduire] Contact : aissaoui@dal.ca |
Le 26 Novembre 2015 :
 |
Rencontre débat autour du film portrait sur Yasmin Khadra "Yasmin et Mohamed" de Régine Abadi Segré (France) - Médiathèque Rencontre débat autour du film portrait sur Yasmin Khadra "Yasmin et Mohamed" de Régine Abadi.
Débat avec Benaouda LEBDAI Contact : Benaouda LEBDAI |
Du 26 au 27 Mai 2016 :
| |
Écrire la Révolution Constructions, projections, postures Luxembourg (Luxembourg) - Université du Luxembourg Révolution d’Octobre, Révolution allemande (1918-1919), Prises de pouvoir fascistes (Italie, Troisième Reich), Été anarchiste (Espagne, 1936), Révolutions chinoises, Mai 68, Chute du mur de Berlin, Printemps arabe… Ces divers bouleversements qui ébranlent l’ordre politico-social établi... [Afficher la suite] Révolution d’Octobre, Révolution allemande (1918-1919), Prises de pouvoir fascistes (Italie, Troisième Reich), Été anarchiste (Espagne, 1936), Révolutions chinoises, Mai 68, Chute du mur de Berlin, Printemps arabe… Ces divers bouleversements qui ébranlent l’ordre politico-social établi ont inspiré d’innombrables écrivains. Au XXe siècle, la Russie ouvre à la fois le bal des révolutions et, à travers l’ouvrage célèbre de L. Trotski, la réflexion sur les rapports entre Littérature et Révolution (1934).
Dans le sillage de la critique marxiste, la mise en fiction de l’évènement révolutionnaire a été discutée par différents penseurs qui se fondent (de façon plus ou moins implicite) sur une série d’antinomies : production intellectuelle vs action radicale, écrivain individuel vs peuple anonyme, institution littéraire établie vs bouleversement politique. Sans déprécier la pertinence heuristique de ce mode d’interrogation, nous voudrions opérer un déplacement de perspective en questionnant la dynamique représentationnelle par laquelle une révolution est mise en récit en tant qu’expérience vécue, épisode historique ou moment à venir. Cette dynamique articule au moins trois aspects interdépendants :
Construction. Le récit reconfigure l’évènement révolutionnaire sur un mode fictionnel, ce qui suppose un ensemble de choix de construction : une temporalité différente, une esthétisation, une multiplicité de voix et de points de vue, une éventuelle interdiscursivité (avec les discours médiatiques, par exemple), etc. (cf. Ricoeur 1983, 1984, 1985, Rabatel 2008).
Projection. En faisant « naître un monde » (Jauss, 1978), la littérature ouvre des possibles potentiellement subversifs. Seront questionnés ici les effets pragmatiques (toujours plurivoques) de la mise en récit : véhiculer une idéologie, informer ou sensibiliser un public, « faire communauté », encourager une pratique, etc.
Posture. À travers l’écriture d’une révolution, l’écrivain construit une image particulière de lui-même (rebelle, réactionnaire, sympathisant détaché,…). Cet « éthos » (Amossy 2010) généralement composite, qui émane du récit, peut être mis en relation avec le positionnement institutionnel et politico-social de l’écrivain (Meizoz 2007). On pourra, entre autres, interroger les différentes formes de « paratopies » (Maingueneau 2004) qui nourrissent la construction du récit, en particulier la difficile négociation entre l’image de l’intellectuel et celle du révolutionnaire.
Les contributions porteront sur un ou sur plusieurs récits littéraires traitant d’une ou de plusieurs révolutions. Seront prises en compte les fictions des XXe et XXIe siècles qui mettent en scène des révolutions politiques et/ou sociales, réelles ou imaginaires, sans restriction géographique. Les récits qui appellent ou annoncent une révolution sont également les bienvenus.
Axes de recherche (à titre indicatif) :
La mise en récit de l’évènement révolutionnaire réclame-t-elle des mécanismes spécifiques (narratifs, énonciatifs, discursifs, rhétoriques,…) ? Par quels moyens cette thématique est-elle articulée à l’esthétique littéraire ?
Comment se noue le rapport entre réflexion politique et fiction ? entre argumentation et narration ? entre idéologie et histoire ?
Comment l’écrivain articule-t-il sa propre image à celle du révolutionnaire ? l’acte d’écriture à l’acte révolutionnaire ? Comment négocie-t-il la temporalité différée du récit par rapport à l’immédiateté de l’acte révolutionnaire ?
Ces récits sont-ils reçus de la même manière par les médias, les intellectuels, les révolutionnaires, les autres écrivains ?
Comment différents auteurs traitent-ils d’une même révolution ? En tant qu’élément fondateur de la modernité, quelle place occupe la Révolution française dans les récits qui traitent d’autres révolutions ? Est-ce une référence, un contre-modèle, est-elle passée sous silence ?
La durée des interventions sera de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Les propositions, sous forme de résumé de 400 mots accompagné d’une brève bio-bibliographie, devront être envoyées pour le 22 janvier aux organisateurs. Les réponses seront notifiées pour le 10 février.
Organisé par IRMA (Institut d’études romanes, médias et arts) de l’Université du Luxembourg, avec le soutien de l'École doctorale IPSE (Identité, Politique, Société, Espace), le colloque se déroulera sur le campus d’Esch-Belval. Les frais d'hébergement seront pris en charge par notre université. Une publication est envisagée.
Conférencier invité : François Cusset (Université Paris X Nanterre)
Organisateurs : Julien Jeusette (julien.jeusette@uni.lu) ; Jeroen Claessen (jeroen.claessen@uni.lu) ; Emilie Goin (emilie.goin@uni.lu)
Comité scientifique : Marion Colas-Blaise (Université du Luxembourg) ; Nathalie Roelens (Université du Luxembourg) ; François Provenzano (Université de Liège) ; Dominique Rabaté (Université de Paris 7 Denis Diderot)
Bibliographie indicative
Sur les révolutions et leurs mises en récit :
Bouthillon, F. (2011), Nazisme et Révolution – Histoire théologique du national-socialisme, 1789-1989, Paris, Fayard.
Cusset, F. (2008), Contre-discours de mai. Ce qu’embaumeurs et fossoyeurs de 68 ne disent pas à ses héritiers, Paris, Actes Sud.
Jenny, L. (2008), Je suis la révolution. Histoire d'une métaphore (1830-1975), Paris, Belin.
Pessin, A. & Terrone, P. (1998), Littérature et anarchie, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
Trotsky, L. (1964), Littérature et révolution, Paris, Union générale d'Édition.
Ouvrages méthodologiques :
Amossy, R. (2010), La présentation de soi. Éthos et identité verbale, Paris, Presses Universitaires de France.
Jauss, H. (1978), Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard.
Maingueneau, D. (2004), Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Colin.
Meizoz, J. (2007), Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur, Paris, Slatkine.
Rabatel, A. (2008), Homo Narrans, pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, Limoges, Lambert-Lucas.
Ricoeur, P. (1983, 1984, 1985), Temps et récit (I, II, III), Paris, Seuil. [Réduire] Contact : julien.jeusette@uni.lu jeroen.claessen@uni.lu emilie.goin@uni.lu |
Du 26 au 27 Avril 2016 :
| |
La traduction dans la littérature. Que peut le littéraire pour (re)penser la traduction? Montréal (Canada) - Université de Montréal APPEL À COMMUNICATION
« La traduction dans la littérature. Que peut le littéraire pour (re)penser la traduction? », colloque annuel de la revue Post-Scriptum
Université de Montréal, 27-28 avril 2016
Organisé par Louis-Thomas Leguerrier (doctorant en littérature comparée, Universit�... [Afficher la suite] APPEL À COMMUNICATION
« La traduction dans la littérature. Que peut le littéraire pour (re)penser la traduction? », colloque annuel de la revue Post-Scriptum
Université de Montréal, 27-28 avril 2016
Organisé par Louis-Thomas Leguerrier (doctorant en littérature comparée, Université de Montréal) et Marie-Eve Bradette (doctorante en littérature comparée, Université de Montréal)
Est-il possible de penser la traduction à partir de la littérature? Une réflexion sur la traduction peut-elle émerger d’une pensée littéraire? Ou est-ce qu’elle ne peut être reléguée qu’au strict champ de la traductologie, des translation studies, elles-mêmes issues de la tradition renaissante des translatio studii à laquelle, d’ailleurs, la littérature comparée doit, à tout le moins en partie, sa formation comme discipline? Les travaux d’Emily Apter (The Translation Zone, 2005; Against World Literature, 2013) aux États-Unis, par exemple, ont posé cette question, mais à l’envers. Il s’agit, pour Apter de repenser la littérature comparée à partir des translation studies ce qui permet aussi une réflexion sur les impasses de la littérature mondiale confrontée à l’intraduisible. Au Québec, Sherry Simon (Le trafic des langues, 1994; Translating Montreal, 2006; Translation Effects, 2014) aborde également le littéraire par le truchement d’une réflexion sur la traduction. Dans cette perspective, Simon a notamment développé une définition importante de ce qu’elle nomme une « poétique de la traduction » (1994 : 19) dans la littérature québécoise. Avec cette idée d’une poétique de la traduction à l’œuvre dans les textes, une matière plus proprement littéraire semble déjà se distinguer. Les travaux de Lawrence Venuti (The Translator's Invisibility: A History of Translation, 1995; Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology, 1992; Translation Changes Everything: Theory and Practice, 2013) articulent, pour leur part, une perspective différente. Venuti voulait provoquer “a rethinking of translation that is philosophical, but also political, engaged in questions of language, discourse, and subjectivity, while articulating their relations to cultural difference, ideological contradiction, and social conflict” (1992 : 6). Ce n’est donc pas la littérature (générale ou comparée) qui est repensée, mais la traduction elle-même. Dès lors, l’angle est à nouveau inversé et dans le sens de la question posée dès le début de cet appel, c’est-à-dire dans l’idée de prolonger une réflexion sur la traduction qui relèverait d’un autre champ d’études. En ce qui nous concerne, la littérature servira de prisme, mais l’on pourra tout aussi bien envisager la traduction à partir du cinéma, des arts visuels, etc. Forcément, cette démarche se veut, comme l’est la traduction elle-même, interdisciplinaire.
C’est donc à partir de cette question : Est-il possible de penser (ou de repenser) la traduction à partir de la littérature?, que nous lançons cet appel à communication pour le colloque annuel organisé par la revue Post-Scriptum. Il semble en effet que la littérature offre un terrain fertile pour aborder une telle problématique. Il faudra, en ce sens, envisager les manières dont la littérature aborde la traduction parfois comme thématique, parfois comme moteur de l’écriture. La littérature pourra même être envisagée comme un lieu de théorisation de la traduction. Les communications pourront être théoriques ou proposer une analyse de texte.
Les axes de réflexion suivants organiseront la réflexion lors du colloque, sans toutefois s’y restreindre :
- La littérature comme théorie de la traduction.
- Fictionnalisation de la traduction dans la littérature.
- Les figures de la traduction ou du traducteur/de la traductrice.
- Le littéraire comme espace de déplacement.
- L’utopie du langage, une approche transversale de la traduction.
- Traduisible/intraduisible.
- Traduction intermédiale, traduction intersémiotique.
- Traductio/translatio.
Les participants doivent envoyer leur proposition de 300 mots au plus tard le 30 janvier 2016 à l’adresse suivante : redaction@post-scriptum.org. Vous devez envoyer votre proposition en deux fichiers distincts : dans le premier document doit apparaître votre nom, votre université d’attache, votre adresse courriel et le titre de votre communication; dans le second document doit apparaître le titre de votre communication et le texte de votre proposition. Les propositions feront l’objet d’une évaluation à l’aveugle par le comité de lecture.
Calendrier :
30 janvier 2016 : envoi des propositions
mi-février : décision du comité
27-28 avril 2016 : Colloque
Bibliographie sommaire
APTER, Emily (2013). Against World Literature. On the Politics of Unstranslability, New York, Verso.
__________ (2006). The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton et Londres, Princeton University Press.
BLODGETT, E. D. (1993). « Translation as a Key to Canadian Literature », dans André Lefevere et José Lambert, dirs. La traduction dans le développement des littératures. Berne, Peter Lang, pp. 239-247.
GENTZLER, Edwin (1999). « Comparative Literature and Translation Studies. The Challenge from Within ». Textus, 12, 2, pp. 243-262.
GILE, Daniel (2001). « Shared Ground in Translation Studies. Continuing the Debate ». Target, 13, 1, 2001, pp. 149-153.
HANNE, Michael (2006). « Metaphors for the Translator », Susan Bassnett et Peter Bush (dirs.), The Translator as Writer. Londres, Continuum, pp. 208-224.
LANE-MERCIER, Gillian (2009), « Repenser les rapports entre la littérature comparée et la traductologie : prolégomènes au braconnage interdisciplinaire », TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 22, n° 2, p. 151-182.
SIMON, Sherry (1994). Le trafic des langues. Traduction et culture dans la littérature québécoise. Montréal, Boréal.
__________ (dir.) (2014). Translation Effects. The Shaping of Modern Canadian Culture, Montréal, McGill-Queen’s Press.
__________ (2006). Translating Montreal. Episodes in the Life of a Divided City. Montréal, McGill-Queen’s University Press.
VENUTI, Lawrence, ed. (1992). Rethinking Translation — Discourse, Subjectivity, Ideology. London and New York, Routledge.
__________ (1995). The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York, Routledge, coll. « Translation Studies ».
__________ (2013). Translation Changes Everything: Theory and Practice, London and New York, Routledge.
Responsable :
Marie-Eve Bradette
url de référence
http://post-scriptum.org [Réduire] Contact : redaction@post-scriptum.org |
Du 24 au 26 Octobre 2016 :
| |
« Explorer les pratiques linguistiques, textuelles et artistiques francophones du point de vue de l’entre-deux et de l’écart » Alger (Algérie) - Ecole Normale Supérieure de Bouzaréah Contact : enslabo@yahoo.fr |
Du 24 au 25 Mars 2016 :
| |
Supports en classe de langue(s) Meknès (Maroc) - Ecole Normale Supèrieure Colloque international Contact : mina.sadiqui@ens.umi.ac.ma |
Du 19 au 20 Novembre 2015 :
 |
La migration des oeuvres en Méditérranée Mahdia (Tunisie) - Hotel Royal El Mansour Contact : Wided_dh@yahoo.fr |
Le 14 Mars 2016 :
 |
D’Orient et d’Occident, les intellectuel-le-s arabo-francophones Lyon (France) - Université Lumière Lyon 2 Le colloque qui a porté sur les représentations croisées entre Orient et Occident avait fait suite à un premier colloque intitulé L’Autre et ses représentations dans la culture arabo-musulmane et prolongeait les réflexions et les discussions autour de l’altérité et ses représentation... [Afficher la suite] Le colloque qui a porté sur les représentations croisées entre Orient et Occident avait fait suite à un premier colloque intitulé L’Autre et ses représentations dans la culture arabo-musulmane et prolongeait les réflexions et les discussions autour de l’altérité et ses représentations dans le monde arabo-musulman et en Occident. Le paradigme saïdien d’un orientalisme suspect continue de servir de référence acquiescée ou critiquée au point de ré-envisager sa « repolarisation sémantique positive ». En effet, il n’est plus question de jeter le bébé de l’orientalisme avec l’eau du bain impérialiste dès lors qu’il est considéré comme une attitude, une posture, y compris chez « l’oriental » lui-même (Pouillon et Vatin, 2011 ).
Dans une même volonté de sortir du clivage Orient / Occident et de le nuancer, la notion d’occidentalisme-s, non plus au sens de « haine contre l’Occident » (Buruma et Margalit ), mais conçue comme l’envers symétrique de l’orientalisme , est interrogée à son tour depuis quelques années.
Simultanément, l’intensification des mobilités encadrées par des organismes étatiques (estudiantine, scientifique, artistiques, etc.), les déplacements des populations en rapport avec les conflits, et l’accroissement de l’accès aux nouvelles technologies (sources ouvertes, livre électronique, bases de données, etc.) nous invitent à examiner d'autres voies pour appréhender les rapports Orient-Occident, non plus sur le mode du clivage mais sur celui de la connexion, du partage, non plus sur celui de la séparation et du conflit mais celui des circulations et des échanges.
Pourtant, la réassignation identitaire n'est jamais aussi forte que lorsque contacts et connexions se font plus intenses, et que les signes d'appartenance se brouillent. Il s'agit tout simplement de réinstaurer de la différence là où il n'y en a plus, par toute une série de stratégies, qui vont de la simple stratégie de condescendance à l'affirmation la plus brutale de la différence irréductible.
L’objectif n’est pas d’évacuer la pertinence des approches précédentes, mais de les éclairer à l’aide de ces lieux de dissémination qui semblent déplacer le rapport à l’altérité.
C’est en particulier la figure tutélaire d’Edmond Amran El Maleh et sa pensée qui serviront de point d’ancrage à ce projet, faisant écho non pas à L’Orientalisme de Saïd mais à ses Réflexions sur l’exil.
En effet, l’œuvre et la vie d’El Maleh dessinent le portrait d’une « communauté inavouable » (Blanchot), communauté constituée selon les principes d’affinités électives autour de l’art et de la littérature : il s’agit des socialités entre écrivains, éditeurs, artistes, philosophes. Ce sont ces socialités réelles ou imaginaires, ces loyautés nées de rencontres au gré des circulations nord / sud et inversement que nous nous proposons d’étudier.
Un séminaire itinérant (entre l’Université Lumière Lyon 2, l’Université de Bordeaux et l’Université Mohamed-V de Rabat) s’articulera à une journée d’étude organisée par le laboratoire Passages XX-XXI (U. Lyon 2) en mars 2016 et un colloque international en 2017.
La journée d’études sera adossée à deux manifestations culturelles simultanées (entre le 11 et le 16 mars 2016) : la semaine de la francophonie et la semaine du Maroc en Rhône-Alpes en partenariat avec l’ENS de Lyon. Cette journée d’étude s’attachera à étudier la place de l’intellectuel arabofrancophone dans le circuit de production et de transmission de savoirs.
Axes de réflexion de la journée d’étude : d’Orient et d’Occident, les intellectuels arabofrancophones.
• Rôles des éditeurs (François Maspéro, Edmond Charlot, André Dimanche, jeunes maisons d’éditions …)
• Rôle des revues ou de journaux : Etudes palestiniennes, Souffles, Le Monde…
• Traduire de / en arabe dans un contexte multilingue et diglossique.
• Identités genrées
Bibliographie indicative
• Aït Mous, Fadma et Ksikes, Driss. Le Métier d’intellectuel. Dialogue avec quinze penseurs du Maroc, Casablanca, éd. Les Presses de l’université citoyenne, 2014.
• Ben Msila, Anouar (coord.). Edmond Amran El Maleh : art, culture et écriture, Meknès, Faculté des sciences humaines, 2013.
• Bogliolo, François, Domens, Jean-Charles, Vène, Marie-Cécile. Edmond Charlot : Catalogue Raisonné D'un Éditeur Méditerranéen, coll. Méditerranée Vivante, Pézenas, Domens, 2015.
• Boulaabi, Ridha. L’Orient des langues au XXème siècle : Aragon, Ollier, Barthes, Macé, Éditions Geuthner, Paris, 2011.
• Brisson, Thomas. « Le savoir de l’autre ? Les intellectuels arabes de l’université parisienne (1955-1980): une relecture de l’orientalisme français », REMMM 125, p. 255-270, 2009.
• Brisson, Thomas. Les intellectuels arabes en France, Paris, La Dispute, 2008.
• Buruma, Ian et Margalit, Avishai. L'Occidentalisme : une brève histoire de la guerre contre l'Occident [Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies, 2004], trad. frse Claude Chastagner, Paris, éd. Climats, 2006.
• Del Fiol, Maxime. « Les "occidentalismes" de la littérature arabo-musulmane d’expressions arabe et française depuis l’expédition d’Égypte : pour une problématisation et une acclimatation du concept en critique littéraire », dans ELFe XX-XXI. Etudes de littérature de langue française des XXe et XXIe siècles, no 4, Continents francophones, sous la direction de Sabrina Parent, Anne Douaire-Banny et Romuald Fonkoua, Classiques Garnier, 2014, p. 111-132.
• El Maleh, Edmond Amran. Le café bleu Zrirek, Grenoble / Casablanca, éd. La Pensée sauvage / Le Fennec, 1998.
• El Maleh, Edmond Amran. Entretiens, par Marie Redonnet, Grenoble / Rabat, La Pensée sauvage / Fondation Edmond Amran El Maleh, 2005.
• Fili-Tullon, Touriya (coord ;). Expressions maghrébines, dossier « Edmond Amran El Maleh », vol. 9, n°2, Barcelone, 2010.
• Jacquemond, Richard. “Les flux de traduction entre le français et l’arabe depuis les années 1980 : un reflet des relations culturelles”, in Gisèle Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS Editions, p. 347-369.
• Messaoudi, Alain. « Orientaux orientalistes : les pharaons, interprètes du Sud au service du Nord », Colette Zytnicki (dir), Sud-Nord, Toulouse, Privat, 2004.
• Pouillon, François. Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, éd. IISMM / Karthala, 2008. (voir aussi le site dédié au dictionnaire).
• Pouillon, François et Vatin, Jean-Claude (éd.), Après l'orientalisme. L'Orient créé par l'Orient, Karthala, 2011.
• Saïd, Edward, L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident [Orientalism, 1978], trad. frse de Catherine Malamoud, préface de Tzvetan Todorov, Le Seuil, 1980, (rééd. augm., 2003).
• Said, Edward, Réflexions sur l'exil et autres essais [Reflections on Exile and Other Essays, 2000], trad. frse de Charlotte Woillez, Arles, Actes Sud, 2008. [Réduire] Contact : Touriya.Filitullon@univ-lyon2.fr |
Du 27 au 30 Septembre 2016 :
| |
CfP: Atelier : Liaisons frontalières / Le Maghreb renouvelle ses fantômes : résurgence, recyclage, ressuscitation dans la littérature actuelle Sarrebruck (Allemagne) Congrès des Franco-Romanistes Allemands : du 28 septembre au 1 octobre 2016, à Sarrebruck
Appel à contributions:
Le Maghreb renouvelle ses fantômes : résurgence, recyclage, ressuscitation dans la littérature actuelle Contact : Ines Bugert (ibugert@mail.uni-mannheim.de), Claudia Gronemann (gronemann@phil.uni-mannheim.de) et Agnieszka Komorowska (komorowska@phil.uni-mannheim.de) |
Du 18 au 20 Mars 2016 :
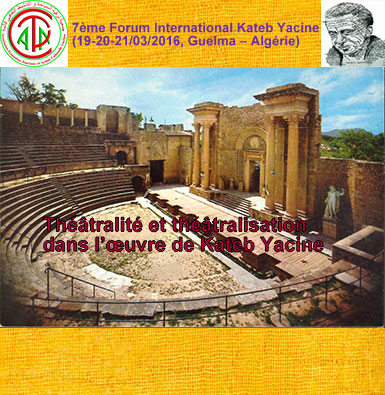 |
Prix Littéraires Kateb Yacine Guelma (Algérie) - Forum International Kateb Yacine à Guelma 7ème Forum International Kateb Yacine
(19-20-21/03/2016, Guelma – Algérie)
Prix littéraire International Kateb Yacine (Nouvelle version)
Prix littéraire International Kateb Yacine (Nouvelle version)
L’Association Promotion Touristique et Action Culturelle de Guelma (APTACG), orga... [Afficher la suite] 7ème Forum International Kateb Yacine
(19-20-21/03/2016, Guelma – Algérie)
Prix littéraire International Kateb Yacine (Nouvelle version)
Prix littéraire International Kateb Yacine (Nouvelle version)
L’Association Promotion Touristique et Action Culturelle de Guelma (APTACG), organisatrice du Forum International Kateb Yacine à Guelma (Algérie), et la direction administrative du Forum ont décidé de réviser la nature et le fonctionnement du Prix Littéraire International Kateb Yacine pour sa seconde édition 2016, la première ayant déclaré ses résultats et décerné ses prix en janvier 2014 (Prix littéraire du Roman : 2000 Euros et Prix spécial : 1000 Euros).
Après examen et évaluation de la première session et à la lumière de consultations élargies, il a été décidé d’organiser la seconde édition du Prix Littéraire International Kateb Yacine, à l’occasion du 7ème Forum International Kateb Yacine de Guelma qui se tiendra du 19 au 21 mars 2016. Le prix couvrira les genres suivants :
• 1 - Le Prix littéraire Kateb Yacine pour le Roman de Langue Française : 1500 Euros + trophée. Il récompense un roman de langue française ayant candidaté pour le prix par une demande émanant soit de l’auteur, soit de l’éditeur et publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Le dossier de participation doit impérativement comprendre la susdite demande au nom de M. le Directeur du 7ème Forum International Kateb Yacine de Guelma et 5 exemplaires du roman. Il est expédié à l’adresse postale suivante : à l’adresse suivante : Monsieur Ali Abbassi, président de l’Association Promotion Tourisme et Action Culturelle, Rue abdelmadjid amrani, n°1 Guelma 24000, Algérie. Le prix est attribué à l’auteur.
2 - Le Prix littéraire Kateb Yacine pour la Poésie de Langue Française : 1000 Euros + trophée. Il récompense un roman de langue française ayant candidaté pour le prix par une demande émanant soit de l’auteur, soit de l’éditeur et publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Le dossier de participation doit impérativement comprendre la susdite demande au nom de M. le Directeur du 7ème Forum International Kateb Yacine de Guelma et 5 exemplaires du roman. Il est expédié à l’adresse postale suivante : à l’adresse suivante : Monsieur Ali Abbassi, président de l’Association Promotion Tourisme et Action Culturelle, Rue abdelmadjid amrani, n°1 Guelma 24000, Algérie. Le prix est attribué à l’auteur.
Le dernier délai de présentation des demandes de candidature est fixé au 31 janvier 2016 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Le Président de l’APTACG
et directeur du Forum
Ali Abbassi
aliabbassi139@yahoo.fr [Réduire] Contact : aliabbassi139@yahoo.fr |
Du 18 au 20 Mars 2016 :
 |
VIIème Forum International Kateb Yacine à Guelma (Algérie) Guelma (Algérie) - Théâtre Régional de Guelma 7ème Forum International Kateb Yacine
(19-20-21/03/2016, Guelma – Algérie)
Colloque : Théâtralité et théâtralisation dans l’œuvre de Kateb Yacine.
Colloque : Théâtralité et théâtralisation dans l’œuvre de Kateb Yacine
Argumentaire
Faut-il consacrer un colloque au th... [Afficher la suite] 7ème Forum International Kateb Yacine
(19-20-21/03/2016, Guelma – Algérie)
Colloque : Théâtralité et théâtralisation dans l’œuvre de Kateb Yacine.
Colloque : Théâtralité et théâtralisation dans l’œuvre de Kateb Yacine
Argumentaire
Faut-il consacrer un colloque au théâtre de Kateb Yacine ? Oui bien sûr, mais ce faisant, peut-on éviter les autres types formes d’expression littéraire quand on sait combien les frontières sont fragiles entre les genres. Ni Nedjma ni le Polygone étoilé ne sont vides de passages franchement théâtraux, indépendamment de toutes les autres stratégies de théâtralisation qui font partie de la poétique katébienne dans ce qu’on convenu d’appeler « Le Cycle de Nedjma ».
La question devient plus complexe quand Kateb se met au théâtre en langues populaires d’Algérie et fonde, en 1978, sa troupe au théâtre Régional de Sidi Bel Abbes. « Nous travaillons toujours en dialectal, dit-il, pour la bonne raison que nous voulons toucher l’ensemble du public et pas seulement une partie du public. C’est-à-dire les gens du peuple, le grand public. » Voilà qui pose déjà le problème de la réception de ce théâtre entre sa première étape, autrement dit dans Le Cycle de Nedjma, et sa seconde étape, celle des langues populaires. D’une certaine façon, il y a lieu de s’interroger sur les lieux de convergence et ceux de divergence entre un premier théâtre, tourné vers la textualité, et un second centré sur le spectacle. Peut-être, en même temps, s’interroger sur la part d’influence de la tragédie grecque et sur celle du théâtre brechtien en passant de l’un à l’autre. A ce propos, faudrait-il considérer L’Homme aux sandales de caoutchouc comme un lieu de transition avec une poétique mixte ?
C’est de ces questions que pose le théâtre katébien ou qu’il permet qu’on lui pose que le conseil scientifique du 7ème Forum International Kateb Yacine de Guelma (Algérie) est parti pour inviter à la réflexion sur « Théâtralité et théâtralisation dans l’œuvre de Kateb Yacine ».
Quelques axes peuvent être proposés à titre indicatif :
1 – Le poétique, le tragique et le comique dans le théâtre du Cycle de Nedjma
2 – Le théâtre dans les textes non narratifs du Cycle de Nedjma
3 – Le théâtre populaire katébien entre le français et le dialectal
4 – L’écrivain à l’oeuvre entre les deux chaises de la création personnelle et l’écriture collective
5 – Kateb et son public
6 – Le théâtre kétébien, l’Histoire et la politique
Il est bien entendu que d’autres ouvertures sont laissées à l'appréciation des intervenants, quant à la lecture des auteurs qui auraient marqué l'oeuvre de Kateb.
Les propositions de communication sont à adresser avant le 10 décembre 2015 sur le mail du président du conseil scientifique : mansourmhenni50@yahoo.fr
Pour des raisons de prévision et de commodité organisationnelles, il est recommandé de mettre en CC du mail d’envoi, M. Ali Abbassi, le président de l’association organisatrice du forum, Association Promotion Touristique et Action Culturelle de Guelma. Son mail est : aliabbassi139@yahoo.fr
Le conseil scientifique donnera sa réponse le 10 janvier 2016 au plus tard et la direction du Forum précisera les conditions de participation dans le même courrier.
Il est à préciser qu’en plus du colloque, le Forum International Kateb Yacine comprend des manifestations culturelles (théâtre, cinéma, musique, exposition, etc.) et deux excursions touristiques et culturelles, une à Guelma et une dans la région.
Membres du conseil scientifique
Président du conseil : Mansour M’HENNI (Tunisie)
Membres :
Zineb ALI BENALI (Algérie)
Zohra BOUCHENTOUF-SIAGH (Algérie)
Sanae GHOUATI (Maroc)
Marc GONTARD (France)
Samir MARZOUKI (Tunisie)
Dalila MEKKI (Algérie)
Abderrahman TENKOUL (Maroc)
Le Président de l’APTACG
et directeur du Forum
Ali Abbassi [Réduire] Contact : mansourmhenni50@gmail.com |
Du 12 au 13 Novembre 2015 :
| |
Tozeur (Tunisie) - Institut Sup des Etudes Appliquées en Humanités Colloque international pluridisciplinaire à propos du thème "Ecrire ses origines" Contact : Hassan Bkhayrya / Ali Abassi 22718861 |
Le 09 Novembre 2015 :
 |
Assia Djebar : De l'écrit au cri Tunis (Tunisie) - Faculté des Sciences Humaines et Sociales L'Unité de recherche "Imaginaire méditerranée et Interculturalité. Approches comparées" (IMIAC) organise une journée d'étude en hommage à l'écrivaine algérienne Assia Djebar Contact : Sonia Zlitni Fitouri |
Du 13 au 14 Decembre 2015 :
| |
L’intertextualité dans la littérature et les arts : Formes , interculturel et altérité Agadir (Maroc) - Université Ibn Zohr, Agadir - Maroc, Faculté des Lettres et Sciences Humaines Colloque international
L’intertextualité dans la littérature et les arts : Formes , interculturel et altérité
14-15 décembre 2015
Appel à contributions
L’approche intertextuelle dans la littérature et les arts
Colloque International organisé par l’Ass... [Afficher la suite] Colloque international
L’intertextualité dans la littérature et les arts : Formes , interculturel et altérité
14-15 décembre 2015
Appel à contributions
L’approche intertextuelle dans la littérature et les arts
Colloque International organisé par l’Association Marocaine Francophone (AMF) en collaboration avec le Département de langue et Littérature Française. Université Ibn Zohr, Agadir-Maroc.
Date limite de réponse à l’appel: 20 novembre 2015
Responsable: M. Sad SLAMTI
Argumentaire
Pourquoi une 7e édition sur l’intertextualité?
Plus que jamais, ce champ d’étude est encore plus d’actualité aujourd’hui. Les six éditions présentées, ici à l’Université Ibn Zohr à Agadir au Maroc depuis 2006 se sont préoccupées de la fonction définitoire sur cette approche critique, laquelle permet d’appréhender le texte à travers une étude transversale, interculturelle multidisciplinaire. L’approche intertextuelle nous est apparue, de ce fait, dotée d’une fonction opératoire dans la mesure où elle constituait un outil d’analyse à même de décrire une poétique du texte littéraire. Cette dimension sera certes privilégiée dans le cadre de ce nouveau colloque. Nous proposons encore de réfléchir sur les procédés par lesquels un texte s’approprie un ou plusieurs textes. Nous proposons d’étudier ce que le texte fait des autres textes qu’il invoque, comment il les modifie, les phagocyte, les transforme ou les révoque. Le texte est pris dans un sens sémiotique plus large puisqu’il donnera aussi l’occasion de se pencher sur l’œuvre d’art de manière générale, ou l’image qu’elle soit dictée par la bande dessinée ou inhérente à l’art de la photographie.
A travers cette rencontre qui est devenue pour nous une rencontre interculturelle: une sorte de communion laquelle nous donne cette opportunité d’associer à la recherche un humanisme cher à notre tradition universitaire marocaine, dans une ère tournée de plus en plus vers le repli identitaire et vers l’émergence d’une littérature xénophobe: un pessimisme régnant par-delà le méandre de cette crise économique qui parait-il n’a pas dit encore son nom.
Aussi, nous avons voulu marquer cette nouvelle édition sous le signe de l’interculturel et de l’altérité tout en poursuivant notre champ d’étude aux formes, aux réminiscences, ou aux filiations que laisse transparaitre chaque texte pour nous offrir finalement une bibliothèque universelle ouverte à la postérité: intertextualité et interculturelle.
Un texte pour élargir le débat, nous dirions qu'une œuvre est finalement «faite des œuvres dont elle vient mais aussi des œuvres qui viendront après elle et qu’il sera possible de mettre en relation avec elle». «L’identité d’une œuvre ne coïncide pas seulement avec les œuvres à venir, mais encore avec des interprétations qu’il sera possible de donner de cette même œuvre d’une époque à une autre de l’histoire littéraire».
Axes du Colloque
– L’ironie littéraire: un acte fondateur de l’intertextualité
– La réception en tant que dimension principale de l’intertextualité
– L’intertextualité comme champ des possibles des textes ou comme mémoire des œuvres
– Formes intertextuelles
– Allégorie, ironie et intertextualité
– Histoire littéraire et intertextualité
– Du texte littéraire au support artistique
– L’intertextualité comme champ des possibles des textes ou comme mémoire des œuvres.
– Le plagiat par anticipation, ou l’intertextualité par anachronisme
– La stylistique, une clef indispensable dans le décodage de l’intertextualité inavouée
– Intertextualité et altérité
– Intertextualité interculturelle
– Intertextualité de l’image dans la publicité, le cinéma, la bande dessinée et la peinture
– La mise en abyme et intertextualité
– Histoire des idées et intertextualité
– Intertextualité et interdiscursivité
– Cinéma et peinture (l’intertextualité de l’image)
– Hypertextualité, parodie ou pastiche
– Intertextualité en art
– intertextualité et publicité
– La mise en abyme comme forme générique de l’intertextualité
– La photographie et le texte ethnographique
Coordinateur: SLAMTI SAD
Comité scientifique
Chaiab Mohamed (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
Dakir Abdenbi (Université Ibn ZOHR Agadir Maroc)
PILORGET Jean Paul (classes préparatoires, lycée Blaise Pascal, Paris)
WAHBI Mohamed (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
SlAMTI Sad (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
Karen meyer Ferreira ( Université Swaziland )
CHAKIR Bouchra ( Université Dar El Hadith HASSANIA, Rabat )
GUENOUN Faiza ( Université Allal Ben Abdellah , Fes )
Comité d'organisation
SlAMTI Sad (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
DIANE lhoucine ( Université Ibn Zohr Agadir Maroc )
WAHBI Mohamed (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
MOUNIR Abdelhak (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
SAMARI Nezha (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
Comité des étudiants
MAJID Majda (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
HAZIM Jawad (Université Ibn Zohr Agadir Maroc)
A contacter
M. Sad SLAMTI
E-mail: de_saaade@hotmail.com
Conditions de participation
Les propositions de communication (250 mots) accompagnées d'une notice biographique (où vous préciserez, votre université d'attache et votre programme d'études) et d'une liste de cinq mots-clés doivent être envoyées avant le 20 novembre 2015. A l’adresse suivante: de_saaade@hotmail.com
La possibilité d'une publication des actes du colloque, après sélection des articles par un comité de lecture, est assurée.
Une fois que le comité d’évaluation vous aura communiqué si votre communication a été retenue, vous devrez vous acquitter d’une inscription de 80 euros. (nos colloques ne sont pas subventionnés)
1 - Obligation de s’engager à participer dans l’un de ces axes précités.
2 - Envoi d’un résumé du travail de recherche avant le 20 novembre 2015.
3 - Date de communication de l’avis favorable du comité scientifique: le 25 novembre 2015.
4 - Langues du Colloque: Arabe, Français, Anglais, Amazighe. [Réduire] |
Du 16 au 17 Mars 2016 :
| |
Ethos et identités de l'écrivain francophone Nantes (France) - Université de Nantes Colloque jeunes chercheurs
Université de Nantes - IRFFLE (Institut de recherche et de formation en français langue étrangère) - Laboratoire CoDiRe - EA 4643 (Construction Discursive des Représentations linguistiques et culturelles)
17 et 18 mars 2016, dans le cadre de la semaine de la fra... [Afficher la suite] Colloque jeunes chercheurs
Université de Nantes - IRFFLE (Institut de recherche et de formation en français langue étrangère) - Laboratoire CoDiRe - EA 4643 (Construction Discursive des Représentations linguistiques et culturelles)
17 et 18 mars 2016, dans le cadre de la semaine de la francophonie.
Argumentaire scientifique
Initiée et développée progressivement à partir des années 1960 par des chercheurs de disciplines diverses, tels Michel Pêcheux et Michel Foucault, l’analyse du discours (désormais AD) a surtout donné la priorité aux discours politiques et médiatiques. Le discours littéraire, quant à lui, a été travaillé plus tardivement, à partir de 1975, grâce aux études de Jean-Michel Adam, de Ruth Amossy ou de Dominique Maingueneau.
Ce colloque vise à mettre à l'honneur l'analyse du discours littéraire (ADL), et plus spécifiquement celle du discours littéraire «francophone». Il s’agit de convoquer des textes littéraires et de proposer des corpus intéressant à la fois les études littéraires et les sciences du langage.
Puisque l'ADL s'est focalisée sur les scénographies et les ethê auctoriaux (Maingueneau, Amossy, Delormas, Diaz, etc.), ce colloque propose de cerner la notion d’«écrivain(s) francophone(s)», sous le prisme méthodologique de l'analyse du discours, à partir des productions littéraires d’auteurs écrivant en langue française (romans, nouvelles, essais, théâtre, poésie, journaux intimes, lettres, etc.).
Comment construit-on une identité d'écrivain, et d'écrivain francophone, à travers des images et des scénographies spécifiques, et ce avec toute la disparité incluse dans l'adjectif francophone? La francophonie est, en effet, perçue de manière différente selon les zones géographiques et culturelles, que ce soit au Maghreb, au Sénégal ou au Canada par exemple. On sait que D. Combe (2010) préfère parler de «francophonies».
En se concentrant sur les postures et les représentations de l’écrivain et sur les mises en scène de son rapport à la langue française et à la francophonie, le colloque s’articulera autour de quatre axes, qu’il sera possible de croiser selon les intérêts des communicants.
Axe 1: Écriture, culture(s) et identité(s)
Parce qu’«aucun discours ne restera sans provoquer l’identification de caractérisations identitaires de chacun de ses acteurs» (Garric 2014), cet axe suggère d’interroger la construction de l’identité ou des identités de l’écrivain francophone, sa culture ou ses cultures. Comment l'écrivain se positionne-t-il dans l'espace dit francophone et quelle vision en donne-t-il? Comment les notions de frontières géographiques ou ethno-culturelles se manifestent-elles ? Le militantisme linguistique et culturel qui peut apparaître dans la question de l'ethos est une piste à creuser. Une double identité linguistique et culturelle apparaît-elle dans le discours comme une richesse ou comme la source de conflits identitaires profonds?
Axe 2: Le rapport à la langue française
Autour du partage de la langue française, l’écrivain francophone justifie-t-il dans ses œuvres le choix de cette langue? Donne-t-il à voir les rapports entre sa/ses langue(s) maternelle(s) et la langue française? Cet axe pourra questionner la relation de l’écrivain à la langue française, avec l’existence possible d’une hybridité linguistique dans le tissu textuel. Il serait donc intéressant de voir comment, par exemple, l’écrivain convoque le lexique de sa/ses langue(s) dans les récits, comment il réemploie des proverbes, des expressions, des termes spécifiques de sa langue qu'il traduit et adapte en langue française, c'est-à-dire comment se créent des phénomènes de langues en contact dans son discours littéraire, que ceux-ci fassent l’objet d’une écriture métalangagière ou non.
Axe 3: L’engagement socio-politique
Cet axe propose d'examiner la mise en scène d'un possible «engagement» de l'écrivain francophone dans des questions socio-culturelles et politiques de son époque. Il existe aussi le cas d' écrivains politiciens, et cette double sensibilité entre littérature et politique a pu se répercuter sur leurs écrits. Que l'écrivain ait occupé des fonctions politiques ou qu'il soit demeuré simple citoyen, les textes littéraires ont pu être pensés comme des discours politiques. Les phénomènes de transgénéricité entre discours littéraire et discours politique pourront attirer l’attention, que cela soit à travers les ethê revendiqués par l'écrivain, ou à travers le style en lui-même (figures de rhétorique et rythmes spécifiques pour déployer des effets de pathos, etc.).
Axe 4: l'édition et la diffusion des écrits francophones: quand l'image de l’écrivain s'exporte
Bien souvent, l’écrivain publie ses écrits hors de son pays d’origine, en France, en particulier. La publication à l’étranger pourrait avoir des effets sur la représentation de l’auteur par lui-même ou par ses lecteurs, mais aussi sur la production et la réception de l’œuvre. Quelle est en particulier la portée symbolique de ce choix? Quelle image de l’écrivain francophone construisent les maisons d’édition mais aussi les instances de diffusion ou de promotion du livre? Peut-on parler d’un business éditorial et médiatique autour de lui?
Le traitement de cet axe implique d'ouvrir la collecte des données à d'autres documents que les productions littéraires, par exemple des statistiques de ventes d’ouvrages, des contrats d’édition, des supports de communication oraux ou écrits. Existe-t-il d'ailleurs un traitement différentiel entre écrivain francophone et écrivain français au niveau éditorial? Il serait aussi intéressant de s’interroger sur les différences possibles pour un écrivain francophone publié à Paris et dans son pays en opérant une comparaison de situation d'un pays à l'autre.
Les contributions attendues pourront s’appuyer et de manière non exhaustive sur les domaines suivants:
- pragmatique et sémantique
- stylistique et argumentation/rhétorique
- énonciation et narratologie
On pourra convoquer les notions telles que:
- discours et interdiscours
- texte et intertexte
- frontières linguistiques et discursives
- lexique et modalité
- nomination et dénomination, etc.
Bibliographie indicative:
Abladi, Dris, & Kastberg Sjoblom, Margareta (éd.), Linguistique & littérature: Cluny, 40 ans après, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010.
Adam, Jean-Michel, La linguistique textuelle, 3e ed., Paris, Armand Colin, coll. «Cursus linguistique», 2011.
Adam, Jean-Michel, & Heidmann, Ute, Le texte littéraire. Pour une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2009.
Amossy, Ruth (dir.), Images de soi dans le discours. La construction de l'ethos, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1999.
Amossy, Ruth, & Maingueneau, Dominique, L’analyse du discours dans les études littéraires. Colloque, du 2 au 9 septembre 2002 à Cerisy, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003-2004.
Combe, Dominique, Les littératures francophones. Questions, débats, polémiques, Paris, PUF, 2010.
Delormas, Pascale, Maingueneau, Dominique, & Ostenstat, Inger (dirs.), Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi, Lambert-Lucas, 2013.
Garric, Nathalie, «De la manipulation de données expérimentales à la construction interdiscursive de représentations identitaires», Signes, Discours et Sociétés [en ligne], n°13, Sens et identités en construction: dynamiques des représentations, 2ème volet, 30 juin 2014.
Garric, Nathalie, & Calas, Frédéric, Introduction à la pragmatique, Paris, Hachette supérieur, coll. «HU linguistique», 2007.
Maingueneau, Dominique, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Armand Colin, coll. «U. Lettres», 2004.
Molinari, Chiara, Parcours d'écritures francophones: Poser sa voix dans la langue de l'autre, Paris, l'Harmattan, 2005.
Rinn, Michael (dir.), Émotions et discours. L'usage des passions dans la langue, Rennes, PUR, 2008.
Comité d’organisation:
Françoise Nicol, MCF HDR, et les jeunes chercheurs du CoDiRe, Université de Nantes: Dieudonné Akpo, Aude Brochard, Diala Diab, May Mingle et Diana Romero Sierra et Elena Thuault
Comité scientifique:
Jean-Michel Adam, Université de Lausanne
Ruth Amossy, Université de Tel Aviv
Abdelhadi Bellachhab, Université de Nantes
Frédéric Calas, Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand II
Patrick Chardenet, Université de Franche Comté / Agence universitaire de la Francophonie
Olga Galatanu, Université de Nantes
Nathalie Garric, Université de Nantes
Julien Kilanga, Université d’Angers
Françoise Le Lièvre, UCO, Angers
Françoise Lionnet, Université d'Harvard, USA
Julien Longhi, Université de Cergy-Pontoise
Françoise Nicol, Université de Nantes
Albin Wagner, UCO, Angers
et les jeunes chercheurs du CoDiRe:
Dieudonné Akpo
Aude Brochard
Diala Diab
May Mingle
Diana Romero Sierra
Elena Thuault
Modalités de soumission des propositions:
Les propositions de communication sont ne devront pas dépasser 500 mots et être présentées au format .doc ou .rtf. Elles comporteront le titre ainsi que l’axe dans lequel s’inscrit la proposition, un résumé précisant la problématique soulevée, la méthode et les résultats escomptés, suivi d’une très brève bibliographie. L’auteur précisera par ailleurs son nom, son adresse de messagerie ainsi que son rattachement disciplinaire et universitaire.
La sélection des propositions se fera dans l’anonymat par le comité scientifique. La décision sera notifiée au plus tard le 15 décembre 2015. Les communications retenues pour le colloque feront l’objet d’une nouvelle sélection pour publication.
Les propositions sont à adresser à Agnieszka Suska à l’adresse Agnieszka.Suska@univ-nantes.fr avant le 15 novembre.
Pour toutes précisions complémentaires sur l’organisation du colloque, voir le site du CoDiRe (http://www.codire.univ-nantes.fr/) et le site du colloque (http://jeunes-codire.weebly.com/) [Réduire] |
Du 29 au 30 Octobre 2015 :
 |
7eme édition des rencontres euro-maghrébines des écrivains Alger (Algérie) - Safex Contact : 213 21 923640 |
Du 29 au 30 Octobre 2015 :
| |
Hommage à Abdelwahab Meddeb Tunis (Tunisie) |
Le 04 Février 2016 :
| |
L’Algérie sous la plume d’Assia Djebar. Histoire d’une écrivaine, histoire d’un peuple Cagliari (Italie) - Université de Cagliari |
Du 31 Mars au 01 Avril 2016 :
 |
Word, Image, and Power in Africa and the African Diaspora New Rochelle et Purchase (États-Unis) - New York Conference
Word, Image, and Power in Africa and the African Diaspora
Organized jointly by the College of New Rochelle, New Rochelle, NY and Manhattanville College, Purchase, NY
April 1 & 2, 2016
In his 2003 essay “How to Write about Africa,” Binyavanga Wainaina parodies the representati... [Afficher la suite] Conference
Word, Image, and Power in Africa and the African Diaspora
Organized jointly by the College of New Rochelle, New Rochelle, NY and Manhattanville College, Purchase, NY
April 1 & 2, 2016
In his 2003 essay “How to Write about Africa,” Binyavanga Wainaina parodies the representation of Africa that has pervaded the literary and cinematic production of Westerners reacting to Africa. These words and images are holdovers from a colonial perspective that saw the continent and its people as the embodiment of the “heart of darkness” (Conrad). These views posit the entire continent as forever lagging behind and, in the words of Wainaina, always seem to focus on the following figures: “the Starving African, who wanders the refugee camp nearly naked, and waits for the benevolence of the West. Her children have flies on their eyelids and pot bellies, and her breasts are flat and empty.” Increasingly, these imaginings veil and distort the realities of a continent that is constantly in flux and in the process of numerous changes.
African writers and artists, in their attempt to change this static vision, have set about re-writing Western views of Africa. They deal with issues like political oppression, the student protests in Senegal and Burkina Faso and the Arab spring, to name but a few of the upheavals that the continent has recently experienced. They also define Africa and Africans within the world in terms of Taiye Selasi’s coinage of the term “Afropolitan”, which aims at capturing the experiences of diasporic subjects. Africa, as a continent experiencing steady economic growth and the rise of a middle class, demands new perspectives.
This two-day conference will take place on Friday, April 1st at the College of New Rochelle and Saturday, April 2, 2016 at Manhattanville College. We invite papers on this emerging vision of Africa and re-writing of Western views of Africa and the African diaspora. Abstracts of 250 words should be sent to Professor Nahed Noureddine at nnoureddine@cnr.edu no later than December 1, 2015.
Languages of the Conference: English and French.
Possible Topics
Images of diasporic subjects
Afropolitan vs Cosmopolitan
African art
African cinema
Graphic novels and bandes dessinées
Civil and religious unrest in Africa
Epidemics and their aftermath
The Arab/African Spring
African music
Student Protests
Pan Africanism
Gender and sexuality
The future of African Literature
Women writers in the development of African literature and society
Human Rights
African Francophone Literatures and Cultures
This conference is sponsored by the Departments of English, World Languages and Literatures, Art History, Political Science, and the African Studies and International Studies Programs at Manhattanville College, the Department of Modern and Classical Languages and the International Studies Program at the College of New Rochelle, and the Westchester Consortium for International Studies (WCIS). [Réduire] Contact : nnoureddine@cnr.edu |
Du 05 au 07 Juin 2016 :
| |
Une nouvelle résistance : les revues de poésie de 1970 à nos jours Cergy (France) - Université de Cergy-Pontoise Colloque international
Université de Cergy-Pontoise
Juin 2016
Une nouvelle résistance :
les revues de poésie de 1970 à nos jours Contact : corinne.blanchaud et Pierre-Henri Kleiber |
Le 19 Novembre 2015 :
| |
Journées d'études « Le fantastique dans les écrits de l'espace francophone » London, Ontario (Canada) - Western University Contact : llawsonh@uwo.ca |
Du 22 Mai au 02 Juin 2016 :
 |
Colloque international « Le merveilleux dans les littératures et cultures de l'espace francophone » Calgary (Canada) - Université de Calgary Contact : llawsonh@uwo.ca |
Du 21 au 22 Mars 2016 :
| |
Les représentations sociales et l’agencement collectif d’énonciation: identités, catégorisations, conflits Meknes (Maroc) - Université Moulay Ismail Contact : colloque_meknes2016@yahoo.fr |
Du 19 Aout au 19 Octobre 2015 :
| |
12ème édition du concours national de la meilleure nouvelle Alger (Algérie) - Médiathèque Jeunesse, 38-40 rue Didouche Mourad, Alger. Le concours national de la meilleure nouvelle, organisé pour la 12ème année consécutive, sera ouvert du 20 août au 20 octobre, annonce l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger.
Ce concours placé sous le thème "mémoire et souvenirs" est ouvert à tous sans distinction... [Afficher la suite] Le concours national de la meilleure nouvelle, organisé pour la 12ème année consécutive, sera ouvert du 20 août au 20 octobre, annonce l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger.
Ce concours placé sous le thème "mémoire et souvenirs" est ouvert à tous sans distinction d’âge, de catégorie professionnelle ou de niveau d’études et sera sanctionné par trois prix.
Les candidats intéressés ont le choix de présenter des écrits inédits ne dépassant pas dix pages en arabe (classique et dialectal), en tamazight et en français.
Les nouvelles, en trois exemplaires ,accompagnées d"une fiche de renseignement comportant nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du postulant doivent être adressées à: Médiathèque Jeunesse, 38-40 rue Didouche Mourad, Alger.
Les oeuvres seront soumises à un jury composé d’hommes de lettres et d’écrivains. La remise des prix est fixée au 1er novembre 2015.
Créé en 2003, ce concours a pour objectif de promouvoir l’action culturelle et la création, et à encourager de nouveaux talents. (APS) [Réduire] Contact : Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger |
Le 17 Novembre 2015 :
| |
Mohammed Khaïr-Eddine (1995-2015) : Echos et métamorphoses d’une voix singulière Tunis (TUNISIE) - Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba La Journée d’étude MohammedKhaïr-Eddine (1995-2015) : Echos et métamorphoses d’une voix singulière tente un état des lieux des études et de la production (critique) faites sur l’Œuvre de Mohammed Khaïr-Eddine. Si cette rencontre s’adresse principalement aux spécialistes de l’écr... [Afficher la suite] La Journée d’étude MohammedKhaïr-Eddine (1995-2015) : Echos et métamorphoses d’une voix singulière tente un état des lieux des études et de la production (critique) faites sur l’Œuvre de Mohammed Khaïr-Eddine. Si cette rencontre s’adresse principalement aux spécialistes de l’écrivain marocain, elle demeure ouverte à tous les chercheurs, penseurs, artistes qui (re)trouvent dans les accents de cette écriture authentique des semences pour un renouvellement des lettres, des arts, de la société et de l’homme dans le Maghreb et dans le monde. [Réduire] Contact : Adel Habbassi |
Du 13 au 15 Avril 2016 :
| |
Université Tunis El Manar Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (Ibn Charaf) |
Du 28 au 29 Novembre 2015 :
| |
Littératures francophones, écritures postcoloniales, interculturalité Tizi-Ouzou (Algérie) - Département de français de la Faculté des Lettres et des langues, Université Mouloud MAMMERI |
Du 24 au 26 Février 2016 :
| |
4e Colloque international sur l'enseignement du français langue étrangère (Québec) - Universidad de Puerto Rico Le Département de langues étrangères de l’Université de Porto Rico, en collaboration avec le Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières, organisent, du jeudi 25 février au samedi 27 février 2016, un colloque portant sur les aspects cultu... [Afficher la suite] Le Département de langues étrangères de l’Université de Porto Rico, en collaboration avec le Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières, organisent, du jeudi 25 février au samedi 27 février 2016, un colloque portant sur les aspects culturels, linguistiques et pédagogiques de l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère (FLE).
Le comité organisateur du colloque invite les professeurs, les chercheurs et les étudiants de cycles supérieurs à soumettre des propositions de communication en lien direct avec la didactique du FLE. Il peut s’agir de résultats de recherche, de pistes de réflexion théorique, d’analyses, etc. Ce colloque s’adresse tout particulièrement aux chercheurs en FLE, mais aussi aux didacticiens du français auprès de non-francophones qui souhaitent parfaire leur formation. Chacun recevra à la fin du colloque une attestation de formation continue.
Thèmes du colloque de 2016
« La création et l’utilisation de laboratoires, médiathèques et autres ressources électroniques dans l’enseignement du FLE et des langues étrangères »
Les propositions et sessions thématiques (« panels ») portant sur d’autres thèmes liés à la didactique du FLE seront aussi considérés, notamment :
la compréhension orale et écrite
l’autoformation des apprenants
théorie linguistique et didactique des langues
Votre proposition de communication doit contenir les éléments suivants :
– un titre de 100 caractères maximum (espaces inclus) ;
– un résumé de 1500 à 2000 caractères (espaces inclus) ;
– la liste des auteurs et des coauteurs avec le prénom, le nom, le statut et l’institution ;
– les coordonnées des auteurs (adresse, courriel, téléphone) ;
– le tout doit tenir sur 1 page maximum ;
– à transmettre en Word au plus tard le 30 août 2015 : colloquefle@yahoo.com
Les propositions de communication seront évaluées par un comité scientifique. La langue du colloque est le français.
Comité organisateur :
Universidad de Puerto Rico : Françoise Ghillebaert, Patrick-André Mather
Université du Québec à Trois-Rivières : Linda de Serres [Réduire] |
Du 05 au 06 Avril 2016 :
| |
Centralité de la marge et du marginalisé dans la langue, la littérature et la civilisation Université de Carthage, Institut Supérieure des Langues à Nabeul |
Du 22 au 23 Novembre 2015 :
| |
Hybridité dans le discours fictionnel : approches diverses Zaghouan (Tunisie) - Institut des études appliquées en humanités de Zaghouan Argumentaire
La journée scientifique qui s’est tenue le 02 Mai 2015 à l’Institut des Etudes Appliquées en Humanités de Tozeur sous le titre « Le chevauchement des genres dans l’œuvre littéraire » ( URL : http://www.fabula.org/actualites/le-chevauchement-des-genres-dans-l-oeuvre-litt... [Afficher la suite] Argumentaire
La journée scientifique qui s’est tenue le 02 Mai 2015 à l’Institut des Etudes Appliquées en Humanités de Tozeur sous le titre « Le chevauchement des genres dans l’œuvre littéraire » ( URL : http://www.fabula.org/actualites/le-chevauchement-des-genres-dans-l-oeuvre-litteraire-journee-scientifique-l-institut-des-etudes_67333.php ) était le fruit d’une collaboration entre les enseignants des départements de Français de l’ISEAH de Tozeur et ceux de l’ISEAH de Zaghouan. Suite à cet événement, le département de Français de l’ISEAH de Zaghouan a décidé d’organiser un second événement dédié à l’approfondissement de l’étude de la question et à l’élargissement de sa portée mais aussi pour y apporter une lecture nouvelle.
En effet, les études exposées pendant cette première journée ont montré que le propre des écrivains était de mettre en éclats le carcan des règles régissant les frontières entre les genres littéraires. Ces écrivains, venant d’horizons différents et appartenant à différentes époques, prouvent que l’écriture ne saurait se soumettre aux frontières admises généralement. Ils créent et recréent conférant à la pratique scripturale une dimension hybride certaine.
L’intérêt de la deuxième journée d’étude tentera donc de revenir sur la perspective de la multiplicité des lectures, des interprétations et évidemment des écritures, à partir de la notion de l’hybride : L’hétérogénéité et la dimension inclassable de certains textes, ce qui nous pousse à réfléchir sur les mécanismes qui aboutissent à ces créations (si mécanismes il y a). Ce qui est intéressant aussi dans cette notion, c’est la multiplicité des textes qu’elle regroupe (littéraire, scientifique, politique, journalistique, etc.)
Nous voulons étudier cette notion à la lumière de différentes lectures, tout en organisant nos travaux le long de deux axes principaux : L’hybridité des genres et l’hybridité du scripteur. Ce choix est motivé par le fait de vouloir englober la totalité de l’acte de l’écriture tout en laissant le champ des interprétations ouvert pour cette journée d’étude. Allant des œuvres véritablement inclassables, ne relevant d’aucun mode d’écriture identifiable ; les œuvres relevant de genres non reconnus ou sous-estimés, aux genres littéraires qui s’appliquent non à la totalité d’une œuvre mais à un corpus textuel restreint de l’œuvre, en passant par les œuvres fondatrices de genres littéraires et celles qui s’inscrivent en faux dans un genre.
Les communications pourront s’orienter vers un de ces axes d’étude :
Comment peut-on analyser la polyphonie de l’énonciation entre les différentes voix, notamment quand il s’agit de la question de «qui parle ?» Outre les modalités de transcription du discours du locuteur et ses effets sémantiques et pragmatiques qui peuvent être abordés dans cet axe des questions autour de l’identité du Locuteur, la relation entre auteur/ scripteur et narrateur, et plus généralement les illusions de l’objectivité littérale pourra aussi être traitée. Dans cet axe, on peut aborder la question de la création et de la recréation de nouvelles catégories et de nouvelles formes ainsi que la manière qui permet de quitter le carcan établi des genres pour en créer de nouveaux.
Une réflexion sur la construction des instances auctoriales serait aussi intéressante : L’écrit de fiction qui révèle la personnalité de l’auteur, les écritures schizophrènes ainsi que la dimension cathartique voire thérapeutique de l’écriture sur l’auteur.
On peut aussi s’interroger sur le fonctionnement des éléments participant à la formation de l’objet littéraire, au niveau textuel et générique ; sur la question du dialogisme, le métissage et les nouveaux « polytopos » que les nouvelles cultures créent.
Quelques références bibliographiques :
Adam, Jean Michel, Les textes : types et prototypes, Paris: Nathan, « FAC », 1992.
Adam, Jean Michel, Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général pour une approche de la presse écrite », 1997.
Authier-Revuz Jacqueline, Ces mots qui ne vont pas de soi, Boucles réflexives et non-coïncidences du dire, (t.1 et2) Paris : Larousse. 1995.
Aristote. La Poétique, trad. Dupont-Roc et Lallot. Paris: Seuil, 1980.
Baby, Hélène (dir.), Fiction narrative et hybridation générique dans la littérature française, Harmattan, 2006.
Bakhtine, Mickhaïl, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978.
Bakhtine, Mickhaïl, Esthétique de la création verbale, Gallimard, 1984.
Benveniste Emile, Problèmes de linguistique générale, Tome 1, Paris : Gallimard, 1996.
Bessière, Jean (dir.) Hybrides romanesques : fictions, PUF, 1988.
Blanchot, Maurice, Le Livre à venir, Gallimard, 1959.
Boyer, Henri, Hybrides linguistiques, L'harmattan, 2010.
Budor Dominique et Geerts Walter, Le texte hybride, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2004.
Collomb, Michel, Figures de l'hétérogène, Publications de l'Université Paul Valéry, 1988.
Compagnon, Antoine. La Notion de genre.
Compagnon, Antoine. Le Démon de la théorie, Seuil, 1998.
Croce, Benedetto, Essais d'esthétique, trad. fr., Gallimard, « Tel »
Dambre Marc et Gosselin-Noat Monique, L'éclatement des genres, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2001.
Dialogisme et polyphonie, Acte de colloque de CERISY, J.Bres, P.P Haillet, S.Mellet, H.Nolké, L.Rossier. 2005.
Dupont, Florence (1994). L'Invention de la littérature. Paris: la Découverte.
Demerson, Guy. La Notion de genre à la Renaissance, Genève, Slatkine, 1984.
Fowler, Alastair. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Oxford, Oxford UP, 1982.
Frye, Northrop. Anatomie de la critique (1957), trad. fr., Gallimard, 1969.
Genette, Gérard (1979). Introduction à l'architexte. Paris: Seuil.
Genette, Gérard (1991). Fiction et diction. Paris: Seuil.
Hamburger, Käte (1977). Logique des genres littéraires. Paris: Seuil, 1986.
Hegel. Esthétique, trad.fr., Flammarion, « Champs », t. IV.
Hernadi, Paul. Beyond Genre, Ithaca, NY, Cornell UP, 1972.
Hybrides et hybridités, Université Charles-de-Gaulle, 1996 (Uranie, 6)
Jauss, Hans Robert. Pour une esthétique de la réception (1978), trad. fr., Gallimard,« Tel ».
Jolles, André, Formes simples (1930), trad fr., Seuil, 1972.
Julia Catherine, Fixer le sens ?la sémantique spontanée des gloses de spécification du sens, Paris : Presse de la Sorbonne Nouvelle, 2001.
Kerbrat-Orrechionni Catherine, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris : Colin, 1980.
Kibédi Varga, Aron, Rhétorique et littérature : Étude des structures classiques, Didier, 1970.
Lukacs, Georg, La Théorie du roman (1920), trad. fr., Gonthier, 1971.
Parler les mots, Le fait autonymique en discours, ouvrage collectif, J.Authier –Revuz, M.Doury, S.Reboul,-Touré (éds), Paris : Presse de la Sorbonne Nouvelle. 2003.
Platon. La République, trad. Pierre Pachet. Paris: Folio/Essais, 1993.
Schaeffer, Jean-Marie, Qu'est-ce qu'un genre littéraire?, Paris: Seuil. 1989.
Schaeffer, Jean-Marie, Théorie des genres, ouvrage collectif. Paris: Seuil, Points. 1986.
Strelka, Joseph. éd., Theories of Literary Genre, University Park, Pennsylvania State UP, 1978.
Szondi, Peter. Poésie et poétique de l'idéalisme allemand (1974), trad. fr., Gallimard, « Tel ».
Szondi, Peter. Théorie des genres , Seuil, « Points »,1986.
Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique (1970), Seuil, « Points ».
Todorov, Tzvetan. « L'Origine des genres », Les Genres du discours, Seuil, 1978
Todorov, Tzvetan. La Notion de littérature, Seuil, « Points ».
Wellek, R., et Warren, A. La Théorie littéraire (1949), trad. fr., Seuil, 1971.
Dictionnaire des genres et notions littéraires, Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, 1997.
Comité Scientifique : (Ordre alphabétique des noms)
Arselène BEN FARHAT
Charles BONN
Sylvie CAMET
Sonia FITOURI-ZLITNI
Laurent JENNY
Francis LACOSTE
Amel MZALI-SEBAÏ
Rémy POIGNAULT
Alain SEBBAH
Mustapha TRABELSI
Patrick VOISIN
Comité d’organisation :
Kawthar Ayed
Lina Babba El Mekki
Myriam El Fekih Jmour
Mohamed Anis Abrougui
Modalités pratiques :
Date limite de soumission des propositions de communication : 1er Septembre 2015
Les propositions sont à envoyer sous la forme d’un résumé sous format Word accompagné d’un titre, et, dans un document à part, d’une notice personnelle (nom et prénom, affiliation, coordonnées professionnelles), à l’adresse suivante : iseahz@yahoo.fr
Responsable : ISEAH Zaghouan
url de référencehttp://www.iseahz.rnu.tn/
adresseISEAH Zaghouan [Réduire] Contact : iseahz@yahoo.fr |
Du 17 au 18 Mars 2016 :
| |
« Parabole(s) », XIIe Colloque International d’Études Francophones, Timisoara (Roumanie), CIEFT, les 18-19 mars 2016 Timisoara (Roumanie) - Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, l’Université de l’Ouest de Timisoara Contact : Le Comité d'Organisation |
Du 12 au 13 Novembre 2015 :
| |
Tozeur (Tunisie) - Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Tozeur Contact : Hassan Bkhairia |
Du 24 au 26 Février 2016 :
| |
Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax Contact : Raoudha Allouch |
Du 10 au 12 Février 2016 :
| |
Art, littérature et démocratie Tunis (Tunisie) - Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis Contact : Wafa Ghorbel |
Du 27 au 29 Avril 2016 :
| |
Pour une géocritique du texte et du cinéma francophones - Université McGill, 28, 29, 30 avril 2016 Montréal (Canada) - Université McGill Appel à communication – Colloque international
Pour une géocritique du texte et du cinéma francophones
Université McGill, 28, 29, 30 avril 2016 Contact : mbaye.diouf@mcgill.ca francoise.naudillon@concordia.ca |
Du 16 au 18 Novembre 2015 :
| |
Colloque international Enseignement / apprentissage de la littérature et les études littéraires contemporaines: onomastique, base de données et comparatisme littéraires (Algérie) APPEL A COMMUNICATIONS
RASYD, Unité de recherche « Les Systèmes de dénomination en Algérie » et ELILAF, Laboratoire
« Environnement linguistique et usages du français en Algérie » organisent
Colloque international
Enseignement / apprentissage de la littérature et les études li... [Afficher la suite] APPEL A COMMUNICATIONS
RASYD, Unité de recherche « Les Systèmes de dénomination en Algérie » et ELILAF, Laboratoire
« Environnement linguistique et usages du français en Algérie » organisent
Colloque international
Enseignement / apprentissage de la littérature et les études littéraires contemporaines: onomastique, base de données et comparatisme littéraires
Du 17 au 19 Novembre 2015, Algérie
Depuis quelques années, une réflexion est amorcée sur la problématique de l’enseignement / apprentissage de la littérature à l’école et l’université, notamment dans une perspective d’articulation entre les cycles de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. En effet, la recherche en littérature a souffert d’une double mise à l’écart par les promoteurs d’une réforme scolaire et universitaire (particulièrement dans le système LMD). Les enseignants de littérature se plaignent d’un déficit de représentation du champ d’études littéraires dans les départements de langues, où elles sont considérées comme « inutiles », du moins difficiles à assimiler. Cette image dépréciative aboutit à sous - estimer l’impact des études littéraires contemporaines dans l’enseignement/apprentissage des langues. Or, la littérature est incontournable pour acquérir les compétences disciplinaires en rapport avec certains métiers et spécialités : médias, édition, culture, communication etc.
L’objectif de ce colloque est de créer une dynamique pluridisciplinaire entre les acteurs du système éducatif, les universitaires, les sociologues de l’éducation, les concepteurs des manuels, les critiques littéraires contemporaines, etc., à l’effet de traiter les thématiques suivantes :
1- Les études littéraires contemporaines
Les nouvelles configurations pédagogiques en milieu scolaire et universitaire peuvent se réaliser à travers les quelques pistes suivantes :
Ouverture sur de nouvelles approches, de type onomastique littéraire : l’étude des noms propres offre des outils d’analyse pertinents pour une exploitation pédagogique du texte littéraire. Dans ses deux volets anthroponymique (Cheriguen, 2007 ; Yermeche, 2005) et toponymique (Atoui, 2005), l’onomastique pourrait être une entrée méthodologique appropriée pour interroger le fonctionnement interne du texte ainsi que ses soubassements socio culturels et anthropologiques (Leroy, 2004).
Comparatisme et transversalité littéraires : une approche comparatiste des littératures nationales et celles des aires culturelles, linguistiques étrangères (Moura, 1998) permettra d’examiner des domaines littéraires contemporains, voire de l’extrême contemporain (Schoentjes, 2014). Il est important de s’interroger sur les productions émergentes (Laronde, 1996), diasporique ou minoritaire, sur les « mauvais genres » (roman policier, sentimental, BD, etc.), la traduction littéraire et leur place dans ces nouveaux dispositifs.
Les ateliers de créativité : La lecture méthodique a mis en place une technicité qui a fondé sa légitimité dans le cadre de l’enseignement/apprentissage du texte littéraire. Elle s’inscrit dans les modalités d’insertion didactique des lectures scolaire et universitaire au sein des ateliers de créativité (jeu onomastique, réécriture des textes, scénarisation, etc.).
L’ouverture incontournable aux dynamiques plurilingues : elle fait écho aux impératifs des standards universitaires internationaux, induits par la mondialisation, dans ses dimensions culturelles et interculturelles les plus productives (Puren, 2010).
Les langues des nouvelles technologies (cyberlangue) et multimédia : après les instructives conclusions du colloque sur la cyberlougha au Maghreb, il est nécessaire de nous interroger sur les nouvelles études qui examinent l’impact des technologies d’information et de télécommunication sur l’émergence de nouvelles scénographies fictionnelles et narratives.
L’utilisation des bases de données : les bases de données sont de nouvelles configurations scientifiques en mesure d’asseoir une exploitation pédagogique optimale en matière littéraire. Les sites de documentation à l’instar de Limag (Bonn, 2009) ou des centres de recherches et des archives, comme celui de Archives et Musée de la littérature en Belgique (Quaghebeur, 2009), le Centre de Littératures française et francophones contemporaines à Paris (Moura & Viart), en sont des exemples remarquables.
2- Littératie et enseignement/ apprentissage du texte littéraire
L’enseignement de la lecture prendrait en ligne de compte les implications cognitives et les effets sociaux de la lecture et de l’écriture. La réflexion de la littératie (Goody, 2006) ne peut être pertinente que si elle fait l’objet de contextualisation pour rendre compte des pratiques de la lecture et l’écriture en milieu scolaire et universitaire. Les différentes interactions de la littératie, induites en contexte plurilingue, par le biais des transferts langagiers et linguistiques, langues maternelles/Langues étrangères, dans le dispositif enseignement/apprentissage de la lecture du texte littéraire, sont à saisir dans une vision valorisante du plurilinguisme (Benramdane, 2013).
3- Quel rôle joue l’enseignement/apprentissage de la littérature et/ ou de la lecture à l’école et l’université ?
Actuellement, la réflexion porte sur la distinction entre enseignement de la lecture et enseignement de la littérature (Todorov, 2004). L’histoire littéraire n’étant plus au centre de l’analyse, elle participe à la construction du sens. Les deux enseignements mettraient en œuvre les fonctions traditionnelles de l’école et de l’université : mission critique, détermination éthique et scientifique, orientation prospective, aptitudes d’anticipation et recherche de l’excellence. Donc, il s’agit de la remise en cause d’une attitude à dominante traditionnaliste ou instrumentaliste qui ne prend pas en compte les conditions de production et de réception. La conception moderne de la littérature est historiquement liée à la notion de nationalisme, consolidant l’affirmation et la légitimité de l’identité linguistique nationale. Toutefois, la littérature est un phénomène esthétique, socio-symbolique et historique. Certains la considèrent comme un patrimoine universel d’œuvres d’écrivains célèbres et consacrés. Il est évident que les mutations mondiales ont bouleversé les univers linguistiques et les imaginaires culturels nationaux dans tous les pays. A cet égard, l’enseignement de la littérature scolaire et du texte littéraire à l’université s’inscrit dans une forme de projet pédagogique en fonction du changement de son public d’une période à l’autre.
Dans le cadre de ce colloque, c’est la dimension empirique qui est prioritairement recherchée par la mise en exergue des résultats de recherche sur des pratiques pédagogiques innovantes, insistant sur des propositions de dispositifs didactiques, renforcées par des assises théoriques appropriées et argumentées. Il est indispensable d’interroger les nouvelles recherches littéraires françaises et francophones contemporaines à partir des approches comparatistes nouvelles et de corpus différents.
Bibliographie
ATOUI (Brahim), 2005, « L’odonymie d’Alger: passé et présent », In Nomination et dénomination. Des noms de lieux, de tribus et de personnes en Algérie. Ouvrage collectif coordonné par Farid Benramdane et Brahim Atoui. Editions CRASC. BENRAMDANE (Farid), 2013, « Littératie, rénovation des curricula des langues et transfert langue française / langues maternelles et secondes. Le cas du système éducatif algérien », actes du colloque Lille 16/17 Mai 2013.
BESSE (Henri), 1989, “Quelques réflexions sur le texte littéraire et ses pratiques dans l’enseignement du français langue seconde ou langue étrangère”, In Trèfle, 9, pp. 1-12.
BONN (Charles), « Le programme LIMAG (Littératures du Maghreb) », In Littératures Au Sud, AUF, 2009.
QUAGHEBEUR (Marc), « Des Archives pour le futur », In Littératures Au Sud, AUF, 2009.
GOODY (Jack), 2006, « La littéracie, un chantier toujours ouvert », In Pratiques. N°131/132, Décembre 2006. Traduit par Kathie Birat.
LEGROS (Denis), all, 2009, « TICE et Cognition de la Littératie plurilingue. Vers un modèle intégrateur », in Synergies Algérie n° 6.
LARONDE (Michel), 1996, L’Ecriture Décentrée, la langue de l’autre dans le roman contemporain, Paris, Harmattan 1996. LEROY (Sarah), 2004, Le nom propre, Paris, OPHRYS.
MOURA (Jean-Marc), 1998, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF.
TODOROV (Tzevetan), 2007, La littérature en péril, Flammarion.
SOUCHON (Albert), 2000. Les textes littéraires en classe de langue. Hachette.
Calendrier du colloque
Lancement de l’appel à communication : 1 Février 2015
Sélection des propositions des communications : Juin 2015
Information des candidatures retenues/ Envoi des invitations : Août-Septembre 2015
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 Mai 2015
Les propositions de communication ne devant pas dépasser un résumé de 500 mots maximum, avec une bibliographie succincte et la fiche de présentation indiquant : nom et prénom, établissement de rattachement, grade et adresse mail. Adresses de réception des propositions à Lila Medjahed : lmedjahed1@gmail.com et farid.17@hotmail.com ou litteraturecolloque2015@gmail.com.
Comité scientifique
Brahim Atoui, RASYD, CRASC
Farid Benramdane, RASYD & ELILAF
Ouerdia Yermeche, RASYD, CRASC
Charles Bonn, LIMAG, France
Tourya Fili-Tullon, Passage XX-XXI, Université Lyon II, France
Marc Quaghebeur, Archive et Musée de la
Littérature, Belgique
Jean-Paul Meyer, Univ. Strasbourg, France,
Jean-Marc Moura, Univ. Paris Nanterre, France,
Michel Laronde, Univ. Iowa, USA,
Bernadette Mimoso-Ruiz, Univ. Toulouse, France
Pierre Schoentjes, Univ. Gand, Belgique
Katrien Lievois, Univ. Anvers, Belgique
Violaine Houdart-Merot, Univ. Cergy- Pontoise,
France,
Cristina Robalo Cordeiro, AUF Maghreb,
Sabine Loucif, Univ. Hofstra, New York, USA
Sonia Zlitni Fitouri, Univ. Manouba, Tunisie,
Mabrour Abdelouehed, LERIC, El Djadida, Maroc,
Comité d’organisation : Slimane Lemnaoui, Univ. Fès, Maroc
Alain Sissao, CNRTS, Univ. Ouagadougou,
Burkina Faso
Pierre Dumont, Univ. Martinique
Patrick Chardenet, AUF
Wafa Berri, Faculté SH, Liban
Moussa Daff, Univ. Dakar, Sénégal
Faouzia Bendjlid, LADICIL & UCCLLA, Oran,
Fatima Medjad, LADICIL, Oran,
Mohamed Daoud, UCCLLA, CRASC
Latifa Kadi, LIPED, Univ. Annaba,
Karima Ait Dahmene, Univ. Alger 2,
Mohamed Miliani, Univ. Oran,
Yamilé Ghebalou, Univ. Alger 3,
Boumedienne Benmousset, Univ. Tlmecen
Taklit Mebarek, RASYD, CRASC
Mohand Haddadou, RASYD, CRASC
Cherif Sini, RASYD, CRASC
Les membres du laboratoire ELILAF et de l’unité de recherche RASYD : Farid BENRAMDANE, Lila MEDJAHED, Nazéha BENBACHIR, Abdelkader SAYAD, Lynda-Nawel TEBBANI, Nezhet BENZIDANE, Malika ABDELAZIZ, Khadidja BENAMMAR, Mohand Akli SALHI, Khadidja BENKASDALI, Mimouna NOUAR, Aouatef SAHNOUN, Leila MOUSSADEK, Farid HADJARI, Saliha BENAISSA, Chahrazed HAOUCHINE, Leila BELKAIM, Azzedine MALEK, Abdelhamid KRIDECH. [Réduire] Contact : Lila Medjahed ; lmedjahed1@gmail.com et farid.17@hotmail.com ou litteraturecolloque2015@gmail.com. |
Le 05 Juin 2015 :
 |
PSYCHANALYSE ET CRÉATIVITÉ Alger (Algérie) - Institut Français d'Alger Des psychanalystes venus de France vont évoquer leur passion, celle de déchiffrer l’inconscient et parler de « l’insistance de l’écriture de l’inconscient », comme l’écrit
Lacan. Cette écriture, c’est la part de créativité qui nous anime et qui puise sa source dans l’enfance ... [Afficher la suite] Des psychanalystes venus de France vont évoquer leur passion, celle de déchiffrer l’inconscient et parler de « l’insistance de l’écriture de l’inconscient », comme l’écrit
Lacan. Cette écriture, c’est la part de créativité qui nous anime et qui puise sa source dans l’enfance et l’adolescence. Elle peut donner à l’individu le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue comme le souligne Winnicott.
C’est à ces échanges, que la conférence « Psychanalyse et créativité» organisée en partenariat avec l’association « Bruits des mots », vous invite.
Avec Annie Topalov, Rachel Frouard, Claude Guy, psychanalystes. Modérateur : Gilbert Grandguillaune, anthropologue
(Note de l'IFA) [Réduire] |
Le 09 Juin 2015 :
| |
Journée d’études 2 : Mondes arabes et comparatisme : pratiques pédagogiques Nanterre (France) - Université Paris-10 |
Du 03 au 04 Juin 2015 :
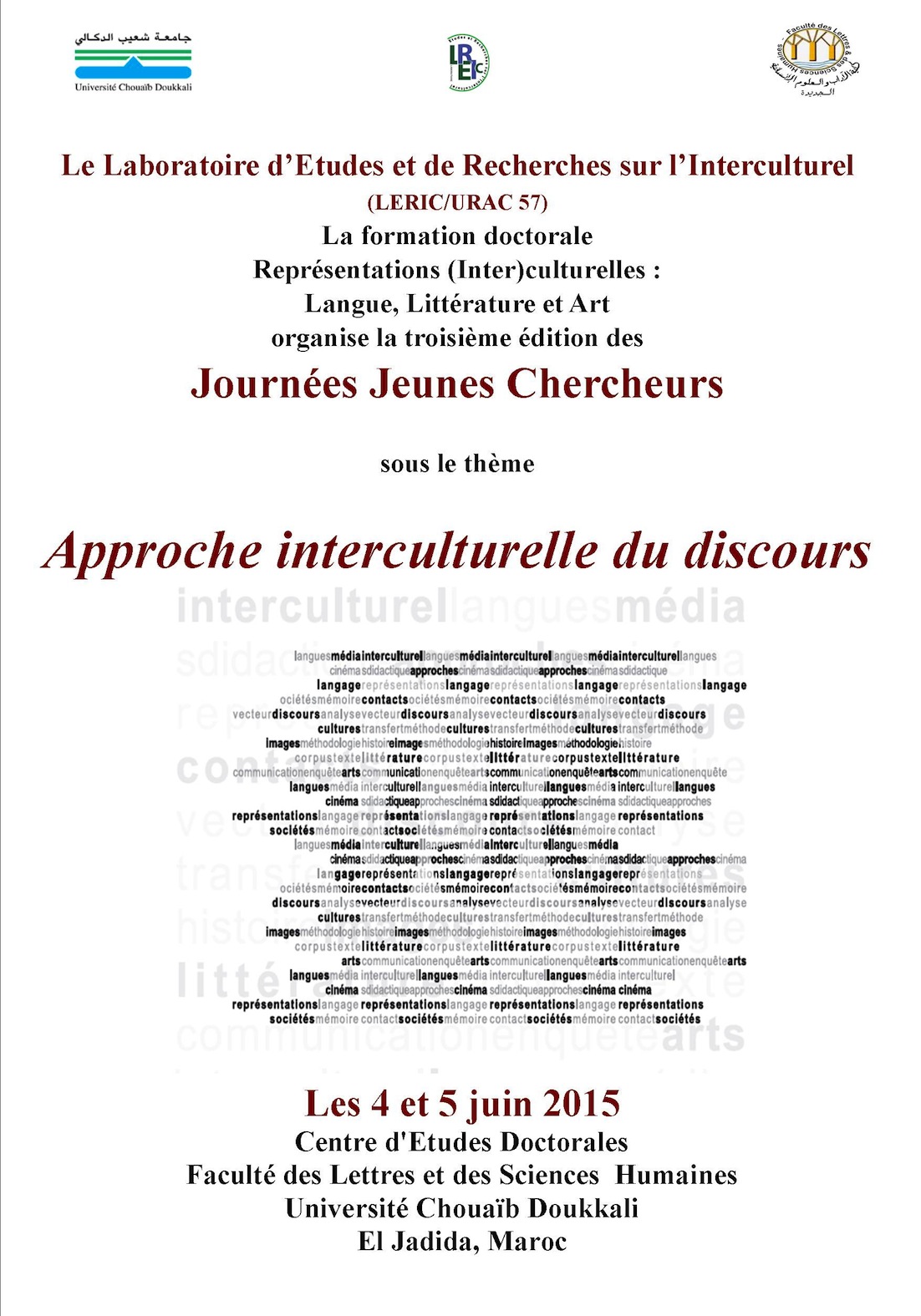 |
Journées Jeunes chercheurs EL JADIDA (MAROC) - Université Chouaib Doukkali - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - LERIC (URAC 57) |
Le 19 Mai 2015 :
| |
« L’école dans la littérature, la littérature à l’école : lectures autour du système scolaire en Algérie » Oran (Algérie) - CEMA, Cité du Chercheur (ex-IAP), Université d’Es-sénia, Oran Conférence d' Erin Twohig, Département de français, Georgetown University:
« L’école dans la littérature, la littérature à l’école : lectures autour du système scolaire en Algérie", à 10h00, mercredi 20 mai 2015
CEMA, Cité du Chercheur (ex-IAP), Université d’Es-sénia, Ora... [Afficher la suite] Conférence d' Erin Twohig, Département de français, Georgetown University:
« L’école dans la littérature, la littérature à l’école : lectures autour du système scolaire en Algérie", à 10h00, mercredi 20 mai 2015
CEMA, Cité du Chercheur (ex-IAP), Université d’Es-sénia, Oran [Réduire] |
Le 12 Juin 2015 :
| |
L'oeuvre d'Assia Djebar dans la langue de l'autre Paris (France) - Centre Culturel Algérien; 171 Rue de la Croix Nivert, 75015 Paris PROGRAMME
MATINÉE :
Houyame Aydi (modératrice)
11h Ouverture de la journée d’étude par Ibrahim Haci, Directeur du Centre culturel algérien et Amel Chaouati, Présidente du Cercle des Amis d’Assia Djebar
Lecture : Jalila Imalhayene-Djennane
11h30 Mourad Yallès (Professeur, INA... [Afficher la suite] PROGRAMME
MATINÉE :
Houyame Aydi (modératrice)
11h Ouverture de la journée d’étude par Ibrahim Haci, Directeur du Centre culturel algérien et Amel Chaouati, Présidente du Cercle des Amis d’Assia Djebar
Lecture : Jalila Imalhayene-Djennane
11h30 Mourad Yallès (Professeur, INALCO, Paris) : Les mots, la fantasia : le Texte maghrébin à l’épreuve de la traduction
Lecture : Patrick Potot (comédien)
11h55 Mounira Chatti (Maître de conférences HDR, Université de la Nouvelle-Calédonie) : Enjeux poétiques et culturels de la traduction arabe de Nulle part dans la maison de mon père (Bawabet el dhikrayet)
Lecture : Mounira Chatti/ Nadia Agsous (écrivain, journaliste)
12h25 Débat
APRÈS-MIDI :
Mounira Chatti (modératrice)
14h Kiyoko Ishikawa (Professeur, Université de Tokyo, Japon) : Ma rencontre avec l’œuvre d’Assia Djebar et la traduction en japonais
Lecture : Kiyoko Ishikawa/ Patrick Potot
14h30 Clarisse Zimra (Professeur, Southern Illinois University) : En couleurs et en technicolor: deux projets de traduction américaine d'Assia Djebar : Femmes d’Alger dans leur appartement et Les Enfants du nouveau monde
Lecture : Clarisse Zimra/Nadia Agsous
15h Seza Yilancioglu (Professeur, Université d’Istanbul): Assia Djebar en langue turque : traduction et réception
Lecture : Seza Yilanoioglu/Patrick Potot
15h30 Débat
16h15 Luisa Etxenike (Professeur, Université du pays Basque) : Assia Djebar en espagnol : pensée métisse, voix en échos
Lecture : Luisa Etxenike/ Nadia Agsous
16h45 Nassima Bougherara (Maître de conférences, Université de Grenoble) : Assia Djebar en pays de langue allemande
Lecture : Nassima Bougherara/ Patrick Potot
17h15 Amel Chaouati (Ecrivain) : Assia Djebar scripteuse des voix féminines multilingues
Lecture : Nadia Agsous
17h40 Débat
PROJECTION ET TABLE RONDE
Amel Chaouati (modératrice)
18h30 Projection du film : La Zerda ou le chant de l’oubli (52 mn)
19h30 Table ronde avec Karima Berger (Écrivain) et Ahmed Bedjaoui (Professeur, Université d’Alger) [Réduire] Contact : Amel CHAOUATI (Présidente du Cercle des Amis d’Assia Djebar) et Mounira CHATTI (Université de la Nouvelle-Calédonie) |
Du 12 au 13 Novembre 2015 :
| |
Voix et voies de l’interculturel : Carrefour entre littérature, traduction, didactique et arts. Oujda (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Contact : interculturelcolloque@gmail.com |
Du 13 au 15 Janvier 2016 :
 |
3ème rencontre des Jeunes Chercheur.e.s en Etudes Africaines (JCEA) Paris (France) Cher.e.s collègues,
La troisième rencontre des Jeunes Chercheur.e.s en Etudes Africaines (JCEA) aura lieu à Paris les 14, 15 et 16 janvier 2016.
Comme lors des éditions précédentes, il s'agira de permettre aux doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s et post-doctorant.e.s de dialoguer et présent... [Afficher la suite] Cher.e.s collègues,
La troisième rencontre des Jeunes Chercheur.e.s en Etudes Africaines (JCEA) aura lieu à Paris les 14, 15 et 16 janvier 2016.
Comme lors des éditions précédentes, il s'agira de permettre aux doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s et post-doctorant.e.s de dialoguer et présenter leurs travaux portant sur les Afriques sans exclusive, Caraïbes et Afrique du Nord comprises, au croisement de toutes les disciplines.
Vous trouverez de plus amples informations à partir du lien suivant, et dans l'appel à communication en pièce jointe :
http://jcea2016.sciencesconf.org/
Les propositions de communication, en français ou en anglais (maximum 500 mots), peuvent être déposées sur la plateforme ci-dessus avant le 15 juillet 2015.
Est également lancé un appel à documentaires, dont les propositions de films ou d'extraits (maximum 26 mn), accompagnées d'une présentation d'environ 500 mots, pourront aussi être déposées sur le site des JCEA 2016 avant le 15 juillet 2015.
Merci de diffuser cet appel dans de vos réseaux, et veuillez nous excuser pour les éventuels doublons.
Très cordialement,
Le comité d'organisation des JCEA 2016
Zone contenant les pièces jointes
Prévisualiser la pièce jointe Appel à communication 3ème rencontre des Jeunes Chercheurs en Etudes Africaines 2016.pdf
PDF
Appel à communication 3ème rencontre des Jeunes Chercheurs en Etudes Africaines 2016.pdf [Réduire] |
Le 01 Mai 2015 :
| |
Rencontre avec Amin Zaoui et vente-dédicaces de ses romans Oran (Algérie) - Librairie "Livres, Art et Culture, centre-ville Bonjour a toutes et a tous,
Notre Librairie, Livres, Art et Culture à l'honneur de recevoir l'auteur Amin Zaoui ce Samedi 02/05/2015 à partir de 15 Heures pour une Vente dédicaces ainsi qu'une présentation de ses ouvrages dont le dernier roman intitulé
"Le miel de la sieste".
... [Afficher la suite] Bonjour a toutes et a tous,
Notre Librairie, Livres, Art et Culture à l'honneur de recevoir l'auteur Amin Zaoui ce Samedi 02/05/2015 à partir de 15 Heures pour une Vente dédicaces ainsi qu'une présentation de ses ouvrages dont le dernier roman intitulé
"Le miel de la sieste".
Bonne journée.
Livres, Art et Culture. [Réduire] |
Le 02 Mai 2015 :
| |
Rencontre avec Amin Zaoui Oran (Algérie) - Département de Français, Faculté des Langues Etrnagères Chers collègues,
Vous êtes cordialement invités à assister à la rencontre avec l’écrivain Amin Zaoui qui sera l’invité du Département de Français, le dimanche 3 mai 2015, à 10h00 au CRM.
L’écrivain viendra présenter ses livres, il parlera de son parcours, de son œuvre e... [Afficher la suite] Chers collègues,
Vous êtes cordialement invités à assister à la rencontre avec l’écrivain Amin Zaoui qui sera l’invité du Département de Français, le dimanche 3 mai 2015, à 10h00 au CRM.
L’écrivain viendra présenter ses livres, il parlera de son parcours, de son œuvre et de la littérature en général et algérienne e particulier.
Cordialement,
Mlle BELKACEM Dalila
PS : Merci d’informer vos étudiants du rendez-vous. [Réduire] |
Du 29 Avril 2014 au 29 Avril 2015 :
 |
Rencontre avecSaïd Oussad Oran (Algérie) - Département de Français, Faculté des Langues Etrangères Rencontre littéraire sur les nouvelles écritures avec l'écrivain et journaliste Saïd Oussad, auteur du roman "Les chemins inutiles" (2014); à 10h |
Du 23 au 25 Septembre 2015 :
| |
Colloque du centenaire Edmond Charlot (1915-2004) Montpellier - Pézenas (France) - Médiathèque Emile Zola et université Montpellier 3 - Théâtre municipal Pézenas ondateur d’une librairie à l’enseigne des Vraies Richesses, Edmond Charlot est d’abord connu pour avoir été, à Alger et dès 1936 l’éditeur, parfois le « découvreur », de nombreux écrivains locaux, d’Albert Camus à Emmanuel Roblès et Taos Amrouche, déplacés (Gide, Soupault,…... [Afficher la suite] ondateur d’une librairie à l’enseigne des Vraies Richesses, Edmond Charlot est d’abord connu pour avoir été, à Alger et dès 1936 l’éditeur, parfois le « découvreur », de nombreux écrivains locaux, d’Albert Camus à Emmanuel Roblès et Taos Amrouche, déplacés (Gide, Soupault,…) ou vivant loin du Maghreb (E. Bove, A. Cossery...). Son catalogue, riche de près de 300 titres et d’une dizaine de collections, témoigne à la fois de son attachement constant à la Méditerranée, d’un engagement aux côtés de la France Libre, puis des Libéraux d’Algérie, mais aussi des difficultés à faire dialoguer, en contexte colonial, les jeunes écrivains et artistes d’Algérie et l’intelligentsia française.
Jusqu’à la fin de la guerre, en dépit des difficultés, Edmond Charlot a également animé des galeries de peinture qui révélèrent les artistes les plus novatrices de la peinture algérienne et les encouragèrent à persévérer. Par ses activités à la radio, où s’exprimèrent aussi nombre de ses auteurs, il a contribué à sortir Alger de la léthargie culturelle dans laquelle les Algérianistes maintenaient la Colonie.
Mais Edmond Charlot fut aussi, après la destruction de sa librairie par l’OAS, un acteur important de la coopération entre la France et l’Algérie, puis en Turquie et au Maroc, et jusqu’en France : à Pèzenas, où il avait établi sa retraite, il avait créé l’association Méditerranée Vivante et renoué des liens entre les deux rives.
Charlot libraire, éditeur de la France libre, découvreur de nouveaux talents ; Charlot galeriste et Charlot homme de radio ; Charlot animateur et passeur de cultures, voilà les différentes facettes que souhaite mettre en évidence le colloque du centenaire, co-organisé à Montpellier et à Pézenas par le réseau des médiathèques de la métropole montpelliéraine, l’association Méditerranée Vivante et l’Université Paul Valéry-Montpellier 3. [Réduire] Contact : Guy Dugas |
Du 19 au 20 Avril 2015 :
 |
La littérature maghrébine de langue française au tournant du 21ème siècle : Formes et expressions littéraires dans un monde en mutation Alger (Algérie) - Bibliothéque Nationale El Hamma Contact : Radia Benslimane |
Du 26 au 27 Avril 2015 :
| |
L’écriture comme dissimulation ou l’écriture de la dissimulation dans les littératures contemporaines, française et francophone (fin du XXe et XXIe siècles) Alger (Algérie) - ENS-Bouzatéah Contact : enslabo@yahoo;fr |
Le 01 Janvier 1970 :
| |
Les représentations sociales et l’agencement collectif d’énonciation: identités, catégorisations, conflits Meknes (Maroc) - Université Moulay Ismail Les représentations sociales et culturelles sont travaillées aujourd’hui par différents courants parfois contradictoires : inscription dans le champ universitaire de nouvelles formes épistémologiques, notamment à travers le développement des studies, large diffusion des luttes militantes, r... [Afficher la suite] Les représentations sociales et culturelles sont travaillées aujourd’hui par différents courants parfois contradictoires : inscription dans le champ universitaire de nouvelles formes épistémologiques, notamment à travers le développement des studies, large diffusion des luttes militantes, renforcement des identités… ; parallèlement, la pensée du commun se trouve tout à la fois réaffirmée et réinterrogée. Le colloque se propose alors de réfléchir à cette bataille des représentations, qui n’est pas sans conséquence sur la vie de tous les jours et sur notre compréhension du monde.
Si la représentation peut être appréhendée comme une forme de médiation entre la sensation et l’intellection, s’intercalant entre le monde et la compréhension que l’on en a, elle peut aussi se saisir comme une expérience qui permet de construire des savoirs, des usages, des pratiques, à ceci près que l’expérience se construit à partir de ces formes imaginaires – historiquement construites – dont il est souvent difficile de s’abstraire. Les sciences sociales depuis Durkheim ont étudié les représentations dans leur dimension collective (Moscovici, Jodelet), tandis que le retour du sujet dans les sciences humaines (Jodelet, 2008) autorise à nouveau à se pencher sur la dialectique entre représentation individuelle et représentation collective.
Dans ce cadre, il est possible de comprendre les représentations collectives au moins de deux manières : (1) comme des nécessités sociales, culturelles et individuelles inhérentes à la vie en société et susceptibles de former et souder des groupes, et (2) comme des institutions de signification, formes modernes du contrôle.Elles peuvent alors être mises en évidence à partir de ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari (1980) appellent« agencement collectif d’énonciation en faisant travailler ensemble divers champs disciplinaires.
Il s’agira dans ce colloque d’examiner un certain nombre de points de vue, à partir de corpus variés, en essayant de mettre en évidence un certain nombre d’agencements. Particulièrement :
 Quel est le rôle de la littérature, des manuels scolaires, des discours de formation, des dictionnaires, des séries télévisées, du discours universitaire… des deux côtés de la Méditerranée dans la construction, le maintien des représentations, ou des déterritorialisations ?
 Comment y sont représentées les « figures » comme la femme, l’immigré, le pauvre… ou les valeurs – le propre, le sale, l’acceptable, le fou …
 Comment y sont représentées les religions monothéistes, l’église et l’homme de religion chrétien, l’islam et le musulman ?...
 Les langues sont aujourd’hui réputées maintenir des représentations obsolètes (voir par exemple les discussions autour du genre en français). Comment les langues sont-elles travaillées par le désir de nouvelles représentations ? [Réduire] Contact : colloque_meknes2016@yahoo.fr |
Le 13 Avril 2015 :
| |
Tribute to Assia DJEBAR (1936-2015) Guelma (Algérie) - Sassi BEN HAMLA auditorium-Université 8 mai 1945 A pioneer of Algerian literature, francophone author Assia Djebar is regarded today as one of the most prolific and greatest writers of the last decades not only at the national level, but also at the international one. Djebar’s large and varied production -novels, plays, essays, movies, etc.- is ... [Afficher la suite] A pioneer of Algerian literature, francophone author Assia Djebar is regarded today as one of the most prolific and greatest writers of the last decades not only at the national level, but also at the international one. Djebar’s large and varied production -novels, plays, essays, movies, etc.- is mainly enrooted in Algerian history and society. Her lifetime and deep concern with female issues and experiences, expressed through different mediums and throughout most of her works, positions her oeuvre close to, or to use her own words “tout contre”, the women of her community while she maintains that she is not trying to be a spokeswoman for them.
The study day aims at shedding light on segments of the life and works of an author who, and to borrow Kateb Yacine’s catchphrase, “vaut son pesant de poudre”. The day is also meant as a tribute to the author who passed away on the 6th February 2015.
*This activity is organized in the frame of the course “Algerian Literature” (Master 1/Dpt of English) [Réduire] Contact : houda.hmd@gmail.com |
Le 22 Avril 2015 :
 |
Le Forum Universitaire Maghrébin des Arts s’invite à Guelma Guelma (Algérie) - Université de 8 mai1945, Guelma |
Du 20 au 21 Avril 2015 :
 |
Le paysage algérien dans la littérature algérienne francophone(1962-2015) Médéa (Algérie) - univeresité de Médéa Contact : paysagealgerien@univ-medea.dz |
Le 15 Avril 2015 :
| |
ART, LITTÉRATURE ET MÉMOIRE Edmond Amran El Maleh, et Émile Habibi Lyon (France) - Le Rize Conférence de Touriya Filli Tullon le jeudi 16 Avril au RIZE, 23, rue Valentin Hauy, Villeurbanne à 19 heures
Soirée organisée par Raja-Tikva Association Rhône-Alpes d’amitié arabo-juive.
Edmond Amran El Maleh (1917-2010), Marocain juif et Émile Habibi (1921-1996), Arabe israélien, s... [Afficher la suite] Conférence de Touriya Filli Tullon le jeudi 16 Avril au RIZE, 23, rue Valentin Hauy, Villeurbanne à 19 heures
Soirée organisée par Raja-Tikva Association Rhône-Alpes d’amitié arabo-juive.
Edmond Amran El Maleh (1917-2010), Marocain juif et Émile Habibi (1921-1996), Arabe israélien, sont deux écrivains qui ont su articuler la question de la mémoire à une réflexion sur la création littéraire et artistique. En déjouant les pièges des identités étriquées pour incarner la figure du « paria conscient » (Arendt), ces deux écrivains ont choisi de faire œuvre de mémoire en témoignant non seulement pour le passé mais aussi pour l’avenir.
Rencontre modérée par Denis Marx, de l’association Raja-Tikva, dans le cadre du séminaire itinérant destiné à saluer la parution de l’ouvrage Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours dirigé par Abdelwahab Meddeb et Benjamin Stora. [Réduire] Contact : Fili |
Le 01 Avril 2015 :
 |
"La sociologie des intellectuels. bilan et perspectives " Oran (Algérie) - UCCLLA/CRASC Sénia Nous vous informons qu’une conférence intitulée : « La sociologie des intellectuels. bilan et perspectives », sera animée par : Giséle SAPIRO, Directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS, ce jeudi 02 avril 2015 à 09h30 au siège du CRASC. |
Du 08 au 10 Juin 2016 :
 |
Colloque de la Société Internationale d’Étude des Littératures de l’Ère Coloniale (SIELEC) Dijon (France) - Université de Bourgogne Contact : g.bridet@free.fr roq.durand@wanadoo.fr |
Du 18 au 19 Mars 2015 :
| |
Mémoire et trauma dans la culture marocaine Meknes (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Le Groupe marocain de sémiotique GMS de l’Université de Meknes et l’Association marocaine de sémiotique organisent en collaboration avec le centre interdisciplinaire sur les mémoires et les traumas culturels, TraMe, de l’Université de Bologne et le laboratoire interdisciplinaire récit... [Afficher la suite] Le Groupe marocain de sémiotique GMS de l’Université de Meknes et l’Association marocaine de sémiotique organisent en collaboration avec le centre interdisciplinaire sur les mémoires et les traumas culturels, TraMe, de l’Université de Bologne et le laboratoire interdisciplinaire récits, cultures et sociétés LIRCES de l’Université de Nice
IVe Congrès international
Mémoire et trauma dans la culture marocaine
19 et 20 novembre 2015 à La Faculté des Lettres de Meknès
Appel à contribution
De plus en plus en vogue, les recherches sur la mémoire ont montré leur importance et leur utilité, non seulement pour comprendre comment des individus, des cultures et des sociétés développées ou émergentes gèrent et négocient leur rapport au passé, mais aussi et surtout comment elles vivent leur présent et se projettent dans le futur. Le passé étant constamment en action et en branle dans la vie présente d’une société, il ne cesse de se modeler en fonction du présent et du futur : il est constamment manipulé, remodelé pour mieux comprendre le présent et supporter, prévenir ou agir sur le futur.
Lorsqu’il s’agit d’un passé traumatique, les choses deviennent plus complexes, mais aussi plus intéressantes. Les universitaires, historiens, psychologues, sociologues, sémioticiens, plus particulièrement ceux qui s’intéressent à la mémoire et aux traumatismes sont appelés à mettre en pratique leur savoir pour aider à mieux comprendre la gestion et la négociation de ce passé traumatique, ainsi que ses métamorphoses et ses influences sur le présent et le futur.
Privilégiant un passé très récent, le choix s’est porté sur cette période appelée les années de plomb. A ce sujet la matière ne manque pas. En effet, depuis quelques décennies, on dispose d’une littérature assez importante sur ce sujet : littérature carcérale, témoignages, articles, études, mais aussi films, émissions télé, etc. Le plus important dans l’approche de ces corpus est de montrer en revanche comment, selon les spécificités de chacun des supports évoqués, les processus de mémorisation peuvent être étudiés parce qu’ils révèlent des dynamiques de construction du trauma comme fait culturel, comme faculté ou comme document.
Les lieux de la mémoire, terme à la fois prolifique et vague qui regroupe des lieux physiques ou intellectuels, sont un de ces éléments de mémorisation. Il s’agit de voir comment au Maroc -mais aussi dans d’autres pays- ces lieux sont marqués et conservés ou en revanche inexistants, sans aucune inscription spatiale des valeurs du passé traumatique, faute de temps, de maturité ou de volonté politique, etc. Quoiqu’il en soit, il est important d’en évaluer l’état et d’en sonder les causes.
Pour la narration du trauma, quel que soit le support, se poser les questions suivantes : comment est représenté le trauma ? Selon quel point de vue ? Selon quelle forme de narration, quelle perspective, quelle focalisation ?
Il s’agit de voir aussi comment la représentation médiatique en général, et cinématographique en particulier, modifie les limites de l’événement en les déplaçant vers d’autres axes chronotopiques qui peuvent en réduire ou en élargir les limites. Il s’agit enfin de considérer ces médias, cinéma, télé ou autre, comme activateur de dislocations spatiales et temporelles de l’événement.
On peut donc envisager les axes de réflexion suivants :
La littérature et la mémoire du trauma, littérature carcérale, témoignage, autobiographie : écriture du trauma Evénements traumatiques et cinéma Politique culturelle de la mémoire traumatique : archives, musée, site, politique culturelle Jeux et enjeux de la mémoire du trauma : identité, idéologie, phases post conflictuelles, mémoire et contre-mémoire Mémoire du trauma et Histoire
On peut envisager d’autres axes, les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 30 mai, date limite, à l’adresse suivante : barnoussim@ymail.com.
Calendrier du congrès :
30 MAI 2015 Date limite de réception des propositions
30 JUIN 2015 Notification d’acceptation, de modification ou de refus des propositions
19 et 20 NOVEMBRE 2015 Déroulement du Congrès à la Faculté des Lettres de Meknès
31 DECEMBRE 2015 Date limite d’envoi des textes définitifs
30 JUIN 2016 Notification d’acceptation, de modification ou de refus des textes après examen en double blind par le comité scientifique
15 SEPTEMBRE 2016 Correction des épreuves
15 OCTOBRE 2016 Publication des Actes du congrès
Comité d’organisation
Mokhtar Belarbi
Mohamed Bernoussi
Driss Bouyahya
Hamid EL Azoui
Mohamed Infi
Comité scientifique
Mokhtar Belarbi
Mohamed Bernoussi
Khalid Hadji
Mohamed Ham
Anna Maria Lorusso
Marc Marti
Hassan Moustir
Patrizia Violi [Réduire] Contact : M. Mohamed Bernoussi |
Du 04 au 07 Mai 2015 :
| |
L'imaginaire Maroc des écrivains marocains et euro-marocains Meknes (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines L’objectif du colloque est de s’interroger sur ce que le Maroc pourrait constituer comme toile de fond ou substrat commun aux écrivains marocains d’ici et d’ailleurs ; autrement dit, en tant qu’espace qui servirait de réceptacle à ces écrivains. Un espace (le mot est à prend... [Afficher la suite] L’objectif du colloque est de s’interroger sur ce que le Maroc pourrait constituer comme toile de fond ou substrat commun aux écrivains marocains d’ici et d’ailleurs ; autrement dit, en tant qu’espace qui servirait de réceptacle à ces écrivains. Un espace (le mot est à prendre ici dans le sens le plus large) dont les contours surdéterminent aussi bien le mode de penser, d’agir, de créer et de produire que les attitudes qui se cristallisent autour des comportements (attitudes face à la vie, à la mort, à l’amour, etc.) En un mot, il s’agit de s’interroger sur les contours d’Un Imaginaire, au confluent d’affluents multiples, dans lequel les écrivains (marocains comme euro-marocains) se retrempent tout en dialoguant avec l’universel. En effet, cet imaginaire, considéré comme la représentation mentale de la réalité marocaine, puise sa richesse dans/se déploie en des territoires et des langues différents. Depuis plusieurs décennies, le répertoire de la “fiction Maroc” s’est élargi : outre l’arabe, tamazight ou le français, il compte désormais des écrits en espagnol, en catalan, en anglais, en néerlandais, etc. Vitalité diraient certains, toujours est-il que si vitalité il y avait, elle aurait partie liée avec les profondes transformations survenues fin des années 1980/début des années 90 : quelque chose de considérable, dirions-nous, s’était produit autant au niveau local qu’au niveau mondial/planétaire. Que s’est-il passé au juste ? Sans vouloir être exhaustifs ni faire office d’historiens, nous rappelons quelques événements marquants au niveau, respectivement, mondial, régional et local : novembre 1989 ; août 1990 ; septembre 1991. Un autre événement, et non des moindres, survint chez le voisin algérien en janvier1992, c’est l’annulation du 2e tour des élections législatives. Début, donc, l’espace d’une longue décennie, d’un cycle de violence aux conséquences incalculables. Avec le recul nécessaire, l’on est en droit de présumer que de tels bouleversements n’étaient pas sans incidences sur le Maroc et particulièrement sur l’écriture comme sur d’autres moyens d’expression culturelle et artistique (littérature, arts plastiques, photographie, cinéma). Cette conjoncture coïncide avec l’émergence d’une génération d’écrivains et d’artistes qui se singularisent par une production plutôt portée sur l’expérience individuelle que collective. C’est en vertu de cette individuation, en effet, que progressivement, en littérature, des écrivains allaient rompre avec les récits consacrés par la tradition de leurs prédécesseurs, lesquels n’avaient pas d’autre choix entre l’allégeance et la contestation (voire le réquisitoire) et qui s’estimaient être les porte-parole d’une communauté d’intérêts linguistiques/culturels ou d’une nation, si ce n’est d’un conglomérat de nations agglutinées autour d’une certaine revendication identitaire, supranationale et exclusive. Mais alors, qu’en est-il des écrivains euro-marocains ? Peut-on dire que, de là où elle s’énonce, leur écriture s’inscrit dans un processus de renouvellement ? S’inscrit-elle dans une démarche critique vis-à-vis de cet “Imaginaire Maroc” en se montrant empreinte d’une certaine fantaisie ou se plie-t-elle aux attentes d’un lectorat européen friand d’exotisme ?Certains de ces écrivains semblent introduire un regard critique, et sans concession, sur le rapport au religieux ou à la communauté. Sur cet “imaginaire Maroc”, dans lequel se reconnaît le lectorat des deux rives, se greffe une vision singulière qui s’exprime en référence à plusieurs territoires de la langue/du langage. Aussi “l’Imaginaire Maroc” se pense-t-il comme une poétique de la coexistence négociée entre deux univers (ceux des deux rives de la Méditerranée) et dont la résultante constitue une invite à l’exploration d’un monde différent. Des écrivains de renom participeront à ce colloque sur l’ “Imaginaire Maroc”. Leurs expériences d’écrivains et, pour certains d’entre eux, d’universitaires permettraient, sans doute, d’éclaircir le débat sur les écritures dont le réceptacle est l’ “imaginaire Maroc”. Nous assurons les intervenants qu’il n’y a pas de restriction quant aux approches critiques. Toutefois, nous souhaitons que les sujets de communication ne soient pas axés sur une œuvre/un auteur, mais sur l’œuvre d’un auteur ou plusieurs de ses œuvres. Au cas où le choix porterait sur un sujet spécifique, plusieurs auteurs devraient être convoqués.
Comité d’organisation :
Driss Aït ZEMZAMI, Ridha BOULAABI, Claude COSTE, Fouad LAROUI, Mohamed LEHDAHDA, Abdellah STITOU, Ieme VAN DERPOEL.
Comité Scientifique :
Abdelkrim CHIGUER, Claude COSTE, Ralph HEYNELS, Fouad LAROUI, Abdellah STITOU, Ieme VAN DER POEL. [Réduire] Contact : M. Mohamed Lehdahda |
Du 14 au 15 Mai 2015 :
.docx) |
Monastir (Tunisie) - Palais des sciences de Monastir Cette rencontre qui s’inscrit dans une série de colloques organisés autour des problématiques du « Goût », s’adresse aux écrivains et aux lecteurs qui ne cessent d’investir le langage du potentiel et de la variété sensorielle que les aliments et les plats ajoutent au(x) plaisir(s) des... [Afficher la suite] Cette rencontre qui s’inscrit dans une série de colloques organisés autour des problématiques du « Goût », s’adresse aux écrivains et aux lecteurs qui ne cessent d’investir le langage du potentiel et de la variété sensorielle que les aliments et les plats ajoutent au(x) plaisir(s) des mots. [Réduire] Contact : Adel Habbassi |
Du 27 au 28 Octobre 2015 :
| |
Définir les territoires de la brachylogie Guelma (Algérie) - Département de littérature et de langue française. Université de 8 mai 1945, Guelma Contact : maafa_amel@yahoo.fr |
Le 01 Janvier 1970 :
| |
Programme de Gisèle SAPIRO Oran (Algérie) - UCCLLA/CRASC Cher(e)s Ami(e)s et Collègues
Je vous transmets le Programme de Gisèle SAPIRO
Directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS
Une série de conférences sont au programme au siège de l’UCCLLA (Es-Senia) le mardi 31 mars et le mercredi 01 avril 2015 et au siège du CRASC (... [Afficher la suite] Cher(e)s Ami(e)s et Collègues
Je vous transmets le Programme de Gisèle SAPIRO
Directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS
Une série de conférences sont au programme au siège de l’UCCLLA (Es-Senia) le mardi 31 mars et le mercredi 01 avril 2015 et au siège du CRASC (USTO) le jeudi 02 avril 2015 à 09h 30
S'il vous plait ramenez vos étudiants et vos doctorants (c'est une belle occasion pour eux)
Cordialement
M.DAOUD
Directeur de l’UCCLLA
Le mardi 31 mars 2015 à 9h 30
"La responsabilité de l'écrivain : liberté d'expression et éthique de l'écriture en France 19e-21e siècle" au siège de l’UCCLLA/Es-Senia
Le mercredi 01 avril 205 à 9h 30
"Traduction et mondialisation: les enjeux socio-économiques de la circulation des livres" au siège de l’UCCLLA/Es-Senia
Le jeudi 02 avril 2015 à 9h 30
"La sociologie des intellectuels: bilan et perspectives" au siège du CRASC/USTO [Réduire] |
Du 08 au 10 Decembre 2015 :
| |
Le détour, tours & détournements Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines Les communications peuvent s’inscrire dans les problématiques suivantes, mais pas exclusivement :
- détour et rhétorique
- détour et discours rapporté
- détour et énonciation
- détour et stratégies discursives
- détour et genres littéraires Contact : urldc.sfax@gmail.com |
Le 15 Mars 2015 :
 |
Rencontre littéraire en hommage à Assia DJEBAR Mostaganem (Algérie) - E.N.S. de Mostaganem L’École Normale Supérieure de Mostaganem en collaboration avec ELILAF et CRASC a rendu un vibrant hommage à Assia Djebar le 16 mars 2015. Lieu de la manifestation Site Universitaire II. Mostaganem.
La rencontre était présidée par Monsieur MAZARI Abdelkader Directeur de L’ENS de Mostag... [Afficher la suite] L’École Normale Supérieure de Mostaganem en collaboration avec ELILAF et CRASC a rendu un vibrant hommage à Assia Djebar le 16 mars 2015. Lieu de la manifestation Site Universitaire II. Mostaganem.
La rencontre était présidée par Monsieur MAZARI Abdelkader Directeur de L’ENS de Mostaganem et Monsieur HADJARI Farid Chef du Département de Langue Française.
Au programme :
Docteur BENAMMAR Khedidja
-Lecture d’une oraison funèbre.
- Projection du film La Nouba des Femmes du Mont Chenoua : Une mise en parallèle entre la
voie /voix littéraire et l’œil de la caméra.
Mme ABDELAZIZ Malika Maitre-assistant
-La mondialité chez Assia Djebar.
Monsieur HADJARI Farid Maitre-Assistant/Chef du département
-L’étude des thèmes récurrents dans l’œuvre de Assia Djebar à partir des hommages parus dans la
Presse. [Réduire] |
Du 15 au 20 Mars 2015 :
 |
Festival interculturel du conte 9e édition - "Une paix contée dès l’enfance" Oran (Algérie) - Institut français d'Oran Les paroles voyageuses iront à la rencontre des grands et petits dans les centres culturels, les espaces publics, le tramway, les écoles et à l’Institut français. Des causeries, des ateliers autour du conte animeront tous les âges. Et les conteurs arriveront du Congo Brazzaville, du Maghreb, ... [Afficher la suite] Les paroles voyageuses iront à la rencontre des grands et petits dans les centres culturels, les espaces publics, le tramway, les écoles et à l’Institut français. Des causeries, des ateliers autour du conte animeront tous les âges. Et les conteurs arriveront du Congo Brazzaville, du Maghreb, du Liban, du Yémen, d’Italie, de Suisse, de France et de Cuba. [Réduire] |
Le 11 Mars 2015 :
| |
Assia Djebar, écriture et présence Alger (Algérie) - Bibliothèque Nationale El-Hamma Le programme contient 15 communications dont 3 en français :
- Afifa Bererhi:"Assia djebar, le sistre des voix recluses" (1re séance:9h30-11h)
- Ahmed Khiat: "Vaste est la prison, lecture critique"(3e séance:12h30-14h)
- Assia Kacedali: "Assia Djebar, une féministe no... [Afficher la suite] Le programme contient 15 communications dont 3 en français :
- Afifa Bererhi:"Assia djebar, le sistre des voix recluses" (1re séance:9h30-11h)
- Ahmed Khiat: "Vaste est la prison, lecture critique"(3e séance:12h30-14h)
- Assia Kacedali: "Assia Djebar, une féministe nostalgique" (4e séance:15h-16h30) [Réduire] |
Le 12 Mars 2015 :
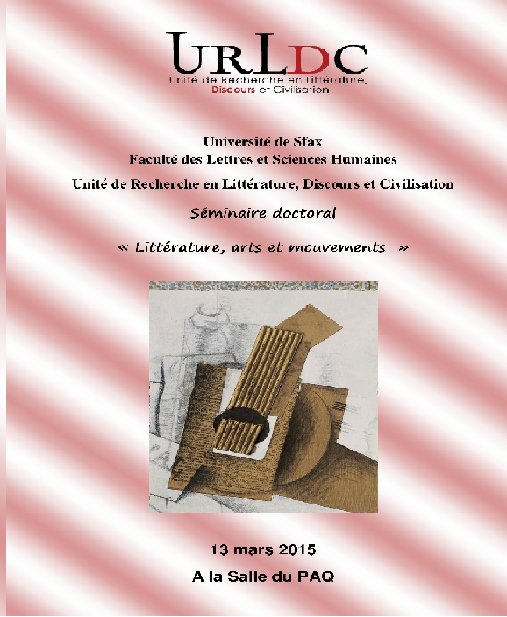 |
Séminaire Doctoral: Littérature, arts et mouvement Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax L'objectif de ce séminaire est l'étude des différentes formes et manifestations du mouvement. Nous essayerons d'y étudier les mouvements établis dans la genèse d'une oeuvre littéraire, les convergences entre les formes artistiques et les formes littéraires aussi bien que la question de la r�... [Afficher la suite] L'objectif de ce séminaire est l'étude des différentes formes et manifestations du mouvement. Nous essayerons d'y étudier les mouvements établis dans la genèse d'une oeuvre littéraire, les convergences entre les formes artistiques et les formes littéraires aussi bien que la question de la réception d'une oeuvre en mouvement. [Réduire] Contact : 25 921 898 |
Le 07 Mars 2015 :
| |
Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme Oran (Algérie) - Université Oran 2 , Faculté des Lettres Etrangères  Objet : Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme

 L’AFEPEC et La Faculté des Langues Etrangères
 - Université Oran 2 -
 organisent
 Le 8 Mars 2015

 JOURN�... [Afficher la suite]  Objet : Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme

 L’AFEPEC et La Faculté des Langues Etrangères
 - Université Oran 2 -
 organisent
 Le 8 Mars 2015

 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME le 8/2/2015 à 9h 30 à l’ILE (ex Maraval)
 Hommage à Assia Djebar
 Programme
 Matinée : à la Faculté des Langues Etrangères (Maraval), Salle CRM
9h30
 Ouverture officielle : Allocution de Mr Lakhdar Barka, Doyen de la Faculté des Langues Etrangères – FLE-
Modératrice : Malika Remaoun, Vice-Présidente AFEPEC
- Propos libres sur Assia Djebar, Benamar Médiène, Professeur des Universités, Ecrivain
- Assia Djebar : inventer une langue entre corps et voix, Fatima Medjad, Université d’Oran2, FLE
 Lecture théâtrale de textes d’Assia Djebar par des jeunes de la troupe de théâtre d’improvisation Drôles Madaires
 - La réception d’Assia Djebar dans les médias arabophones, Daoud Mohamed, Université d’Oran, Directeur UCCLLA/CRASC
- Une rétrospective de l’œuvre littéraire d’Assia Djebar, Khedidja Benammar, Université de Mostaganem – FLE
- Au seuil de l'écriture de soi: quelques jalons autobiographiques dans trois romans d'Assia Djebar, Latifa Sari Mohamed, Université de Tlemcen
- La dimension féminine dans l’écriture de Assia Djebar, le cas de loin de Médine, Cherifa Benhamamouch, magistrante FLE
- De la Nouba … à la Zerda…Assia Djebar Cinéaste accomplie, Mohamed Bensalah, Université d’Oran2- FLE
 Après-midi Au Conservatoire d’Oran
 14h30
 - Assia Djebar et la cause des droits des femmes. Zaza Belhadj, Présidente AFEPEC
- Assia, un souvenir encore vivace, Dalila Alloula, belle-sœur d’Assia
- Propos libres sur Assia Djebar, Benamar Médiène, Professeur des Universités, Ecrivain
- Oraison funèbre, Khedidja Benammar, Université de Mostaganem – FLE
 - Projection d’Extraits des films La Nouba des femmes du mont Chenoua et La Zerda ou les chants de l’oubli.
- Lecture de textes d’Assia Djebar par la comédienne Fadéla Hachemaoui et la conteuse Djamila Hamitou [Réduire] |
Le 01 Janvier 1970 :
| |
Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme Oran (Algérie) - ILE/ Faucultés des Lettres Etrangères Objet : Bonjour (Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme)
L’AFEPEC et La Faculté des Langues Etrangères
- Université Oran 2 -
organisent
Le 8 Mars 2015
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME le 8/2/2015 à 9h 30 à lILE (ex Maraval)
Hommage à Assia Djeba... [Afficher la suite] Objet : Bonjour (Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme)
L’AFEPEC et La Faculté des Langues Etrangères
- Université Oran 2 -
organisent
Le 8 Mars 2015
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME le 8/2/2015 à 9h 30 à lILE (ex Maraval)
Hommage à Assia Djebar
Programme
Matinée : à la Faculté des Langues Etrangères (Maraval), Salle CRM
9h30
Ouverture officielle : Allocution de Mr Lakhdar Barka, Doyen de la Faculté des Langues Etrangères – FLE-
Modératrice : Malika Remaoun, Vice-Présidente AFEPEC
- Propos libres sur Assia Djebar, Benamar Médiène, Professeur des Universités, Ecrivain
- Assia Djebar : inventer une langue entre corps et voix, Fatima Medjad, Université d’Oran2, FLE
Lecture théâtrale de textes d’Assia Djebar par des jeunes de la troupe de théâtre d’improvisation Drôles Madaires
- La réception d’Assia Djebar dans les médias arabophones, Daoud Mohamed, Université d’Oran, Directeur UCCLLA/CRASC
- Une rétrospective de l’œuvre littéraire d’Assia Djebar, Khedidja Benammar, Université de Mostaganem – FLE
- Au seuil de l'écriture de soi: quelques jalons autobiographiques dans trois romans d'Assia Djebar, Latifa Sari Mohamed, Université de Tlemcen
- La dimension féminine dans l’écriture de Assia Djebar, le cas de loin de Médine, Cherifa Benhamamouch, magistrante FLE
- De la Nouba … à la Zerda…Assia Djebar Cinéaste accomplie, Mohamed Bensalah, Université d’Oran2- FLE
Après-midi Au Conservatoire d’Oran
14h30
- Assia Djebar et la cause des droits des femmes. Zaza Belhadj, Présidente AFEPEC
- Assia, un souvenir encore vivace, Dalila Alloula, belle-sœur d’Assia
- Propos libres sur Assia Djebar, Benamar Médiène, Professeur des Universités, Ecrivain
- Oraison funèbre, Khedidja Benammar, Université de Mostaganem – FLE
- Projection d’Extraits des films La Nouba des femmes du mont Chenoua et La Zerda ou les chants de l’oubli.
- Lecture de textes d’Assia Djebar par la comédienne Fadéla Hachemaoui et la conteuse Djamila Hamitou
Interlude musical avec Laribi Mustapha
Objet : Hommage à Assia Djebbar le 08 mars journée internationale de la femme
L’AFEPEC et La Faculté des Langues Etrangères
- Université Oran 2 -
organisent
Le 8 Mars 2015
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME le 8/2/2015 à 9h 30 à l’ILE (ex Maraval)
Hommage à Assia Djebar
Programme
Matinée : à la Faculté des Langues Etrangères (Maraval), Salle CRM
9h30
Ouverture officielle : Allocution de Mr Lakhdar Barka, Doyen de la Faculté des Langues Etrangères – FLE-
Modératrice : Malika Remaoun, Vice-Présidente AFEPEC
- Propos libres sur Assia Djebar, Benamar Médiène, Professeur des Universités, Ecrivain
- Assia Djebar : inventer une langue entre corps et voix, Fatima Medjad, Université d’Oran2, FLE
Lecture théâtrale de textes d’Assia Djebar par des jeunes de la troupe de théâtre d’improvisation Drôles Madaires
- La réception d’Assia Djebar dans les médias arabophones, Daoud Mohamed, Université d’Oran, Directeur UCCLLA/CRASC
- Une rétrospective de l’œuvre littéraire d’Assia Djebar, Khedidja Benammar, Université de Mostaganem – FLE
- Au seuil de l'écriture de soi: quelques jalons autobiographiques dans trois romans d'Assia Djebar, Latifa Sari Mohamed, Université de Tlemcen
- La dimension féminine dans l’écriture de Assia Djebar, le cas de loin de Médine, Cherifa Benhamamouch, magistrante FLE
- De la Nouba … à la Zerda…Assia Djebar Cinéaste accomplie, Mohamed Bensalah, Université d’Oran2- FLE
Après-midi Au Conservatoire d’Oran
14h30
- Assia Djebar et la cause des droits des femmes. Zaza Belhadj, Présidente AFEPEC
- Assia, un souvenir encore vivace, Dalila Alloula, belle-sœur d’Assia
- Propos libres sur Assia Djebar, Benamar Médiène, Professeur des Universités, Ecrivain
- Oraison funèbre, Khedidja Benammar, Université de Mostaganem – FLE
- Projection d’Extraits des films La Nouba des femmes du mont Chenoua et La Zerda ou les chants de l’oubli.
- Lecture de textes d’Assia Djebar par la comédienne Fadéla Hachemaoui et la conteuse Djamila Hamitou
Interlude musical avec Laribi Mustapha [Réduire] |
Le 18 Novembre 2015 :
| |
Colloque : "Humour : (dé)former le sens ?" Casablanca (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik Colloque international : "Humour : (dé)former le sens ?" Contact : Lahcen OUASMI |
Du 16 Novembre au 18 Février 2015 :
| |
Enseignement / apprentissage de la littérature et les études littéraires contemporaines: onomastique, base de données et comparatisme littéraires (Algérie) APPEL A COMMUNICATION
RASYD, Unité de recherche « Les Systèmes de dénomination en Algérie » et ELILAF, Laboratoire « Environnement linguistique et usages du français en Algérie » organisent
Colloque international
Enseignement / apprentissage de la littérature et les études littéra... [Afficher la suite] APPEL A COMMUNICATION
RASYD, Unité de recherche « Les Systèmes de dénomination en Algérie » et ELILAF, Laboratoire « Environnement linguistique et usages du français en Algérie » organisent
Colloque international
Enseignement / apprentissage de la littérature et les études littéraires contemporaines: onomastique, base de données et comparatisme littéraires
Du 17 au 19 Novembre 2015, Algérie
Depuis quelques années, une réflexion est amorcée sur la problématique de l’enseignement / apprentissage de la littérature à l’école et l’université, notamment dans une perspective d’articulation entre les cycles de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. En effet, la recherche en littérature a souffert d’une double mise à l’écart par les promoteurs d’une réforme scolaire et universitaire (particulièrement dans le système LMD). Les enseignants de littérature se plaignent d’un déficit de représentation du champ d’études littéraires dans les départements de langues, où elles sont considérées comme « inutiles », du moins difficiles à assimiler. Cette image dépréciative aboutit à sous - estimer l’impact des études littéraires contemporaines dans l’enseignement/apprentissage des langues. Or, la littérature est incontournable pour acquérir les compétences disciplinaires en rapport avec certains métiers et spécialités : médias, édition, culture, communication etc.
L’objectif de ce colloque est de créer une dynamique pluridisciplinaire entre les acteurs du système éducatif, les universitaires, les sociologues de l’éducation, les concepteurs des manuels, les critiques littéraires contemporaines, etc., à l’effet de traiter les thématiques suivantes :
1- Les études littéraires contemporaines
Les nouvelles configurations pédagogiques en milieu scolaire et universitaire peuvent se réaliser à travers les quelques pistes suivantes :
Ouverture sur de nouvelles approches, de type onomastique littéraire : l’étude des noms propres offre des outils d’analyse pertinents pour une exploitation pédagogique du texte littéraire. Dans ses deux volets anthroponymique (Cheriguen, 2007 ; Yermeche, 2005) et toponymique (Atoui, 2005), l’onomastique pourrait être une entrée méthodologique appropriée pour interroger le fonctionnement interne du texte ainsi que ses soubassements socio culturels et anthropologiques (Leroy, 2004).
Comparatisme et transversalité littéraires : une approche comparatiste des littératures nationales et celles des aires culturelles, linguistiques étrangères (Moura, 1998) permettra d’examiner des domaines littéraires contemporains, voire de l’extrême contemporain (Schoentjes, 2014). Il est important de s’interroger sur les productions émergentes (Laronde, 1996), diasporique ou minoritaire, sur les « mauvais genres » (roman policier, sentimental, BD, etc.), la traduction littéraire et leur place dans ces nouveaux dispositifs.
Les ateliers de créativité : La lecture méthodique a mis en place une technicité qui a fondé sa légitimité dans le cadre de l’enseignement/apprentissage du texte littéraire. Elle s’inscrit dans les modalités d’insertion didactique des lectures scolaire et universitaire au sein des ateliers de créativité (jeu onomastique, réécriture des textes, scénarisation, etc.).
L’ouverture incontournable aux dynamiques plurilingues : elle fait écho aux impératifs des standards universitaires internationaux, induits par la mondialisation, dans ses dimensions culturelles et interculturelles les plus productives (Puren, 2010).
Les langues des nouvelles technologies (cyberlangue) et multimédia : après les instructives conclusions du colloque sur la cyberlougha au Maghreb, il est nécessaire de nous interroger sur les nouvelles études qui examinent l’impact des technologies d’information et de télécommunication sur l’émergence de nouvelles scénographies fictionnelles et narratives.
L’utilisation des bases de données : les bases de données sont de nouvelles configurations scientifiques en mesure d’asseoir une exploitation pédagogique optimale en matière littéraire. Les sites de documentation à l’instar de Limag (Bonn, 2009) ou des centres de recherches et des archives, comme celui de Archives et Musée de la littérature en Belgique (Quaghebeur, 2009), le Centre de Littératures française et francophones contemporaines à Paris (Moura & Viart), en sont des exemples remarquables.
2- Littératie et enseignement/ apprentissage du texte littéraire
L’enseignement de la lecture prendrait en ligne de compte les implications cognitives et les effets sociaux de la lecture et de l’écriture. La réflexion de la littératie (Goody, 2006) ne peut être pertinente que si elle fait l’objet de contextualisation pour rendre compte des pratiques de la lecture et l’écriture en milieu scolaire et universitaire. Les différentes interactions de la littératie, induites en contexte plurilingue, par le biais des transferts langagiers et linguistiques, langues maternelles/Langues étrangères, dans le dispositif enseignement/apprentissage de la lecture du texte littéraire, sont à saisir dans une vision valorisante du plurilinguisme (Benramdane, 2013).
3- Quel rôle joue l’enseignement/apprentissage de la littérature et/ ou de la lecture à l’école et l’université ?
Actuellement, la réflexion porte sur la distinction entre enseignement de la lecture et enseignement de la littérature (Todorov, 2004). L’histoire littéraire n’étant plus au centre de l’analyse, elle participe à la construction du sens. Les deux enseignements mettraient en œuvre les fonctions traditionnelles de l’école et de l’université : mission critique, détermination éthique et scientifique, orientation prospective, aptitudes d’anticipation et recherche de l’excellence. Donc, il s’agit de la remise en cause d’une attitude à dominante traditionnaliste ou instrumentaliste qui ne prend pas en compte les conditions de production et de réception. La conception moderne de la littérature est historiquement liée à la notion de nationalisme, consolidant l’affirmation et la légitimité de l’identité linguistique nationale. Toutefois, la littérature est un phénomène esthétique, socio-symbolique et historique. Certains la considèrent comme un patrimoine universel d’œuvres d’écrivains célèbres et consacrés. Il est évident que les mutations mondiales ont bouleversé les univers linguistiques et les imaginaires culturels nationaux dans tous les pays. A cet égard, l’enseignement de la littérature scolaire et du texte littéraire à l’université s’inscrit dans une forme de projet pédagogique en fonction du changement de son public d’une période à l’autre.
Dans le cadre de ce colloque, c’est la dimension empirique qui est prioritairement recherchée par la mise en exergue des résultats de recherche sur des pratiques pédagogiques innovantes, insistant sur des propositions de dispositifs didactiques, renforcées par des assises théoriques appropriées et argumentées. Il est indispensable d’interroger les nouvelles recherches littéraires françaises et francophones contemporaines à partir des approches comparatistes nouvelles et de corpus différents.
Bibliographie
ATOUI (Brahim), 2005, « L’odonymie d’Alger: passé et présent », In Nomination et dénomination. Des noms de lieux, de tribus et de personnes en Algérie. Ouvrage collectif coordonné par Farid Benramdane et Brahim Atoui. Editions CRASC.
BENRAMDANE (Farid), 2013, « Littératie, rénovation des curricula des langues et transfert langue française / langues maternelles et secondes. Le cas du système éducatif algérien », actes du colloque Lille 16/17 Mai 2013.
BESSE (Henri), 1989, “Quelques réflexions sur le texte littéraire et ses pratiques dans l’enseignement du français langue seconde ou langue étrangère”, In Trèfle, 9, pp. 1-12.
BONN (Charles), « Le programme LIMAG (Littératures du Maghreb) », In Littératures Au Sud, AUF, 2009.
QUAGHEBEUR (Marc), « Des Archives pour le futur », In Littératures Au Sud, AUF, 2009.
GOODY (Jack), 2006, « La littéracie, un chantier toujours ouvert », In Pratiques. N°131/132, Décembre 2006. Traduit par Kathie Birat.
LEGROS (Denis), all, 2009, « TICE et Cognition de la Littératie plurilingue. Vers un modèle intégrateur », in Synergies Algérie n° 6.
LARONDE (Michel), 1996, L’Ecriture Décentrée, la langue de l’autre dans le roman contemporain, Paris, Harmattan 1996.
LEROY (Sarah), 2004, Le nom propre, Paris, OPHRYS.
MOURA (Jean-Marc), 1998, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF.
TODOROV (Tzevetan), 2007, La littérature en péril, Flammarion.
SOUCHON (Albert), 2000. Les textes littéraires en classe de langue. Hachette.
Calendrier du colloque
Lancement de l’appel à communication : 1 Février 2015
Sélection des propositions des communications : Juin 2015
Information des candidatures retenues/ Envoi des invitations : Août-Septembre 2015
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 Mai 2015
Les propositions de communication ne devant pas dépasser un résumé de 500 mots maximum, avec une bibliographie succincte et la fiche de présentation indiquant : nom et prénom, établissement de rattachement, grade et adresse mail. Adresses de réception des propositions à Lila Medjahed : lmedjahed1@gmail.com et farid.17@hotmail.com ou litteraturecolloque2015@gmail.com.
Comité scientifique
Brahim Atoui, RASYD, CRASC
Farid Benramdane, RASYD & ELILAF
Ouerdia Yermeche, RASYD, CRASC
Charles Bonn, LIMAG, France
Tourya Fili-Tullon, Passage XX-XXI, Université Lyon II, France
Marc Quaghebeur, Archive et Musée de la Littérature, Belgique
Jean-Paul Meyer, Univ. Strasbourg, France,
Jean-Marc Moura, Univ. Paris Nanterre, France,
Michel Laronde, Univ. Iowa, USA,
Bernadette Mimoso-Ruiz, Univ. Toulouse, France
Pierre Schoentjes, Univ. Gand, Belgique
Katrien Lievois, Univ. Gand, Belgique
Violaine Houdart-Merot, Univ. Cergy- Pontoise, France,
Cristina Robalo Cordeiro, AUF Maghreb,
Sabine Loucif, Univ. Hofstra, New York, USA
Sonia Zlitni Fitouri, Univ. Manouba, Tunisie,
Mabrour Abdelouehed, LERIC, El Djadida, Maroc,
Slimane Lemnaoui, Univ. Fès, Maroc
Alain Sissao, CNRTS, Univ. Ouagadougou, Burkina Faso
Pierre Dumont, Univ. Martinique
Patrick Chardenet, AUF
Wafa Berri, Faculté SH, Liban
Moussa Daff, Univ. Dakar, Sénégal
Faouzia Bendjlid, LADICIL & UCCLLA, Oran,
Fatima Medjad, LADICIL, Oran,
Mohamed Daoud, UCCLLA, CRASC
Latifa Kadi, LIPED, Univ. Annaba,
Karima Ait Dahmene, Univ. Alger 2,
Mohamed Miliani, Univ. Oran,
Yamilé Ghebalou, Univ. Alger 3,
Boumedienne Benmousset, Univ. Tlmecen
Taklit Mebarek, RASYD, CRASC
Mohand Haddadou, RASYD, CRASC
Cherif Sini, RASYD, CRASC
Comité d’organisation :
Les membres du laboratoire ELILAF et de l’unité de recherche RASYD : Farid BENRAMDANE, Lila MEDJAHED, Nazéha BENBACHIR, Abdelkader SAYAD, Lynda-Nawel TEBBANI, Nezhet BENZIDANE, Malika ABDELAZIZ, Khadidja BENAMMAR, Mohand Akli SALHI, Khadidja BENKASDALI, Mimouna NOUAR, Aouatef SAHNOUN, Leila MOUSSADEK, Farid HADJARI, Saliha BENAISSA, Chahrazed HAOUCHINE, Leila BELKAIM, Azzedine MALEK, Abdelhamid KRIDECH. [Réduire] Contact : litteraturecolloque2015@gmail.com |
Le 05 Février 2015 :
 |
La Plume et la plaie. Caricatures et libertés Paris (France) - 65 rue des Gands Moulins - 75013 Journée d'études organisée par l'Unité de recherches LACNAD (INALCO) Contact : mourad.yelles@inlaco.fr |
Du 03 au 04 Février 2015 :
| |
De la critique littéraire journalistique à la critique universitaire Alger (Algérie) - Bibliothèque Nationale,El Hamma Contact : Nadia Sebkhi |
Du 17 au 18 Novembre 2015 :
 |
Enfants de guerres : mémoires, témoignages et représentations Tlemcen (Algérie) - Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen Laboratoire de recherche « Diversité des Langues, Expressions Littéraires, Interactions Cu La représentation de l'enfant face à la violence des guerres et conflits armés dans la littérature et les représentation artistiques. Contact : laboratoiredeslangues@gmail.com ; colloqueguerre@gmail.com |
Le 08 Février 2015 :
| |
rExils : Rencontre littéraire autour de Kateb Yacine Paris VIème arrond. (France) - Théâtre de l'Odéon Lundi 9 Février 2015 / 20h00
Odéon 6e / Grande Salle
Kateb Yacine
Exils. En présence de Mohamed Kacimi. Textes lus par Jean-Damien Barbin
Kateb Yacine |
"Mon père pris soudain la décision irrévocable de me fourrer sans plus tarder dans «la gueule du loup», c’est-à-dire à... [Afficher la suite] Lundi 9 Février 2015 / 20h00
Odéon 6e / Grande Salle
Kateb Yacine
Exils. En présence de Mohamed Kacimi. Textes lus par Jean-Damien Barbin
Kateb Yacine |
"Mon père pris soudain la décision irrévocable de me fourrer sans plus tarder dans «la gueule du loup», c’est-à-dire à l’école française. Il le faisait le cœur serré : – Laisse l’arabe pour l’instant. Je ne veux pas que comme moi tu sois assis entre deux chaises. [...] La langue française domine. Il te faudra la dominer, et laisser en arrière tout ce que nous t’avons inculqué dans ta plus tendre enfance. Mais une fois passé maître dans la langue française, tu pourras sans danger revenir avec nous à ton point de départ. [...]
Jamais je n’ai cessé, même aux jours de succès près de l’institutrice, de ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l’écolier de sa mère que pour les arracher, chaque fois un peu plus, au murmure du sang, aux frémissements réprobateurs d’une langue bannie, secrètement, d’un même accord,aussitôt brisé que conclu... Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables – et pourtant aliénés !"
Rencontre littéraire animée par Paula Jacques [Réduire] |
Le 21 Janvier 2015 :
| |
Rencontre-vente dédicace : Autour de l’œuvre de Maïssa BEY Oran (Algérie) - Librairie « Livres, Art et Culture », 22 rue Moulay Mohamed, Oran rencontre-débat avec Maïssa Bey autour de son oeuvre et vente-dédicace |
Du 05 au 06 Mars 2016 :
 |
Le roman algérien de langue française: un siècle d'écriture et de création Oran (Algérie) - UCCLLA/CRASC CENTRE DE RECHERCHE EN ANTHROPLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE/CRASC
Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, les Littératures et les Arts/UCCLLA
PROJET DE RECHERCHE : RECEPTION CRITIQUE DU ROMAN CONTEMPORAIN ALGERIEN
COLLOQUE INTERNATIONAL LES 6 ET 7 MARS 2015
THEME ... [Afficher la suite] CENTRE DE RECHERCHE EN ANTHROPLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE/CRASC
Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, les Littératures et les Arts/UCCLLA
PROJET DE RECHERCHE : RECEPTION CRITIQUE DU ROMAN CONTEMPORAIN ALGERIEN
COLLOQUE INTERNATIONAL LES 6 ET 7 MARS 2015
THEME : LE ROMAN ALGERIEN DE LANGUE FRANÇAISE : UN SIECLE D’ECRITURE ET DE CREATION
« J’écris en Français parce que la France a envahi mon pays et qu’elle s’y est taillée une position de force telle qu’il fallait écrire en français pour survivre ; mais en écrivant en Français, j’ai mes racines arabes ou berbères qui sont vivantes, par conséquent tous les jugements que l’on portera sur moi, en ce qui concerne la langue française, risquent d’être faux si on oublie que j’exprime en Français quelque chose qui n’est pas français. »
Kateb Yacine
La littérature comme mode d’expression de l’imaginaire dans le vaste champ des études anthropologiques et des sciences humaines se manifeste à toutes les époques de l’Histoire d’Algérie depuis les temps les plus anciens. La production littéraire est le fait de toutes les civilisations qui ont dominé le pays.
La littérature algérienne de langue française est non seulement un produit objectif de l’apprentissage de la langue du colon mais un héritage de l’Histoire qui enrichit le patrimoine culturel algérien. Un bref regard à l'histoire des idées en Algérie nous révèle que d’autres civilisations du bassin méditerranéen et d’ailleurs, aux ambitions expansionnistes, ont convoité les rivages et la terre d ’Algérie ; ils s’y installent et viennent de ce fait amplifier et accroitre davantage le socle culturel ancestral. C’est dire que l’imaginaire algérien, et tout particulièrement littéraire, est imprégné profondément par toutes ces influences civilisationnelles qui sédimentent et travaillent toute la question identitaire qui puise sa substance constitutive et toute sa signification dans l’hybridité et le fragment, le composite et le métissage, le croisement et la multiculturalité. C’est dans ce contexte culturel ainsi constitué dans le brassage de différentes cultures que se manifeste la littérature algérienne de langue française dont les fictions sont intensément racinées dans la mémoire collective et la tradition ancestrale immémoriale ; elle représente un moment particulier de l’histoire des idées et le mouvement de la pensée en Algérie et au Maghreb. Elle est inhérente à une conjoncture historique récente dans cette trajectoire culturelle millénaire. L’indépendance du pays ne voit point son extinction. Dans cette nouvelle étape de l’Histoire, la littérature s’épanouit de plus belle dans un pays confronté à la construction de la modernité et à son intégration dans le concert des nations à l’instar de tous les pays décolonisés. Bien plus, cette littérature continue à prospérer et à se déployer durant la période post-coloniale, et à se développer davantage dans les temps modernes caractérisés par la mondialisation que favorise considérablement le développement accéléré de la technologie du numérique, la communication satellitaire dans les échanges entre les pays et les hommes et les multiples et incessants exodes humains entre tous les continents de la planète. Ainsi, dans cette ère de circularité et de mouvements, de nouvelles poétiques, de nouvelles écritures, une « nouvelle diversité littéraire en Algérie », selon Najib Redouane , ont-elles vu le jour ; de ce fait, les valeurs esthétiques sont totalement bouleversées et métamorphosées car elles se font dans la multiculturalité, le dialogue des cultures, la confrontation de divers discours, le transfert et la mobilité des procédés et mécanismes d’écriture, en somme dans une poétique de l’hybridité, une « poétique du divers », telle qu’instituée par Edouard Glissant à travers sa notion de la littérature fondée sur la pensée philosophique « Le tout-monde » . Cette grande transversalité de la pensée humaine met en place l’ère du soupçon, celle des remises en cause, celle des questionnements qui fondent une nouvelle vision de la valeur littéraires du texte romanesque et l’avènement d’une diversité scripturaire. Aussi, l’imaginaire, dans les fictions tout particulièrement, se trouve-t-il affranchi des schèmes de pensées et de la rigidité des dogmes littéraires ayant prospéré dans le champ littéraire occidental considéré pendant longtemps comme le centre. Intellectuellement, esthétiquement, philosophiquement, voire idéologiquement, on peut évoquer l’idée d’un décentrement réel qui se manifeste par une errance de l’écriture, par sa mobilité, par le caractère ouvert du genre romanesque à tous les possibles artistiques et narratifs. Compte tenu de ce préalable, notre colloque s’intéressera à l’histoire littéraire du roman algérien. Après un siècle d’écriture romanesque, il s’agit de faire un état des lieux sur l’écriture du roman algérien, de l’interroger à la lumière des bouleversements de l’histoire du monde, de l’histoire d’Algérie et celle des temps modernes de la mondialité. Il est question d’une lecture/relecture de son émergence, de l’évolution de ses techniques d’écriture, de son esthétique, de ses discours et de sa réception critique. Il s’agit, ainsi, en définitive, de questionner la notion même de roman algérien et sa (re)définition. Qu’est-ce qui fait, construit aujourd’hui la littérature algérienne et son histoire, et tout particulièrement celle du roman comme modalité d’expression hérité de la tradition littéraire occidentale ? Dans quelles conditions peut-on parler de spécificité générique du roman algérien? Dans quelles conditions et perspectives peut-on évoquer son universalité ? Quel dialogue instaure-t-il au niveau de la poétique et des discours au sein du Maghreb et de la littérature francophone? Quelle classification générique et périodique peut-on suggérer pour écrire l’histoire littéraire? Peut-on parler à l’époque contemporaine de l’émergence d’un « nouveau roman algérien » selon Lynda-Nawel Tebbani ? Où d’un « nouveau souffle du roman algérien » selon les propos de Rachid Mokhtari ? Quelles en seraient les dimensions esthétiques ? Pour avoir quelques réponses, nous soumettons à la prospection et à l'analyse les axes de recherche et de réflexion suivants :
- Les romans émergents des pionniers
- Le roman postcolonial
- Le roman iconoclaste
- Le roman contemporain des années 1990 à nos jours
- Le roman de l’exil
- Le roman issu de l’immigration
- Comment élaborer l’histoire littéraire algérienne :
 . Synchronie ou diachronie
 Thématique
 Révolution et rupture
- L’avenir de la littérature algérienne : quels enjeux et perspectives ?
- Edition et diffusion de la littérature : quel rôle dans l’histoire littéraire ?
Comité scientifique
Professeur Zineb Ali-Benali, Université de Paris 8 (France) ; Dr. Karim Amellal, auteur (Paris, France); Professeur Zoubida Belaghoueg , Université de Constantine ; Professeur Bouchra Ben Bella , Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès (Maroc); Dr. Bendchehida Mansour, MC/A, Université de Mostaganem ; Professeur Faouzia Bendjelid, Université d’Oran 2 ; Dr. Benhaïmouda Miloud, MC/A, Université de Mostaganem ; Professeur Emérite Charles Bonn, Université de Lyon 2 (France) ; Dr. Boudjadaja Mohamed, MC/A ,Université de Sétif ; Dr. Dris Louise Léïla, MC/A, Université d'Oran 2 ; ; Professeur Ghellal Abdelkader, Université d'Oran 2 ; Professeur Saïd Khadraoui, Université de Batna ; Dr. Medjad Fatima, MC/A, université d’Oran 2 ; Dr. Medjahed Leïla, MC/A, Université de Mostaganem ; Professeur Mehadji Rahmouna, Université d’Oran 2, Dr. Merine Kheira, MC/A, Université d’Oran 2 ; Professeur Hadj Miliani, Université de Mostaganem ; Professeur Anda Radulescu, Université de Craiova (Roumanie) ; Professeur Najib Redouane, California State University, Long Beach (USA) ; Dr. Seza Yilancioglu, MC, Université Galatassaray (Turquie) ; Dr. Zinaï Yamina, MC/A, Université d’Oran 2.
Calendrier
- Soumission des propositions jusqu’au 31 juillet 2015
- Evaluation des propositions : septembre 2015
- Notification d’acceptation : 15 septembre 2015
- Envoi des communications : jusqu’au 06 février 2016
Propositions des Participants
- A soumettre à l’adresse e-mail : colloque.roman2015@gmail.com ; f-bendjelid@hotmail.fr ; lyndanawel@hotmail.fr
- (Time new roman12, interligne 1,5)
- Nom et prénom du communicant, grade, institution universitaire d’attache
- Titre de la proposition
- Axe dans lequel s’inscrit la proposition
- Résumé de la proposition en 500 mots au plus
- Notice bio-bibliographique de l’auteur [Réduire] Contact : colloque.roman2015@gmail.com,f-bendjelid@hotmail.fr, lyndanawel@hotmail.fr |
Du 04 au 05 Mai 2015 :
| |
LA LITTERATURE A L’EPREUVE DE LA CIVILISATION DE L’IMAGE batna (algérie) - université de batna Université Hadj Lakhdar- Batna-Algérie
Faculté des Lettres et des langues
__________________________________________________________
Le Laboratoire « Imaginaire orale et civilisation de l’oralité, de l’écriture et de l’image », en collaboration avec l... [Afficher la suite] Université Hadj Lakhdar- Batna-Algérie
Faculté des Lettres et des langues
__________________________________________________________
Le Laboratoire « Imaginaire orale et civilisation de l’oralité, de l’écriture et de l’image », en collaboration avec la Faculté des Lettres et des Langues de l’université de Batna (Algérie), organise
le 1er Colloque international sur:
LA LITTERATURE A L’EPREUVE DE LA CIVILISATION DE L’IMAGE
5-6 mai 2015
___________________________________________________________
APPEL A COMMUNICATIONS
Argumentaire
Véritable ontologie, l’image se distingue par une présence historique, en symbiotique relation avec l’existence même de l’homme depuis les figures rupestres (à ce titre, elle relève des structures anthropologiques profondes de l’imaginaire). Présence symbolique, aux dimensions tant abstraites que sociales, sacralisée, investie de pouvoirs magiques, de capacités occultes, alliant dialectiquement le phénomène et le noumène, l’essence et l’être, l’identité et la différance, le figuratif et l’abstrait, le réel et le simulacre, l’image a fait de l’homme un éternel iconolâtre. Jusqu’à faire de la poésie, première expression de la littérature, une activité, une production d’images, et de l’imaginaire le ferment de tout travail scripturaire.
La littérature, alchimie du verbe, des mots, de leur juxtaposition et combinaison, faculté des plus mystérieuses, des plus prolifiques, reste, pour une large part, énigmatique, mais foncièrement tributaire de l’image. Car l’acte scripturaire devient, chaque jour un peu plus, présentations de représentations, intégrant un espace sémantique adjacent à la poétique proprement dite, et introduit ainsi un espace à la fois textuel et figuratif.
Si l’ingénieuse imprimerie a entrainé une diffusion élitiste du livre, l’image a suturé très rapidement le dénivellement dans la réception. Désormais, le lecteur est devenu majoritairement spectateur, et le lisible se voit supplanter par le visible. Ce progrès, incontestablement celui de l’image, annoncé par certains visionnaires, comme étant la culture de cette dernière, s’impose partout, dans tous les domaines.
L’essor des technologies de la communication favorisant la propension de l’image, a substitué l’imaginaire iconique à celui du verbe. La sémiologie, nouvelle science de toutes les ambitions, dénue à l’image cette neutralité apparente, lui donne un statut privilégié dans ses prospections, interprète l’espace iconique dans des perspectives multiples, aussi bien artistiques qu’idéologiques, et montre la relation indéniable des textes et des arts figuratifs.
Libérant l’image de sa nature exclusivement artistique, les nouvelles technologies participent à l’inversion de la tendance et les textes deviennent secondaires face à l’activité picturale, disséminée dans des substances variées : photographie, cinéma, télévision, internet, industries à l’origine du village planétaire (Le message c’est le médium, annonce prophétiquement Marshall Mc Luhan, dès les années soixante).
Véritables enjeux du monde moderne, sans concurrent notable, les images, dans leurs différentes configurations, investissent l’économie, le capital, le marketing, les médias, l’information, la formation, la publicité, les loisirs, et se généralisent grâce à la fascination évidente et indiscutable des écrans de plus en plus performants et envahissants, évinçant tous les autres supports.
Dans un tel contexte, quel devenir pour la littérature ? Quel destin pour tous les arts symboliques ? Devant le succès sans précédent de l’image, aidée par ces puissants moyens technologiques, une influence mutuelle du scriptural et du pictural, est-elle raisonnablement envisageable ? La textique, ensemble de textes où l’image sous-jacente veille jalousement à sa prééminence, ne se substitue-t-elle pas insidieusement à la vénérable littérature ? Se peut-il que la densité inaliénable du texte triomphe de l’image et en fasse un accessoire, un ersatz de l’expression poétique ? L’hybridité de l’opacité des productions littéraires, et de la transparence des reproductions iconiques serait-elle possible ?
Axes de recherche suggérés :
1- Atavismes et avatars de l’imaginaire littéraire face aux mutations civilisationnelles.
2- Interférences des lettres et des arts visuels (arts figuratifs, photographie, cinéma, bande dessinée, télévision, publicité, internet, etc.).
3- Littérature / image : mimésis, sémiosis, synergies, déterminations.
4- Rhétorique de l’image et évanescence de la littérature.
5- Civilisation de l’image et textique.
6- Scripturalité, lisibilité, visibilité, sensibilité.
7- Médias, culture de masse, imagologie, mondialisation.
8- Enjeux, horizons, perspectives.
Instances du colloque :
Président d’honneur : Pr. Tahar Benabid, Recteur de l’Université.
Directeur du colloque : Pr. Abdessalem Dhif , Doyen de la Faculté
Président du colloque: Pr.Tayeb Bouderbala, Directeur du Laboratoire
Comité scientifique :
-Dr. Malika Noui (Présidente)
-Dr. Saida Benbouza
-Dr. Miloud Reguig
-Dr. Said Saidi
-M.A.Abdealaziz Agti
-M.A. Salima Messaoudi
Comité d’organisation
-Dr.djamel Saadna (Président)
-Dr.Tareq Thabet
-M.A. Abdelaziz Fidhali
-M.A. Djemai Benharkat
- M.A. Fatima Zahra Chalabi
- M.A. Chaia Bey
Conditions de participation :
- Originalité et intérêt scientifique des textes de communications.
- Résumé de 300 à 500 mots.
- Communications de 4000 à 7000 mots.
- Graphie : Times new roman, 14.
- Langues des résumés et des communications du colloque :
- l’arabe, le français et l’anglais.
Calendrier :
- 28 février 2015 : date limite de réception des propositions de communications. (résumé de 300 à 500 mots).
- 05 mars 2015 : date limite de notifications d’acceptation ou de rejet du comité scientifique.
- 10 avril 2015 : date limite de réception des textes définitifs des communications.
- 20 avril 2015 : Notification d’acceptation pour les communications retenue par le Comité scientifique.
- 5-6 mai 2015, date du colloque.
- Les propositions de communication doivent être accompagnées d’un court C.V.
-Les intervenants disposeront de 20 minutes pour la présentation de la communication, suivie de 10 minutes de discussion.
- Les frais d’inscription, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par les organisateurs. Les frais de déplacement sont à la charge des intervenants.
-Les résumés et les communications sont à envoyer à:
Littrature.civilisation@yahoo.fr
_________________________________________________
Contact : +(213)772262648
ou +(213)774734412
Formulaire de participation
-Nom et prénom…………………………….
-Diplôme……………………………………..
-Grade scientifique……………………………
-Spécialité………………………………………
-Institution d’affiliation………………………..
-Fonction…………………………………………
-Ville……………………………………………..
-Pays……………………………………………..
-Mail…………………………………………………
-téléphone……………………………………………
-Axe choisi……………………………………………
-Titre de la Communication………………………….
-Mots clés……………………………………………..
- Publication Scientifique…………………………….
Responsable :
Pr.Tayeb Bouderbala
U.R.L. de référence :
www.univ-batna.dz
Adresse :
Université de Batna-Algérie [Réduire] Contact : Littrature.civilisation@yahoo.fr |
Du 27 au 28 Mai 2015 :
| |
Colloque au 83ème Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) "Le récit colonial dans les littératures francophones contemporaines" Rimouski, Québec (Canada) - Université du Québec à Rimouski Les littératures francophones, toutes aires et tous genres confondus, se sont alimentées du fait colonial soit pour le justifier (littérature colonialiste), soit pour le dénoncer (littérature anticoloniale). Après les indépendances, la pensée s’est tournée, avec la littérature et la crit... [Afficher la suite] Les littératures francophones, toutes aires et tous genres confondus, se sont alimentées du fait colonial soit pour le justifier (littérature colonialiste), soit pour le dénoncer (littérature anticoloniale). Après les indépendances, la pensée s’est tournée, avec la littérature et la critique postcoloniales, vers la condition des pays libérés du joug colonial, leurs nouveaux rapports avec leurs maîtres d’hier, leur place dans le nouvel ordre du monde. Au lendemain de la fin du protocole colonial, Albert Memmi, une des figures de proue de la pensée postcoloniale s’étonnait que « par une conjonction inattendue, ex-colonisés et ex-colonisateurs se rejoignent […] pour suggérer que la colonisation fut une idylle, un peu agitée, mais somme toute poétique, après laquelle ces amants intelligents seraient demeurés les meilleurs amis du monde » (Anthologie des écrivains du Maghreb. Paris : Présence Africaine : 1969, 13) tout en soulignant le corrélat politique d’un tel changement de vue : « Ainsi, les nécessités de la politique rejoignent une autre aspiration banale des peuples : l’oubli des misères passées, leur transfiguration en mythes rassurants et flatteurs » (ibidem). Au tournant du siècle, un des continuateurs de la pensée postcoloniale, Achille Mbembe, en réorientait la réflexion vers d’autres utopies : « De la postcolonie suggère que pour sortir du cul-de-sac fanonien – celui de la circulation et de l’échange généralisé de la mort comme condition de la montée en humanité – il importe d’examiner dans quelle mesure donner la mort à la mort serait, en fait, le noyau de toute véritable politique de la vie et, partant, de la liberté » (De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine : 2000, xvii).
Où se situent les littératures francophones de l’époque contemporaine par rapport au récit colonial ? Telle est la problématique que notre colloque entend soumettre à la réflexion des chercheurs qui s’intéressent aux représentations de la colonisation dans les littératures francophones. Puisque, manifestement, ces dernières n’ont pas franchi le pas de l’oubli que craint et dénonce Memmi, une série de questions (non limitative) nous aidera à explorer le sujet. Comment les littératures francophones contemporaines représentent-elles la colonisation ? L’investissent-elles de nouveaux contenus ? Lui fixent-elles de nouveaux enjeux ? Déploient-elles de nouvelles techniques d’écriture ? Quelles nouvelles utopies, quels nouveaux projets de société proposent-elles et à quelles fins ? A quelle nouvelle épistémè le champ littéraire francophone contemporain, en gardant ouverte la page de l’histoire coloniale, ouvre-t-elle ? Quel(s) autre(s) savoir (s) sur le phénomène colonial – et ses divers épiphénomènes – cette épistémè recèle-t-elle ? A quelle nouvelle (méta)critique du fait colonial les textes littéraires s’emploient-ils ? Comment inscrivent-ils, dans leur déploiement narratif et énonciatif, la mémoire coloniale ?
Merci d’envoyer une proposition de communication d’environ 250 mots, avant le 15 février, aux responsables du colloque dont les courriels suivent:
- Philippe Basabose, Memorial University of Newfoundland, basabose@mun.ca
- Josias Semujanga, Université de Montréal, josias.semujanga@umontreal.ca [Réduire] Contact : josias.semujanga@umontreal.ca, basabose@mun.ca |
Du 22 au 24 Janvier 2015 :
| |
Rencontre Frantz Fanon, Kateb Yacine, Édouard Glissant Paris (France) - INSTITUT DU TOUT-MONDE, Maison de l’Amérique Latine La "Rencontre Frantz Fanon, Kateb Yacine, Edouard Glissant" se tiendra les vendredi 23 et samedi 24 janvier 2015 à la Maison de l'Amérique à Paris, et se prolongera le dimanche 25 janvier au New Morning par une soirée spéciale, poétique et musicale, consacrée aux trois écrivains.
... [Afficher la suite] La "Rencontre Frantz Fanon, Kateb Yacine, Edouard Glissant" se tiendra les vendredi 23 et samedi 24 janvier 2015 à la Maison de l'Amérique à Paris, et se prolongera le dimanche 25 janvier au New Morning par une soirée spéciale, poétique et musicale, consacrée aux trois écrivains.
Vendredi 23 janvier 2015
Lieu : Maison de l'Amérique latine
"Fanon, Kateb, Glissant : de la décolonisation aux indépendances"
10h00 : Ouverture de la rencontre : Sylvie Glissant et Catherine Delpech-Hellsten
10h15-12h00 : conférences. (Présidente de séance : Danielle Perrot-Corpet)
Daniel-Henri PAGEAUX : « Fanon, Glissant, Yacine. Écritures de la médiation »
Victoria FAMIN : « Écriture, lecture et analyse des atavismes dans l’œuvre d’Edouard Glissant, de Frantz Fanon et de Kateb Yacine »
Florian ALIX : « Raconter des luttes anticoloniales en contrepoint : chroniques épiques et lyrisme ironique dans Les Damnés de la terre, L’Homme aux sandales de caoutchouc et Ormerod »
14h00 – 16h15 : conférences. (Présidente de séance : Catherine Delpech-Hellsten)
Samia KASSAB CHARFI : « Frantz Fanon, Edouard Glissant, Kateb Yacine : visions croisées »
Bénamar MEDIENE : « Fanon, Kateb, Glissant : le verbe tendu comme une catapulte »
Zineb ALI BENALI « Nommer le monde c’est le rencontrer. Glissant, Kateb, Fanon… »
Manthia DIAWARA : « La réception des trois auteurs aux USA »
Raphaël LAURO : « Brève présentation des archives politiques d'Edouard Glissant - Années 1950-1960 »
« Paroles d'Abdelwahab Meddeb – Hommage »
16h15 – 19h00: Table ronde (Présentée et dirigée par Samia-Kassab Charfi)
Benamar Médiene, Tahar Bekri, Nicole Lapierre, Daniel Henri Pageaux, Michaël Dash, Charles Bonn.
Samedi 24 janvier 2015
Lieu : Maison de l'Amérique latine
"Penser le monde aujourd'hui, avec Frantz Fanon, Kateb Yacine, Édouard Glissant"
14h15 : Présentation de Romuald Blaise Fonkoua
14h30 - 15h40 : conférences. (Présidente de séance : Samia Kassab-Charfi)
Michael DASH : « Naître au monde: Frantz Fanon, Edouard Glissant et le rêve d'habiter »
Edwy PLENEL : « Martinique, Algérie : de l’île au continent, l’archipel des indépendances »
Catherine DELPECH-HELLSTEN : « F. Fanon, K. Yacine, É. Glissant, passeurs de peuples »
15h45 – 17h30 : Table ronde (Présentée et dirigée par Romuald Blaise Fonkoua)
Alice Cherki, Manthia Diawara, Benjamin Stora, Edwy Plenel, Zineb Ali Benali.
Dimanche 25 janvier 2015
Lieu : New Morning
Soirée au New Morning autour des textes de Frantz Fanon, Kateb Yacine et Édouard Glissant, avec
Jacques Coursil, Julien Béramis, Jean-Michel Martial... [Réduire] |
Du 25 au 26 Mai 2015 :
 |
Colloque international : « Frantz Fanon, la révolution algérienne et l’interdisciplinarité » Bejaia les 26 et 27 mai 2015. Bejaia (Algérie) - Université de Bejaia. Colloque internationale oraganisé par la faculté des sciences humaines de l'Université Abderrahmane-Mira de Bjaia |
Du 16 au 19 Mars 2015 :
 |
3ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts Rabat (Maroc) - Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc Appel à candidatures : Concours de posters scientifiques
Le Bureau Maghreb de l’Agence universitaire de la Francophonie a choisi d’inscrire la 3ème édition du Forum Universitaire Maghrébin des Arts sous le signe de la Communication interculturelle. Nous invitons les étudiants issus des �... [Afficher la suite] Appel à candidatures : Concours de posters scientifiques
Le Bureau Maghreb de l’Agence universitaire de la Francophonie a choisi d’inscrire la 3ème édition du Forum Universitaire Maghrébin des Arts sous le signe de la Communication interculturelle. Nous invitons les étudiants issus des établissements membres de l'AUF en Algérie, au Maroc et en Tunisie (niveaux Master et Doctorat) de toutes disciplines à illustrer et commenter, au moyen d'un poster scientifique, cette idée de conciliation, harmonieuse ou discutée, de valeurs et d'aspects, de décors et de modes de vie, dont le Maghreb contemporain tire son originalité.
Date limite : 30 janvier 2015 [Réduire] |
Du 17 Novembre 2014 au 15 Janvier 2015 :
 |
Appel à candidature : Collège doctoral "Patrimoine dans le pourtour méditerranéen" L'Agence universitaire de la Francophonie propose aux étudiants d’intégrer le Collège doctoral inter-régional "Patrimoine dans le pourtour méditerranéen" qu'elle met en place dans les régions Maghreb et Europe centrale et orientale. Les candidats doivent être des doctorants inscr... [Afficher la suite] L'Agence universitaire de la Francophonie propose aux étudiants d’intégrer le Collège doctoral inter-régional "Patrimoine dans le pourtour méditerranéen" qu'elle met en place dans les régions Maghreb et Europe centrale et orientale. Les candidats doivent être des doctorants inscrits en deuxième et troisième année à la rentrée universitaire 2014-2015 dans un établissement membre de l'AUF relevant du Bureau Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et du Bureau Europe centrale et orientale. L'appel à candidatures a pour objet la sélection d'une cohorte de doctorants qui bénéficieront de cet accompagnement sur une période de 3 ans. [Réduire] |
Du 15 au 16 Decembre 2014 :
| |
Langues et identités des écrivains méditerranéens francophones de la diaspora. Etat des lieux Oran (Algérie) - UCCLLA-CRASC |
Le 10 Decembre 2014 :
 |
Banlieues enragées, banlieues engagées: littérature, cinéma et pouvoir Bologne (Italie) - Université de Bologne, Département LILEC Contact : ilaria.vitali@unibo.it |
Le 23 Novembre 2014 :
 |
La marginalité dans le roman contemporain algérien Oran (Algérie) Journée d'études |
Du 30 Novembre au 02 Decembre 2014 :
| |
Paris (France) - Université Paris 8 Contact : zinebbenali@yahoo.fr et tquemeneur@hotmail.com |
Du 02 au 04 Decembre 2014 :
| |
L’Occident au prisme de l’Islam. Montpellier (France) - Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier Salle des séminaires 17, rue de l’Abbé de l’Epée 34090 Montpellier Programme du colloque MSH-M
L’Occident au prisme de l’Islam.
Montpellier, 3-5 décembre 2014
Responsables : Maxime Del Fiol (UPV, RIRRA 21) et Claire Mitatre (UPV, CERCE)
Partenaires : Centre Jacques Berque (Rabat), Institut de Recherches sur le Maghreb Contemporain (Tunis), Passages... [Afficher la suite] Programme du colloque MSH-M
L’Occident au prisme de l’Islam.
Montpellier, 3-5 décembre 2014
Responsables : Maxime Del Fiol (UPV, RIRRA 21) et Claire Mitatre (UPV, CERCE)
Partenaires : Centre Jacques Berque (Rabat), Institut de Recherches sur le Maghreb Contemporain (Tunis), Passages XX-XXI (Lyon II), Université Montpellier 3
Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier
Salle des séminaires
17, rue de l’Abbé de l’Epée 34090 Montpellier
MERCREDI 3 DECEMBRE : RELIGION ET CONSTRUCTION DE L’ALTERITE
9h30 - Accueil des participants
9h45 - Maxime Del Fiol et Claire Mitatre : Introduction
10h30 - Pause café
Président : Paul Pandolfi
11h00 - Dominique Casajus : « Pour les Touaregs, les Occidentaux ne sont-ils que des Infidèles ? »
11h30 - Zakaria Rhani : « Des djinns musulmans et chrétiens. Que disent les relations inter-spécifiques du rapport entre humains ? »
12h - Débat
12h15 - Pause déjeuner
Président : Claire Mitatre
14h00 - Abderrahmane Moussaoui : « Eglise d’Algérie ou Eglise algérienne ? »
14h30 - Hassan Rachik : « Facettes extrêmes de l’Occident : idéologies religieuses réformistes et radicales »
15h 00 - Débat
15h15 - Pause café
Président : Eric Soriano
15h45 - Thomas Brisson : « Une position intenable ? Tariq Ramadan – Relecture sociologique d’une critique théologico-politique de l’Occident »
16h15 - Débat et clôture de la journée
JEUDI 4 DECEMBRE : MODELES, REFERENCES, USAGES
9h30 - accueil des participants
Président : André Mary
9h45 - Makram Abbes : « Approche du texte coranique entre islamisme et orientalisme »
10h15 - Jamal Bammi : « Le savoir médical au Maroc du 19e siècle après le « choc de l’Occident » : analyse anthropo-historique »
10h45 - Débat
11h00 - Pause café
Présidente : Touriya Fili
11h30 - Ridha Boulaabi : « L’homoérotisme oriental au risque de l’Occident »
12h - Débat
12h15 - Pause déjeuner
Président : Maxime Del Fiol
14h - Abdul Karim Barghouti : « Occidentalism : Tahtawi and Tantawi, Sharabi and Abu-Lughod »
14h30 - Robbert Woltering : « Representations of the West in post-Mubarak Egypt »
15h - Débat
15h15 - Pause café
Président : Hassan Rachik
15h45 - Touriya Fili : « Lumière d’Orient et Occident des lumières : l’utopie contrariée de Mohammed Ibn Al Hassan Al Hajoui»
16h15 - Abdel Wedoud Ould Cheikh : « Des (in)commodités de la traduction »
16h45 - Débat et clôture de la journée
VENDREDI 5 DECEMBRE : PRISMES LITTERAIRES
9h30 - accueil des participants
Présidente : Claire Ducournau
9h45 - Sonia Zlitni Fitouri : « L’Occident à l’épreuve de l’imaginaire maghrébin dans la littérature maghrébine de langue française »
10h15 - Daniel Lançon : « L’Islam des orientaux francophones au début du 20e siècle : l’utopie de la concorde »
10h45 - Débat
11h00 - Pause café
Président : Ridha Boulaabi
11h30 - Jalel Al Gharbi : « Ahmed Faris Chidyaq : le plus arabe des écrivains rabelaisiens »
12h00 - Richard Jacquemond : « La perception arabe de « l’Occident » au prisme des traductions littéraires contemporaines »
12h30 - Débat et clôture du colloque
13h00 Déjeuner [Réduire] Contact : maximedelfiol@gmail.com |
Le 05 Novembre 2014 :
 |
Littérature tunisienne et révolution Tunis (Tunisie) - CREDIF, El Manar 2, Tunis Contact : Kmar Bendana |
Du 01 au 02 Avril 2015 :
 |
« Orient/Occident : Représentations croisées » Marrakech (Maroc) - Faculté des lettres de l’université Cadi Ayad de Marrakech Cette manifestation, qui sera co-organisée par le Laboratoire Culture, Patrimoine et Tourisme Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Marrakech et les équipes d’Accueil TELEM/CLARE, Université de Bordeaux-Montaigne, fera suite à un premier colloque organisé le 21-22 novembre 2013 par l’�... [Afficher la suite] Cette manifestation, qui sera co-organisée par le Laboratoire Culture, Patrimoine et Tourisme Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Marrakech et les équipes d’Accueil TELEM/CLARE, Université de Bordeaux-Montaigne, fera suite à un premier colloque organisé le 21-22 novembre 2013 par l’équipe TELEM/Bordeaux-Montaigne à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. Elle prolongera les réflexions et les discussions ainsi engagées autour de l’altérité et ses représentations dans le monde arabo-musulman.
Depuis les années 1970, le concept d’« orientalisme », théorisé par Edward Said, a beaucoup servi comme paradigme opératoire pour étudier l’altérité arabo-musulmane. La thèse développée dans le livre manifeste Orientalism (1978) postule qu’au-delà de l’acception classique d’un Orientalisme « universitaire » en tant que domaine d’érudition dont le champ d’investigation est l’Orient, ce domaine s'avère être « un style occidental de domination, de restructuration et d’autorité sur l’Orient » . S’inspirant des théories foucaldiennes sur le discours et le savoir-pouvoir, Said considère l’orientalisme comme un discours produit d’un point de vue politique, sociologique, militaire, idéologique, et imaginaire autant que scientifique, donnant lieu à un savoir orientaliste producteur de représentations négatives sur un Orient imaginaire créé par l’Occident.
Si la thèse d’Edward Said a eu plus d’audience que d’autres essais du même ordre , c’est parce qu’en plus des raisons d’ordres politique, scientifique et institutionnelle inhérentes au contexte américain, ce dernier a englobé dans le concept d’« orientalisme » différents champs disciplinaires allant de la politique à l’anthropologie tout en donnant une place importante à la critique littéraire et la critique d’art. L’autre apport essentiel de la théorie saidienne réside dans le fait d’avoir relié l’analyse historique des situations coloniales à la notion plus large d’« empire ». L’universitaire américain d’origine palestinienne a fait du colonialisme un paradigme théorique et heuristique, une forme globale de pensée, qui dépasse largement l'ordre politique lié à la période historique du colonialisme.
« Depuis L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (traduit en français en 1980), écrit Yves Gounin, […] aucune aire culturelle ne peut désormais être appréhendée sans s’interroger sur la manière dont les discours et les fantasmes européens l’ont façonnée » . Plus encore, certains chercheurs comme Thomas Brisson considèrent que « L’Orientalisme (1978) d’Edward Said est […] unanimement considéré comme le moment fondateur d’une prise de parole des intellectuels arabes (mais aussi indiens, asiatiques ou africains) au sein des champs de savoir occidentaux» .
Dans un récent ouvrage intitulé Après l’orientalisme. L’Orient créé par l’Orient, Jean Claude Vatin fait le constat suivant : « Nous sommes, en principe, au-delà de l’orientalisme, mais nous n’en finissons pas de payer le passif de sa succession […]. Depuis deux décennies, on a l’impression de piétiner dans l’après-saidisme. Impression fausse si l’on juge par une vaste littérature touchant les études postcoloniales… »
Cette remarque est doublement pertinente. En effet, la thèse saidienne continue, encore aujourd’hui, à alimenter les débats, surtout avec les récents événements politiques qui ont mis d'une manière brutale et surprenante l’Orient sur le devant de la scène mondiale, poussant certains chercheurs à qualifier l’attitude occidentale, surtout américaine, à l’encontre du monde arabo-musulman, de néoorientalisme, qui serait le visage moderne voire post-moderne de l’ancien orientalisme. De plus, on remarque depuis quelques décennies, surtout dans le monde anglo-saxon, l’émergence d’un nouveau champ de recherche, celui des études postcoloniales, dont L’Orientalisme serait une pièce fondatrice.
Néanmoins, s’ils reconnaissent le rôle primordial joué par l’œuvre d’E. Said dans la genèse des études postcoloniales, certains théoriciens à l’image d’Homi Bhabha, contestent une partie de l’analyse saidienne en remettant en cause l’« essentialisation anhistorique » qui consisterait à confondre le discours universitaire et la prise de position militante ainsi que les oppositions binaires et les modes de représentations déterministes et fonctionnalistes. L’opposition frontale entre l’Orient et l’Occident, entre « Nous » et les « Autres », se trouve alors nuancée par l’introduction de concepts tels que l’« hybridité », «l’ambivalence » «le processus de subjectivation », « la créolisation »… qui sont mis en avant pour reconsidérer des identités longtemps données pour figées et déterminées par une instance hégémonique. Ces « nouvelles identités » à déterminer se situeraient dans des espaces interstitiels, d’entre-deux, qu’Homi Bhabha définit comme des « terrains d'élaboration des stratégies du soi » .
Comme lors de la précédente session, nous continuerons dans nos travaux à interroger les représentations, « ces formes de l’économie humaine, nécessaires pour la vie en société et entre les sociétés » , que se fait l’Orient arabe de l’Occident.
Toutefois, si nous avions dans notre premier colloque privilégié la parole « locale », celle de la périphérie, en réservant une place de choix aux communications qui mettaient en exergue la voix des Orientaux à travers différentes époques et à partir de multiples lieux, nous avons décidé lors de cette nouvelle session d’élargir le champ d’études et d’échanges en donnant la parole aussi à l’Autre, l’Occidental, afin d’enrichir nos débats, de multiplier les points de vues et les approches scientifiques. C’est de cette manière que nous croyons possible un échange fructueux et un débat fécond. C’est pourquoi nous parlons de croiser les « regards », parce que, comme le dit Hegel, c’est à travers cet acte du regard que les êtres doués de conscience sont en relation et que se révèle l’existence de l’Autre.
Nous nous y emploierons donc lors de cette nouvelle session en questionnant, à la lumière des récents changements, politiques, économiques et épistémologiques qui ont affecté le monde moderne et qui continuent de modeler notre réalité contemporaine, les nouvelles représentations véhiculées dans le monde des lettres et des arts orientaux et occidentaux.
Certains chercheurs arabes reprochèrent à Edward Said d’avoir sciemment « orientalisé les Orientaux » en occultant toutes les tentatives et essais d’intellectuels arabes pour contester l’hégémonie occidentale. N’y a-t-il pas eu de voix arabes qui se sont élevées pour contester voire déconstruire l’image qu’on se faisait d’eux ? La production littéraire et artistique moderne et contemporaine arabe ne recèle-elle pas de traces de cette remise en question, ne véhicule-t-elle pas de nouvelles représentations ignorées par l’Autre ?
Par ailleurs, en Occident, est-il vrai que toute la production culturelle depuis le XIXe siècle est marquée par le sceau indélébile du colonialisme ? N’y aurait-il pas de voix dissonantes ? Est-il vrai que la littérature et les arts occidentaux n’ont véhiculé que des représentations négatives d’un Orient fantasmé, craint, puis érigé en ennemi à abattre ?
Qu’en est-il aussi de ceux qui évoluent dans l’entre-deux, qui se déplacent d’un bord à l’autre, ou qui ne revendiquent aucune appartenance ?
Voilà quelques unes des questions, parmi d’autres, qui motivent et animeront ce colloque dans lequel deux grands axes seront privilégiés :
- Le premier portera sur la littérature, arabe ou occidentale, arabe ou francophone, moderne ou contemporaine. Les communications pourront porter sur l’analyse textuelle, la critique littéraire, l’histoire littéraire ou sur les théories critiques ou littéraires ayant pour objet d’étude l’altérité.
- Le deuxième axe portera sur les Arts, arabes ou occidentaux modernes ou contemporains. Par arts, nous ciblons tous les genres artistiques : arts du spectacle, arts visuels, arts cinématographiques, arts plastiques…
Modalités de participation
Les propositions de communication (titre, résumé en français de 2000 signes), ainsi qu’une brève notice biobibliographique (nom, prénom, affiliation, courriel, intérêts de recherche, titres de publications) seront à envoyer par mail en format.doc ou. pdf jusqu’au 15 décembre 2014, à l’adresse suivante : colloquemarrakech2015@gmail.com
Après sélection du comité scientifique les candidats recevront une notification avant le 15 janvier 2015.
Pour les propositions retenues, une version préliminaire des communications (30 000 signes) est à envoyer avant le 15 mars 2015.
Les interventions qui seront sélectionnées par le comité scientifique feront l’objet d’un volume à paraître en 2016.
L'inscription au colloque est gratuite. Le comité d’organisation prendra en charge deux déjeuners (2-3 avril) et un dîner (2 avril). Les frais de transport, d’hébergement sont à la charge des participants. Les organisateurs mettront à la disposition des participants des offres d’hébergement pour la période du déroulement du colloque (possibilité de réservation de logements universitaires).
Comité scientifique :
Reina Abed, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université libanaise
Khadija Alaoui-Youssoufi, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Michel Ballard, Université de l’Artois
Ayoub Bouhouhou, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Jacqueline Chabbi, Université de Paris-VIII
Laurence Denooz, Professeur, Université de Lorraine /Université libre de Bruxelles
Jean-Michel Devesa, Université Bordeaux-Montaigne
Eddy Dufourmont, Université Bordeaux-Montaigne
Boutros El-Hayek, Université Lille-3
Gonzalo Fernández Parrilla, Universidad Autónoma de Madrid
Omar Fertat, Université Bordeaux-Montaigne
Touriya Fili-Tullon, Université Lumière-Lyon 2
Saïd Hammoud, Université Bordeaux-Montaigne
Stéphane Hirschi, Université de Valenciennes
Mohamed Jouway, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Pierre Katuscweski, Université Bordeaux-Montaigne
Mustapha Laarissa, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Claude Lefébure, EHESS, Paris
Martine Mathieu-Job, Université Bordeaux-Montaigne
Mohamed Martah, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Jean Peeters, Université de Lorient
Abdelhaï Sadiq, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Ouidad Tebbâa, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Mourad Yelles, INALCO
Comité d’organisation :
Mostapha Boudjafad, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Hanane Essaydi, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Omar Fertat, Université Bordeaux-Montaigne
Saïd Hammoud, Université Bordeaux-Montaigne
Abdelhaï Sadiq, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Ouidad Tebbâa, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech
Responsables :
Omar Fertat, Université Bordeaux-Montaigne
Abdelhaï Sadiq, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech [Réduire] |
Du 12 au 13 Octobre 2015 :
| |
Les littératures contemporaines de l’exil Annaba (Algérie) - Faculté des Lettres Sciences Humaines et Sociales Contact : Pr. Dalila MEKKI |
Du 15 au 16 Decembre 2014 :
 |
Women as Self, Women as Other. (De)constructing Female Identities and Representations Guelma (Algérie) - Université 8 Mai 1945 -Guelma. Faculté des Lettres et des Langues The colloquium aims at examining how the ‘feminine’ is (de)constructed, (re)defined and identified in different (con)texts, discourses, and practices. Due, partly, to the development of feminist, women, and gender studies, and to the critical tools they offer in different disciplines, one can ob... [Afficher la suite] The colloquium aims at examining how the ‘feminine’ is (de)constructed, (re)defined and identified in different (con)texts, discourses, and practices. Due, partly, to the development of feminist, women, and gender studies, and to the critical tools they offer in different disciplines, one can observe a growing awareness in regard to the importance of reconsidering what was for long regarded as unquestionable and immutable when it comes to women’s concerns and issues. For instance, normalized/canonized representations and discourses that directly or indirectly contribute in shaping female identities are actually being challenged thanks to critical/fictional works that offer new readings, new visions, and new perspectives. This pluridisciplinary colloquium proposes to shed light on the former issues, and welcomes contributions covering a variety of disciplines including: literature, arts, translation, civilization, linguistics, etc. [Réduire] Contact : colloquium.2014.women@gmail.com |
Du 03 au 04 Mai 2015 :
 |
L'Emir Abdelkader, Poètique et Tassawuf Oran (Algérie) - UCCLLA/CRASC à Es-Senia L’EMIR Abdelkader : Poétique et Tasawwuf
Les 04 et 05 mai 2015 au siège de l’UCCLLA/CRASC
Es-Senia – Oran –
Beaucoup de travaux ont été consacrés aux aspects politiques, militaires, et stratégiques qui ont marqué le parcours de l’Emir Abdelkader (1808 – 1883), mais parado... [Afficher la suite] L’EMIR Abdelkader : Poétique et Tasawwuf
Les 04 et 05 mai 2015 au siège de l’UCCLLA/CRASC
Es-Senia – Oran –
Beaucoup de travaux ont été consacrés aux aspects politiques, militaires, et stratégiques qui ont marqué le parcours de l’Emir Abdelkader (1808 – 1883), mais paradoxalement sa vie intellectuelle n’a fait l’objet que de peu de travaux de recherche.
Ses postures intellectuelles et littéraires ont fait de lui une personnalité éminente qui a su faire face aux défis et enjeux de l’époque. Porteur d’un projet humaniste, il a pu dépasser, par sa profonde vision, les frontières locales et régionales.
L’Emir n’a pas été uniquement le fondateur de l’Etat Algérien moderne et résistant à l’occupation française durant plusieurs années, il s’est illustré, également, par la maîtrise du verbe, tantôt poète, tantôt penseur traitant de plusieurs questions.
Il a légué un œuvre très riche dont on peut citer « Kitab al mawaquif » ou « Le livre des haltes » et « Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent » traduit par « Lettre aux Français » où il met en exergue le mérite du savoir et des savants. Il a écrit de même plusieurs traités et poèmes qui font de lui un poète et un soufi de grande stature.
Le rapprochement de l’Orient et de l’Occident, le dialogue des cultures et des religions ont été au cœur de ses réflexions. Il est à rappeler que plusieurs colloques nationaux et internationaux ont été organisés afin d’étudier la vie et l’œuvre de l’Emir Abdelkader. On peut en citer à titre d’exemple : Le colloque international organisé à Tlemcen à l’occasion de l’évènement culturel : Tlemcen Capitale de la Culture Islamique 25-28 Février 2012, le symposium international à l’Université de Uludag (Barça – Turquie) les 11-13 Mai 2012 colloque national qui s’est tenu du du 28 au 30 mai 2013 à Alger, et le colloque international organisé à Mascara les (11-13 Mars 2014), etc., autant d’ activités scientifiques organisées par des universités, des centres de recherches, la Fondation Emir Abdelkader et autres associations.
Il s’agit pour nous dans ce colloque qu’organise l’Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, la Littérature et les Arts UCCLLA affiliée au CRASC d’envisager une lecture approfondie des textes (littéraires, théologiques, philosophiques) élaborés par cette éminente personnalité historique. Le but étant de faire connaître la pensée de l’Emir Abdelkader (spirituel, poète et soufi) de revisiter son héritage culturel, de mener des lectures croisées en rapport avec le patrimoine universel et de confronter ses prises de positions aux questions du moment.
Axes du colloque:
- Poétique et langage chez l’Emir
- La langue d’écriture chez l’Emir
- Œuvre et expérience Soufie de l’Emir
- La résistance de l’Emir dans la poésie populaire
- Le paradigme de liberté et de tolérance chez l’Emir
- Les fondements théologiques et philosophiques chez l’Emir
- L’Orient et l’Occident, Dialogue des cultures et des religions
- L’image de l’Emir dans l’écriture de l’Autre. [Réduire] Contact : Mohamed DAOUD |
Du 18 au 19 Mars 2015 :
| |
Cette langue est-elle la mienne ? Plurilinguisme et migrations dans la littérature de langue française Colloque International Coimbra (Portugal) - Faculté des Lettres - Université de Coimbra Ce colloque international a pour ambition de formaliser et de théoriser un phénomène qui concerne à la fois la linguistique et la littérature de forme égale. Il existe un intérêt croissant pour l´écriture plurilingue à travers différents types de textes et de genres. Nous espérons recev... [Afficher la suite] Ce colloque international a pour ambition de formaliser et de théoriser un phénomène qui concerne à la fois la linguistique et la littérature de forme égale. Il existe un intérêt croissant pour l´écriture plurilingue à travers différents types de textes et de genres. Nous espérons recevoir des propositions de communications qui combinent un intérêt pour les questions théoriques avec l´analyse de textes ou d´auteurs spécifiques.
L'objectif est de réunir des chercheurs travaillant sur les questions d'actualité dans le contexte des langues et de la culture. Plus précisément, le colloque prétend fournir un aperçu de l´état de l´art, d'explorer de nouvelles directions et les nouvelles tendances dans les cultures et les langues.
Aussi, l’Association Portugaise d’Études Françaises, en partenariat avec la Faculté des Lettres de l’Université de Coimbra, est-elle heureuse d’annoncer ce colloque qu’elle organise à l’Université de Coimbra, les 19 et 20 mars 2015, et en raison duquel elle lance cet appel à communications aux chercheurs que cette thématique transversale ne manquera pas d'intéresser et d’interpeller. [Réduire] Contact : francophonie2015@gmail.com |
Du 25 au 26 Février 2015 :
| |
La littérature de contrebande : de l’exemple à l’exemplarité Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université de Sfax (Tunisie)
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Unité de Recherche en Littérature, Discours et Civilisation (URLDC)
Colloque international
La littérature de contrebande : de l’exemple à l’exemplarité
JEUDI 26 - VENDREDI 27 FEVRIER 2015
L�... [Afficher la suite] Université de Sfax (Tunisie)
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Unité de Recherche en Littérature, Discours et Civilisation (URLDC)
Colloque international
La littérature de contrebande : de l’exemple à l’exemplarité
JEUDI 26 - VENDREDI 27 FEVRIER 2015
L’intitulé de ce colloque fait le rapprochement de notions divergentes, voire antithétiques. Si le mot « contrebande », dérivant de l’italien contrabbando, signifie « fait contre le ban, contre la loi » et implique une expérience de la clandestinité et un rejet des règles imposées par la société, la notion d’exemplarité, associée à exemple, se rattache souvent à un idéal éthique et/ou esthétique. En effet, de par son étymologie, le mot « exemple », -du latin exemplum- signifie : 1/ « qui peut servir d’échantillon », 2/ « un modèle ».
Le premier sens renvoie à ce qu’on appelle l’exemple rhétorique ; il se décline sur plusieurs formes à savoir l’exemple personnel, historique, littéraire, culturel ; la citation, l’anecdote, le récit, la fable, le mythe, …etc. Il apporte des éclaircissements sur des controverses ou des soupçons comme il assure une mise au point. Ainsi, il fonctionne pour appuyer une idée, corroborer un enseignement ou justifier un choix. C’est un outil d’argumentation qui remplit la fonction de preuve. Il s’intègre volontairement dans une narration, dans une démonstration ou encore dans un traité philosophique ou pédagogique. Le recours à l’exemple s’avère une pratique privilégiée dans la production écrite.
Le second sens, modèle, ou « le bon exemple » implique une personne ou une conduite dotée d’un mérite particulièrement convoité et singulièrement digne d’imitation. Le modèle en tant que bon exemple est sous-jacent à la notion d’exemplarité. Celle-ci porte en elle, en fait, une exigence éthique et implique une démarche modèle ; C. Giordano la définit comme l’« ensemble de vertus destinées à être admirées et si possible imitées » . Contrairement à l’exemple qui est un outil pédagogique, l’exemplarité est un état de grandeur saturée vers lequel tend l’Homme. Elle est donc un sujet de réflexion, un thème.
L’exemplarité en tant que thème littéraire se prête à une polémique car les critères du modèle changent en fonction de leur réception. L’exemplaire pour les uns est banditisme pour les autres : Robin Wood, Jean Valjean ou Louis Mandrin incarnent le hors-la-loi, mais ils sont aussi des modèles de courage. Ces marginaux ou brigands ne sont pas des anti-héros chez Mérimée ou Maupassant, mais des insoumis à l’ordre établi. Le bandit corse est, chez ces écrivains, un révolté qui pose le problème de la liberté et des rapports de l’homme à la société. Ce héros en marge du commun, en quête de valeurs humaines universelles, ne porte-t-il pas en lui l’essence de l’exemplarité ?
Opposer l’exemplarité au banditisme ne manque pas de pertinence dans la mesure où le thème, selon Michel Collot , s’associe, par affinité ou par contraste à d’autres signifiants pour donner son plein sens. De ce point de vue, le thème de l’exemplarité renverrait, légitimement, à son thème antithétique du banditisme.
Ce projet cherche à étudier le lien entre exemple, -(un élément de dispositif argumentatif), exemplarité, -(un idéal à atteindre)- et littérature de contrebande, -(fournisseur de modèles de résistance)-, productrice de l’archétype de l’opposant à toute forme d’oppression et d’injustice et ce à travers les personnages du marginal, du brigand et de l’agitateur. Il s’agit d’étudier l’écriture de l’exemplarité vs banditisme dans la littérature dite de contrebande.
Jeter le pont entre littérature de contrebande et exemplarité n’est donc pas étrange …Outre qu’il permet l’analyse des spécificités de chacune d’entre elles, il sous-tend la question des modes de production et de réception de l’œuvre littéraire ; celle du rapport entre la littérature et l’idéologie ou encore la question de la lisibilité et de l’hermétisme du texte littéraire.
Ce projet de recherche ambitionne d’intéresser plusieurs disciplines et de solliciter des lectures de l’exemple et de l’exemplarité de différents angles de vue. Les communications pourraient répondre, mais ne sont pas limitées, aux pistes de réflexion suivantes :
- Entre exemplarité morale et exemplarité esthétique
- Exemplarité et banditisme dans la littérature
- Portrait du hors-la-loi (bandit, rebelle, anti-héros, insurgé, marginal, picard)
- La littérature de contrebande : pratique subversive et / ou fabrique du modèle
- L’écriture de la contrebande : de l’exemple à l’exemplarité
Bibliographie :
- ARAGON, Louis. « Un théâtre de contrebande, quelques hypothèses sur Vitez et le communisme », Sociétés et Représentations, Publication de la Sorbonne, n°11, 2001, p. 382.
- BARTHES, Roland. « L’Ancienne rhétorique. Aide-Mémoire », Communications, n°16, 1970.
- BETTS, Madeleine. La poésie de Résistance, Université Ottawa, 1963.
- BOUJU, Emmanuel, Alexandre Gefen, Guiomar Hautcoeur et Marielle Macé [dir.]. Littérature et exemplarité, Rennes, Presses universitaires de Rennes (« Interférences »), 2007.
- BREMOND, Claude, Jacques le Goff et Jean Claude Schmitt. L’exemplum, Brepols, Turnhout (Belgique), 1982.
- FEDERINI, Fabienne. Ecrire ou combattre : des intellectuels prennent les armes (1942-1944), Paris, La découverte, 2006.
- GIORDANO, C. La fabrication de l’exemplarité, Edition de la Maison des Sciences, 1998.
- MATHIEU Francis, Alchimie rhétorique et morale : l’exemplarité dans le roman de l’âge classique et des Lumières, University of California, Santa Barbara, 2007.
- SAPIRO, Gisèle, La guerre des écrivains (1940-1953), Fayard, 1999.
- SEGHERSS, Pierre. La Résistance et ses poètes, (France 1940-1945), Poésie Seghers, 2004.
Comité scientifique : Ali Abassi, Philippe Antoine, Noël Benhamou, Arbi Dhifaoui, Chabane Harbaoui, Fadhila Laouani, Françoise Laurent, Abdallah Mdarhri Alaoui, Alain Montandon, Kamel Skander, Sonia Zlitni-Fitouri.
Comité d’organisation : Mariem Ahmed, Raoudha Allouche, Arselène Ben Farhat, Taeib Hajsassi Salwa Taktak.
Délai d’envoi des propositions (avec une notice biographique) : 30 octobre 2014 à
allraoudha@yahoo.fr
Date limite de réponse et de confirmation : 31 novembre 2014
Remise des articles : 31 avril 2015
Responsable : Raoudha Allouche et Salwa Taktak [Réduire] Contact : Raoudha ALLOUCHE |
Du 05 au 11 Octobre 2014 :
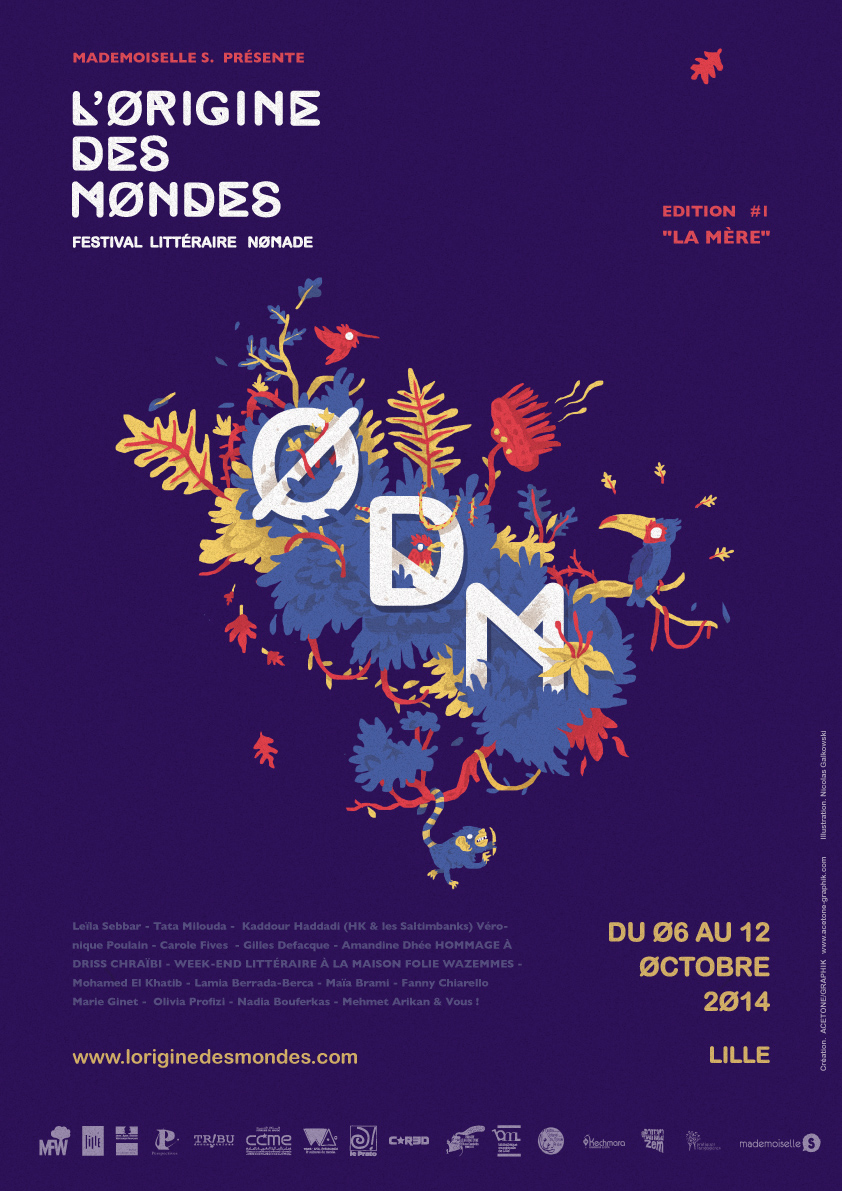 |
L'ORIGINE DES MONDES -Festival littéraire nomade à Lille LILLE (France) - Prato, Maison Folie Wazemmes, Librairie Bateau Livre et ailleurs. Une semaine de rencontres littéraires, mais aussi de lectures musicales, rencontre en appartement sur le thème de la mère. Avec Lamia Berrada, Maia Brami, Leila Sebbar, Mohamed El Khatib, Hommage à Driss Chraibi... Contact : association Mademoiselle S. |
Du 15 au 17 Novembre 2014 :
| |
LA 1ère ÉDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL Nouvelles perspectives en sociolinguistique et en didactique Quels défis pour le terrain francophone ? Constantine (Algérie) - Université Constantine 1 Les problématiques relatives à la sociolinguistique et à la didactique des langues dans les sociétés modernes sont de plus en plus d’actualité. La première concerne intrinsèquement la vie sociale des individus et sa covariance avec les langues qu’ils emploient (A. Meillet 1906 & ... [Afficher la suite] Les problématiques relatives à la sociolinguistique et à la didactique des langues dans les sociétés modernes sont de plus en plus d’actualité. La première concerne intrinsèquement la vie sociale des individus et sa covariance avec les langues qu’ils emploient (A. Meillet 1906 & W. Labov 1967 & L-
J Calvet 1993& H. Boyer 2001), la seconde interroge la dimension de l’enseignement/ apprentissage
des langues dans cette société (J-P Cuq 2005& L- Porcher 2004). Au cours des dernières décennies,
le renouvellement méthodologique au sein des deux univers a fait objet de plusieurs recherches et a
été étudié dans de nombreux colloques et congrès en Algérie, en France et partout dans le monde. Les chercheurs tentent d’adapter ces disciplines aux besoins des individus et aux spécificités de leurs environnements sociaux, pour qu’elles accompagnent régulièrement leur évolution et reflètent strictement leurs mutations. La mondialisation, la reconfiguration de la carte géopolitique et socioéconomique du monde, et les bouleversements de tout ordre que les individus vivent quotidiennement, sont autant d’éléments qui doivent être appréhendés avec beaucoup d’attention car
sous tendant la pensée humaine et la réflexion scientifique.
L’objectif de ce colloque est de faire le point sur toutes ces dimensions et d’interroger de nouvelles perspectives en sociolinguistique et en didactique. Il devient, aujourd’hui, incontournable de revoir toutes les données relevées auparavant et de définir le nouveau profil de la société moderne. Dans ce cas, la sociolinguistique doit redéfinir les principes de la covariance qu’elle établit entre la langue et
la société. Tout changement au sein de la communauté linguistique entraînera indéniablement un remaniement de la corrélation entre elle et les codes en présence. Le contexte didactique devient, ainsi, le reflet de tous ces bouleversements. Les politiques et les stratégies adoptées répondent à un besoin sociétal de redynamisation des programmes d’enseignement et d’amélioration des compétences des apprenants. Ici, les questions relatives au modèle monolingue hégémonique à l’école qui affronte le plus souvent une réalité sociale plurilingue (D. Sankoff & S. Poplack 1981,
E .Woolford, 1983, J. P. Cuq, I. Grucca 2002, J. C. Beacco 2008.) peuvent être un des sujets de cette partie.
Quelques thèmes peuvent être discutés :
Thème 1 : la(es) langue(s) entre pratiques et représentations
Thème 2 : Les langues de/dans la ville
Thème 3 : La variation dans (par) la langue
Thème 4 : La sociodidactique
Thème 5 : FOS, FOU…Nouvelles approches et méthodes d’enseignement du français
Thème 6 : Didactique FLE- FLS
Comité scientifique
1. Pr. Khaoula TALEB IBRAHIMI (Département d'arabe. Faculté des Lettres et Langues. Alger)
2. Pr. Balkacem BENTIFOUR (ENS d’Alger. Algérie)
3. Pr. Latifa KADI (Université d’Annaba. Algérie)
4. Pr. Hacene BOUSSAHA (Université Constantine 1. Algérie)
5. Pr. Fatiha HACINI (Université Constantine 1. Algérie)
6. Pr. Mohamed Lakhdar SEBIHI (Université Constantine 1. Algérie)
7. Pr. Mohamed MILLIANI (Université d’Oran. Algérie)
8. Pr. Zahri HAROUNI (Université Constantine 1. Algérie)
9. Pr. Farid BENRAMDAN (Université de Mostaganem. Algérie)
10. Pr. Thierry BULOT (Université de Rennes. France)
11. Pr. Jacqueline BILLIEZ. (Université de Grenoble. France)
12. Pr. Marielle RISPAIL (Université de Grenoble. France)
13. Pr. Louis-Jean CALVET. (Université de Provence. Aix-en-Provence. France)
14. Pr. Jean pierre CUQ. (Université de Nice-Sophia Antipolis. France)
15. Pr. Christian PUREN. (Université Jean Monnet. Saint Etienne. France)
16. Pr. Robert BOUCHARD (Université Lyon Lumière 2. France)
17. Pr. Teddy ARNAVIELLE (Université Paul-Valery. Montpellier 3. France)
18. Pr. Antony LODGE (Université de Manchester. Royaume Unie)
Conférences plénières
Pr. Khaoula TALEB IBRAHIMI Pr. Louis-Jean CALVET
Pr. Mohamed MILLIANI Pr. Thierry BULOT
Pr. Latifa KADI
Pr. Antony LODGE
Pr. Teddy ARNAVIELLE Pr. Christian PUREN
Pr. Robert BOUCHARD
Comité d’organisation
1- Souheila HEDID (Université Constantine 1)
2- Imen BENSID (Université de Batna)
3- Reda BOULSANE (CEIL de Université Constantine 1- Université Oum El Bouaghi)
4- Chafik ZEGHNOUF (Université Constantine 1)
5- Fateh MERTANI (Université Constantine 1)
6- Osman CHAGGOU (ENS Constantine)
7- Mouna CHAGGOU (ENS Constantine)
8- Mohamed Cherif AIFOUR (Université Oum El Bouaghi)
9- Lilia BOUMENDJEL (Université Constantine 1)
10- Leila BOURZEM (Université Constantine 1) [Réduire] Contact : colloqueconstantine1@gmail.com |
Du 17 au 19 Octobre 2015 :
 |
Les langues de/dans la ville arabe Constantine (Algérie) - Université Constantine 1 Les difficultés qui surgissent à chaque fois que les chercheurs abordent la question linguistique de/dans la ville est l’incroyable fluidité de l’espace urbain et sa perpétuelle reconfiguration (T. Bulot 2007, L-J Calvet 2013). Les facteurs souvent cités se rapportent essentiellement aux qu... [Afficher la suite] Les difficultés qui surgissent à chaque fois que les chercheurs abordent la question linguistique de/dans la ville est l’incroyable fluidité de l’espace urbain et sa perpétuelle reconfiguration (T. Bulot 2007, L-J Calvet 2013). Les facteurs souvent cités se rapportent essentiellement aux questions telles que : l’urbanisation accélérée, la mobilité socio spatiale de populations, les discours épilinguistiques et les pratiques langagières des locuteurs de/dans la ville,…Dans le monde arabe, la ville a toujours été porteuse d’une idéologie spécifique (C. Miller, D. Caubet 2013, C. Miller 2006, Kh. Taleb Ibrahimi 2002, D. Morsly 1996), les chercheurs insistent sur sa particularité par rapport aux autres villes du monde. Les différents bouleversements socioéconomiques, historiques et politiques nous mettent quotidiennement devant de nouvelles réalités linguistiques, langagières et épilinguistiques de/dans cet espace. Le printemps arabe constitue à lui seul un véritable volcan qui a donné naissance à de nouvelles configurations de plusieurs métropoles arabes (L. Bonnefoy, M. Catusse 2013). Le présent colloque tente ouvrir un débat sur la nouvelle carte sociolinguistique de la ville arabe. Plusieurs pistes sont à explorer :
1- Les pratiques langagières dans la ville arabe
2- Les discours épilinguistiques des locuteurs urbains
3- Les parlers arabes (citadins, urbains, ruraux,…)
4- Le plurilinguisme urbain arabe
Conférenciers invités
Assia LOUNICI. Université d’Alger. Algérie
Marie-Madeleine BERTUCCI. Université Cergy Pontoise. France
Catherine MILLER. Université d’Aix-Marseille. France
Soha ABBOUD HAGGAR. Université Complutense de Madrid. Espagne
Kalidou SY. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sénégal
Leila MESSAOUDI. FLSH Kenitra. Maroc
Dominique CAUBET. Professeure des universités émérite INALCO. Paris
Michael ABECASSIS. Université d’Oxford. Royaume Uni
Comité scientifique
Catherine MILLER. Université d’Aix-Marseille. France
Marie-Madeleine BERTUCCI. Université Cergy Pontoise. France
Assia LOUNICI. Université d’Alger. Algérie
Leila MESSAOUDI. FLSH Kenitra. Maroc
Thierry BULOT. Université Rennes 2. France
Gudrun LEDEGEN. Université Rennes 2. France
Kalidou SY. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sénégal
Michael ABECASSIS. Université d’Oxford. Royaume Uni
Hacène KATEB. Université Constantine 1. Algérie.
Hacène BOUSSAHA. Université Constantine 1. Algérie.
Laurence DENOOZ. Université de Lorraine. Nancy. France
Mohamed Lakhdar SEBIHI. Université Constantine 1. Algérie.
Karima ZIAMARI. Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Maroc
Mouncif CHENNI. Université Constantine 1. Algérie.
Madjda CHELLI. Université Constantine 1. Algérie.
Coordinatrices du projet : Souheila HEDID. Université Constantine1
Comité d’organisation
Souheila HEDID (Université Constantine1)
Lilia BOUMENDJEL (Université Constantine1)
Abdelfateh MERTANI (Université Constantine1)
Chafik ZAGHNOUF (Université Constantine1)
Kais BENACHOUR (Université Constantine1)
Reda BOULSANE (Université Oum El Bouaghi)
Mohamed Cherif AIFOUR (Université Oum El Bouaghi)
Sonia HAINE (Université Constantine1)
Asma KASSI (Université Constantine1)
Dahlia LAROUS (Université Constantine1)
Mounia BELGUECHI (Université Constantine1)
Mehdi BENDIAB ABERKANE (Université Constantine1)
Modalités de participation
Les propositions de communication doivent être rédigées selon les critères suivants :
- Une page maximum, références comprises : l’auteur précise ses objectifs, le cadre théorique de son travail, la méthodologie préconisée, ainsi que le plan de sa présentation.
- Police : Times New Roman
- Taille de Police : 12
- Interligne 1,5
La proposition doit contenir les renseignements suivants :
- Titre de la communication (20 mots maximum)
- Nom et prénom de l’auteur
- Son adresse électronique
- Son établissement de rattachement (université, laboratoire…)
Calendrier
La date limite pour l’envoi des propositions: 15 janvier 2015
Notification d’acceptation : 30 février 2015
Contact :
Toutes les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante: colloqueconstantine1@gmail.com [Réduire] Contact : colloqueconstantine1@gmail.com |
Le 18 Septembre 2014 :
| |
Tranches d'histoire. Fondations et ruptures, périodes et événements dans l’historiographie des littératures africaines Créteil (France) Vendredi 19 septembre 2014
Université Paris-Est Créteil, Amphithéâtre 4
Programme
08 : 30 Accueil
09 : 00 Introduction
Perspectives générales sur la périodisation
09 : 15 Dominique Ranaivoson (Université de Lorraine), Faut-il vraiment découper l’histoire (litt�... [Afficher la suite] Vendredi 19 septembre 2014
Université Paris-Est Créteil, Amphithéâtre 4
Programme
08 : 30 Accueil
09 : 00 Introduction
Perspectives générales sur la périodisation
09 : 15 Dominique Ranaivoson (Université de Lorraine), Faut-il vraiment découper l’histoire (littéraire) en tranches ? De la validité des périodisations pour décrire les littératures africaines
09 : 45 Raphaël Thierry (docteur Université de Lorraine / Yaoundé 1), Histoire des littératures et du livre en Afrique : vers l’émergence d’études éditoriales comparées ?
10 : 15 Christine Le Quellec Cottier (Université de Lausanne), Repenser l’histoire littéraire francophone africaine : le concept d’autodétermination poétique
Fondations, ruptures, tournants
11 : 00 Zineb Ali-Benali (Université Paris 8-Vincennes), La Colline oubliée entre national et local. Un moment de la fabrique du texte littéraire francophone en Algérie [1952]
11 : 30 Landry-Wilfrid Miampika (Universidad de Alcalá, Madrid), Littérature hispano-africaine : fondation, événement et modernité
12 : 00 Comment on écrit l’histoire : entretien avec Lilyan Kesteloot, par Papa Samba Diop
Études de cas
14 : 00 Martin Mourre (doctorant – Université de Montréal / EHESS), Les circulations littéraires d’un massacre colonial au Sénégal
14 : 30 Fernanda Vilar (doctorante Université de Paris X – Nanterre ), Le système littéraire au Mozambique, Congo et Afrique du Sud : enjeux pour une périodisation littéraire
15 : 00 Madeline Bedecarré (doctorante – EHESS), Un « counter narrative » de la Francophonie et d’une histoire littéraire francophone
15 : 30 Marie-Rose Abomo-Maurin (Université de Yaoundé 1), L’histoire littéraire camerounaise existe-t-elle ?
17.00-19.00 Assemblée générale de l’Association
Co-organisation :
L.I.S. (Lettres, Idées, Savoirs EA 4395), ECRITURES (EA 3943), APELA

Organisation pratique :
L.I.S. (Lettres, Idées, Savoirs EA 4395)

Comité scientifique :
Nathalie Carré, Papa Samba Diop, Claire Ducournau, Pierre Halen
Pour venir à l’Université Paris-Est Créteil :
En métro, prendre la ligne 8 (Balard-Créteil), jusqu’à la station « Créteil Université », puis suivre l'indication « Mail des Mèches - Université Paris 12 », jusqu’au bout de la passerelle. L’amphithéâtre 4, où aura lieu la journée, se nommait anciennement amphithéâtre gris. Pour un plan, voir :
http://www.u-pec.fr/footer-3/plans-d-acces/campus-centre-301991.kjsp?RH=1176931876081 [Réduire] |
Du 02 au 03 Decembre 2014 :
| |
Analyse des Discours et des Objets Signifiants Oran (Algérie) - Université d'Oran Analyse des discours médiatique, politique,littéraire et artistique,culturel, interculturel et didactique des langues. Contact : colloque2014loapl@yahoo.fr |
Du 13 au 15 Mai 2015 :
| |
IDEOLOGY IN POSTCOLONIAL TEXTS AND CONTEXTS Münster (Allemagne) - University of Münster Voir le pdf sur le site consacré Contact : GAPS2015@uni-muenster.de |
Du 11 au 13 Février 2015 :
| |
Politiques linguistiques - éducatives innovantes et dimension identitaire : approches sociolinguistiques, littéraires et didactiques. Besançon (France) - l’Université de Franche – Comté, Besançon Politiques linguistiques et la notion d'identité ; 3 volets sont considérés ; sociolinguistique, littéraire et didactique. Contact : LaFEF.besancon2015@gmail.com |
Du 19 au 21 Avril 2015 :
| |
L'arabe vu par l'Occident Constantine (Algérie) - Université Constantine 1. Campus des 500 places pédagogiques Les discours sur la langue arabe qui s'affichent dans les études occidentales.Colloque dans les langues suivantes :
arabe, espagnol, français, anglais Contact : colloquearabe1@gmail.com |
Du 04 au 05 Mars 2015 :
| |
Colloque International Regard croisé sur les transformations du statut de la femme au XXIème sicècle dans le monde/ "La femme: quel rôle, quelle société" Meknès (Maroc) - Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Contact : colloque.femme2015@gmail.com |
Du 28 au 29 Janvier 2015 :
| |
Géographies composées : arts et littératures du Moyen-Orient et du Maghreb dans les langues et cultures d’Occident LE MANS (FRANCE) - université du Maine Saisi dans sa dimension interculturelle ou migratoire, le déplacement induit la mise en place d’une nouvelle géographie non seulement au sens objectif (être quelque part) mais surtout subjectif (devenir quelqu’un). La construction de ce devenir s’appuie sur les ressources du désir et sur l... [Afficher la suite] Saisi dans sa dimension interculturelle ou migratoire, le déplacement induit la mise en place d’une nouvelle géographie non seulement au sens objectif (être quelque part) mais surtout subjectif (devenir quelqu’un). La construction de ce devenir s’appuie sur les ressources du désir et sur la manière dont le manque et le deuil se font travail productif de symbolisation, ou sur ce que la sociologie de l’immigration appelle empowerment.
L’imaginaire de la rencontre va de pair avec ce qu’on peut nommer travail de la rencontre : la rencontre avec l’autre induit l’acceptation de payer le prix symbolique de la perte de l’origine dans le cadre de l’exil, de l’immigration ou de la déportation (displacement). Aussi conviendra-t-il d’examiner les problématiques du travail de deuil qui libère des possibles en facilitant les passages, ou du travail de la mélancolie qui les obstrue en niant le réel de la perte.
Dans ces conditions, l’« objet » perdu ou non perdu peut être la langue elle-même. Freud n’écrit-il pas à Arnold Sweig : « En Amérique, il faudrait en plus renoncer à votre langue, qui n’est pas un vêtement, mais votre propre peau » (lettre de 1936). Parler une autre langue, c’est donc muer, autrement dit laisser disparaître progressivement ces lieux symboliques où le nom du sujet a pris naissance et sens ; c’est donc forcément trahir ou transgresser, se plaindre ou jubiler. Dans cette perspective, écrire, c’est non seulement témoigner mais également se confesser, naître/n’être et tuer. Advenir, c’est inscrire le parricide et le matricide dans la sphère de l’interculturel, ou alors différer ou éviter cet acte fondateur.
Celui-ci peut être « sublimé » dans le sens où l’écriture est une mise en signes du « corps » de la langue (lalangue, disait Lacan) et du réel de l’Autre primordial qui l’habite et qui l’a indéfiniment et irrémissiblement marquée et orientée. Comment la création, déjà matricide, déjà parricide, met-elle cependant en perspective les enjeux de l’interculturel dans l’espace symbolique et imaginaire intermédiaire créé par l’artiste ou l’écrivain américain/anglophone et moyen-oriental ?
D’ailleurs, dans ces lieux intermédiaires investis par la création artistique, qu’est-ce qu’une langue maternelle pour un sujet bilingue ou multilingue, qui donne à des notions comme « loyauté » ou « appartenance »…, une autre dimension éthique ? Quel usage fait-on de la langue des parents lorsqu’on est comme la poétesse Naomi Shihab Nye native de Saint-Louis et issue d’un couple mixte aux origines germano-palestiniennes ? L’espace intermédiaire de Nye est fait de figuiers, de pins, de cèdres et de palmiers…, et comme le suggère son « oignon voyageur » (« Travelling Onion »), l’écriture est une inlassable cartographie des espaces du possible interculturel et même transculturel. En vérité, le sujet poétique met subtilement en jonction une double altérité : celle du discours interculturel et celle de la parole intersubjective, celle du moi qui s’affirme par le tissage (ou par le rejet) du lien culturel et social, et celle de l’Autre en lui, déjà ailleurs, toujours autre.
Si la notion de géographie intermédiaire induit la production par l’écriture d’un espace artistique intermédiaire, elle renvoie également à la confrontation par le sujet d’un déjà-là idéalisant ou avilissant, réducteur dans tous les cas, qui expulse ou tend à expulser l’altérité hors de l’ordre symbolique, par son inscription dans l’imaginaire ou dans le « réel », c’est-à-dire dans l’espace de la parole non advenue : être défini sans pouvoir définir ni se définir.
Le devenir problématique du sujet « à trait d’union » se construit aussi en fonction du regard de l’autre, par quoi l’altérité est mise à l’index. La monstration met en jeu la réification culturelle et sociale, et le sujet ne peut échapper aux forces d’agrégation et de désagrégation collectives (ou identitaires). La géographie s’appréhende alors comme une mise en jeu du lien subjectif en relation avec la réalité sociohistorique et les forces qui la déterminent : politiques, anthropologiques, linguistiques…, dont les effets peuvent être perçus à l’aune de l’acculturation, de l’aliénation ou de l’interculturalité. Le sujet de la hyphenated geography ne cesse de cartographier ses identités en associant des territoires (ou « communautés imaginaires », selon la pertinente expression de Bénédicte Anderson), par le voyage réel ou imaginaire. Le déplacement induit alors une dimension transfrontalière qui à son tour induit une autre transnationale ou transidentitaire. En ce sens, un pays comme les Etats-Unis d’Amérique a en vérité des « frontières » communes avec le Moyen-Orient ! Cette mitoyenneté qui favorise l’interculturel nargue les clôtures idéologiques, et empêche peut-être que ces frontières (qui disent le passage) ne se transforment en des limites infranchissables.
Quelles formes, quels récits, ces écrivains, poètes, artistes, cinéastes, donnent-ils à ces tensions « géographiques » mesurables de manière dialectique et non binaire à l’aune du passage ou du blocage, de l’image du mur ou de la porte, de la partition ou de la suture, de la rencontre ou de sa négation ? Quelles formes prend le trait d’union (hyphen) qui est aussi un trait de désunion, reliant et séparant des espaces et des réalités variés en vertu de données à la fois prometteuses et coercitives ? La notion d’entre-deux revêt ici une importance particulière, eu égard aux crispations idéologiques qui peuvent entrer en jeu, notamment chez les auteurs qui restent dans cette position intermédiaire, dans/sur le trait d’union, incapables de franchir l’espace/la ligne de séparation ; ceux qui s’imaginent une « communauté » cosmopolite qui serait coupée des deux bords, en suspension entre les deux bords.
Ainsi, ce colloque mettra en chantier une création littéraire, artistique et cinématographique, à la fois complexe et dynamique, qui reste trop peu connue en France et en Europe, tout en ouvrant le champ analytique à d’autres problématiques connexes, celles qui s’intéressent aux enjeux du trait d’union et de désunion dans notre monde.
Organisé par 3L.AM (Le Mans) et CAS (Toulouse II-le Mirail) [Réduire] Contact : Jacqueline Jondot (jjondot@yahoo.fr) et Rédouane Abouddahab (r.abouddahab@free.fr) |
Du 10 au 12 Mai 2015 :
 |
« Les langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques discursives en contexte pluri/multilingue » Bejaia (Algérie) - Université « Les langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques discursives en contexte pluri/multilingue » est une thématique d’actualité qui interpelle, entre autres, les spécialistes de nombreuses disciplines qui tentent de comprendre l’impact des cultures sur la producti... [Afficher la suite] « Les langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques discursives en contexte pluri/multilingue » est une thématique d’actualité qui interpelle, entre autres, les spécialistes de nombreuses disciplines qui tentent de comprendre l’impact des cultures sur la production/compréhension des discours oraux et/ou écrits. Dans leurs analyses, ils s’interrogent encore sur la question, ils continuent à ce jour d'élaborer des hypothèses, à proposer des études de terrain pour faire la lumière sur des aspects problématiques. C'est le signe que les rapports qu'entretiennent les langues et les cultures, dans un contexte endogène ou exogène, sont complexes et que les préoccupations scientifiques qu'ils suscitent sont toujours d'actualité. Ce colloque voudrait offrir l'opportunité aux linguistes, aux théoriciens des littératures, aux didacticiens des langues, aux interprètes, ...d'échanger leurs points de vue sur l'état actuel de la question stylistique. [Réduire] Contact : Boualit Farida |
Du 26 au 27 Octobre 2014 :
| |
ÉTUDES KATEBIENNES. Une esthétique de la modernité et une épistémologie Guelma (Algérie) - L\'université de 08 mai 1945, Guelma « Le cercle vicieux n’était qu’une promenade à contre cœur qui avait failli le perdre, dont il revenait à tâtons, pas seulement lui l’adolescent retournant au bercail, non son fantôme voué à cette impitoyable démarche d’aveugle butant sur le fabuleux passé, le point du jour, la pr... [Afficher la suite] « Le cercle vicieux n’était qu’une promenade à contre cœur qui avait failli le perdre, dont il revenait à tâtons, pas seulement lui l’adolescent retournant au bercail, non son fantôme voué à cette impitoyable démarche d’aveugle butant sur le fabuleux passé, le point du jour, la prime enfance vers laquelle il demeurait prostré »
Nedjma, ENAL, p. 108. [Réduire] Contact : katebyacineguelma@gmail.com |
Du 11 Decembre 2014 au 05 Juin 2015 :
| |
Relectures postcoloniales des échanges artistiques et culturels entre Europe et Maghreb (Algérie, France, Italie, Maroc et Tunisie) – 18e -21e siècles Paris - Rome - Tunis (France-Italie-Tunisie) - Paris - Rome - Tunis Contact : colloques@ecoledulouvre.fr |
Du 10 au 11 Juin 2015 :
| |
Figures et poétique(s) du récit de voyage Nice (France) - Université Nice Sophia Antipolis Les figures de discours se définissent par des traits stables et reconnaissables ; le colloque pose cette hypothèse qu’elles se caractérisent aussi par des variations discursives dépendantes du type de texte dans lequel elles s’insèrent et qui les particularise. L'enjeu du colloque est d'an... [Afficher la suite] Les figures de discours se définissent par des traits stables et reconnaissables ; le colloque pose cette hypothèse qu’elles se caractérisent aussi par des variations discursives dépendantes du type de texte dans lequel elles s’insèrent et qui les particularise. L'enjeu du colloque est d'analyser ces réalisations dans le genre du récit de voyage.
C’est dans son rapport au réel que le récit de voyage trouve sa spécificité. Genre dit factuel, il s’appuie sur un matériau préconstruit : le monde découvert qu’il s’ingénie ensuite à retranscrire. Ce n’est toujours cependant qu’une expérience du monde découvert qui est proposée. Le travail d’écriture est une entreprise de construction qui peut se confondre – en particulier lorsque le voyageur est un écrivain – avec une œuvre qui trouve sa place dans le champ littéraire. Si l’on pressent une corrélation entre les figures et le genre de discours, quelles sont celles qui peuvent être considérées comme consubstantielles au genre du récit de voyage et entrer dans la constitution d’un paradigme figural définitoire ? Certaines figures sont-elles spontanément ou génériquement favorisées par les relations de voyage ? Les figures seront appréciées en fonction du paramètre quantitatif de la récurrence et de leur exemplarité. La contextualisation des figures devra évaluer leur apport stylistique dans ce genre particulier.
Les figures du discours sont envisagées ici dans le sens extensif de « constructions discursives, activées par leur entourage syntaxique et par leur contexte », comme schèmes discursifs, définis comme structures récurrentes et dynamiques (M. Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, Paris, Champion, 2005) indices à la fois d’une vision du référent et d’un positionnement de l’énonciateur, dans l’appréhension de l’altérité.
Les analyses des figures pourront s’organiser autour de quatre axes :
1. Les paramètres rhétoriques de l’énoncé : ainsi pourront être étudiées les figures qui jouent sur le lexique (les xénismes, les mots-valises, la traduction, la synonymie par exemple), sur l’organisation de la syntaxe (l’ellipse, la suppression, la permutation…) ;
2. La fonction pathémique et l’émotivité de l’énonciateur-voyageur (l’hyperbole, l’ironie, l’euphémisme, le chleuasme…) ; celles qui sont centrées sur l’allocutaire du récit (l’apostrophe oratoire, l’hypotypose, la citation, l’allusion…).
3. Les paramètres cognitifs de l’énoncé : les figures sont alors liées au processus de la description (l’analogie et les tropes, l’antithèse, le paradoxe…) ; elles ont partie liée avec l’expression du référent (l’approximation, la périphrase, le symbole, le stéréotype…).
4. Le métadiscours des voyageurs renvoyant à la norme générique supposée.
Les figures pourront être abordées d’un point de vue littéraire et linguistique. Toutefois, les études ne devront pas prendre un caractère anecdotique mais devront servir à poser les bases d’une poétique du récit de voyage appuyée sur des figures qui peuvent être proposées comme définitoires du genre. Une praxis du récit de voyage pourra être ainsi illustrée : le choix de figures peut être caractéristique d’un imaginaire, d’un lieu décrit, d’une époque et servir l’approche générique. On s’intéressera en particulier à la motivation et à l’efficacité des figures, aux raisons qui peuvent expliquer la prégnance de telle construction figurale dans le récit de voyage. [Réduire] Contact : gannier@unice.fr; magri@unice.fr |
Du 22 au 24 Avril 2015 :
| |
1er Congrès Mondial de Brachylogie Kénitra (Maroc) - Université Ibn Tofaïl Poétiques et problématiques des formes brachylogiques.
Quelles lectures pour les oeuvres minimalistes ? Contact : abderrahmantenkoul@yahoo.fr |
Du 11 au 13 Octobre 2014 :
| |
Les langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques discursives en contexte pluri/multilingue Bejaia (Algérie) - Université de Bejaia La faculté des lettres et des langues et le laboratoire de recherche LAILEMM de l'université de Bejaia organisent, les 12 - 13 et 14 octobre 2014, un colloque international sur le thème "langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques discursives en contexte pluri/mul... [Afficher la suite] La faculté des lettres et des langues et le laboratoire de recherche LAILEMM de l'université de Bejaia organisent, les 12 - 13 et 14 octobre 2014, un colloque international sur le thème "langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques discursives en contexte pluri/multilingue". La langue du colloque est le français. La date limite de soumission des propositions est fixée au 10 juillet. [Réduire] Contact : Boualit Farida |
Du 18 au 20 Mars 2015 :
| |
Prix littéraire International Kateb Yacine de la ville de Guelma Guelma (Algérie) - Théâtre régional Le Prix littéraire International Kateb Yacine de la ville de Guelma est attribué annuellement à l’occasion du Forum International Kateb Yacine à Guelma (Algérie) organisé par l’Association Promotion Tourisme et Action Culturelle, conformément au règlement suivant :
• Il est attribu�... [Afficher la suite] Le Prix littéraire International Kateb Yacine de la ville de Guelma est attribué annuellement à l’occasion du Forum International Kateb Yacine à Guelma (Algérie) organisé par l’Association Promotion Tourisme et Action Culturelle, conformément au règlement suivant :
• Il est attribué un seul prix littéraire consacré au roman de langue française publié par un éditeur au Maghreb ; il est récompensé d’un diplôme, d’un trophée et d’une somme de 2000 euros.
• Il est attribué un prix spécial récompensant un travail de recherche ou un essai critique jugé d’un apport important dans la réflexion et l’analyse portant spécifiquement sur l’œuvre katébienne ou sur la littérature maghrébine de langue française en général ; ce prix spécial est récompensé d’un diplôme, d’un trophée et d’une somme de 1000 euros. [Réduire] Contact : Ali Abbassi |
Du 18 au 20 Mars 2015 :
| |
Sixième Colloque International Kateb Yacine à Guelma - Algérie / Kateb Yacine : Interactions culturelles, textuelles et artistiques Guelma (Algérie) - Théâtre régional Kateb constitue un moment nodal et un lieu stratégique de ce qu’on s’est accordé à appeler l’interculturel, avec ses différents avatars et ses multiples variantes. Certes la dimension universaliste est là dans toute la richesse de ses références et dans le flot de ses échos polyphoniqu... [Afficher la suite] Kateb constitue un moment nodal et un lieu stratégique de ce qu’on s’est accordé à appeler l’interculturel, avec ses différents avatars et ses multiples variantes. Certes la dimension universaliste est là dans toute la richesse de ses références et dans le flot de ses échos polyphoniques. Mais un autre rapport s’est instauré, depuis Kateb, entre la littérature maghrébine de langue française et la notion d’arabité dans ses manifestations littéraire, religieuse, linguistique, culturelle au sens large, politique aussi, d’une certaine façon. La question de la traduction n’étant pas étrangère à ce rapport.
Le cinquième colloque Kateb Yacine a ouvert le champ à l’interrogation de ce rapport, mais la question n’est qu’effleurée encore : l’arabité s’ouvre à Kateb, il faut élargir cette fenêtre.
On a cependant peu travaillé, semble-t-il, sur la relation de Kateb et son œuvre aux autres arts, le théâtre excepté. Même pour ce dernier, il serait intéressant que les spécialistes des arts de la scène, qui ont monté des pièces de Kateb, s’expriment pour faire part de leur propre gestation créatrice à la représentation des textes katébiens.
Quant aux autres arts, d’emblée, on pense à Issiakham, le compagnon de voyage de Kateb, on pense aux spectacles audiovisuels inspirés de l’œuvre katébienne, surtout de Nedjma. De ce point de vue, l’initiative de Benamar Mediène est à revisiter et à faire proliférer. On verrait la musique s’approprier d’extraits ciblés du cycle de Nedjma ou retravailler certains passages du théâtre populaire (Pensons au « Poète comme un boxeur »). D’autres formats, grâce surtout à l’art numérique, sont à envisager, dans la même perspective. [Réduire] Contact : Mansour M'henni |
Du 16 au 17 Octobre 2014 :
| |
IIIème Séminaire des Etudes Brachylogiques : Rhétorique et brachylogie Tunis (Tunisie) - Institut supérieur des sciences humaines de Tunis On le sait, historiquement, la brachylogie est fille de la rhétorique, qu’elle fût une façon de concevoir le discours dialectique, par opposition à la macrologie, ou une simple figure de rhétorique construite sur la base de la brièveté et de la concision, voire même de l’élision ou de ... [Afficher la suite] On le sait, historiquement, la brachylogie est fille de la rhétorique, qu’elle fût une façon de concevoir le discours dialectique, par opposition à la macrologie, ou une simple figure de rhétorique construite sur la base de la brièveté et de la concision, voire même de l’élision ou de l’inaccomplissement, se laissant prendre ainsi tantôt pour un moyen de réussir l’expression, tantôt au contraire, pour un « vice d’élocution » la compromettant au point de la rendre confuse et inintelligible.
Le IIIème Séminaire des études brachylogiques est né autour de l’intitulé : « Rhétorique et brachylogie », et son organisation est répartie en deux volets :
1 – Les origines de la dichotomie brachylogia/copia (écriture de la brièveté/écriture de l’abondance) : mythologie, philosophie, littérature et théorie.
2 – Argumentativité et pragmatique des figures brachylogiques (Cf. les travaux de Marc Bonhomme, par exemple). [Réduire] Contact : Sabeh Ayadi |
Du 25 au 26 Novembre 2014 :
| |
Représentations de Paris : des Marocains à la rencontre de la « ville-lumière » Tétouan (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan Représentations de Paris : des Marocains
à la rencontre de la « ville-lumière »
« Paris ! Mais qui pourra vous décrire ce qu’est Paris ! »
(Voyageurs marocains)
Colloque International à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan
Les 26 et 27 novembre 2014
... [Afficher la suite] Représentations de Paris : des Marocains
à la rencontre de la « ville-lumière »
« Paris ! Mais qui pourra vous décrire ce qu’est Paris ! »
(Voyageurs marocains)
Colloque International à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan
Les 26 et 27 novembre 2014
Argumentaire
Au dix-neuvième siècle, le monde arabo-musulman découvre la France. Cette découverte se fait à travers Paris, une ville qui va émerveiller les voyageurs arabes successifs qui vont suivre à la trace, le pionnier, l’initiateur des voyages vers la « ville-lumière » : l’Egyptien Rif’at at-Tahtâwî. Celui-ci s’y rend, rappelons-le comme directeur et guide spirituel, avec un groupe d’étudiants envoyés en France (à Paris précisément) par le Pacha Mohamed ‘Alî pour y faire des études entre 1826 et 1831. L’Egypte sous l’égide de son gouvernement s’est engagée dans la voie de la modernisation et des réformes qui devront aboutir à la Nahda. Son expérience à Paris, ses aventures, ses descriptions, ses observations, ses réflexions et sa vision il les publiera dans son célèbre récit de voyage (rihla) (Takhlîç al-ibrîz fî talkhîç Bârîs, traduction française, par A. Louca sous le titre, L'Or de Paris,) qui laissera une profonde impression et empreinte sur les lecteurs du monde arabe et notamment les élites marocaines. Ce livre deviendra une référence majeure pour tous les voyageurs arabes et particulièrement marocains et constituera un des jalons de l’histoire de la rencontre et des contacts du monde arabe avec l’Europe et notamment avec la France.
En Orient, la Turquie et l’Egypte sont concernés par ce phénomène, tandis qu’en Occident musulman, le Maroc s’affirme comme un interlocuteur et un partenaire de premier rang avec la France.
Aussi tout au long du dix-neuvième siècle puis au vingtième siècle, nombreux seront les Marocains qui visiteront Paris. Citons quelque uns : Essafar, El ‘Amraoui, A. El Fassi, M. El Hajoui, as-Sayyah… Ce sont pour la plupart des ambassadeurs ou des notables investis de missions officielles qui s’y rendent ; ils sont impressionnés par la capitale française et vont traduire leurs sentiments, impressions et observation dans leurs récits respectifs de voyage. Ces voyageurs appartiennent aux élites intellectuelles et politiques : il s’agit de représentants ayant le statut de clercs, ce sont des ulema, lettrés, imprégnés d’une culture humaniste et la rencontre avec Paris révèle leur vision moderniste, leur ouverture d’esprit, leur tolérance… Ces voyages ont lieu sous divers règnes et dans des contextes politiques différents. Au-delà de la mission officielle qu’ils accomplissaient, ces voyageurs visiteront Paris, ses monuments, ses institutions, ses lieux de culture et de loisirs, s’intéresseront à ses écoles et universités, à ses bibliothèques, à ses institutions politiques, à sa presse, à la société parisienne/française, aux divers aspects de la vie sociale et économique, etc.
Ainsi Paris suscite l’intérêt, la curiosité et l’admiration ; Paris captive ; Paris séduit ; Paris fascine. Et derrière cette ville, se profile toute une société, toute une civilisation et à travers le récit sur Paris nous lisons comment nos voyageurs appréhendent une civilisation qui si elle rebute ou choque par certains de ses aspects qui heurtent la sensibilité religieuse et morale des concernés, suscite davantage l’admiration, apparaît comme un modèle, et renvoie en même temps aux faiblesses, déficits, tares, de leur propre société enfoncée dans les problèmes, le désordre, le sous-développement, l’analphabétisme, les superstitions.. Derrière l’explicite dans les textes on perçoit beaucoup de choses implicites et de non-dit. C’est ce dont témoigne les récits de voyage dont certains ont été publiés tandis que d’autres sont encore à l’état de manuscrit.
Puis à partir de la moitié du vingtième siècle, commence une nouvelle étape, Paris n’est plus la ville que l’on visite de passage pour y accomplir une mission officielle momentanée, elle devient avec le contexte colonial une ville où s’installent et vivent des Marocains, notamment des intellectuels, des artistes, des écrivains qui rejoignent une colonie de plus en plus nombreuse d’émigrés, pour la plupart d’origine rurale, venus pour y chercher un emploi, des moyens de subsistance, un gagne-pain. Paris conquiert sa place dans les écrits littéraires et les productions de l’art, le cinéma notamment. Elle devient à travers la fiction, le décor d’histoires et d’aventures diverses, un objet de description. Paris devient aussi le lieu de vie de plusieurs marocains « ordinaires », des travailleurs qui se heurtent au mirage de la vie moderne, vivent l’expérience de l’expatriation, les difficultés de l’exil, les frustrations, les rêves de prospérité matérielle…
La rencontre avec la France, avec Paris, est une page de l’histoire des relations de deux pays, de deux sociétés, de deux cultures, (à travers les expériences d’hommes et de femmes), qui mesurent leurs écarts culturels, qui dialoguent et échangent, qui se fécondent mutuellement… Des Marocains à la rencontre de Paris, c’est ce que propose d’examiner et d’analyser sous les angles les plus divers ce Colloque International organisés par plusieurs structures de recherche de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan : Equipe de Recherche sur les Ecritures Identitaires au Maghreb, Département de Langue et Littérature Françaises, Groupe de Recherche de Critique Civilisationnelle et de Dialogue des Cultures et des Etudes Méditerranéennes, Equipe de Recherche sur les Cultures et les Sociétés Méditerranéennes, Groupe de Recherches sur les Etudes Audiovisuelles et le Cinéma. Ce Colloque sera organisé avec la collaboration et le soutien du Conseil des Marocains Résidents à l’Etranger. Il interpelle, les littéraires, les historiens, les géographes, les sociologues… qui s’efforceront de répondre aux interrogations suivantes et à d’autres :
Quels sentiments éveillent et quelles attitudes révèlent la visite et le séjour à Paris ?
Quelles images se construisent et se forgent sur ou autour de Paris ?
Quel rôle joue la rencontre et le contact avec Paris dans l’épanouissement du projet de réformisme et l’aspiration au modernisme qui anime les élites marocaines ?
Quels échanges entre les cultures, permet et promeut la visite et le séjour à Paris ?
Quels paysages et quels lieux retiennent l’attention et sont l’objet de descriptions et avec quel sens esthétique ?
Quelles écritures génèrent Paris ?
Quelles représentations s’affirment dans la fiction littéraire, dans les récits modernes, dans l’art et le cinéma ? Avec quelles continuités et quelles ruptures ?
Quelle vie à Paris pour ceux qui y ont élu résidence avec quels vécus, quels rêves, quelles difficultés… ?
Coordinateur du Colloque Pr Mohammed Saâd Zemmouri
Le Comité d’organisation est composé des Professeurs
Zemmouri Mohammed Saâd
Hanafi Mustapha
Gorfti Ouafae
Ghachi Mustapha
Aidouni Hamid
Tajditi Nizar
Ce Colloque International organisé conjointement par l’Equipe de Recherche sur les Ecritures Identitaires au Maghreb, le Département de Langue et Littérature Françaises, le Groupe de Recherche sur les Civilisations et le Dialogue des Cultures en Méditerranée, le Groupe de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel, l’Equipe de Recherche sur les Cultures et les Sociétés du Monde méditerranéen se tiendra le 26 et 27 novembre 2014 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan.
Les titres et les résumés (de 10 à 15 lignes) sont à envoyer à l’adresse mel : mustghachi@gmail.com, avant le 31 juillet 2014.
Les communications seront envoyées au plus tard le 30 septembre 2014 à la même adresse mel (mustghachi@gmail.com). [Réduire] Contact : mustghachi@gmail.com |
Du 15 au 16 Mai 2014 :
 |
Colloque International : "Tout sucre tout miel" Monastir (Tunisie) - Palais des Sciences Contact : habib.salha@yahoo.fr |
Du 21 au 24 Mai 2014 :
 |
Marseille (France) - MuCem En écho au cycle d’expositions au fort Saint-Jean, Des artistes dans la
cité, le temps fort Paroles dans la cité ouvre portes et fenêtres sur le
Maroc contemporain. |
Du 27 au 29 Avril 2014 :
| |
Etude comparée et dialogues des littératures Tunis (Tunisie) - Académie Beit-Al-Hikma, Carthage Contact : Sonia Zlitni Fitouri |
Du 29 Mai au 29 Avril 2014 :
| |
« De la libération politique à la libération sociale » Les écritures romanesques et poétiques dans le monde arabe Paris (France) - EHESS IISMM-EHESS
Séminaire interdisciplinaire
Orient-Littératures
Table ronde du 30 mai
Organisée par
Maher Al Munajjed et Gilles Ladkany
« De la libération politique à la libération sociale »
Les écritures romanesques et poétiques dans le monde arabe
... [Afficher la suite] IISMM-EHESS
Séminaire interdisciplinaire
Orient-Littératures
Table ronde du 30 mai
Organisée par
Maher Al Munajjed et Gilles Ladkany
« De la libération politique à la libération sociale »
Les écritures romanesques et poétiques dans le monde arabe
- 14h00 : Ouverture de la séance : Gille Ladkany, Fondateur du séminaire Orient-Littérature (ENS et IISMM-EHESS)
- 14h05 : Présentation et Modérateur : Maher Al Munajjed (IISMM-EHESS et CRLC Sorbonne)
- 14h10 : M. Waciny Laredj (écrivain et romancier)
L'Ecriture romanesque (algérienne de langue arabe) face aux tabous, du tabou politique au tabou religieux.
- 14h30 : M. Tahar BEKRI (poète, Université Paris X)
L’œuvre littéraire comme champ/chant de liberté, propos et réflexions.
- 14h50 : Mme. Lynda-Nawel TEBBANI (chercheuse, Université Paris-Sorbonne)
De l’identification nationale à la remise en cause testimoniale : Le social, la société et le politique. De l’émergence à l’actualité dans le roman algérien.
-15h10 : Mme. Zineb Laouedj (poétesse et éditrice)
"La poésie algérienne moderne/ Evolution des thèmes et des formes"
- 15h30-16h10 : Débat avec le public
- 16h10-16h30: Pause
- 16h30 : M. Mohamed Ghamgui (historien et politologue)
At-Tahtawy et l’ouverture à un monde nouveau d’idées politiques et sociales.
- 16h50 : Mme. Roula NABULSI (enseignante INALCO)
"Ecrivaines soudanaises d'avant garde face aux régimes rétrogrades."
- 17h10 : M. Nadjib Achour (chercheur et essayiste EHESS)
Typologie d'un théâtre militant de langue arabe : du théâtre "missionnaire" des islahistes, à la réhabilitation de la figure du « adib » en Algérie dans les années 50.
- 17h30 : Mme. Ons Debbech (chercheuse, Université Paris-Sorbonne)
"Mémoires d'une princesse arabe" : parcours d'une femme vers la liberté.
- 17h50-18h30 : Débat avec le public
- 18h30 : Clôture de la journée – Pot [Réduire] Contact : maher.al@wanadoo.fr |
Du 26 au 28 Novembre 2014 :
.doc) |
Colloque: La violence dans le discours Gafsa (Tunisie) - Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités Contact : hasni0122000@yahoo.fr |
Du 06 au 07 Novembre 2014 :
 |
Colloque "Emmanuel Roblès et le Théâtre. le thééâtre d'Emmanuel Roblès" Limoges (France) - Bibliothèque Francophone multimédia Emmanuel Roblès, auteur prolifique, animateur infatigable de la vie littéraire en Algérie puis en France, aurait eu cent ans en 2014.
Après avoir consacré deux colloques à Emmanuel Roblès et ses amis (Montpellier 1997, publ. Université de Montpellier 2000) et Emmanuel Roblès et l’hisp... [Afficher la suite] Emmanuel Roblès, auteur prolifique, animateur infatigable de la vie littéraire en Algérie puis en France, aurait eu cent ans en 2014.
Après avoir consacré deux colloques à Emmanuel Roblès et ses amis (Montpellier 1997, publ. Université de Montpellier 2000) et Emmanuel Roblès et l’hispanité en Oranie (Oran, 2008, publ. L’Harmattan, 2012), le Fonds Roblès (Bfm Limoges et Université Montpellier 3) s’intéressera à cette occasion à Emmanuel et le théâtre, au théâtre d’Emmanuel Roblès.
Roblès est l’auteur d’une douzaine de pièces de théâtre, drames historiques ou comédies plus légères, recueillies en deux volumes aux éditions Grasset. La plus connue, Montserrat, créée simultanément à Alger et Paris en 1948, a été traduite dans une trentaine de langues et continue d’être jouée partout à travers le monde. Mais derrière ce chef d’œuvre, bien d’autres pièces moins connues, qu’elles soient critiques comme Île déserte, ou engagées comme La Fenêtre ou Plaidoyer pour un rebelle, méritent qu’on s’y intéresse.
Ce colloque accueillera aussi des communications sur l’action de Roblès en faveur du théâtre en Algérie : son travail de metteur en scène avec le Théâtre de la Rue, son militantisme pour un théâtre populaire, sa collaboration avec les personnalités du théâtre algérien, Mahieddine Bachtarzi aussi bien qu’Albert Camus qui eut sur lui une grande influence,...
Propositions de communication accompagnées de dix à douze lignes d'argument
à adresser avant le 30 juillet 2014 à guy.dugas@univ-montp3.fr [Réduire] Contact : guy.dugas@univ-montp3.fr |
Du 26 au 27 Octobre 2014 :
| |
LA LITTÉRATURE MAGHRÉBINE D'EXPRESSION FRANÇAISE À L'ÉPREUVE DU NOUVEAU SIÈCLE – MILLÉNAIRE : ÉCRITURES ET NOUVELLES PERSPECTIVES Batna (Algérie) - université de Batna 3ème colloque international sur la littérature maghrébine d'expression française , 27-28 octobre 2014 , laboratoire SELNoM. Contact : saidkhadraoui2002@yahoo.fr |
Le 30 Mai 2014 :
 |
Ecritures poétiques, écritures politiques Alger (Algérie) - Ecole Nationale Supérieure des Sciences Politiques Contact : Yamilé Ghebalou |
Le 15 Avril 2014 :
 |
Les causeries du mercredi - Ali Bécheur face à ses lecteurs Manouba (Tunisie) - Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités Le Laboratoire de Recherches "Etudes Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle" et l'Association des Littératures Maghrébines, Africaines, Méditerranéennes et Comparées organisent une série de rencontres débats avec des auteurs tunisiens, baptisée "Les ca... [Afficher la suite] Le Laboratoire de Recherches "Etudes Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle" et l'Association des Littératures Maghrébines, Africaines, Méditerranéennes et Comparées organisent une série de rencontres débats avec des auteurs tunisiens, baptisée "Les causeries du mercredi". Ce rendez-vous hebdomadaire a pour objectif d'établir un lien direct entre plusieurs noms de la scène littéraire et culturelle tunisienne et leur lectorat, en ciblant tout particulièrement le public estudiantin. Inaugurées le 26 février 2014 avec Mustapha Tlili, ces "causeries" se poursuivent le 16 avril 2014 avec Ali Bécheur et se proposent d'accueillir ultérieurement Azza Filali, Mokhtar Sahnoun, Ezzedine Madani, Youssef Seddik et bien d'autres invités. [Réduire] Contact : habib.salha@yahoo.fr |
Du 16 au 19 Decembre 2014 :
 |
Congrès International "Critique de la critique maghrébine" Tunis (Tunisie) Contact : habib.salha@yahoo.fr |
Du 09 au 11 Avril 2014 :
| |
Inspiration littéraire? L’islam en filigrane dans les littératures contemporaines Lucerne (SUISSE) - Université de Lucerne |
Du 26 au 27 Mars 2014 :
 |
Colloque Identité/Identités LYON (FRANCE) - Université Lyon III et Théâtre du lavoir public Le projet consiste dans l’organisation d’un colloque, autour de la construction identitaire des «communautés» et leur-s représentation-s dans les arts. Il porte le titre d’Identité / Identités : la construction identitaire dans les arts et la culture.
Il fait suite à une journée d... [Afficher la suite] Le projet consiste dans l’organisation d’un colloque, autour de la construction identitaire des «communautés» et leur-s représentation-s dans les arts. Il porte le titre d’Identité / Identités : la construction identitaire dans les arts et la culture.
Il fait suite à une journée d'études, sur le même thème qui a eu lieu en mars 2013, avec grand succès et a suscité l’intérêt des nombreux participants. La réussite de cette journée a mis en lumière l'importance d'un approfondissement et d'un développement supplémentaire.
La notion d’identité, issue plus particulièrement de la sociologie et de la psychanalyse, s’entend comme un ensemble de données, conscientes ou non, valorisées ou pas, qui permet à un individu de se construire comme tel et en même temps de se différencier des autres. On assiste de nos jours à des questionnements de plus en plus importants sur cette notion.
L’identité d’une personne peut se penser en termes de génération, de sexe biologique, de lieu de naissance et d’appartenance à un pays. Mais le concept est bien plus large et ses contours plus flous. En effet l’identité, c'est-à-dire cette reconnaissance de moi en l’autre, de l’autre en moi, dans un aller-retour de correspondances et de différences, peut aussi se faire par rapport au genre ou sexe social, orientation sexuelle, ethnie, langue… On construit son identité, elle est le fruit d’une appropriation d’un certain nombre de codes, de règles qui servent en général à la vie en société, ou du moins, à un groupe donné. Car c’est bien là, à frontière de ces notions complexes que sont : l’individu, le groupe et la société, que l’identité se joue. L’identité est en mouvement, elle est même un mouvement.
On sait, depuis Foucault, que l’individu est composé d’un nombre important d’identités, on peut aussi penser à L’Homme Pluriel de Bernard Lahire. Les lignes de force de telle ou telle caractéristique se croisent créant des lignes de force formant une identité souvent changeante et en tout cas temporaire.
Du point de vue des artistes qui les produisent comme de ceux qui les « consomme », la construction identitaire se nourrit des pratiques culturelles, de la plus légitime à la plus populaire. Comment une communauté d’interprétation se forme-t-elle en fonction d’une quête identitaire, d’une part, et d’autre part, comment une œuvre peut-elle cristalliser les attentes de « reconnaissance » de cette communauté ?
Lors la précédente journée sont apparues nombre de pistes de réflexion dont le colloque se fera écho, telles que la construction culturelle de l'identité dans la pensée philosophique et les théories développées dans la suite du post-modernisme, enrichies des concepts de créolisation, hybridation, hétérogénéité, tant du côté de la réception que de la production ou encore, les différentes mises en scène de soi comme l'autoportrait, l'auto-fiction, le ré-engendrement du soi, ou les relations entre sujet et objet dans la création littéraire et artistique. Les riches communications de cette journée nous ont aussi amené à ouvrir la réflexion sur la place des artistes qui travaillent dans l'espace interstitiel d'un exil ou d'un exil intérieur, les marginaux, les oubliés, les exclus, les minorités et sur une hybridation esthétique et transculturelle. L'esprit du colloque est donc basé sur une approche interdisciplinaire et polyphonique, porteur d'une vision décentrée, qui puisse amener à de nouveaux points de vue et à de nouvelles perspectives de recherche.
Le colloque de deux jours est prévu le 27 et 28 mars. Il vise donc à offrir une ouverture sur ces questions et un échange international et interdisciplinaire (à travers des intervenants choisis, des chercheurs (doctorants, maîtres de conférences, professeurs, artistes, ... ) spécialisés dans ces questions, dans divers domaines artistique et scientifique : cinéma, théâtre, danse, musique, littérature, peinture, photographie, sociologie, anthropologie, philosophie .... Certains intervenants ont été invités, d'autres ont été choisis, parmi la centaine de propositions, suite à un appel à communication.
Il se déroulera pour une journée dans les lieux de l'Université de Lyon, pour l'autre journée dans les locaux du Théâtre Le Lavoir Public de Lyon, permettant ainsi à la fois une plus grande visibilité à notre événement et la création de relation de partenariat avec des institutions culturelles de la ville de Lyon. [Réduire] |
Du 14 au 16 Octobre 2014 :
 |
“THE ROLE OF DIASPORAS, MIGRANTS and EXILES IN THE ARAB REVOLUTIONS and POLITICAL TRANSITIONS” Tunis (Tunisie) This international conference aims to inquire into the ways in which diasporas, migrants and exiles have participated in the political changes at work in the Arab world. Participants are invited to move away from the dichotomy between domestic and international spaces for engagement.
This topic is ... [Afficher la suite] This international conference aims to inquire into the ways in which diasporas, migrants and exiles have participated in the political changes at work in the Arab world. Participants are invited to move away from the dichotomy between domestic and international spaces for engagement.
This topic is part and parcel of the scientific forum created by the WAFAW program that seeks to analyze the recomposition of Arab political scenes in the light of the changes brought about by the fall of some authoritarian regimes and the legitimacy crisis of the remaining ones. [Réduire] Contact : DiasporaTunis2014@gmail.com |
Du 10 au 11 Avril 2014 :
.jpg) |
Perspectives du cinéma et de l'audiovisuel dans un monde arabe en devenir Tunis (Tunisie) - Ennejma Ezzahra - Sidi Bousaid APPEL A COMMUNICATION
Cher(e)s collègues,
L’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un colloque international les 11 et 12 Avril 2014 autour du thème :
« PERSPECTIVES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL DANS
UN MONDE ARABE ... [Afficher la suite] APPEL A COMMUNICATION
Cher(e)s collègues,
L’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un colloque international les 11 et 12 Avril 2014 autour du thème :
« PERSPECTIVES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL DANS
UN MONDE ARABE EN DEVENIR ».
Ce colloque s’adresse aux chercheurs, doctorants, ou professionnels, soucieux de réfléchir sur le cinéma et l'audiovisuel afin de s’interroger sur les défis et les enjeux de demain.
Vous constaterez à partir du document ci- joint que nous avons réparti cette manifestation sur deux grands axes. Le premier sera consacré aux perspectives et enjeux des structures, le second traitera les mutations et les problématiques modernes touchant les contenus.
Merci d’envoyer vos contributions à colloqueesac2014@gmail.com
accompagnées d’un abstract de 250 mots minimum.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux documents en pièces jointes.
Espérant vous voir parmi nous, recevez Cher(e)s collègues, l'expression de ma considération distinguée.
Lamia BELKAIED GUIGA
Maitre Assistante
Coordinatrice du Master de Recherche et du colloque
Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma - Gammarth 20, Avenue Farhat Hached 2078 Gammarth B.P 614 La Marsa -Safsaf Tél: (216) 71 981 441 GSM : 00216 23 499 499 Fax : (216) 71981288 Mail: lamiabel2001@yahoo.fr [Réduire] Contact : colloqueesac2014@gmail.com |
Du 09 au 10 Novembre 2014 :
| |
Colloque international Littérature et Histoire algérienne (s) Mostaganem (Algérie) - Département de français. Université de Mostaganem Le va-et-vient entre la fiction algérienne et l’Histoire écrite de l’Algérie montre un grand intérêt à développer. Ce colloque permettra de passer de la considération du roman algérien de l’image du témoignage au niveau de: contribution à expliquer l’Histoire. Contact : littethist@outlook.fr |
Du 24 au 25 Novembre 2014 :
| |
Langue et discours, quel enseignement ? Méknès (Maroc) - Université Moulay Ismaïl Université Moulay Ismaïl Faculté des Lettres - Meknès
Appel à contribution
L’Equipe de Recherche Langages, Textes et Discours (Université Moulay Ismaïl) organise les 25 et 26 novembre 2014 à la Faculté des Lettres de Meknès (Maroc) un col... [Afficher la suite] Université Moulay Ismaïl Faculté des Lettres - Meknès
Appel à contribution
L’Equipe de Recherche Langages, Textes et Discours (Université Moulay Ismaïl) organise les 25 et 26 novembre 2014 à la Faculté des Lettres de Meknès (Maroc) un colloque international sur le thème :
Langue et discours, quel enseignement ?
Aujourd’hui, plus qu’auparavant, tandis que la mise en œuvre de la réforme universitaire L.M.D. semble désormais acquise au Maroc, la reconsidération de l’enseignement des langues et de leurs cultures respectives s’avère une tâche pressante. Or, l’intention première de ce colloque consiste en une contribution des sciences du langage (linguistique, sémiotique, pragmatique, analyse de discours, rhétorique) au traitement de problèmes posés par l’étude de la langue et du discours et que l’on peut replacer dans le cadre plus précis de l’enseignement du français. Comment des enseignants-chercheurs ayant acquis quelque pratique des sciences du langage peuvent-ils œuvrer pour optimiser l’utilisation de ces disciplines et, corrélativement, permettre une bonne maîtrise du français ? Ne pouvons-nous pas redéfinir, dans ce cadre scientifique, des contenus d’enseignement afin de répondre aux nouveaux besoins de l’étudiant ? Quels outils analytiques pourrons-nous mettre à la disposition de l’apprenant pour qu’il puisse réfléchir sur la langue et sur le discours et à partir d’eux, mais aussi acquérir un savoir-faire, accomplir des performances, en sciences du langage ? Celles-ci s’affinent davantage et les nouvelles technologies prennent des formes de plus en plus sophistiquées ; et il importe d’en exploiter les derniers apports et de les rendre accessibles.
S’il entend tracer des voies de communication entre sciences du langage (recherche) et enseignement, le colloque ne prétend pas pour autant à l’élaboration d’une nouvelle pédagogie du français ; il convie à une redistribution des savoirs de ces disciplines en tenant compte des expériences concrètes d’enseignement (pratique). Car, on le sait, une classe contribue à montrer la toute relativité d’une théorie (savoirs dits savants) et amener ainsi à la reconstruire. C’est donc la relation entre le modèle théorique et son usage qu’il importe aussi de soumettre à l’interrogation.
Voici à présent les principaux fondements scientifiques du colloque. L’enseignement de la langue tel qu’il est envisagé ici, s’il concerne principalement le français langue étrangère, eu égard au contexte marocain, se rapporte aussi au français langue maternelle. Ces deux modes d’enseignement, tout comme la réflexion sur les deux langues et leurs productions discursives, peuvent se révéler fructueux l’un pour l’autre. C’est ce qui justifie aussi dans une certaine mesure le caractère international du colloque. D’autre part, outre cette diversité linguistique inscrite au sein d’une même langue, il y a celle qu’implique le contact de langues appartenant à des sphères culturelles différentes (plurilinguisme) : le français aux côtés de l’arabe et de l’amazighe. Autrement dit, réfléchir sur le français conduit également à porter le regard sur ces deux langues. D’ailleurs, une bonne connaissance de la langue maternelle facilite aussi bien l’approche que l’acquisition d’une langue étrangère.
Pour ce qui est du discours, il est pris dans son acception étendue, car il inclut cette unité qu’est le texte, notamment le texte littéraire. En effet, le texte acquiert le trait « discursif » une fois rattaché à la situation de sa production et de sa réception. Le discours, c’est le texte en contexte. Et si nous souhaitons tenir la balance égale entre langue et discours, c’est parce que la langue en tant que système de signes et de règles (virtualité) reste inséparable du discours comme lieu de sa matérialisation (actualisation). Et cela d’autant plus que les deux domaines s’inscrivent dans une constante interaction.
Axes des contributions
Linguistique et enseignement du français (Phonologie, grammaire, sémantique)
Sciences du langage et discours (littéraire, artistique, politique, médiatique…)
Traitement informatique de la langue et du discours
Lecture / écriture ou construction du sens
La langue à travers ses productions écrites et orales
Sociolinguistique : une approche sociale de la langue et du discours
Langues en contact ; plurilinguisme et traduction
Ethique et linguistique
Calendrier
Le 31 mai 2014 : date limite de soumission des propositions (résumé d’une page environ)
Le 30 septembre 2014: notification aux auteurs de la décision du comité scientifique
(Les 25 et 26 novembre 2014 : tenue du colloque)
Le 25 décembre 2014 : date limite d’envoi des textes pour la publication
Modalités de présentation et de participation
Communication de vingt minutes ; langue d’intervention : le français.
La faculté des lettres de Meknès, l’université Moulay Ismaïl et leurs partenaires prendront en charge le séjour des participants durant le colloque.
Comité d’organisation : Noraddine Bari, Anouar Ben Msila, Malika Bezaa, Saida Bougrine, Abdeljalil El Kadim, Fouad Mehdi .
Comité scientifique : Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Anouar Ben Msila, Amal Chekrouni, Mohamed Embarki, Bouchta Es-Setté, Ali Fallous, Tijania Hidass, Eric Landowski, Zohra Lhioui, Hassan Moustir, Mohamed Naji, André Petitjean, Dalida Témim, Kamal Toumi, Karima Ziamari.
Adresse et coordination : Anouar Ben Msila ; bbenmsila@yahoo.fr
GSM : (00.212) 6.62.09.27.42 [Réduire] Contact : bbenmsila@yahoo.fr |
Le 26 Février 2014 :
 |
La Recherche à La Faculté des Sciences Ben M’sik: Etat, implications et perspectives de développement CASABLANCA (MAROC) - UNIVERSITÉ HASSAN II CASABLANCA MOHAMMEDIA Dans le cadre de la commémoration de son 30ème Anniversaire, La Faculté des Sciences Ben M’sik, Organise une Journée sous le thème:
La Recherche à La Faculté des Sciences Ben M’sik:
Etat, implications et perspectives de développement
Le Jeudi 27 Février 2014
Durant les 30 ann�... [Afficher la suite] Dans le cadre de la commémoration de son 30ème Anniversaire, La Faculté des Sciences Ben M’sik, Organise une Journée sous le thème:
La Recherche à La Faculté des Sciences Ben M’sik:
Etat, implications et perspectives de développement
Le Jeudi 27 Février 2014
Durant les 30 années d’existence de La Faculté des Sciences Ben M’sik (FSBM), la recherche scientifique à toujours constitué l’un des domaines phares de son activité.
Actuellement la Faculté compte parmi les établissements scientifiques qui contribuent activement à la production scientifique à l’échelle régionale et nationale.
En 2013 un nouveau pas a été franchi avec la finalisation du processus de structuration des laboratoires selon les normes nationales et la charte d’accréditation de l’Université Hassan II Mohammedia. Aujourd’hui, presque 90% des chercheurs travaillent au sein des 16 laboratoires accréditées et membres des 3 centres de recherche « Sciences et Techniques » de l’université.
Par ailleurs, la structuration de la formation doctorale dans le cadre du CEDoc a permis d’améliorer le déroulement du cycle du doctorat depuis l’inscription du doctorant, son implication dans la formation complémentaire, la prise en charge de son sujet de recherche et le couronnement du travail de la thèse pour sa soutenance.
Afin de renforcer la gouvernance de la recherche et dynamiser ses structures et ses instances Cette journée est organisée et se fixe comme objectifs de:
- Informer les chercheurs sur les orientations, les mesures d’accompagnement et le bilan de la recherche scientifique à l’échelle nationale et universitaire.
- Dresser un bilan de l’activité scientifique de la FSBM.
- Renforcer la gouvernance des structures de recherche locales.
La Faculté des sciences Ben M’Sik, qui entend associer l'ensemble des organismes et entreprises intéressés par cette thématique, sollicite à travers cette annonce une participation massive à cet événement. [Réduire] Contact : Faculté des sciences Ben M’Sik Avenue Cdt Driss El Harti, Casablanca. Pr. O. TANANE GSM 0664226815 e-mail o.tanane@gmail.com |
Du 14 au 15 Avril 2015 :
| |
La littérature maghrébine de langue française au tournant du 21ème siècle : FORMES ET EXPRESSIONS LITTERAIRES DANS UN MONDE EN MUTATION Alger (Algérie) - Université d'Alger 2 A la fin des ères coloniales, la littérature maghrébine s’est attribué la mission de révolutionner les sociétés endogènes promises à des mutations sociales et politiques pour entrer résolument dans la modernité. Dans cet élan, souvent le roman algérien, plus généralement le roman ma... [Afficher la suite] A la fin des ères coloniales, la littérature maghrébine s’est attribué la mission de révolutionner les sociétés endogènes promises à des mutations sociales et politiques pour entrer résolument dans la modernité. Dans cet élan, souvent le roman algérien, plus généralement le roman maghrébin, a été appréhendé à travers le prisme de l’inter-culturalité, du métissage, du nomadisme et autres concepts qui ont induit par exemple les thèmes de l’exil et des migrations, orientés vers le Nord à la fois enchanteur et décevant.
Dans ce contexte, l’aboutissement d’une telle préoccupation, s’inscrivait dans ce qui a été appelé : « La littérature Monde », en écho à l’idée de mondialisation préconisant la rupture des frontières, à la faveur d’une plus souple circulation des hommes, des biens et des idées. Ainsi disparaîtrait le ‘’National’’ et ce qui le désigne tout spécifiquement, voyant en cela un frein au progrès de l’humanité.
Or, force est de constater que cet élan fédérateur à grande échelle s’essouffle du fait d’un retour précisément au national qui alimente les imaginaires ; comme si l’ailleurs dictait maintenant le retour à soi, encouragé par un contexte politico-idéologique qui clame la fermeture sur soi comme disposition sécuritaire et comme mesure d’accompagnement des efforts pour juguler les crises économiques internes des pays occidentaux. Peut-être faut-il aussi se ranger du côté de Stéphane Hessel défenseur des frontières « pour au moins avoir le plaisir de les franchir. »
De fait, la littérature magrébine en ce nouveau siècle, renoue volontiers les liens avec le territoire interne ; les lieux de l’ailleurs sont plutôt absents. Dans les récentes livraisons, les espaces narratifs s’éloignent de ceux de l’outre Méditerranée au moment même où paradoxalement le flot des harraga ne cesse de gonfler. Et quand il est question de départ, c’est encore une manière de parler de ce qui de l’intérieur l’Algérie le suscite.
Les motifs narratifs puisent dans l’Histoire qui se réécrit à contre- courant de celle dite officielle, dans la société qui décline ses multiples visages inédits et contradictoires, dans l’actualité internationale avec ses incidences directes sur le national, etc. Dans le présent, la littérature d’Anouar Benmalek, par exemple, donne de l’Algérie et de l’Algérien une représentation inédite.
Des questions antérieurement soulevées sont ressaisies, mais selon de nouvelles postures. Pour exemple, l’image de la femme n’est plus celle d’un sujet mais souvent d’un citoyen qui se positionne par la parole et les actes. Signe de libération qui va parfois jusqu’à la provocation ressentie par certains quand par exemple Sarah Haïder publie Virgules en trombes, un véritable phénomène littéraire. Il est aussi des écrits, plus marginaux, comme ceux de Djamel Mati qui s’inscrivent volontiers dans la création, plutôt distante des préoccupations socio-politiques et historiques. Plus originale est aussi l’écriture de Y.B.
Ce que l’on peut affirmer c’est que le retour à soi dans la littérature algérienne en ce présent s’effectue dans la rupture avec la littérature post-coloniale et les théories qui l’accompagnent. Nouvelle perception du monde et de soi qui conduit à se revisiter de l’intérieur sans pour autant perdre de vue la complexité de la relation à l’autre qui se pose en des termes nouveaux. Dans cette reconfiguration, le champ littéraire, autant par la variété des problématiques soulevées que par celle des modes d’écriture qui déclinent des factures esthétiques plurielles, mérite un état des lieux qui participe assurément à l’écriture de l’histoire littéraire algérienne.
Au cours de ce colloque, l’objectif majeur est de décrire et de définir le(s) nouveau(x) visage(s) de la littérature algérienne afin de mettre au jour le(s) Sens qu’elle construit en cette première décennie du XXI°S.
Axes d’intervention :
- Réécritures de l’Histoire
- Anciennes thématiques, nouvelles approches : Exil, harraga, immigration, écriture de Soi, écriture et thématiques féminines…
- Au-delà des notions : Inerculturalité, littérature monde, mondialisation, Post-colonialisme…
- Nouveaux modes d’expressions. [Réduire] |
Du 07 au 08 Février 2014 :
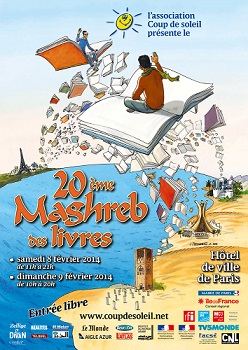 |
Paris (France) - Hôtel de Ville |
Du 18 au 20 Octobre 2014 :
| |
L’Autorité et ses discours Boumerdès (Algérie) - Université de Boumerdès |
Du 12 au 13 Avril 2014 :
| |
Femmes combattantes. Histoire et mémoire Chlef (Algérie) - Université Hassiba Benbouali - Chlef - Algérie Colloque international. Femmes combattantes. Histoire et mémoire Contact : colloque.femmescombattantes@yahoo.fr |
Du 10 au 12 Février 2014 :
 |
Francophonies méditerranéennes (XXIème siècle) langues, littératures Grenoble (France) - Université Stendhal Grenoble 3 Contact : Ridha Boulaâbi |
Du 22 au 24 Janvier 2014 :
| |
Lyon (France) - Musée des Moulages, Université Lumière Lyon 2 Le Master 2 pro TLEC et l'Université Lumière Lyon 2 ont le plaisir de vous convier à Lumières d'ailleurs, les premières Rencontres interculturelles de l'édition étrangère et de la
traduction, qui auront lieu les 23, 24 et 25 janvier 2014 dans le magnifique lieu du Musée des Moulages (Lyon... [Afficher la suite] Le Master 2 pro TLEC et l'Université Lumière Lyon 2 ont le plaisir de vous convier à Lumières d'ailleurs, les premières Rencontres interculturelles de l'édition étrangère et de la
traduction, qui auront lieu les 23, 24 et 25 janvier 2014 dans le magnifique lieu du Musée des Moulages (Lyon 3°). Comment construit-on une idée de l’Autre dans une société traversée de multiculturalisme et de replis identitaires ? Éditeurs, traducteurs, auteurs, chercheurs, responsables de festivals et d’institutions culturelles échangeront en présence du public, universitaire ou non. Lumières d’ailleurs, c’est aussi un salon du livre, spécialisé sur le domaine étranger, et un lieu de découvertes à travers diverses animations culturelles (lectures, ateliers, dégustations, concerts...).
Nous proposons des ateliers de traduction littéraire le vendredi après-midi avec des traducteurs professionnels. Une expérience unique de découvrir les subtilités du métier !
"Lumières d’ailleurs" est conçu et organisé par les étudiants du M2 pro TLEC (Traduction littéraire et édition critique) de la Faculté des Langues, sous la direction de Sylvie Protin et Marianne Duflot. Vous trouverez plus d’informations sur le site de Lumières d’ailleurs :
http://www.lumieresdailleurs.fr/
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux !
- sur twitter : https://twitter.com/Lumdailleurs
- et sur facebook : https://fr-fr.facebook.com/lumieresdailleurs
Nous vous attendons nombreux !
Nos invités :
Fernando Ainsa, Lise Belperron, Jörn Cambreleng, Vicente Cervera, Colette Combe, Alexis Dedieu, Touriya Fili Tullon, Georges-Arthur Goldschmidt, Pascal Jourdana, Samia Kassab, Laurence Kieffé, Jean-Yves Loude, Jean-Yves Masson, Isabelle Nièvres-Chevrel, Juliette Ponce, Gisèle Sapiro, Emmanuel Varlet, Jean-Claude Villegas, Dominique Vittoz, Michel Volkovitch, Hélène Wadowski. [Réduire] Contact : ocerambaud@gmail.com |
Du 07 au 08 Mai 2014 :
| |
La circulation du film dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord: Stratégies, acteurs économiques et pratiques des publics Saint-Denis (FRANCE) - Mairie FRANCE Contact : Patricia CAILLÉ |
Le 02 Février 2014 :
| |
Le corps et ses outrances dans le roman algérien contemporain Oran (Algérie) - UCCLLA/CRASC, CENTRE DE RECHERCHE EN ANTHROPLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
Unité de Recherche Sur la Culture, la Communication, les Langues, les Littératures et les Arts
PROJET : RECEPTION CRITIQUE DU ROMAN CONTEMPORAIN ALGERIEN
JOURNEE D ETUDE, LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 A 9H, UCCLLA/CRASC,
ES-SENIA, ORAN, ALGERI... [Afficher la suite] CENTRE DE RECHERCHE EN ANTHROPLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
Unité de Recherche Sur la Culture, la Communication, les Langues, les Littératures et les Arts
PROJET : RECEPTION CRITIQUE DU ROMAN CONTEMPORAIN ALGERIEN
JOURNEE D ETUDE, LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 A 9H, UCCLLA/CRASC,
ES-SENIA, ORAN, ALGERIE
THEME : LE CORPS ET SES OUTRANCES DANS LE ROMAN ALGERIEN CONTEMPORAIN
Argumentaire
Dans son ouvrage intitulé Sur le corps romanesque, Roger Kempf met sur un même pied d’égalité et de dignité le livre et le corps arguant que « Tout parle ou se parle, s’écrit, se lit […] », faisant ainsi du corps un thème littéraire de prédilection, mais aussi et surtout un générateur et un producteur de discours. Il est donc légitime d’avancer que le texte littéraire contrairement aux autres discours sur le corps (biologique, neuroscientifique, philosophique, sociologique et anthropologique) met des mots sur un savoir qui serait resté probablement occulte ou comme le dit Proust « le secret de chacun ».
Même s’il trouve sa place dans le texte, essentiellement dans le texte féminin où il participe à un processus de reconquête de la parole et de la liberté, force est de reconnaitre que le rapport de l’écriture algérienne contemporaine au corps reste problématique. En effet, le corps reste toujours assiégé par la morale et vécu comme une plaie et une blessure en témoignent les écrits de Nina Bouraoui, Meyssa Bey ou encore Malika Mokkedem. Contrairement à la littérature occidentale qui a su créer entre le corps et l’écriture un rapport d’ouverture et de parole, la littérature maghrébine n’a donc fait que l’occulter en l’enveloppant dans une gangue, dans un vide textuel. Pour pallier cette absence de l’écriture du corps dans le texte romanesque et combler cette béance thématique, certains auteurs ont carrément choisi de faire dans la violence et la provocation. Nous pensons notamment à Rachid Boudjedra et Amin Zaoui qui excellent dans l’impudicité et les excès langagiers. Sous leur plume, le corps est meurtri et soumis aux pires sévices. Pire encore, il est totalement éjecté du monde du rêve et de l’imaginaire, de ces fantaisies, désirs et autres pulsions du moi qui lui permettent habituellement d’exister et d’être un objet jouissif.
La question centrale à laquelle cette journée d’étude tentera de répondre est : « Quelles sont les différentes représentations du corps dans le roman algérien contemporain ? ». Cette journée d’étude se donne donc comme objectif d’interroger l’écriture romanesque des années 1990 à nos jours sur le thème de la corporéité et de dresser un état des lieux. Ainsi, pourront être abordés différents axes de réflexion suivants :
- Poétique du corps dans les fictions contemporaines
- Les discours et thèmes sur le corps dans le roman moderne : corps malade, corps meurtri, corps blessé, corps violenté, corps érotique, corps pornographique, corps voilé/dévoilé …
- La symbolique du corps féminin dans les narrations actuelles
Comité scientifique et d’organisation
BENDJELID Faouzia, chef de projet, Présidente ; MERINE Kheira, membre ; DRIS Leila, membre ; ZINAÏ Yamina, membre ; Lynda-Nawel TEBBANI, membre [Réduire] Contact : bendjelid.f@gmail.com |
Du 10 au 11 Avril 2014 :
| |
Territoires de l'Ecran, Territoires Inter-dits : transgressions, censures, déliaisons Toulouse (France) - Faculté Libre des Lettres et des Sciences Humaines L’équipe de recherche en cinéma CES (Cinéma Esthétique Sémiologie), dans le cadre de son plan de recherche sur la représentation au cinéma, propose un colloque autour de la question des territorialités et des transgressions, ouvert aux spécialistes des études filmiques tout comme aux aut... [Afficher la suite] L’équipe de recherche en cinéma CES (Cinéma Esthétique Sémiologie), dans le cadre de son plan de recherche sur la représentation au cinéma, propose un colloque autour de la question des territorialités et des transgressions, ouvert aux spécialistes des études filmiques tout comme aux autres domaines, permettant ainsi de dresser un pont pluridisciplinaire entre le cinéma et les autres formes artistiques, culturelles et sociétales. [Réduire] Contact : Gérard Dastugue |
Du 04 au 05 Mai 2014 :
| |
ASSIA DJEBAR : LE PARCOURS D’UNE FEMME DE LETTRES. LITTÉRATURE, RÉSISTANCE ET TRANSMISSION Oran (Algérie) - Université Contact : ladicil@gmail.com |
Du 06 au 08 Mai 2014 :
| |
Colloque international autour du cinéma et de la Palestine Safi (Maroc) - Faculté Polydisciplinaire de Safi Colloque international autour du Cinéma et de la Palestine.
La 9ème édition des Journées Cinématographiques de Safi (JCS) organise les 7, 8, et 9 mai 2014 un colloque international dédié au Cinéma et la Palestine.
La thématique exploitera et questionnera à la fois cette relation épin... [Afficher la suite] Colloque international autour du Cinéma et de la Palestine.
La 9ème édition des Journées Cinématographiques de Safi (JCS) organise les 7, 8, et 9 mai 2014 un colloque international dédié au Cinéma et la Palestine.
La thématique exploitera et questionnera à la fois cette relation épineuse, qui ne cesse de s’enraciner dans l’imaginaire dans toutes ses configurations (religieuse, patrimoniale, historique, conflictuelle, humaine…), et essayera de donner des éléments de réponses pluridisciplinaires à ce rapport.
Sujet médiatique par excellence, la Palestine deviendra, lors des JCS un matériau d’études dans sa dimension esthétique pour en dégager une substance qui va au-delà de ce que les télé journaux et Cie ont fait d’elle.
Argumentaire
Il est des lieux de toutes les controverses, de toutes les convoitises, mais aussi de toutes les amours et de toutes les haines, de toutes les religions, de toutes les guerres, et de toutes les paix aussi. Il est des lieux de toutes les langues. AlQods, Jérusalem, Ourshalim, Pilistine, Palestine, Terre des Géants, Terre perdue… Des noms du même lieu décliné dans des langues qui ne cachent pas leurs différends l’une par rapport à l’autre. La Palestine est de tout temps captivante, le cinéma, dans toutes ses déclinaisons, va, lui aussi la capturer, pour en faire tour à tour une martyre, une sainte, un pays, deux pays, des guerres, une résistante, un mur, une mosquée, un temple... Avec l’avènement du cinéma elle sera présente sous tous ses (E)états.
Dans un récent ouvrage de Sylvain Dreyer, évolutions ! - Textes et films engagés - Cuba, Vietnam, Palestine, Paris : Armand Colin, coll."Cinéma / Arts visuels", 2013. 256 p. l’auteur discute de la naissance en France, puis un peu partout d’un engagement artistique critique envers le politique avec un souci esthétique avoué. Et dans cette carte politique de l’art cinématographique, une place d’honneur a été donnée à la Palestine, qui va émerger comme une Terre de l’Image alors qu’elle était depuis toujours une Terre de la Parole et de l’Ecriture.
Le colloque discutera de cette présence de la Palestine dans le cinéma en tant que Terre de l’Histoire Ancienne et de l’Histoire actuelle selon des perspectives qui sont de l’ordre de l’artistique tout d’abord, sans négliger, toutefois, de donner la belle part aux différentes manifestations des thèmes chers au sujet :
Temporalité et témoignage
Burlesque et question palestinienne
Le comique
Le tragique
Les guerres
Le cinéma israélien visitant la question palestinienne
Le péplum et la Palestine
Les Arabes et la Palestine
Les palestiniens et leur question…
Représentation du Palestinien dans le cinéma international
Cinéma palestinien et Histoire
Représentation des Israéliens par les palestiniens et vice-versa
Patrimoine palestinien
Le colloque est ouvert à un corpus de films variés : fiction ou documentaires permettant de rendre compte du thème en l’inscrivant dans l’Histoire d’une Terre et dans l’Art.
Vous pouvez adresser vos propositions de communications jusqu’au 15 mars 2014 aux professeurs Abdelaziz Amraoui (amraouia@hotmail.com) ou Rachid Naim (rachid.naim@gmail.com) pour les textes en français. Pour les propositions écrites en arabe, veuillez vous adresser au Professeur Mounir ElBaskri (elbaskrimounir@yahoo.fr) en précisant votre nom, votre affiliation, le titre proposé pour votre communication, résumé d’une demi-page environ ainsi qu’une note bio-bibliographique.
Responsables : Pr. Abdelaziz Amraoui, Pr. Mounir ElBaskri, Pr. Rachid Naim
Les journées se dérouleront les 07, 08 et 09 mai 2014.
Les frais de participation sont de 500 dh pour les intervenants des pays du Sud et de 750 dh pour ceux du Nord. A régler une fois sur place.
Les organisateurs prendront en charge les frais d'hébergement en pension complète. [Réduire] Contact : AMRAOUI Abdelaziz |
Du 25 au 29 Aout 2014 :
| |
XXXVe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française-ASPLF Rabat (Maroc) Maroc Contact : rivesmed.philo2014@gmail.com |
Le 16 Mars 2014 :
| |
Casablanca (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik Casablanca Colloque sur le Conte et la Communication |
Du 22 au 23 Avril 2014 :
| |
Colloque national: « La conception et/ou la représentation de la femme dans la littérature algérienne d’expression française Laghouat (Algérie) - Université de Laghouat Contact : chahrazade.lahcene@outlook.fr |
Du 11 au 13 Novembre 2013 :
 |
Francophonies méditerranéennes (XXIe siècle) : langues, littératures Grenoble (France) - Université Grenoble Alpes Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une série de rencontres organisées par le centre Traverses 19-21 et l’université de Grenoble Alpes depuis plusieurs années. En novembre 2006, une journée d’études porte sur le roman maghrébin contemporain, en collaboration avec l’associati... [Afficher la suite] Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une série de rencontres organisées par le centre Traverses 19-21 et l’université de Grenoble Alpes depuis plusieurs années. En novembre 2006, une journée d’études porte sur le roman maghrébin contemporain, en collaboration avec l’association grenobloise Amal et avec la participation du romancier algérien Boualem Sansal. Quatre ans plus tard, en avril 2010, Claude Coste et Daniel Lançon consacrent un colloque aux « Perspectives européennes des études francophones », dont les actes doivent paraître en septembre 2013 aux éditions Honoré Champion. Par ailleurs, le département de Lettres et le centre Traverses 19-21 participent depuis sa création en 2005 à l’École Doctorale Algéro-Française (l’EDAF), devenue depuis 2012 le LATEF. De nombreux liens ont ainsi été tissés avec plusieurs universités algériennes (Oran, Annaba, Constantine…) et tout particulièrement avec l’ENS Bouzaréah d’Alger et son laboratoire de français le LISODIP (codirection de thèses, séminaires, éditions). Parallèlement à cette collaboration régulière avec l’Algérie, l’université de Stendhal-Grenoble 3 et le centre Traverses 19-21 travaillent depuis 2010 avec le centre Lettres et Arts GRAL de l’université de Meknès au Maroc dont Ridha Boulaâbi est membre associé. Un colloque « Barthes au Maroc » s’est tenu à l’université Moulay Ismaïl en mai 2010 sous la direction de Ridha Boulaâbi, Claude Coste et Mohamed Lehdahda. Les actes vont paraître en avril 2013 aux Presses Universitaires de Meknès.
En proposant de co-organiser un colloque sur les francophonies méditerranéennes au début du XXIe siècle, le centre Traverses 19-21 poursuit donc son travail de collaboration avec le Maghreb et le Machrek. Après avoir mis en valeur la littérature de l’Indépendance ou de la dernière décennie de XXe siècle, les organisateurs, algériens, français et marocains, de ces journées souhaiteraient mettre l’accent sur la quinzaine d’années qui ouvrent le XXIe siècle. La fin de la décennie noire en Algérie, la mondialisation des échanges et de la culture, les révolutions arabes, les crises économiques, les nouvelles formes d’immigration, les guerres africaines (Lybie et Mali), constituent des événements majeurs dont l’impact ne se fait pas encore forcément sentir, mais dont on ne peut faire l’économie quand on réfléchit à l’état présent de la francophonie dans le monde méditerranéen. A cette première délimitation temporelle (2000-2014) s’en ajoute une autre, concernant cette fois-ci l’objet même de la recherche. Si le monde francophone touche à tous les sujets et à tous les domaines, on privilégiera la langue (ou les langues) et la littérature. La francophonie – faut-il le rappeler ? – est d’abord une question linguistique : présence de la langue française, confrontation aux autres langues de la région comme l’arabe ou le berbère ou à des langues étrangères comme l’anglais ou l’espagnol, développement et didactisation du plurilinguisme. Ces réalités ne sont pas neuves, mais il paraît nécessaire de faire le point sur la situation actuelle à une époque où la colonisation s’éloigne. La linguistique et la socio-linguistique tiendront une grande place dans les interventions d’autant que le le laboratoire de recherches de l’ENS d’Alger, le LISODIP, s’intéresse aux pratiques langagières plurilingues dans différents contextes (social, littéraire, scolaire, universitaire, professionnel) et aux représentations sur toutes les langues en présence en Algérie. Quant au LIDILEM de Grenoble 3, il manifeste une grande expérience dans le domaine du français langue étrangère ou du français langue seconde. Au-delà de l’usage quotidien de la langue, la littérature offre un champ d’exploration dont il est inutile de souligner l’importance. Où en sont les littératures francophones de la Méditerranée ? Quels sont les objets qu’elles se donnent ? Peut-on parler d’une langue littéraire propre aux milieux bilingues ? Quels sont les lieux de productions et de diffusion (maisons d’éditions, revues, presse, etc.) ? Comment se pose la question des archives et quel est l’avenir des études génétiques dans cette région du monde où la relation au manuscrit ne correspond pas forcément au fétichisme du monde occidental ?
Le colloque se propose ainsi d’explorer les domaines suivants :
1) La langue entre réalité et imaginaire : état des lieux, phénomènes de « créolisation », représentation de sa propre langue et de celle de l’ « autre », didactique du français et du plurilinguisme, problématique de la traduction…
2) La littérature : nouvelles thématiques, nouvelles formes, nouveaux genres, dialogue avec les littératures de langue arabe, lectorat…
3) Les archives et les éditions : bibliothèques, librairies et maisons d’édition, centres de recherches, catalogage, numérisation, imaginaire du livre et de la trace…
4) La recherche en critique littéraire et en sciences humaines : place des études postcoloniales en Méditerranée, confrontation de la recherche occidentale et d’autres traditions littéraires, les Orients de la francophonie méditerranéenne (orientalisme et francophonie), réalité et fiction du décentrement culturel, études de genre…
5) La francophonie à l’aune de l’histoire (révolutions arabes, crises économiques) : quelle place, quel discours et quel avenir pour la langue française ? quels sont les nouveaux espaces d’écriture et les nouvelles stratégies de communication (blogs, bandes dessinées, caricatures, forums de discussion, tchats) ? Quelle écriture suscite l’immigration, légale ou clandestine (Sansal, Jelloun, Teriah) ?
Ces rencontres universitaires souhaiteraient inviter des écrivains afin qu’ils puissent intervenir pendant le colloque et éclairer la réflexion par leur point de vue de créateurs. Cette présence d’un ou deux écrivains permettra également d’ouvrir les travaux universitaires à un public beaucoup plus large. D’une part, une table ronde sera organisée en ville en collaboration avec les bibliothèques publiques et les associations franco-maghrébines grenobloises. D’autre part, un écrivain sera invité par l’UFR LLASIC et le département de lettres pour intervenir dans le séminaire de master consacré aux études francophones et dialoguer avec les étudiants autour d’une de ses œuvres inscrite au programme. [Réduire] Contact : ridha.boulaabi@wanadoo.fr |
Du 20 au 22 Novembre 2013 :
 |
Langues et Méditerranéité Tunis (Tunisie) - Institut Supérieur des Sciences Humaines Contact : Kamel Gaha/ Mansour Mhenni/ Hedia Abdelkéfi |
Du 12 au 13 Mars 2014 :
| |
Le texte en contexte(s), CIEFT 2014, XIe Colloque International d’Études Francophones Timişoara (Roumanie), les 13-14 mars 2014 Timisoara (Roumanie) - Université de l'Ouest de Timisoara Appel à communications
Le texte en contexte(s), CIEFT 2014, XIe Colloque International d’Études Francophones, Timisoara (Roumanie),
les 13-14 mars 2014
La XIe édition du Colloque international d’études francophones de Timişoara (CIEFT 2014) se propose de remettre en discussi... [Afficher la suite] Appel à communications
Le texte en contexte(s), CIEFT 2014, XIe Colloque International d’Études Francophones, Timisoara (Roumanie),
les 13-14 mars 2014
La XIe édition du Colloque international d’études francophones de Timişoara (CIEFT 2014) se propose de remettre en discussion la problématique si vaste du texte dans une perspective linguistique, didactique, littéraire.
Malgré le nombre toujours croissant d’études qui lui ont été consacrées, le texte continue à susciter des réflexions et, les dernières décennies, de nouveaux acquis théoriques et méthodologiques ont enrichi le domaine. C’est pourquoi nous avons considéré qu’une reprise du sujet dans le cadre des études francophones ne manquera pas d’intérêt.
Ce colloque essaie de circonscrire ce sujet aux liens que le texte entretient avec son environnement linguistique ou extralinguistique:
•les unités textuelles entre elles et leurs liens hiérarchiques jusqu’au niveau du texte (phrases, séquences, énoncés, périodes, paragraphes, séquences, plans de texte) ;
•le texte et l’environnement socio-culturel et historique ;
•le texte entre producteur et utilisateur ;
•le texte français vs. texte francophone ;
•le texte et l’intertexte ;
•le texte en synchronie et le texte en diachronie ;
•le texte comme structure d’intervention et d’échange ;
Les thèmes peuvent être regroupés autour des trois axes traditionnels : linguistique, littéraire et didactique :
a)en linguistique
- l’influence du co/con-texte sur le sens du texte ;
- le texte en discours : les interactions verbales;
- les données sémantiques et pragmatiques du sens ;
- le texte sous l’empreinte du socio-culturel ;
- le texte oral vs. le texte écrit ;
- la cohésion, la connexité et la cohérence textuelles.
b) en littérature
- le texte littéraire et ses réverbérations socio-culturelles françaises et francophones;
- le rapport texte - intertexte – architexte – paratexte – supratexte ;
- les métamorphoses du texte littéraire : formes, types, structures, architecture, variations, etc.
- le texte littéraire et paralittéraire durant les grandes époques des littératures française et francophones.
c)en didactique
-les types de textes et l’enseignement des FLE, FOS, FOU ;
-la relation texte authentique / texte construit ;
-les perspectives socio-culturelles dans l’enseignement des FLE, FOS, FOU ;
-le rôle de l’environnement multimédia dans l’enseignement des FLE, FOS, FOU ;
Toute autre proposition ayant trait à ce domaine sera la bienvenue.
Comité scientifique
Eugenia ARJOCA- IEREMIA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie
Sorin BARBUL, Maître de Conférences, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Roumanie
Mohamed DAOUD, Professeur des universités, Université Es-Senia Oran et CRASC Oran, Algérie.
Liliana FOŞALĂU, Maître de Conférences, Université Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Roumanie
Floarea MATEOC, Maître de Conférences, Université d’Oradea, Roumanie
Liana POP, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Roumanie
Trond Kruke SALBERG, Professeur des universités, Université d’Oslo, Norvège
Nathalie SOLOMON, Professeur des universités, Université Via Domitia, Perpignan, France
Carmen STOEAN, Professeur des universités, ASE, Bucureşti, Roumanie
Maria ŢENCHEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie
Estelle VARIOT, Maître de Conférences, Université Aix-Marseille, France
Carmen VLAD, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Roumanie
Présidente du colloque
Mariana PITAR, Université de l’Ouest de Timişoara
Comité d'organisation
Andreea Gheorghiu, Ramona Maliţa, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara.
Secrétaire du colloque
Dana UNGUREANU
Calendrier
– 15 décembre 2013 : envoi des propositions de titres de communication et des résumés, ainsi que du formulaire d’inscription (fiche personnelle).
– 15 janvier 2013 : notification d’acceptation.
Ce sont déjà inscrits pour des communications en sessions plenières les suivants : Carmen VLAD, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca ; Liana POP, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca ; Efstratia OKTAPODA, Ph.D., Université de Paris IV-Sorbonne.
Bulletin d’inscription
à renvoyer par courriel à : Mariana Pitar, pitarmariana@yahoo.fr , Dana Ungureanu danamariaungureanu@yahoo.com avant le 15 décembre 2013
Nom:
Prénom:
Intitulé de la communication:
Section du colloque :
Affiliation:
Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) :
E-mail:
Adresse professionnelle:
Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos :
Oui ou non
Résumé en français (200 - 250 mots)
Notice bio-bibliographique (10 lignes)
Frais d’inscription au colloque :
•50 euros (payables en RON pour les participants de Roumanie).Les frais d’inscription comprennent la participation au Colloque, la documentation, les pauses-café, ainsi que la publication des actes du Colloque.
À noter
•Le temps prévu pour chaque communication est de 20 minutes, suivi d’une discussion de 10 minutes.
Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique [Réduire] |
Du 11 au 13 Novembre 2013 :
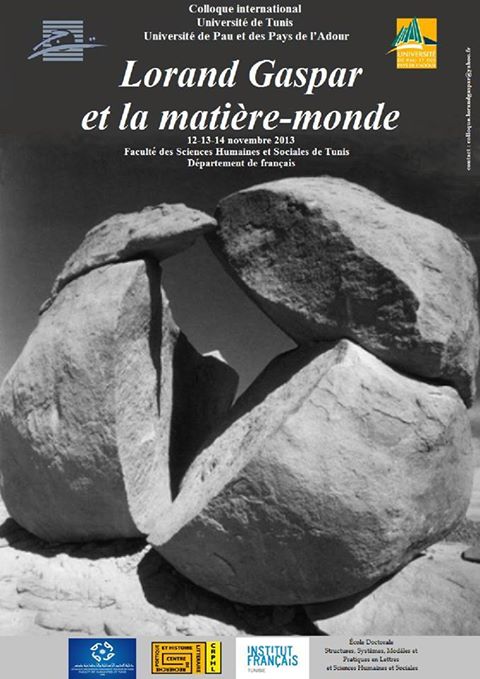 |
Lorand Gaspar et la matière-monde Tunis (Tunisie) - Faculté des Sciences Humaine et Sociales Tunisie Contact : Anis Nouiri |
Du 27 au 29 Avril 2014 :
| |
Assia Djebar: histoire et mémoire Boumerdès (Algérie) - Université M'Hamad Bougara, Boumerdès Contact : Mohand-Akli Rezzik, Département des langues, Université M\\\'Hamad Bougara, Boumerdès, 35000 |
Du 14 au 17 Janvier 2014 :
| |
Prix littéraire International Kateb Yacine de la ville de Guelma Guelma (Algérie) - Guelma Algérie Contact : aliabbassi139@yahoo.fr |
Du 14 au 17 Janvier 2014 :
 |
V° colloque Kateb Yacine à Guelma - Algérie Guelma (Algérie) Contact : mansourmhenni@yahoo.fr |
Du 06 au 08 Novembre 2013 :
| |
Albert Camus, un Homme de multiples présents Aix-en-Provence (France) - IAU College |
Du 03 au 04 Mars 2014 :
| |
Paysages minorants, dynamiques et implications Alger (Algérie) - ENS de Bouzaréah |
Du 01 au 02 Mai 2014 :
 |
Cinéma de festival, cinéma populaire : pratiques cinématographiques en Afrique au 21e siècle Montréal (Canada) - Université Concordia COLLOQUE INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ CONCORDIA (MONTRÉAL)
2 et 3 MAI 2014
CINÉMA DE FESTIVAL, CINÉMA POPULAIRE : PRATIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES EN AFRIQUE AU 21E SIÈCLE
(Françoise Naudillon : comité organisateur)
Alors que Grigris, le film du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh H... [Afficher la suite] COLLOQUE INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ CONCORDIA (MONTRÉAL)
2 et 3 MAI 2014
CINÉMA DE FESTIVAL, CINÉMA POPULAIRE : PRATIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES EN AFRIQUE AU 21E SIÈCLE
(Françoise Naudillon : comité organisateur)
Alors que Grigris, le film du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun, a obtenu le Prix Vulcain de l’Artiste-Technicien, décerné par la C.S.T au Festival de Canne 2013, cette reconnaissance laisse peut-être dans l’ombre d’autres pratiques cinématographiques qui contribuent à diversifier l’écosystème d’un cinéma dont on souligne trop souvent le manque de ressources et la difficulté d’accès. Pourtant, lors de la 23e édition du Fespaco, le plus grand festival panafricain du cinéma (23 février au 2 mars), les ministres de six états africains ont proclamé la Déclaration solennelle d’Ouagadougou laquelle survient après la proclamation de la Charte d’Alger en 1975 et du Manifeste de Niamey au Niger en 1982 qui insistaient sur le rôle primordial de l’État pour le développement du cinéma en Afrique. Cette nouvelle donne changera-t-elle les pratiques cinématographiques en Afrique avec la création du Fonds panafricain du cinéma?
Entre Nollywood et Cinéma Numérique Ambulant, entre téléréalité et autres séries qui s’épanouissent sur les écrans de télévisions africains, entre chefs d’œuvre primés, reconnus mondialement et célébrations du cinéma africain au cours de nombreux festivals (Vues d’Afrique, FESPACO, FIFP, African Movie Academy Award, etc.), la réflexion de Boubaka Diallo, réalisateur et promoteur de la structure de production, les Films du Dromadaire, reste pertinente : « Le cinéma dit populaire a indéniablement enrichi le paysage audiovisuel du continent et il serait dommage d’arrêter ou de renoncer à cette source de transmission de la culture. », reconnait-il. Cependant : « On ne saurait répondre à la question de savoir « Quel cinéma pour l’Afrique en ce début du XXIe siècle » sans poser le problème fondamental de l’industrialisation du cinéma d’Afrique noire. Il nous semble qu’il faut aller au-delà de cette considération qui est faite du cinéma comme d’un simple divertissement. L’autonomisation et l’indépendance devraient constituer des objectifs essentiels pour lesquels toutes les pistes - et hors-pistes - devraient se croiser pour faire éclore un cinéma digne de l’ambition d’une Afrique nouvelle qui veut se donner une image d’elle-même et offrir de nouvelles images au monde. »
Il s’agira de réfléchir aux nouvelles pratiques cinématographiques sur le Continent alors que nous sommes dans la deuxième décennie du 21e siècle. Les thèmes suivants pourraient être abordés :
- Indépendance ou autonomie : le cinéma africain comme entreprise culturelle
- Le facteur numérique : pratiques esthétiques
- Un cinéma nomade : home cinéma, cinéma ambulant, etc. Analyse des pratiques, analyse des publics
- Que serait un cinéma populaire en Afrique?
- Cinéma africain et institutions
- Pratiques artisanales, pratiques industrielles dans le cinéma africain, etc.
Le colloque se tiendra en même temps que le Festival Vues d’Afrique (24 avril - 3 mai, 30e édition) et sera l’occasion pour les participants de visionner des films inédits et de rencontrer les réalisateurs invités.
Nous proposerons certaines activités en partenariat avec le festival Vues d’Afrique.
Par ailleurs le colloque sera l’occasion du lancement du site web : L’Afrique fait son cinéma
http://afriquefaitsoncinema.nt2.ca/ (site en construction)
Vous êtes priés d’envoyer vos propositions de communication accompagnées de votre bio-bibliographie avant le 30 novembre 2013 à l’adresse suivante : cinepopcinefest@gmail.com
Pour tout renseignement s’adresser à :
Pour le comité organisateur
Françoise Naudillon
Université Concordia
Montréal
Tel 1-514-848-2424- ext 7511
Email fjnaud@alcor.concordia.ca [Réduire] Contact : cinepopcinefest@gmail.com |
Du 27 au 29 Avril 2014 :
| |
L'étude comparée et le dialogue des cultures Tunis (Tunisie) - Faculté des sciences Humaines et sociales de Tunis Tunisie Contact : Omar Jomni |
Le 21 Octobre 2013 :
 |
Lyon (France) - ENS 15 parvis René Descartes 69007 Contact : veronique.corinus@univ-lyon2.fr cecile.vandenavenne@ens-lyon.fr |
Du 04 Octobre 2013 au 04 Janvier 2014 :
| |
AIX en Provence (France) - Bibliothèque Méjanes Cité du Livre exposition pour le centenaire de la naissance d'Albert Camus... visites commentées, rencontres, débats, films, parutions, spectacles, lectures. Contact : 04 42 91 98 88 |
Du 20 au 21 Octobre 2013 :
 |
Présence de nouvelles voix culturelles en méditerranée: Du global au local Mostaganem (Algérie) - Université de Mostaganem Contact : hmiliani@yahoo.fr |
Du 22 au 23 Avril 2014 :
| |
Oran (Algérie) - Université, Maraval Algérie |
Du 03 au 05 Novembre 2013 :
| |
PRATIQUES ET ENJEUX DU TEXTE AUJOURD’HUI Nouvelles approches en littérature, linguistique, didactique Strasbourg (France) - Université France |
Le 25 Octobre 2013 :
 |
Camus. Une oeuvre au présent Lyon (France) - Ecole Normale Supérieure Lettres et sciences humaines Contact : coupdesoleilra@gmail.com mwilson@rhonealpes.fr |
Du 08 au 09 Octobre 2013 :
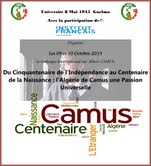 |
Du cinquantenaire de l'indépendance au centenaire de la naissance: l'Algérie de Camus, une passion universelle Guelma (Algérie) - Université 8 mai 1945, Guelma, Faculté des lettres et langues Algérie |
Du 20 au 21 Octobre 2014 :
 |
Bechar (Algérie) - Université de Bechar |
Du 30 Septembre 2013 au 01 Janvier 1970 :
.docx) |
(France/Corse) - Université Pasquale Paoli France/Corse Contact : Jacques Isolery |
Du 12 au 14 Novembre 2014 :
| |
XXXIXe Congrès de la SFLGC : Littérature et expériences croisées de la guerre Apports comparatistes Strasbourg (France) - Université Problématique
Au moment où plusieurs disciplines réfléchissent, en 2014, à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, au sens et à la portée de cet événement pour les sciences humaines, l’Institut de littérature comparée de l’Université de Strasbourg et ... [Afficher la suite] Problématique
Au moment où plusieurs disciplines réfléchissent, en 2014, à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, au sens et à la portée de cet événement pour les sciences humaines, l’Institut de littérature comparée de l’Université de Strasbourg et son groupe de recherche L’Europe des lettres invitent les membres de la SFLGC à définir la contribution de leur discipline à une approche des représentations littéraires de la guerre, des réflexions et des décisions auxquelles elle oblige. Nullement limitée au XXe siècle (même si plusieurs ateliers lui seront consacrés), la problématique proposée sera celle des points de vue croisés d’écrivains de cultures diverses sur le conflit. Il s’agira de considérer et de comparer l’expérience que chacun des camps peut avoir d’un même conflit.
En plaçant la question de la perspective au cœur de leurs travaux, les historiens J. Keegan, puis V. D. Hanson (Le Modèle occidental de la guerre. La bataille d'infanterie dans la Grèce classique, trad. fr. 1990) ont profondément renouvelé l’historiographie de la guerre depuis une vingtaine d’années. Dans son ouvrage de référence, Poétique du récit de guerre (Corti, 1998), Jean Kaempfer a procédé de façon similaire et montré les variations de perspective que connaît l’écriture littéraire de la guerre au fil de l’histoire.
Parce qu’elle a fait des perspectives contrastées l’un de ses objets privilégiés, la littérature comparée offre un apport irremplaçable pour interroger les images et la poétique de la guerre. Regards différents portés sur la même situation historique selon que l’écrivain appartient à un camp ou un autre ; croisement ou non de ces regards au moment même de la guerre; effets de focalisation, regards engagés ou regards distancés (sans oublier le regard de Dieu, souvent invoqué) ; aperçus à ras de terre du soldat ou perspective aérienne de l’aviateur ; lyrisme ou anti-lyrisme de la poésie de guerre ; devenir des traductions en temps de guerre (que deviennent les textes écrits dans la langue de l’ennemi ?) – autant d’axes pour aborder les modes littéraires du conflit armé. Le théâtre peut proposer ici un terrain de choix : n’offre-t-il pas, au sein parfois d’une même pièce, des perspectives opposées sur la guerre ? La littérature croise par ailleurs aussi des discours extra-littéraires (discours militaire, récit historique) et d’autres arts (peinture, musique, photographie, cinéma) qu’il peut être précieux de lui associer, ou de lui opposer.
Les analyses peuvent concerner les trois champs suivants:
1. Représentations
– Récits croisés d’un même conflit : la bataille vue de part et d’autre de camps ennemis (Catholiques et Protestants lors des guerres de religion ; Stendhal, Tolstoï et Thackeray devant les guerres napoléoniennes) ; Maupassant et Fontane devant la guerre franco-prussienne; Cendrars et Erich Maria Remarque sur le front de 1914-1918; ou Hemingway et Joseph Roth sur le front austro-italien à la même époque ; évocations confrontées d’une bataille : l’assaut, les blessés, les ambulanciers, les prisonniers vus d’ici – ou de là-bas ; la vie quotidienne à l’arrière : alimentation, habitat, sexualité en temps de guerre de part et d’autres des lignes. Mais aussi la figuration des deux camps par la mise en scène de frères ennemis.
2. Rhétoriques de la guerre
– L’écriture comme façon de participer au conflit ou, au contraire, de le refuser ; polémiques, propagandes opposées, satires et portraits-charge symétriques; apologie du fait guerrier ou déploration élégiaque, interprétations allégoriques du conflit et des ses causes. La guerre pousse parfois les auteurs à vouloir représenter ou justifier par un virtuosisme rhétorique ou une téléologie forcée les malheurs injustifiables qu’elle entraîne (au XVIe siècle Agrippa d’Aubigné).
L’engagement peut être idéologique mais aussi esthétique (la « poésie » des champs de bataille chez Apollinaire, Marinetti, ou encore Jünger). Écrire peut être une façon de lutter contre une guerre en rappelant d’autres exigences de justice (Hesse et bien d’autres). À l’inverse, cesser d’écrire ou de publier peut aussi être la réponse de la littérature à la guerre (Char pendant la Résistance).
3. Guerre et mise en crise de l’écriture
– L’épreuve de la guerre est indissociable en profondeur d’une mise en crise de l’écriture. Cette indissociabilité, perceptible à tous les siècles, s’accroît encore au XXe siècle. La guerre somme l’écriture d’être à la mesure de la douleur historique et individuelle qui doit être affrontée. Elle exige des écrivains qu’ils redéfinissent la forme, la légitimité, la fonction de l’écriture, et même son rythme, qu’elle peut modifier de façon significative. Cette quadruple redéfinition demande d’autant plus à être explorée qu’elle peut prendre des dimensions radicalement différentes : soit le retour à une écriture plus classique car plus compréhensible par tous (Aragon) ; ou tout au contraire une mise à mal du langage qui se retourne violemment contre lui-même et s’invente au plus près du risque du mutisme (Trakl). Cette mise en demeure de l’écriture par la guerre est un des enjeux centraux d’une réflexion consacrée au face à face redoutable de la littérature et de la guerre.
Informations pratiques
Il est rappelé que la problématique du Congrès concerne tous les siècles et ne se limite pas aux littératures, ni aux conflits du XXe siècle – pas plus qu’elle ne se cantonne aux littératures et conflits européens. Seront privilégiées les communications qui, dès leur titre et leur présentation synthétique (1500 signes maximum) contribueront à la question des perspectives croisées sur l’expérience de la guerre. Aussi les propositions purement monographiques sont-elles à éviter. Les ateliers seront constitués par le Comité scientifique en fonction des propositions reçues, et des ensembles chronologiques qui se dessineront.
Le nombre total des communications sera nécessairement limité. Soucieux de la cohérence scientifique de la manifestation, le Comité devra sans doute écarter certaines propositions, sans que l’intérêt ni la qualité de ces dernières ne soient pour autant mis en cause. Les communications ne pourront dépasser 20-25 minutes. Il est rappelé enfin que, comme pour les autres Congrès de la SFLGC, l’essentiel des frais de voyage et de séjour à Strasbourg sera à la charge des participants. Pour des raisons de logistique hôtelière à Strasbourg (Sessions parlementaires) il est demandé aux futurs participants de se signaler avant le dernier délai d’envoi des propositions (30 avril 2014).
Une publication des actes en ligne est prévue. Les textes ne pourront dépasser 25000-30000 signes.
Les propositions (1500 signes, brève bio-bibliographie incluse) sont à envoyer par mail simultanément (double envoi) à Tatiana Victoroff et Patrick Werly aux adresses suivantes avant le 30 avril 2014 :
tatiana.victoroff@gmail.com
werly@unistra.fr
À signaler : le Congrès coïncide avec l’ouverture, à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), de l’exposition
1914 : La Mort des poètes (Charles Péguy, Wilfred Owen, Ernst Stadler)
organisée par Tatiana Victoroff, qui en proposera une visite commentée aux participants du Congrès. [Réduire] Contact : tatiana.victoroff@gmail.com werly@unistra.fr |
Du 01 au 02 Mai 2014 :
| |
COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS 2014 Intertextualités francophones Québec (Canada) - Université Laval a Chaire de recherche du Canada en Littératures africaines et Francophonie organise, les 2 et 3 mai 2014, à l’Université Laval, à Québec, un colloque international destiné aux jeunes chercheurs en littératures francophones.
Les historiens de la littérature soulignent généralement que la... [Afficher la suite] a Chaire de recherche du Canada en Littératures africaines et Francophonie organise, les 2 et 3 mai 2014, à l’Université Laval, à Québec, un colloque international destiné aux jeunes chercheurs en littératures francophones.
Les historiens de la littérature soulignent généralement que la littérature française et d’autres littératures occidentales offrent le modèle aux littératures francophones concernant les formes, et parfois les thèmes. D’autre part, ils reconnaissent la permanence des formes littéraires anciennes (légendes, mythes, contes, épopées, etc.) sur les formes de ces littératures. Il ne s’agit pas de contester ces hypothèses, mais de ne pas perdre de vue que tout texte se construit sur fond des textes antérieurs à propos desquels il déploie une double stratégie de différenciation et de distinction. Ce qui rejoint la notion d’intertextualité qui, selon Julia Kristeva, implique à la fois l’absorption d’un corps étranger et son intégration dans un nouveau contexte.
Dans ce sens, l’objectif de ce colloque est d’amener les jeunes chercheurs à ne pas confondre la critique intertextuelle avec la critique des sources qui se limite à inventorier les influences subies par un écrivain. L’objectif vise à démontrer, sur base des analyses de textes précis, que les textes francophones sont en conversation avec les autres formes de discours. Il s’agira de ne pas oublier que chaque société sécrète ses stéréotypes. Comment l’écrivain francophone se sert-il de ces stéréotypes? Quelle est la fonction des stéréotypes dans son discours? Comment réinvestit-il la dimension de l’Histoire dans ses textes?
On s’attardera également à examiner comment le thème de la littérature occupe une place de plus en plus importante à même les textes. Sur ce plan, certains textes font de la littérature l’objet d’un discours esthétisant. Ainsi, le texte francophone se veut parfois une sorte de bibliothèque mouvante qui ne cesse de commenter, d’idéaliser et même de désavouer la littérature. D’autres textes abordent le littéraire de façon allusive ou métaphorique, alors que d’autres encore intègrent le littéraire de façon massive.
Enfin, il conviendra de montrer que cette articulation du texte avec d’autres textes ou d’autres formes de discours est l’expression la plus sûre de sa modernité, apportant ainsi aux littératures francophones, notamment au roman, un renouvellement des formes du texte qui se dit à la fois journal, fiction, chant, épopée, subordonnant la fiction aux artefacts linguistiques.
Veuillez envoyer votre proposition de communication (15 lignes au maximum), accompagné d’un CV (de 5 lignes tout au plus, précisant votre statut et votre institution universitaire, vos publications et votre participation à des colloques), au plus tard le 20 décembre 2013 à l’adresse suivante : jeunes.francophonie@flsh.ulaval.ca <mailto:jeunes.francophonie@fl.ulaval.ca> [Réduire] Contact : : jeunes.francophonie@flsh.ulaval.ca <mailto:jeunes.francophonie@fl.ulaval.ca> |
Le 23 Septembre 2013 :
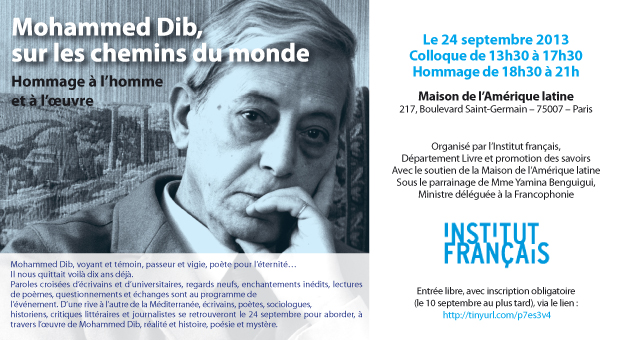 |
Colloque - Hommage à l’écrivain Mohammed Dib Paris (France) - Maison de l’Amérique latine 217, Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris Mohammed Dib, voyant et témoin, passeur et vigie, poète pour l’éternité…
Il nous quittait voilà dix ans déjà.
Paroles croisées d’écrivains et d’universitaires, regards neufs, enchantements inédits, lectures de poèmes, questionnements et échanges sont au programme de l’événe... [Afficher la suite] Mohammed Dib, voyant et témoin, passeur et vigie, poète pour l’éternité…
Il nous quittait voilà dix ans déjà.
Paroles croisées d’écrivains et d’universitaires, regards neufs, enchantements inédits, lectures de poèmes, questionnements et échanges sont au programme de l’événement. D’une rive à l’autre de la Méditerranée, écrivains, poètes, sociologues,historiens, critiques littéraires et journalistes se retrouveront le 24 septembre pour aborder, à travers l’oeuvre de Mohammed Dib, réalité et histoire, poésie et mystère. [Réduire] |
Du 28 Juin au 05 Juillet 2014 :
 |
Congrès 2014 du CIEF à San Francisco San Francisco (Etats-Unis) Appel à communications
Congrès 2014 à San Francisco
29 juin au 6 juillet 2014
Quêtes et conquêtes de nouveaux mondes
Dans l’imaginaire populaire, l’Ouest évoque les grands espaces, la ruée vers l’or, les nouveaux départs : un lieu à dimension mythique où tout est possible, u... [Afficher la suite] Appel à communications
Congrès 2014 à San Francisco
29 juin au 6 juillet 2014
Quêtes et conquêtes de nouveaux mondes
Dans l’imaginaire populaire, l’Ouest évoque les grands espaces, la ruée vers l’or, les nouveaux départs : un lieu à dimension mythique où tout est possible, un Eldorado accessible à tous. Ville arc-en-ciel, San Francisco occupe une place spéciale dans cet imaginaire du fait qu’elle a su faire naître des mouvements avant-gardistes qui, à leur tour, ont créé de nouveaux mondes. Pont entre le passé et l’avenir, ouverte sur l’océan, la ville accueille la marge et la fait sienne.
Par ailleurs, 2014 est, ne l’oublions pas, le centenaire du début de la Première Guerre mondiale qui a marqué la destruction de tout un monde et annoncé le début d’une ère nouvelle.
La thématique de notre colloque s’articule autour de l’exploration des diverses perspectives liées aux nouveaux mondes : féminisme, genre et sexualité ; malaise sociétal, contestation et revendication ; destruction et construction ; quêtes et conquêtes ; pont(s) entre les époques et les cultures.
Afin d’encourager de manière interdisciplinaire le développement des études, de la recherche, des publications portant sur la littérature, la langue, la culture, les arts et les sciences sociales dans tout le monde francophone, Le CIEF accueille chaque année à son congrès un large éventail de sessions regroupées sous ces catégories. Nous vous proposons également une liste de thèmes ouverts dans lesquels la francophonie est un facteur principe et qui permettront de rassembler les intervenants autour de problématiques d’actualité, sous les grandes catégories de LANGUE-CULTURE-LITTÉRATURE-HISTOIRE-PÉDAGOGIE. Nous invitons les propositions sur les thèmes suivants de manière non exclusive :
• Quêtes et conquêtes de nouveaux mondes
• Ponts entre les époques et les cultures
• Le voyage dans tous ses états
• La langue française dans la grande et la petite histoire
• Guerre et violence : expressions francophones
• Autour d’un auteur
• Malaise sociétal, contestation et revendication
• Les francophonies ultramarines et africaines
• Déterritorialisation, immigration et identité • La francophonie des Amériques : enjeux, identités et langues
• Texte(s) et image(s)
• L’espace et/ou l’écriture cinématographique
• Écriture au féminin/masculin/genre ouvert
• Repenser le postcolonial francophone
• Le français, langue véhiculaire: hier et aujourd'hui
• Nouvelles techniques & didactique du français
• Linguistique comparative & francophonie
• Sociologie du français dans l'humanitaire
Échéancier
Pour lancer un pré-appel pour votre session: 10 septembre 2013
Pour répondre à un pré-appel: 8 octobre 2013
Pour soumettre une session complète: 15 octobre 2013
Pour soumettre une proposition individuelle: 15 octobre 2013
Pour de plus amples renseignements (août) : http://cief.org/congres/2014/index.html [Réduire] Contact : Carla CALARGE |
Du 09 au 10 Mars 2014 :
| |
Le théâtre d’Abdelkader ALLOULA (1939- 1994) Le texte et la scène Oran (Algérie) - CRASC Contact : UCCLLA/CRASC, Cité Bahi Amar, Bloc A, N° 1 Es-Senia, BP : 1955, El M’naouer, 31000, Oran – Algérie Téléfax : 00 213 (0) 41 58 32 86. Email : ucclla_ucclla2013@yahoo.fr Site : www.crasc-dz.org |
Du 15 au 16 Mai 2014 :
| |
Littérature, art et monde contemporain - récits, histoire, mémoire Beyrouth (Liban) - Université Saint Joseph Contact : Mme Nayla Tamraz |
Du 20 au 21 Octobre 2014 :
| |
Approches des politiques éducatives et linguistiques en Algérie et au Maghreb : Le cas du français Mostaganem (Algérie) - Université de Mostaganem Algérie Contact : flaifa.colloque2014@gmail.com |
Du 26 au 28 Avril 2014 :
 |
ALGÉRIE : 50 ANS DE PRATIQUES PLURILINGUES Constantine (Algérie) Algérie Contact : dal.morsly@wanadoo.fr cherradnedjma@yahoo.fr |
Du 22 au 24 Octobre 2013 :
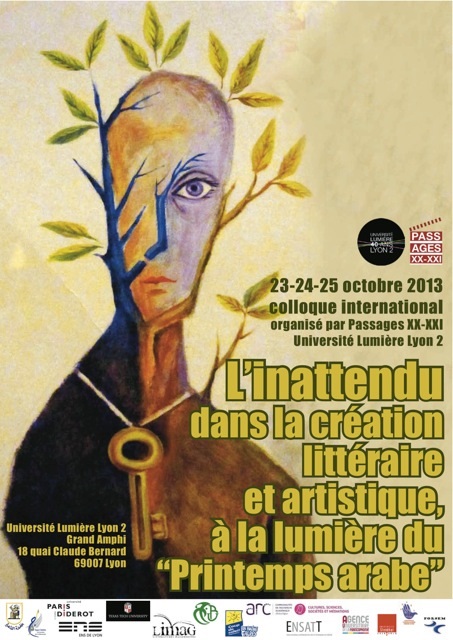 |
L'inattendu dans la création littéraire et artistique, à la lumière du 'Printemps arabe': Programme Lyon (France) - Université Lumière Lyon 2 Contact : touriya.fili@gmail.com bonn.charles@gmail.com |
Du 03 au 05 Novembre 2013 :
 |
Premières Rencontres Scientifiques du Réseau Mixte LaFEf (Langue française et Expressions francophones) Pratiques et enjeux du texte aujourd’hui. Nouvelles approches en littérature, linguistique, didactique Strasbourg (France) - Université |
Du 23 au 24 Avril 2014 :
| |
Cultures au Maghreb. Représentations et interactions El Jadida (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Chouaïb Doukkali Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel
(LERIC/URAC 57) organise, les 24-25/04/2014, un colloque international
sous le thème :
« Cultures au Maghreb. Représentations et interactions »
à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Chouaïb Douk... [Afficher la suite] Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel
(LERIC/URAC 57) organise, les 24-25/04/2014, un colloque international
sous le thème :
« Cultures au Maghreb. Représentations et interactions »
à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, Maroc
Chercheurs et universitaires sont appelés, périodiquement, à interroger certains aspects de leur environnement social, politique, économique et culturel. C’est le cas de nos jours où, face à une Méditerranée en ébullition et à une mondialisation galopante, chercheurs maghrébins et penseurs de divers horizons reconsidèrent le Maghreb, chacun selon ses convictions, sa sensibilité et ses centres d’intérêt, tout comme l’ont fait leurs prédécesseurs notamment dans les années soixante-dix et quatre-vingt. Sauf que le contexte de cette époque-là imposait aux intellectuels du moment des problématiques spécifiques. Il y avait urgence de clarifier les rapports avec l’ex colonisateur, de réclamer sa différence en se (re)construisant une identité propre. Tous les écrits de cette période attestent de cet état d’esprit inspiré en partie par Franz fanon, Sartre et les tenants des discours marxisant.
Qu’en est-il de nos jours ? Ces mêmes préoccupations continuent-elles de mobiliser les esprits ? Y a-t-il ouverture sur d’autres questionnements ? S’occupe-t-on davantage du local, laissant au régional le temps de mûrir et de s’imposer de lui-même ? L’universel, au contraire, constitue-t-il un « horizon de pensée » pour les Maghrébins ? Pour répondre à ces interrogations et à d’autres encore, il n’y a pas mieux que de faire l’état des lieux de ce Maghreb des cultures : ses limites, ses points de répulsion, ses lieux d’attraction et de fascination, ses interpénétrations… et pour y accéder, il est indispensable de décrire et d’analyser les cultures qui le façonnent en tant qu’entité spécifique… Il va sans dire que l’idée du Maghreb n’est vivable et ne peut être viable que grâce à cette sève qui coule dans ses veines malgré les contingences politiques et les contraintes socioéconomiques endo et exogènes.
D’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, l’observateur ne peut que s’étonner de la richesse et de la pluralité des cultures maghrébines. Les peuples sont dépositaires d’un fond commun pluriel : amazigh, hébraïque, grec, romain, arabe, andalou, ottoman, français, etc., mais chaque communauté en use selon son génie propre. L’art de vivre citadin, (surtout celui des villes impériales et/ou spirituelles : Kairouan, Tlemcen, Fès…) est souvent millénaire. Il y va de l’architecture, de l’aménagement de l’espace et de l’art culinaire, en passant par l’habillement, les chants, les danses, les contes, les rituels, les cérémonies… Le mode de vie sahraoui, celui des campagnes et des montagnes n’ont rien à envier à l’art de vivre dans les cités urbaines. Là où l’on va, on est frappé par des invariants culturels à base religieuse et/ou païennes et par des variantes dues aux contextes historiques, géographiques, climatiques, politiques, économiques et linguistiques. Ce sont justement ces variétés de normes, de croyances, d'institutions et d'artefacts qui constituent le nerf vivace des sociétés maghrébines qui méritent qu’on s’y arrête.
L’objectif de ce colloque est donc d’interroger, dans une vision comparatiste et pluridisciplinaire, ces multiples manifestations intra, inter et transculturelles qui configurent le Maghreb profond. Il s’agit d'identifier ce autour de quoi peuvent se rencontrer culturellement des Maghrébins et se reconnaître en tant que tels. Décrire les manifestations et les brassages culturels d’aujourd’hui et préfigurer ce que sera le Maghreb de demain en matière de culture, cela ne peut qu’aider à une meilleure intégration de la région dans la sphère méditerranéenne et, partant, universelle.
Y a-t-il altération ou renforcement (voire endurcissement) des repères culturels dits maghrébins ? Les sociétés maghrébines sont-elles dissociées de leurs cultures propres ou bien vivent-elles l’avènement d’une déconstruction de toutes les normes, valeurs et croyances et par voie de conséquence une (re)construction hésitante, éprouvante, progressive d’une vaste aire culturelle maghrébo-méditerranéenne ? Enfin est-il pertinent, de nos jours, de parler de maghrébinité culturelle face au déferlement inexorable du « prêt à penser »…?
Pour tenter de répondre à ces questions ou à certaines d'entre elles, sont proposés, à titre indicatif, les axes suivants :
- Langues en usage et en contact
- Traditions orales
- Rites et cérémonies
- Musiques, danses, chorégraphie…
- Arts culinaires et gastronomiques
- Littératures et productions paralittéraires
- Arts plastiques
- Arts visuels
- Architectures…
Calendrier:
18 octobre 2013 : date limite de soumission des propositions,
29 novembre 2013 : réponse aux contributeurs : 28 mars 2014 : remise des communications en vue de la publication des Actes du Colloque.
Appelacomeljadida
Ficheparticipationeljadida [Réduire] |
Le 06 Juin 2013 :
| |
Journée Maghrébine de Heidelberg Heidelberg (Allemagne) - Place de l'Université/ Tente littéraire - Spiegelzelt Tous les deux ans, selon un voeux de Hamid Skif, prix des littératures de l'exil de la ville de Heidelberg, nous organisons une journée de littérature maghrébine dans le cadre des journées littéraires de Heidelberg. Cette journée se déroule aujourd'hui, vendreid 7 juin 2013, de 18h00 à 23h0... [Afficher la suite] Tous les deux ans, selon un voeux de Hamid Skif, prix des littératures de l'exil de la ville de Heidelberg, nous organisons une journée de littérature maghrébine dans le cadre des journées littéraires de Heidelberg. Cette journée se déroule aujourd'hui, vendreid 7 juin 2013, de 18h00 à 23h00, avec la participation, entre autres, de Najet Adouani, poétesse tunisienne exilée en Allemagne, et Hind Meddeb qui montréra son documentaire "Tunisia Clash". Il y aura aussi une table ronde avec la participation de Jörg Armbruster, grand reporter de la télé allemande pour le Proche Orient, Mourad Kusserow et Ibrahim el-Koni [Réduire] |
Du 08 au 09 Octobre 2014 :
 |
Appel à communication colloque "La guerre d'Algérie, le sexe et l'effroi" Paris (France) - Bibliothèque nationale de France et Institut du monde arabe La Guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi
APPEL À COMMUNICATION/CALL FOR PAPERS
Colloque organisé par Catherine Brun et Todd Shepard, les 9 et 10 octobre 2014
à la Bibliothèque nationale de France et l’Institut du monde arabe
Sorbonne nouvelle – Paris 3 (EA 4400 « Écritures ... [Afficher la suite] La Guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi
APPEL À COMMUNICATION/CALL FOR PAPERS
Colloque organisé par Catherine Brun et Todd Shepard, les 9 et 10 octobre 2014
à la Bibliothèque nationale de France et l’Institut du monde arabe
Sorbonne nouvelle – Paris 3 (EA 4400 « Écritures de la modernité, Littérature et sciences humaines » / CNRS) et Johns Hopkins University (Program for the Study of Women, Gender, and Sexuality), en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut du Monde Arabe.
Comité scientifique :
Catherine Brun (Paris 3, Littérature), Jean-Pierre Bertin-Maghit (Paris 3, Cinéma), Carolyn Dean (Yale University, Histoire), Eric Fassin (Paris 8, Sociologie), Ann Laura Stoler (New School, NYC, Anthropologie), Jean-Michel Hirt (Paris 13, Psychanalyse), Abderrahmane Moussaoui (Lyon 2, Anthropologie), Tiphaine Samoyault (Paris 3, Littérature comparée), Todd Shepard (Johns Hopkins, Histoire), Judith Surkis (Rutgers, Histoire), Joan Tumblety (University of Southampton, UK, French Studies), François Zabbal (Rédacteur en chef Qantara).
Stéphane Audoin-Rouzeau a souligné le paradoxe que constitue la survie du stéréotype de virilité corporelle et morale du combattant, alors que les guerres occidentales du XXe siècle ont « démembré » l’homme en portant atteinte aux formes de la masculinité traditionnelle, avec une virulence encore accrue quand était déniée à l’ennemi l’appartenance à une humanité commune . La guerre dite « d’Algérie » côté français, « de libération nationale » côté algérien, pourrait en être le parangon : exacerbation des postures viriles et des appels à l’honneur d’une part, multiplication des atteintes à leur siège de l’autre. Les représentations sexuelles obsèdent les discours et les figurations. Ce colloque, international et pluridisciplinaire, voudrait interroger, au-delà de la sexualisation attachée à tout épisode belliqueux, cette omniprésence du sexe dans les représentations de la guerre d’Algérie. Si des travaux existent, qui ont tenté de dire la réalité des exactions, et plus particulièrement de la torture et des viols , peu prennent pour objet la sexualisation du conflit, qu’il s’agisse de féminiser l’ennemi ou de surviriliser le pouvoir . Or viols (des femmes comme des hommes), émasculations, bâtardises, exacerbations viriles, tortures ciblées, outrages sexuels des cadavres, commerces des corps ne sont pas simplement des lieux communs des guerres.
Ils méritent d’être recontextualisés, d’être resitués entre la stigmatisation de « l’impulsivité criminelle chez l’indigène algérien », caractéristique de la psychiatrie coloniale de l’École d’Alger, qui construit la figure de sauvages amoraux, primitifs et violents , et les anathèmes des Cassandres de « l’invasion arabe », qui postulent à la fin des années 1960 les prétendues perversions des immigrés algériens pour mieux tenir en échec les revendications montantes de révolution sexuelle et politique.
Ils valent d’être spécifiés, et comparés. Les viols de la guerre d’Algérie, pour profanatoires qu’ils aient été, n’ont pas les caractéristiques de ceux perpétrés en ex-Yougoslavie . Les mutilations et exhibitions de cadavres doivent être examinées comme autant de « véhicules discursifs » et la dimension sexuelle des tortures doit être pensée dans sa centralité . L’obsession virile, celle du gain ou de la perte de la puissance, exige d’être appréhendée comme une construction stratégique, politique, symbolique, anthropologique. Rappelons comment les Européens d’Algérie ont pu être accusés de personnifier une « masculinité hors normes », tantôt virile à l’excès, tantôt invertie, de sorte à mieux les distinguer des Français métropolitains et à leur dénier la qualité de « vrais » Français.
C’est donc aux confins des disciplines, entre anthropologie, psychanalyse, littérature, arts de l’image, histoire, qu’il faudra tenter de penser la vectorisation sexuelle de ce conflit, de ses figurations et de ses mémoires – de ses hantises. Quelles représentations du sexe ? de la violence sexuelle ? Quelles constructions identitaires ? génériques ? Quelles genèses et quelles postérités de cette sexualisation massive ? Dans les mémoires, dans l’imaginaire, dans l’organisation socio-politique de la nation ? Quelles singularités et quelles comparaisons ?
Les propositions de communication (300-500 mots) sont à envoyer en anglais ou en français à Catherine Brun (catherine.brun@univ-paris3.fr) et Todd Shepard (tshep75@jhu.edu), accompagnées d'un titre et d'une courte notice biobibliographique, avant le 15 juillet 2013. Les auteurs seront informés de la décision du comité mi-septembre 2013. Le colloque, qui se déroulera en français les 8 et 9 octobre 2014, donnera lieu à publication. [Réduire] Contact : catherine.brun@univ-paris3.fr, tshep75@jhu.edu |
Le 20 Mai 2013 :
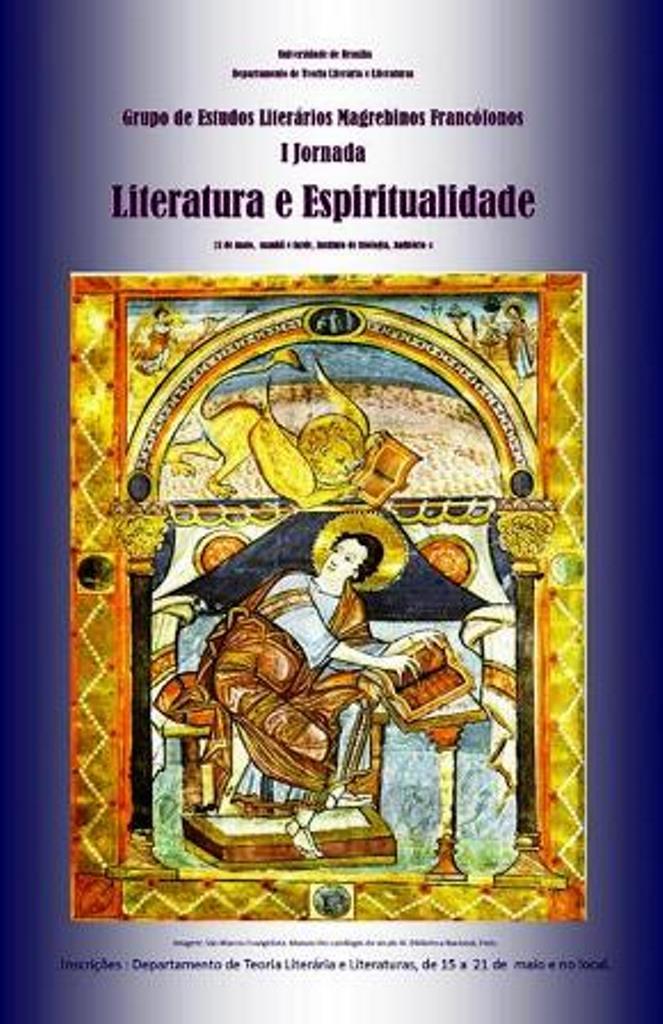 |
Literatura e Espiritualidade Brasília (Brésil) - Université de Brasília Contact : Cláudia Falluh |
Du 08 au 10 Novembre 2013 :
| |
L’expérience créative de Assia Djebar. Assia Djebar ou l’oeuvre d’une vie Tizi-Ouzou (Algérie) - Université Université Mouloud Mammeri
Faculté des lettres et des langues
Laboratoire d’analyse du discours
Le Laboratoire d’analyse du discours et la faculté des lettres
et des langues de l’université Mouloud Mammeri, Tizi-
Ouzou (Algérie) en collaboration avec Le Cercle des Amis
d’Assia Dje... [Afficher la suite] Université Mouloud Mammeri
Faculté des lettres et des langues
Laboratoire d’analyse du discours
Le Laboratoire d’analyse du discours et la faculté des lettres
et des langues de l’université Mouloud Mammeri, Tizi-
Ouzou (Algérie) en collaboration avec Le Cercle des Amis
d’Assia Djebar, Paris (France), organisent un
Colloque international sur l’oeuvre d’Assia Djebar:
L’expérience créative de Assia Djebar
Assia Djebar ou l’oeuvre d’une vie
Le 9-10-11 novembre 2013
Argumentaire :
L’oeuvre plurielle de l’écrivain algérienne Assia Djebar
témoigne d’une longue et riche expérience créative dans la
production littéraire et cinématographique fondée sur le
questionnement et marquée par la quête et l’expérimentation.
Depuis son premier roman, La soif (1957) jusqu’au dernier,
Nulle part dans la maison de mon père (2007), elle soumet ses
oeuvres à l’expérimentation à partir d’un important travail sur la
langue et par l’investissement de son encyclopédie culturelle à
l’exemple de l’art, de la littérature, de la mémoire féminine et de
l’Histoire, notamment l’Histoire de la colonisation de l’Algérie
élément apparent dans la majorité de ses romans. La femme et
son rapport à l’homme, sujet central dans l’oeuvre, occupe des
espaces de réflexions symboliques permettant d’interroger sa
situation et son statut, hier et aujourd’hui.
Partant du fait que la littérature, le roman en particulier, est
une représentation culturelle d’une société, reflétant sa structure
anthropologique, son imaginaire, ainsi que son mode relationnel
à l’Autre; et partant d’une vision contemporaine de la littérature
2
définie comme un espace dialogique ouvert qui permet
d’exprimer clairement les conflits intérieurs et extérieurs de
l’individu et de la société, le parcours créatif d’Assia Djebar
depuis plus d’un demi-siècle, caractérisé par la multiplicité des
genres (romans, nouvelles, pièces de théâtre, poésies, cinéma,
etc.) peut donner un éclairage sur un certain nombre de
problématiques en lien avec la société algérienne. En effet,
l’important travail expérimental par l’écriture et le cinéma sur
cette société, nous permet de soulever de nombreux
questionnements parmi lesquelles:
- Assia Djebar est-elle parvenue en écrivant dans la langue
de l’Autre à exprimer les différentes expériences du peuple
algérien durant la colonisation et après l’indépendance, à
réduire les fendillements de la mémoire et à élaborer sa
propre théorie sur la crises des identités dans la société?
- A-t-elle réussi à modifier l’image de l’Algérien et édifier
des passerelles pour un dialogue civilisationnel avec
l’Autre?
- Quel serait l’influence de son travail littéraire et
cinématographique sur la production culturelle algérienne
contemporaine?
On tentera de répondre à ces questions à travers les axes
suivants:
1- L’Histoire comme thème d’écriture dans l’oeuvre d’Assia
Djebar.
2- La problématique de la langue et de l’écriture chez Assia
Djebar.
3- L’expérience cinématographique d’Assia Djebar.
4- Modernisme et procédés d’expérimentation dans l’ensemble
de l’oeuvre.
5- La vision du monde d’Assia Djebar et sa position vis-à-vis de
la culture de l’Autre.
6- Rôle de la traduction dans la restitution de la littérature
d’Assia Djebar.
7- La trace de cette oeuvre dans les créations contemporaines des
écrivains et cinéastes algériens.
3
Présidente du colloque : Dr. Amina Belaala, Ummto.
Comité scientifique :
- Dr. Boudjemaa Chetouane, Ummto, président du Comité
scientifique.
- Mme. Amel Chaouati, Présidente du Cercle des Amis d’Assia
Djebar.
- Dr. Hamou L’Hadj Dehbia, Ummto.
- Dr. Raouia Yahiaoui, Ummto.
- Dr. El’Abes Abdouche, Ummto.
- Dr. Samya Daoudi, Ummto.
- Dr. Amar Ghendouzi, Ummto.
- Dr. Hamid Ameziane, Ummto.
Enseignants consultés :
- Dr. Abdelmalik Mortadh, Université d’Oran.
- Dr. Abdellah Al Achi, Université de Batna.
- Dr. Abdelhamid Bourayou, Université d’Alger.
- Dr. Lakhdar Djamaï, Université d’Alger.
- Dr. Badiaa El Tahri, Université d’Agadir (Maroc).
- Dr. Youcef Ouaghlissi, Université de Constantine.
- Dr. Rachid Ben Malek, Université de Tlemcen.
- Dr. Mohamed Tahrichi, Université de Béchar.
- Dr. Lahcène Kroumi, Université de Béchar.
- Dr. Habib Mounsi, Université de Sidi- Bel- Abbès.
- Dr. Abdelhamid Hima, Université de Ouargla.
- Dr. Hatem Al Fatnassi, Université de Sousse (Tunis).
- Dr. Clarisse Zimra, Université Southern Illinois University
(USA).
- Dr. Kiyoko Ishikawa, Department of International Culture-
Hamamatsu-shi (Japon).
- Dr. Hibo Moumin Assoweh, Université de Djibouti (Djibouti).
- Dr. Hervé Sanson, université d’Aix-la-Chapelle (France).
- Dr. Denis Legros-Laboratoire CHART, Université Paris 8
(France).
- Dr. Charles Bonn, Université de Lyon (France).
- Dr. Mounira Chatti, Maitre de conférences en disponibilité et
romancière (France).
4
Comité d’organisation:
- Aziz Namane, Ummto, président du comité d’organisation.
- Semch-Eddine Chergui, Ummto.
- Saliha Merabti, Ummto.
- Chama Mekli, Ummto.
- Hacène Halouane, Ummto.
- Samia Mechtoub, Université de Boumerdès.
- Letimi Mourad, Ummto.
- Khadidja Hami, Ummto.
- Mohamed- Seghir Nabil, Ummto.
- Amine Flissi, Ummto.
- Djamel Abdelli, Ummto.
- Lynda Keddir, Ummto.
- Wahiba Matouk, Ummto.
Dates importantes:
- Les langues de communication retenues sont l’arabe, le
français et l’anglais.
- Les titres et les résumés des communications doivent parvenir
au plus tard le 25 juin 2013.
- Les textes des communications intégrales doivent parvenir au
plus tard le 06 octobre 2013.
- Les résumés et les communications doivent parvenir à
l’adresse suivante : coldjebar.lad@gmail.com
Téléphone et faxe : 0021326213291
5
Fiche de participation:
Prénom et nom du participant :
Université :
Adresse personnelle :
Adresse électronique :
Téléphone et faxe :
Axe de la communication :
Intitulé de la communication :
Résumé de la communication : [Réduire] Contact : Cercle des amis d\'Assia Djebar |
Le 09 Mai 2013 :
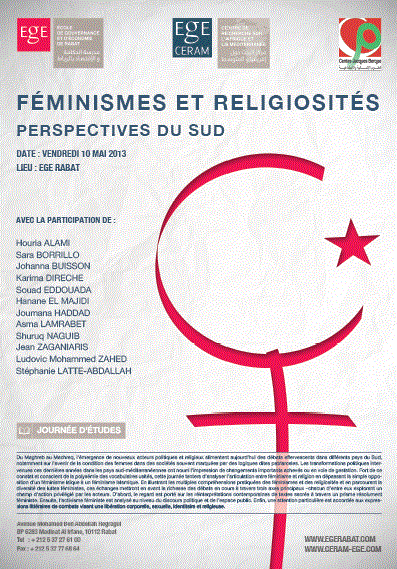 |
Féminismes et religiosités : perspective du Sud Rabat (Maroc) - EGE - CERAM Mohamed Ben Abdellah Regragui 1011 Rabat - Maroc Du Maghreb au Machreq, l’émergence de nouveaux acteurs politiques et religieux alimentent aujourd’hui des débats effervescents dans différents pays du Sud, notamment sur l’avenir de la condition des femmes dans des sociétés souvent marquées par des logiques dites patriarcales. Les transf... [Afficher la suite] Du Maghreb au Machreq, l’émergence de nouveaux acteurs politiques et religieux alimentent aujourd’hui des débats effervescents dans différents pays du Sud, notamment sur l’avenir de la condition des femmes dans des sociétés souvent marquées par des logiques dites patriarcales. Les transformations politiques intervenues ces dernières années dans les pays sud-méditerranéennes ont nourri l’impression de changements importants achevés ou en voie de gestation. Fort de ce constat et conscient de la polysémie des vocabulaires usités, cette journée tentera d’analyser l’articulation entre féminisme et religion en dépassant la simple opposition d’un féminisme laïque à un féminisme islamique. En illustrant les multiples compréhensions pratiquées des féminismes et des religiosités et en parcourant la diversité des luttes féministes, ces échanges mettront en avant la richesse des débats en cours à travers trois axes principaux –chacun d’entre eux explorant un champ d’action privilégié par les acteurs. D’abord, le regard est porté sur les réinterprétations contemporaines de textes sacrés à travers un prisme résolument féministe. Ensuite, l’activisme féministe est analysé au niveau du discours politique et de l’espace public. Enfin, une attention particulière est accordée aux expressions littéraires de combats visant une libération corporelle, sexuelle, identitaire sions et religieuse. [Réduire] Contact : hasna.hussein@hotmail.com |
Du 09 au 10 Mai 2013 :
| |
Tunis (Tunisie) - Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba Laboratoire de Recherche
Études Maghrébines, Francophones, Comparées
et Médiation Culturelle
Organise un Colloque International
« Eau et sel »
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités
La Manouba - Tunis 10 et 11 mai 2013
Lamta - Monastir 12 mai 2013
Si l’o... [Afficher la suite] Laboratoire de Recherche
Études Maghrébines, Francophones, Comparées
et Médiation Culturelle
Organise un Colloque International
« Eau et sel »
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités
La Manouba - Tunis 10 et 11 mai 2013
Lamta - Monastir 12 mai 2013
Si l’on s’en tient aux hypothèses de la fameuse « soupe primordiale » (Oparin, 1924, et Haldane, 1929), l’eau serait antérieure à l’oxygène dans ce milieu liquide où la vie est supposée être apparue. Telle que nous la connaissons aujourd’hui, elle est à l’origine des formes de vie (cellulaire, végétale, animale, etc.) qui peuplent notre planète. Les chimistes réduisent sa formule brute à un H2o laconique. La plupart des traditions symboliques en font une substance purificatrice et synonyme de fécondité : l’eau est une des conditions, fondamentales, de la vie. Dans le Coran, cette substance est souvent désignée comme « élément pur(ificateur) ». Quant au sel, il est présent dans beaucoup de religions, de rituels et de mythes. Son image est souvent mêlée à des traditions et à des textes sacrés. Il est constamment présent en peinture, en littérature, en philosophie ou en poésie, avec Plutarque, Homère, Philon, Léonard de Vinci ou Lucrèce.
Qu’en est-il justement des associations de ces deux matières à travers l’histoire et les cultures ? Tel est le questionnement qui est au centre de notre colloque. Eau et sel… S’agirait-il de travailler sur la figure de l’hendiadyn ? Eau et sel… donc l’eau salée, la mer à l’état naturel ou l’eau grégorienne ayant servi à consacrer dans le rituel catholique chrétien – du moins jusqu’en 1869 – ou encore le sérum physiologique… Avec une autre figure de style, la redondance, puisque le mot « sel » vient du grec als « la mer » ! Mais « eau et sel » c’est plus qu’un trope ; l’alliance a plus d’un tour dans son sac.
Le sel a parcouru l’histoire antique comme la légende du sel semé par les Romains sur les terres de Carthage ; on pense au Sel Noir d’Édouard Glissant qui rend hommage à la ville d’Elissa. Le sel porte en lui des significations paradoxales allant de l’acte de souffler la vie (fertilité) jusqu’à celui d’arracher la vie (stérilité). C’est également le symbole d’une valeur sacrée : la liberté ; l’exemple de la marche du sel de Gandhi, acte symbolique visant à arracher aux Anglais l’indépendance des Indes, est à ce titre mémorable. Cette matière qui marque le goût de nos plats est au centre d’une métaphore (de l’) essentiel(le). La Statue de sel d’Albert Memmi n’aspire-t-elle pas, entre autres, à réécrire les saveurs et les senteurs d’une « mémoire tatouée » (Abdelkébir Khatibi) ? Tel est le sens de cette quête interminable qui met les hommes sur les chemins labyrinthiques de l’Histoire et des cultures : « Nous marchions. Caravanes de thé. Caravanes de cotonnade. Caravanes de sel, mes préférées [...]. Les caravanes de sel restent pour moi un conte de lumière », affirme Malika Mokaddem dans Les Hommes qui marchent (Paris, Grasset, 1997).
Produit de luxe, le sel avait sa route, comme la soie, l’étain, l’ambre, etc. Depuis la nuit des temps, il a toutes sortes d’utilisations : culinaires, médicinales, religieuses… Dès lors il serait pertinent de s’interroger sur la nature, les propriétés et les fonctions du sel. D’un point de vue lexical, par exemple, le mot « sel » entre dans une grande quantité d’expressions : « mettre son grain de sel », raconter une « histoire salée », payer une « addition salée », « un propos qui ne manque pas de sel », un garçon « dessalé », être « le sel de la terre », être « un pur grain de sel », « sel attique », prendre « avec un grain de sel », cheveux « poivre et sel », « le sel de l’amour »… Tout seul, le sel est déjà un élément symbolique : symbole de justice pour Pythagore, symbole de sagesse chez les chrétiens, symbole de beauté chez le poète latin Lucrèce, symbole purificateur ou de malédiction, tantôt positif tantôt négatif, tantôt propitiatoire tantôt apotropaïque, dans l’antiquité grecque, chez les Celtes, au Moyen Âge avec le « pacte du sel », en Scandinavie, à Madagascar, au Japon dans le monde des sumos en particulier… et quasiment partout dans le monde.
Mais le mot « sel » entre en relation – voire en composition au sein d’expressions – avec d’autres mots tels que le « pain » ou la « fève » ; ainsi l’amitié est-elle liée au partage du pain et du sel pour les Sémites ; et, chez le Grec Plutarque, elle est liée au sel et à la fève. Synonyme de cordialité, la relation du sel avec le goût et l’authenticité conserve, au Maghreb, le même apport.
C’est donc le couple constitué par « l’eau » et « le sel » qui s’invite à la table de notre colloque – table d’amitié puisque, en dialectal tunisien, l’expression « d’eau et de sel » condense la valeur d’une vraie amitié –, nous prévenant de ne pas renverser maladroitement la salière des mots. L’expression « à la sel et eau » existe au Canada pour dire « sans autre assaisonnement ». Dans la Tentation de Saint-Antoine, Flaubert écrit : « Ils disent : par le sel, par l’eau, par la terre, par le ciel, par l’air et par le vent » ; on baptise « par le sel et par l’eau » dans L’Île des Pingouins d’Anatole France ; les juifs purifient la viande avec de l’eau et du sel. Serait-ce parce que le sel et l’eau s’attirent selon le principe chimique d’hydrophilie, engageant ainsi des dimensions à la fois imaginaires et symboliques ? Mais le sel mélangé à l’eau n’est-il pas amené à se dissoudre ? Auquel cas l’on revient à l’eau salée… et l’hendiadyn retrouve son unité sans redondance.
Il conviendra donc d’explorer toutes les directions anthropologiques, sociologiques, géologiques, scientifiques, littéraires, linguistiques, artistiques… de cette association de l’eau et du sel, en partant du rite de l’hospitalité, donc en ne fermant aucune porte à une quelconque interrogation ouverte, dans une quête du sens indécidable, pour constituer une communauté interprétative qui ne déplairait nullement à Stanley Fish.
Axes de recherche
L’eau, principe et vecteur de la vie… L’eau, composant élémentaire et source de symboles profanes et sacrés…. L’eau, métaphore obsédante des artistes et des créateurs… Le sel, note(s) culinaire(s) incontournable(s) : variétés d’usage… Le sel des diététiciens, des médecins et des chimistes : entre saveur(s) et danger(s)… Le sel des origines, dans les grands textes fondateurs… Les routes du sel : une odyssée de l’Histoire et des cultures… Métaphores et représentations du sel dans les arts et les lettres… Les paradigmes du sel dans les langues, les parlers et les façons de dire… Toute association de l’eau et du sel, dans quelque domaine que ce soit, à titre d’expérience ou de représentation…
Les propositions de communication (ne dépassant pas une page) doivent être envoyées au professeur Habib Ben Salha, directeur du Laboratoire des Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle :
habib.salha@yahoo.fr
Calendrier
Dernier délai pour les propositions de communication : le 13 avril 2013
Réponse du comité scientifique : le 27 avril 2013
Programme officiel : le 4 mai 2013
Comité scientifique
Habib Ben Salha (Université de Manouba)
Hamdi Hmaïdi (Université de Manouba)
Patrick Voisin (Classes Préparatoires aux ENS Paris et Lyon, Pau)
Sadok Gassouma (Université de Manouba)
Comité d’organisation
Wafa Bsais-Ourari (Université de Carthage)
Issam Maachaoui (Université de Carthage)
Faten Ben Aïssa
Rym Kheriji (Université de Manouba)
Ibtihel Ben Ahmed (Université de Manouba)
Hanène Harrazi Ksontini (Université de Carthage)
Donia Maraoub (Université de Manouba)
Habib Ben Salha (Université de Manouba)
Adel Habbassi (Université de Tunis)
Responsable : Pr. Habib Ben Salha
Url de référence :
http://www.flm.rnu.tn/presentation.php
Adresse : Pr. Habib Ben Salha, Faculté des Lettres, Arts et Humanités, Campus universitaire de La Manouba, 2010, Manouba, Tunisie [Réduire] Contact : Habib Ben Salha |
Le 01 Janvier 1970 :
 |
Saïdia (Maroc) - Marina EXPOSITION DE PEINTURE EN PLEIN AIR A MARINA Contact : Abderrahmane Zenati |
Du 01 au 02 Mai 2013 :
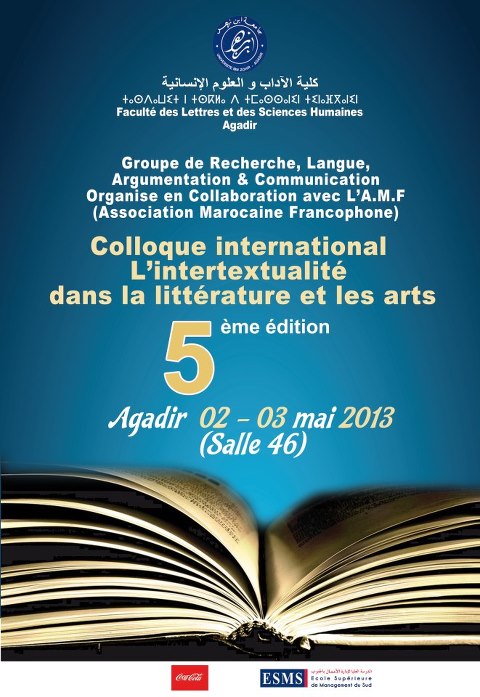 |
l'intertextualité dans la littérature et les arts AGADIR (MAROC) - Université Ibn Zohr |
Du 20 au 21 Novembre 2013 :
| |
L’Autre et ses représentations dans la culture arabo-musulmane Bordeaux (France) - Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3/ Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine S’il existe en Occident, et ce depuis le Moyen-Age, de très nombreux écrits ayant pour objet d’étude l’ « être arabe », à travers lesquels des intellectuels occidentaux ont essayé, au fil des époques, d’appréhender l’altérité arabo-muslmane selon différents prismes (religieux... [Afficher la suite] S’il existe en Occident, et ce depuis le Moyen-Age, de très nombreux écrits ayant pour objet d’étude l’ « être arabe », à travers lesquels des intellectuels occidentaux ont essayé, au fil des époques, d’appréhender l’altérité arabo-muslmane selon différents prismes (religieux, philosophique, politique, ethnologique ou sociologique), qu’en est-il du monde arabo-musulman ? Quelle place les intellectuels de ce monde ont-ils assignée à l’Autre ?
L’essayiste Abdellah Laroui postule : « Sans remonter aux exemples classiques de Mas’ûdi et Birûni, on peut soutenir que les Lettres persanes ne furent pas seulement un artifice littéraire, qu’il en exista de réelles sous diverses formes… »
Pour abonder dans ce sens, on peut en effet rappeler qu’au cours de son histoire, le monde arabo-musulman, à travers ses voyageurs, ses ambassadeurs, ses commerçants ou ses armées, a été en contact avec une multitude de civilisations et de peuples étrangers qui, en intégrant l’Empire musulman, sont devenus d’importants acteurs et promoteurs de son développement et du rayonnement de sa civilisation.
Au sein de cette nouvelle aire culturelle qu’on nomma « terre d’islam », principalement caractérisée par sa diversité sociale et ethnique et dans laquelle en tout cas les Arabes sont devenus minoritaires, comment a-t-on défini l’ « Autre »? Quelles représentations s’en est-on faites ? Est-ce qu’on considérait un Indien, un Persan ou un Grec de la même manière qu’un Chinois, un Berbère ou un Africain ?
Un certain « relativisme » a pu caractériser les représentations arabo-musulmanes de ce qui était ressenti comme « externe » durant la période où le monde arabo-musulman a exercé sur une grande partie du monde une position de domination, mais avec l’effondrement de l’Empire, ce mode d’appréhension s’est progressivement fissuré. Une autre donne est venue bouleverser la vision que les intellectuels arabo-musulmans se faisaient de l’ « Autre » : l’émergence de l’Occident comme nouvelle puissance moderne qui non seulement a menacé la suprématie de leur civilisation mais a même réussi à les assujettir.
Abdellah Laroui écrit encore : « Depuis trois quarts de siècle les Arabes se posent une seule et même question : « qui est l’autre (…) ? Après s’être appelé pendant longtemps, Chrétienté et Europe, il porte aujourd’hui un nom, vague et précis à la fois, celui d’Occident. »
Cet « Autre » occidental et ses avatars ne cesseraient donc de hanter l’imaginaire et la conscience de l’individu arabe, mais selon des modalités pour le moins variables, ne serait-ce qu’en fonction des époques. Si certains intellectuels à l’image d’un Tahtawi, voyaient en lui, et par extension le monde qu’il représente, un symbole de progrès et de modernité, d’autres tels que Hassan Hanafi, plus marqués par l’épisode colonial, investissent l’altérité d'une signification antithétique en considérant l’ « Autre » comme un ennemi, « un serpent à extirper de son ventre ». D’autres encore, tel Edward Saïd, en contestant la chosification et l’artificieuse « orientalisation » occidentale du monde arabe, essaient d’élaborer un nouveau discours afin d’édifier de nouvelles représentations de soi, que certains chercheurs qualifient aujourd’hui de postcoloniales, parce que débarrassées de l’hégémonie occidentale.
Notre propos est de mettre au jour et d’approfondir ces différentes appréhensions de l’altérité. Nous envisagerons l’« Autre » dans une acception métonymique pouvant renvoyer à un large ensemble, culturel, politique, géographique, identitaire… Quant au terme « représentation », il peut être entendu dans son sens premier c’est à dire en tant qu’action de présentification impliquant des dispositifs cognitifs, descriptifs, esthétiques de figuration aussi bien que dans une acception philosophique d’appréhension intellectuelle visant à donner sens et valeur à l’objet considéré ou même dans un sens plus sociologique permettant de prendre en considération des perceptions collectives.
Notre colloque vise donc à poser cette question des représentations de l’« Autre » dans la culture arabe pour chercher à en distinguer les étapes-clés et les modalités selon les médiums d’expression. Les propositions pourront porter aussi bien sur le monde arabo-musulman classique que sur le contemporain. Elles trouveront leur champ d’application dans la littérature arabe, aussi bien francophone qu’arabophone, dans les écrits historiques aussi bien que philosophiques, dans les arts visuels (cinéma, vidéo, etc.) aussi bien dans les arts plastiques ou spectaculaires.
Modalités
Les propositions de communication (titre, résumé en français 2000 signes), ainsi qu’une brève notice biobibliographique (nom, prénom, affiliation, courriel, intérêts de recherche, titres de publications) seront à envoyer par mail en format .doc ou .pdf jusqu’au 30 juillet 2013, à l’adresse suivante : colloquebordeaux2013@gmail.com
Après sélection du comité scientifique les candidats recevront une notification avant le 15 août 2013.
Pour les propositions retenues, une version préliminaire des communications (30 000 signes) est à envoyer avant le 15 octobre 2013.
Les interventions qui seront sélectionnées par le comité scientifique feront l’objet d’un volume à paraître en 2014 aux Presses universitaires de Bordeaux.
L'inscription au colloque est gratuite. Le comité d’organisation prendra en charge deux déjeuners (21-22) et mettra à la disposition des participants l’offre d’hébergement pour la période du déroulement du colloque. Les frais de transport, d’hébergement sont à la charge des participants.
Coordination du colloque:
• Omar Fertat (Université Michel de Montaigne-Bordeaux3)
• Ahmed Khanboubi (Université Michel de Montaigne-Bordeaux3)
Comité Scientifique :
• Martine Job, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3
• Ahmed Khanboubi, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3
• Saïd Hammoud, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3
• Omar Fertat, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3
• Abdellah Bounfour, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris
• Mourad Yelles, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris
• Touriya Fili-Tullon, Université Lumière-Lyon 2
• Samir Marzouki, Université de Manouba, Tunis
• Hédia Khaddar, Faculté des Sciences Humaines et sociales, Tunis
• Zohra Makach, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc
• Abderrazak Sayadi, Université de Manouba, Tunis [Réduire] Contact : colloquebordeaux2013@gmail.com |
Du 31 Mars au 01 Avril 2014 :
| |
Colloque international : « La poétique de l’histoire dans la littérature africaine francophone » Nouakchott (Mauritanie) Argumentaire
Le lien presque intrinsèque que la littérature entretient avec l’histoire a été souligné par de nombreux critiques et non des moindres (Lilyan Kesteloot , Jacques Chevrier …). Sous cet angle de perception, la réalité historique serait la source principale d’inspiration du... [Afficher la suite] Argumentaire
Le lien presque intrinsèque que la littérature entretient avec l’histoire a été souligné par de nombreux critiques et non des moindres (Lilyan Kesteloot , Jacques Chevrier …). Sous cet angle de perception, la réalité historique serait la source principale d’inspiration du texte littéraire africain.
La lutte contre la présupposée supériorité culturelle occidentale et les revendications pour la souveraineté des peuples colonisés ont été au cœur des poésies et proses de Césaire, Damas et Senghor ; la dénonciation des nouveaux pouvoirs politiques africains issus des indépendances en 1960 a constitué la toile de fond thématique des romanciers de la seconde génération (Séwanou Dabla , G. Ngal ) alors que les publications des décennies 1990 et 2000 sont marquées par cet effort presque obsessionnel de comprendre les cohabitations conflictuelles qui aboutirent à des drames humains dont le plus connu est celui du Rwanda en 1994 (Mamadou K BA ).
Ainsi, la littérature africaine serait donc le champ de déploiement d’une perception de l’histoire du continent notamment dans ce qu’elle a de douloureux et fascinant. L’écrivain se positionne en observateur critique de l’histoire qu’il s’efforce alors de recomposer, sans doute subjectivement, par des « mots-chaire-de sang » (Sony L. Tansi). A l’instar de l’histoire elle-même qui est multidimensionnelle, l’œuvre littéraire entreprend d’investir la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, la politique, la linguistique et même la géographie…
Mais cette approche du texte littéraire n’annihile t- elle pas toute une dimension de l’œuvre ? Justin Bisanswa n’a-t-il pas partiellement raison lorsqu’il s’insurge contre ces appréhensions du texte littéraire sous le prisme des dichotomies conceptuelles directement inspirées de l’histoire ?
Voilà, entre autres, les nombreuses pistes qui peuvent être explorées, par les participants à ce colloque, à travers la diversité littéraire africaine francophone qui s’étend du Maghreb à l’Afrique centrale.
Plusieurs axes de réflexions retiennent particulièrement l’attention.
Axe 1 : une interrogation des textes dans leur rapport à l’histoire sociale, politique et économique du continent.
Axe 2 : la dénomination littérature africaine (même au pluriel) reste-t-elle toujours pertinente ? Si oui quels arguments plaident en sa faveur? Le réel historique du continent continue-t-il de demeurer l’une des sources prépondérante des écrivains ? Que dire donc du concept relativement nouveau de « littérature monde » ou de celui de « littérature de la diaspora » ?
Axe 3 : Est-ce pertinent d’étudier les textes littéraires africains suivant une approche structuraliste ou néo-structuraliste qui ferait alors fi de toute référence à l’histoire ou au contexte du continent ?
Axe 4 : La violence de l’écriture telle qu’elle se dégage des textes africains francophones notamment des deux dernières décennies est-elle le résultat de la violence de son histoire mise en mots ; ou est-elle simplement le produit d’un effort des écrivains dans leur recherche esthétique ?
Les propositions de communication doivent être envoyées aux adresses suivantes au plus tard le 30 novembre 2013. Pas plus d’une page (police 12, times new roman, interligne simple, notes éventuels en bas de page).
- mamadoukba@gmail.com
- mbouhseta@yahoo.fr
- dahmed.mamadou@yahoo.fr
Comité scientifique :
Catherine Mazauric, Maître de conférences, Habilité à Diriger des Recherches, Université de Toulouse2-Le Mirail.
Mamadou BA, Maître de conférences, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Mamadou Kalidou BA, Maître de conférences, Habilité à Diriger des Recherches, Université de Nouakchott.
Marie-José Fourtanier, Professeure des universités, Université de Toulouse2- le Mirail.
Mbouh Séta Diagana, Maître de Conférences, Université de Nouakchott.
Pierre Soubias, Maître de conférences, Université de Toulouse2- Le Mirail.
Mamadou Dahmed, Maître de conférences, Université de Nouakchott.
Gérard Langlade, Professeur des Universités, Université de Toulouse2-Le Mirail.
Après expertise du comité scientifique, les réponses vous seront adressées au plus tard le 31 janvier 2014.
NB : L’hébergement et la restauration des participants seront pris en charge par les organisateurs du colloque. [Réduire] |
Le 23 Mai 2013 :
| |
Littératures francophones et orientalisme, Maghreb et Machrek (journée d’étude dans le cadre du séminaire « orientalismes ») Paris (France) - ENS Rue d'Ulm, salle Dussane Vendredi 24 mai 2013, 45 rue d’Ulm, salle Dussane
Littératures francophones et orientalisme, Maghreb et Machrek
(journée d’étude dans le cadre du séminaire « orientalismes »)
L’orientalisme des écrivains francophones peut être appréhendé comme une quête d’identités (arabe... [Afficher la suite] Vendredi 24 mai 2013, 45 rue d’Ulm, salle Dussane
Littératures francophones et orientalisme, Maghreb et Machrek
(journée d’étude dans le cadre du séminaire « orientalismes »)
L’orientalisme des écrivains francophones peut être appréhendé comme une quête d’identités (arabe, chrétienne ou musulmane) entre ressourcements passéistes et utopie d’avenir ; comme un débat intérieur pour les écrivains d’origine orientale (créer avec et contre les thématiques et les postures esthétiques orientalistes héritées du passé occidental ou oriental) ; mais encore comme une entreprise « orientale » poursuivie par les résidents francophones d’origine européenne.
9h30 Ouverture : Dominique Combe et Daniel Lançon
Dans un siècle en quête de sources
1. « Représenter la femme « nouvelle » en Égypte francophone. Relectures féministes de l'orientalisme : Jehan d'Ivray, Out-el-Kouloub (1898-1961) », par Élodie Gaden (Université Paris 4 - Sorbonne)
2. « ‘‘Il a fait sienne cette terre du Mex toute brûlée de soleil...’’. Littérature et Orient (1921) d'Henri Thuile : le témoignage oublié d'un Français en Égypte, ou l'Orient vu depuis les marges d'Alexandrie », par Paul-André Claudel (Université de Nantes)
3. « Kateb Yacine : orientaliste malgré lui ? », par Touriya Fili-Tullon (Université Lumière - Lyon 2)
4. « Diptyque oriental d'Assia Djebar : les peintres, les religions », par Mireille Calle-Gruber (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)
14h30 Débats contemporains
5. « Albert Cossery : le refus de la revendication ou la revendication du refus. Un Orient sans orientalisme », par David L. Parris (Trinity College, Dublin)
6. « Le détournement de l’imagerie de l’Orient rêvé chez Jamel Eddine Bencheikh », par Cyrille François (Université de Cergy-Pontoise)
7. « La résistance des écrivaines arabes à l’injonction contique : Pour en finir avec Sharazade (1996) de Fawzia Zouari », par Christiane Chaulet-Achour (Université de Cergy-Pontoise)
8. « L’orientalisme romancé : La Nuit des origines (2005) de Nourredine Saadi », par Ridha Boulâabi (Université Stendhal - Grenoble 3) [Réduire] Contact : smoussa@free.fr |
Du 01 au 03 Novembre 2013 :
| |
Voyager d'Egypte vers l'Europe et inversement : Parcours croisés (1830-1950) Le Caire (Egypte) - Université Parmi les récits de voyageurs égyptiens partis à la découverte de la France au cours du 19ème siècle, l'ouvrage de Rifa'a al-Tahtawi – De l'or raffiné pour un Paris en résumé, ou selon le titre abrégé de sa traduction française par Anouar Louca : L'Or de Paris (1988) - se taille sans... [Afficher la suite] Parmi les récits de voyageurs égyptiens partis à la découverte de la France au cours du 19ème siècle, l'ouvrage de Rifa'a al-Tahtawi – De l'or raffiné pour un Paris en résumé, ou selon le titre abrégé de sa traduction française par Anouar Louca : L'Or de Paris (1988) - se taille sans conteste la part du lion. Mais tout se passe comme si cette œuvre pionnière allait devenir peu à peu, et pour des décennies, l'arbre qui cache la forêt.
Car très tôt, on le sait, l'esprit de la Nahda a contribué à tourner les yeux de toute l'intelligentsia égyptienne, et arabe plus largement, vers la "civilisation occidentale" et, dans beaucoup de cas, cette ouverture s'est concrétisée par une traversée de la Méditerranée et un contact direct avec la France et les pays avoisinants. Parmi ceux qui ont laissé un témoignage de leur séjour en terre d'Europe, que celui-ci ait été motivé par une mission scientifique ou diplomatique, l'exil, ou une curiosité de touriste éclairé, on citera Ali Mubarak, le cheikh Mohammed Sélim al-Bayoumi, Amin Fikri, Mohammed al-Muwaylihi, Ahmed Zaki, Moustafa Kamil, Ali Aboul-Fotouh, Moustafa Abdel Razek, Zaki Mubarak, Mohammed Hussein Haykal…
Or leurs écrits, bien qu'ils nous apportent un éclairage très vivant sur le climat intellectuel de la Renaissance arabe, ses ambitions, ses débats, ont longtemps été négligés par la critique universitaire qui, à son insu, a laissé s'installer l'idée, surtout dans l'imaginaire européen, que, face à l'orientalisme conquérant et passionné par l'étude de l'autre, il y avait un grand vide ou quelques tentatives timides et sans écho. La richesse des études consacrées, en France, aux Voyages en Orient et en Égypte, l'intérêt suscité par ce type de littérature admirablement servie par des anthologies diverses, des rééditions de textes rares et de correspondances, la publication de carnets de notes et de photographies, n'ont fait qu'amplifier le déséquilibre au cours des trois dernières décennies.
Cependant, on a pu déceler tout dernièrement, du côté de la littérature arabe, quelques initiatives prometteuses, un nombre grandissant de "Voyages en Europe", rédigés entre 1840 et 1950, commençant à devenir disponibles en librairie ou sur la toile. Emboîtant le pas à ces réalisations éditoriales, notre colloque a pour objectif majeur de participer à ce travail d'anamnèse qui s'amorce, de redécouvrir ces textes, de les analyser avec attention et de leur redonner toute leur place, d'une part dans le champ de la littérature de voyage, de l'autre dans le grand dialogue Orient-Occident.
C'est pourquoi ce colloque étendra ses axes de recherches à la réflexion théorique sur la littérature itinérante et à ses avancées ainsi qu'aux apports récents du comparatisme et de l'Histoire des civilisations dans le domaine des relations entre les deux rives du monde méditerranéen.
Cette perspective élargie nous paraît indispensable, même si l'originalité de cette rencontre tient plutôt à la valorisation du premier axe indiqué par son titre (d'Égypte vers l'Europe) et à des interrogations telles que celles-ci : Quelles traces l'esprit de la Nahda imprime-t-il aux récits des voyageurs égyptiens et arabes en France et plus généralement en Europe ? La division en catégories de voyageurs (les "religieux", les touristes, les pédagogues, etc.) est-elle vraiment pertinente ou la personnalité, la curiosité, de chaque auteur prend-elle le dessus dans l'élaboration d'une vision individuelle ?
Mais aussi : Quelle part la littérature de voyage fait-elle au discours sur soi ? Peut-on y repérer de grandes constantes au niveau des thèmes privilégiés, des codes rhétoriques, des références culturelles, des principes idéologiques et moraux ? À quels procédés le voyageur recourt-il pour traduire et "rendre" l'étrangeté de ce qu'il a vu (voire fabriquer un "effet d'étrangeté") à l'intention du lecteur resté au pays ? La dichotomie Voyageurs européens en Égypte / Voyageurs égyptiens en Europe nous conduit-elle vers un système d'oppositions et de divergences, ou au contraire la condition de voyageur comporte-t-elle une pose, un comportement, des réflexes typiques qui créent une sorte de communauté insoupçonnée entre tous ceux qui, de quelque bord qu'ils appartiennent, s'embarquent vers l'ailleurs ?
Axes proposés :
- Actualité de la littérature de voyage : acquis et renouvellements des perspectives
- Enjeux du voyage vers l'Occident durant la Nahda
- Voyageurs français en Egypte, Voyageurs égyptiens en France : le jeu des images
- Formes et thématiques privilégiées du récit de voyage dans la littérature arabe moderne (1830-1950) : entre l'héritage de la rihla et l'émergence de nouveaux défis
- Le cas particulier des Expositions universelles : le témoignage des voyageurs venus d'Orient
- La représentation de l'Égypte et de l'Orient dans les Expositions universelles
Responsable du projet : Randa Sabry
Comité de lecture :
Sarga Moussa (Lyon 2), Hachem Foda (INALCO)
Amina Rachid, Aziza Saïd, Gharraa Mehanna, Randa Sabry (Le Caire)
Langues du Colloque : français, arabe
Envoi d'un titre et d'un résumé de 400 mots : avant le 31 mars 2013, à l'une des adresses suivantes :
- Rania Gouda : rgouda100@hotmail.com
- Inès el Sérafi : ielserafi@hotmail.com
Les propositions de communication seront soumises aux membres du jury de façon anonyme.
Réponse du comité de lecture : au cours du mois de mai 2013
Pour toute information complémentaire : Randa Sabry : rsabry@hotmail.com [Réduire] Contact : Randa Sabry: rsabry@hotmail.com |
Du 28 Mars au 06 Avril 2013 :
 |
Salon du Livre de Casablanca Casablanca (Maroc) |
Du 21 au 22 Mai 2013 :
 |
Langues, cultures et Mediterranéite Oran (Algérie) - Université de Tlemcen "L'aire méditerranéenne", communément connue sous le terme générique de « Bassin méditerranéen », représente beaucoup plus une zone de mélanges et de brassages de langues, de dialectes et de cultures sous toutes leurs formes, qu’une simple dénomination géographique.
La qu... [Afficher la suite] "L'aire méditerranéenne", communément connue sous le terme générique de « Bassin méditerranéen », représente beaucoup plus une zone de mélanges et de brassages de langues, de dialectes et de cultures sous toutes leurs formes, qu’une simple dénomination géographique.
La question de l’interculturel en Méditerranée demeure une question d’actualité pour plusieurs raisons. La Méditerranée est le berceau d’un ensemble de croyances et de modes de vies qui reflètent des identités, des expériences et des échanges culturels que l’on retrouve à travers le Monde oriental et occidental. Les deux rives de la Méditerranée constituent un ensemble géopolitique, linguistique et culturel pluriel et varié que l’on soumet à la réflexion lors des travaux de ce colloque.
Axes :
1. L'identité linguistique et culturelle en Méditerranée
2. Migration, mutation, identité et différence en Méditerranée
3. Patrimoine oral et écrit en Méditerranée vecteur de l'interculturel
4. Architectures, langues et cultures en Méditerranée
5. L'interculturel en Méditerranée : diversité et contacts
6. Culture(s) Méditerranéenne(s) dans l’espace et le temps.
7. La culture dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère.
Comité Scientifique Comité d’Organisation
AbiAyad Ahmed Université d’Oran Abbad Ahmed Université d’Oran
Bedjaoui Fawzia Université de SBA Behilil Abdelkader Université d’Oran
Belhadj Hacen Abdelhamid Circeft /Escol, Paris 12 Belbachir Rafiaa Université d’Oran
Benkalfat Mokhtar Université de Tlemcen Bouri Zine Eddine Université d’Oran
Benmoussat Boumedienne Université de Tlemcen Sadji Aboubakr Université d’Oran
Benmoussat Ismail Université de Tlemcen Chaabani Mohamed Université de SBA
Bensafi Zoulikha Université d’Alger Bouzeboudja Mourad Université d’Oran
Benyelles Radia Université de Tlemcen Yahia Mohamed Université d’Alger
Bleicher Thomas Université de Mainz Chohra Fouzia Université d’Oran
Bonn Charles Université de Lyon II Drioua Abdelkader Université d’Oran
Borsali Fewzi Université d’Adrar Benmestoura Faiza Université d’Oran
Bouhadiba Farouk Université d’Oran Amar Rabah Université d’Oran
Cherifi Abdelwahed Université d’Oran Allem Leila Université d’Oran
El Korso Kamal Université d’Oran Bensalah Mohamed Université d’Oran
Gelas Bruno Université de Lyon Nouali Ghouti Université de SBA
Ghellal Abdelkader Université d’Oran Seghour Ahlem Université d’Oran
Hamzaoui Hafida Université de Tlemcen Benamar Naima ENSET d’Oran
Mami Nawel Université de Sétif Merbouh Zouaoui Université de SBA
Mebarki Belkacem Université d’Oran Boussena Leila Université de Chlef
Meliani Mohamed Université d’Oran Fetita Belkacem Université Ouargla
Nebia Slimane Rafik Université d’Oran Baghli Wafaa Université d’Oran
Parpette Chantal Université de Lyon II Benhattab Lotfi Université d’Oran
Sari Fawzia Université d’Oran Azzouz Benamar Université d’Oran
Terki Hassain Ismat Université d’Oran Moulfi Leila Université d’Oran [Réduire] Contact : EL KORSO Kamal |
Le 11 Avril 2013 :
| |
Rencontre avec le poète et universitaire Carpanin Marimoutou Lyon (France) - Université Lyon 2 Jean-Claude Carpanin Marimoutou
Politiques de la marge, poétiques du passage
en pays de créolisation : les littératures
réunionnaises
le vendredi 12 avril 2013 de 10 h à 12 h
Université Lumière Lyon 2,
16 Quai Claude Bernard, Lyon 7e – Salle D 121 |
Le 14 Mars 2013 :
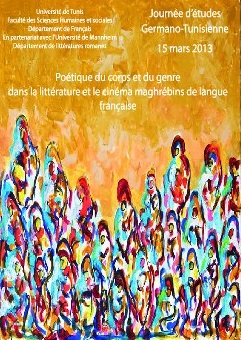 |
Journée d'études germano-tunisienne:"Poétique du corps et du genre dans la littérature et le cinéma maghrébins de langue française Tunis (Tunisie) - Faculté des Sciences Humaines et Sociales 9h00 : Allocutions d’ouverture par :
- M. Noureddine Kridis, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
- Mme Amel Fakhfakh, Directrice du Département de Français de la FSHST
Première séance modérée par Sonia Zlitni-Fitouri
9h30-9H50 : Claudia Gronemann, « Nom d... [Afficher la suite] 9h00 : Allocutions d’ouverture par :
- M. Noureddine Kridis, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
- Mme Amel Fakhfakh, Directrice du Département de Français de la FSHST
Première séance modérée par Sonia Zlitni-Fitouri
9h30-9H50 : Claudia Gronemann, « Nom de plume et genre/Gender: la mise en scène d'auteur chez Assia Djebar. »
9H50-10H10 : Sonia Zlitni- Fitouri, « L’imaginaire du corps aux limites d’une identité genrée dans Harrouda de Tahar Ben Jelloun. »
10H10-10H30 : Anissa Kaouel, « Le Pain nu de Mohamed Chokri : par-delà le féminin et le masculin. »
10H30-10H50 : Michael Gebhard, « Exorciser la douleur: Des femmes face à la terreur./Rachida de Yamina Bachir-Chouikh. »
10H50-11H10 : Discussion
11H10-11H30 : Pause-café
Deuxième séance modérée par Jamil Chaker
11H30-11H50 : Sophia Majeri : « Le corps à l’épreuve du genre dans L’enfant de sable de Tahar Ben Jelloun. »
11H50-12H10 : Agnieszka Komorowska, « Le regard clinique et la question du genre. La représentation de la psychiatrie dans le film algérien. »
12H10-12H30 : Dorsaf Karaani, « La sémiographie du corps blessé et ‘’tatoué’’ dans Amour bilingue et La blessure du nom propre de Abdelkébir Khatibi. »
12H30-12H50 : Discussion
13H00 : Déjeuner
Troisième séance modérée par Claudia Gronemann
15H00-12H20 : Ines Bugert, « L’Algérie est un homme » - Le double conflit de l’identité sexuelle et nationale dans Garçon manqué de Nina Bouraoui. »
15H20-15H40 : Zouhour Bessrour, « Cor(ps) et graphies dans La Transe des insoumis de Malika Mokaddem. »
15H40-16H00 : Chantal Marquardt, « Ambre, Artichauts et fifilles tunisiennes : Question du genre dans les blogs tunisiens. »
16H00-16H50 : Discussion
16H50-16H30 : Pause-café
16H30-17H30 : Table ronde d’écrivains tunisiens de langue française
Modérée par Sonia Zlitni-Fitouri et Samia Kassab-Charfi
- Abdelaziz Belkhodja
- Wahiba Khiari Gammoudi
- Aicha Ibrahim
- Ahmed Mahfoudh
- Wafa Bsaies
20H00 : Dîner
Comité d’organisation : Sonia Fitouri et Anissa Kaouel en collaboration avec Claudia Gronemann et Michael Gebhard [Réduire] |
Du 29 Juin au 03 Juillet 2013 :
| |
Das weiße Meer - An den Küsten gegenüber Volterra/Toscane (Italie) - Ville Le Guadalupe Réflexions et Rencontres autour de la Méditerrannée, avec la participation de Habib Tengour, Rachid Boutayeb, Karim Rafi, Leila el Houssi et d'autres ... En langue allemande. |
Du 20 au 21 Mars 2013 :
| |
L’inscription du ‘Trauma’ dans les littératures postcoloniales Le Mans (France) - Université du Maine, Le Mans Chers collègues,
voici le programme du colloque « L’inscription du ‘Trauma’ dans les littératures postcoloniales » qui se tiendra à l’université du Maine, Le Mans, les 21 et 22 mars 2013. Ce colloque est organisé dans le cadre du partenariat entre l'Université du Maine, Le Mans, Lab... [Afficher la suite] Chers collègues,
voici le programme du colloque « L’inscription du ‘Trauma’ dans les littératures postcoloniales » qui se tiendra à l’université du Maine, Le Mans, les 21 et 22 mars 2013. Ce colloque est organisé dans le cadre du partenariat entre l'Université du Maine, Le Mans, Labo 3L. AM 4335 et l'Université d’Alger 2, Facultés des Lettres, Algérie.
Les collègues et doctorants sont les bienvenus, pas de frais d'inscription.
cordialement,
Ben LEBDAI
Jeudi 21 mars 2013
9h
Accueil des participants
9h 15
Ouverture du colloque par
Professeur Laurent BOURQUIN, Vice-Président du Conseil Scientifique
Franck Laurent, Directeur du Labo 3L. AM
Ben Lebdai, Directeur-adjoint du Labo 3L. AM
(Organisateur, Le Mans)
Amina Bekkat, Professeur Littérature africaine)
(Organisatrice, Université d’Alger 2)
9h 30
Conférence inaugurale
Marc Amfreville, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 :
« Peut-on parler de trauma collectif ? »
Pause
Dire et dépasser le trauma (1) : Président : Franck Laurent
10h 45 : Afifa Bererhi, université d’Alger 2, Algérie, « Dire le trauma de part et d'autre. L'expression poétique de Yamina Méchakra et la parole de conscience de Jérôme Ferrari »
11h 15: Zohra Bouchentouf-Siagh, Université de Vienne, Autriche, « Histoire, mémoire et identité dans Entendez-vous dans nos montagnes (2002) de Maïssa Bey, approche d’un « texte-sépulture »
11h 45 : Benaouda Lebdai, Université du Maine, Le Mans, « ‘Fatwa’ et écriture ou le trauma de la négation »
Déjeuner
Dire et dépasser le trauma (2) : Présidente : Nathalie Prince
14h 15 : Christiane Chaulet-Achour, Université de Cergy Pontoise, « Traumatismes de guerre : père/fille. Comment reconstruire la filiation ? »
14h 45 : Amina Bekkat, Université d’Alger 2 et de Blida, Algérie, « Destins de femmes dans Photo de groupe au bord du fleuve d'Emmanuel Dongala »
15h 15 : Fernanda Vilar : Université de Cergy-Pontoise, « Le corps et le récit du trauma »
Pause
Trauma et esthétiques scripturales (1) : Président : Ricardo Tejada Minguez
16h : Michel Naumann, Université de Cergy-Pontoise, « Perversité, traumatisme et voies de libération chez Coetzee et Dostoievsky »
16h 30 : Katherine Doig, Université Paris-8 Vincennes-St Denis/ CERC Paris-3 Sorbonne Nouvelle, « J. M. Coetzee : logorrhées post-traumatiques et la tâche de l'écrivain »
17h : Fériel Khellaf : Université du Maine, Le Mans, « L'écriture du trauma et de la mémoire chez Zoe Wicomb »
17 h 30 : Vicki Briault, Université de Grenoble, « Ost-racisme et trauma des Métisses sud-africains, dans l’œuvre de Bessie Head et Zoë Wicomb »
20h 15 : Banquet
Vendredi 22 mars
Trauma et esthétiques scripturales (2) : Président : Redouane Abouddahab
9h 15 : Jelena Antic, Université Lumière Lyon 2, « Raconter le trauma par l’impossibilité de raconter l’amour dans le roman d’Assia Djebar Vaste est la prison (1995) »
9h 45 : Sarah Kouider-Rabah, Université de Blida, Algérie, « Les Figuiers de barbarie : symbolisation du trauma et écriture de la résilience »
10h 15 : Ismaïl Abdoun, Université d’Alger 2, Algérie, « La révolution trahie et la Liberté confisquée dans Le polygone étoilé de Kateb Yacine »
Pause
Trauma et esthétiques scripturales (3) : Présidente : Eliane Elmaleh
11h : Natalia Naydenova, Université Russe de l'Amitié des Peuples, Moscou, Russie, « Le traumatisme psychologique chez l’intellectuel africain à la lumière du discours littéraire »
11h 30 : M'bouh Seta Diagana, Université de Nouakchott, Mauritanie, « Création romanesque et écriture du trauma : le cas d’Une Vie de sébile de Bios Diallo »
12h : Wafa Triki, Université de Jandouba, Tunisie, « Blancs, silences et disparition du mot, expressions d’un mal traumatique chez Chamoiseau »
Déjeuner
Visages du trauma (1) : Présidente : Anne-Marie Santin-Guettier
14h 15: Sylvie Brodziak, Université de Cergy-Pontoise, « Trauma et territoires d’enfance » : La femme aux pieds nus de Scholastique Mukasonga et L’aîné des orphelins de Tierno Monembo »
14h 45 : Fella Benabed : Université de Annaba, Algérie « L’art-thérapie contre le trauma de l’enfant-soldat : Moses, Citizen and Me de Delia Jarrett-Macauley »
15h 15: Redouane Abouddahab, Université du Maine, Le Mans, « Trauma, deuil et mélancolie dans l'œuvre poétique de Naomi Shihab Nye »
Pause
Visages du trauma (2) : Président : Benaouda Lebdai
16h : Ena Eluther, Université du Maine, Le Mans, « Le Passage du milieu, traversée dans la cale négrière dans les littératures et oralitures afro-caribéennes : lieu incontournable, miroir du traumatisme »
16h 30 : Kouakou Dongo Adamou, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire, « Noël X. Ebony, du cauchemar, de la fièvre et de la peur : l’écriture du trauma dans ‘’Portrait des siècles meurtris’’ »
17h : Jacqueline Jondot, Université de Toulouse, « Et le colonisateur dans tout ça ? »
Clôture du colloque [Réduire] |
Du 15 au 16 Février 2013 :
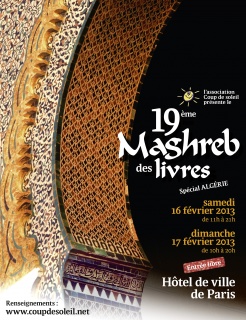 |
19ème Maghreb des Livres: Lettres algériennes Paris (France) - Hotel de Ville Communiqué de presse du 26 janvier 2013
Organisé par l’association Coup de soleil,
le 19ème Maghreb des livres
se tiendra les samedi 16 et dimanche17 février 2013
à l’Hôtel de ville de Paris
Les lettres algériennes y seront à l’honneur
2
Deux objectifs majeurs
- Le premier obje... [Afficher la suite] Communiqué de presse du 26 janvier 2013
Organisé par l’association Coup de soleil,
le 19ème Maghreb des livres
se tiendra les samedi 16 et dimanche17 février 2013
à l’Hôtel de ville de Paris
Les lettres algériennes y seront à l’honneur
2
Deux objectifs majeurs
- Le premier objectif de cette manifestation est de mettre en valeur l’ensemble de la production
éditoriale relative au Maghreb « de là-bas » et au Maghreb « d’en France », qu’il s’agisse de
littérature (roman et poésie) bien sûr, mais aussi des essais, B.D., beaux-livres, etc., parus dans le
courant de l’année 2012.
- Le second objectif de Coup de soleil est de multiplier, à cette occasion, les espaces de
découverte et de réflexion à travers cafés littéraires, cartes blanches, entretiens, lectures,
rencontres et tables-rondes.
► Au coeoeoeoeur de la manifestation : les livres et les auteurs
● Les livres : sont concernés les livres édités (dans les 12 derniers mois) en France, au
Maghreb… et ailleurs ; ouvrages en langues française, arabe et tamazight. Ils sont au coeur de
la manifestation avec une grande librairie (et des milliers de volumes) installée dans la grande
salle des fêtes : la librairie des ouvrages édités en France (Philippe Touron et la librairie
Gallimard - Le Divan) et celle des ouvrages édités au Maghreb (tenue par Roger Tavernier).
● les auteurs : Quelques 138 auteurs sont présents pour dialoguer avec leurs lecteurs et
dédicacer leurs livres (une sélection de 50 d’entre eux figurent au bas de ce communiqué). Seront
naturellement présents cette année de nombreux auteurs algériens, d’ici et de là-bas. Outre les
dédicaces, le public pourra mettre à profit la présence des auteurs et d’autres intervenants,
journalistes et universitaires, à travers :
- les cafés littéraires : cinq cafés littéraires sont prévus avec trois ou quatre écrivains que
rapproche le thème de leurs ouvrages ;
- quatre « cartes blanches » autour d’un livre collectif ou d’une revue mise à l’honneur ;
- les entretiens publics d’une trentaine d’auteurs répondant aux questions d’un journaliste ;
- une vingtaine de lectures de textes par de jeunes comédiens, en présence de l’auteur
concerné, avec lequel le public peut ensuite débattre.
- quatre rencontres et quatre tables rondes ;
● le prix littéraire « Beur FM Méditerranée » sera remis au lauréat le samedi à 16h45.
Organisé par l’association Coup de soleil,
le 19ème Maghreb des livres
se tiendra les samedi 16 et dimanche17 février 2013
à l’Hôtel de ville de Paris
Les lettres algériennes y seront à l’honneur
3
► Cafés littéraires, cartes blanches,
entretiens, lectures,
rencontres et tables-rondes
Outre les livres et les auteurs, Coup de soleil offre au public du Maghreb des livres (de 4 000 à
6 000 visiteurs chaque année) des espaces de découverte, de débat et de réflexion :
● 5 cafés-littéraires réunissent trois ou quatre auteurs autour d’un thème commun ou
voisin traité dans leurs derniers ouvrages. Animés par le journaliste littéraire Gérard MEUDAL,
ces cafés littéraires traiteront les thèmes suivants (titres provisoires) :
1- Les exils, avec Michel CANESI et Jamil RAHMANI, Sandrine CHARLEMAGNE, Dominique
DUSSIDOUR et Fabienne JACOB
2 - La guerre d’Algérie, avec Daho DJERBAL, Denis GONZALEZ, Claude JUIN, Guy
PERVILLÉ et Benjamin STORA
3 - L’Islam, avec Rachid BENZINE, Christian DELORME, Raphaël LIOGIER et Tareq
OUBROU
4 - Les « libéraux » d’Algérie, avec José-Alain FRALON, Nathalie FUNÈS, Michel
LEVALLOIS et Simon-Pierre THIERY
5 - Les Printemps arabes, avec Tarik GHEZALI, Bernard GUETTA, Mathieu GUIDÈRE et
Gilles KRAEMER
● 4 cartes blanches autour :
1) d’une revue qui fête ses 20 ans: - « Ecarts d’identité » avec Abdellatif CHAOUITE (directeur
de la revue) et André CHABIN
2) et de trois livres collectifs :
- « Nous la cité...on est partis de rien et on a fait un livre » (éd Zones (La Découverte). Animée
par Grégoire CHAMAYOU, directeur de collection aux éd. Zones, avec 3 co-auteurs : Sylvain
ERAMBERT, Riadh LAKHÉCHÈNE, Alexandre PHILIBERT et le coordonateur de l’ouvrage
Joseph PONTHUS
- « Histoire coloniale » (co-éd. par la Découverte à Paris et Barzakh à Alger). Animée par Daniel
LINDENBERG, professeur émérite à l’université de Paris-8, avec deux des co-directeurs de
l’ouvrage : Jean-Pierre PEYROULOU et Abderrahmane BOUCHÈNE.
- « Enfances juives en Méditerranée » (éd. Bleu autour). Animée par Leïla SEBBAR
(coordonatrice de l’ouvrage) avec deux auteurs : Daniel SIBONY et Dany TOUBIANA.
4
● 8 séquences d’entretiens (chaque séquence d’une heure permet d’interroger 4
auteurs) sont offertes à une trentaine d’auteurs qui, de quart d’heure en quart d’heure, répondent,
devant le public de la librairie, aux questions d’un journaliste littéraire : Yves CHEMLA
● 5 séquences de lectures (chaque séquence d’une heure permet de lire 4 extraits
d’ouvrage) sont offertes à une vingtaine d’auteurs qui, de quart d’heure en quart d’heure,
assistent à la lecture d’un extrait de leur ouvrage par des comédiens de la compagnie Par Has’Arts
(dirigée par Rafik SLAMA), accompagnés de deux musiciens.
● 4 rencontres (d’une durée d’1 heure) nous permettent d’honorer la mémoire
d’écrivains et de personnalités dont nous nous sentons proches:
- Mouloud Aounit, militant de la fraternité. Animée par Samia MESSAOUDI, avec Boualem
BENMEKHLOUF et Madjid SI-HOCINE
- Pierre Chaulet, médecin et militant algérien. Animée par Georges MORIN, avec Alice
CHERKI, Ali HAROUN (en cours de confirmation), Martine SÉVEGRAND et Saadeddine
ZMIRLI.
- Tahar Djaout, écrivain assassiné il y a 20 ans. Animée par Philippe ROBICHON, avec
Outoudert ABROUS, Louis GARDEL et Youcef MERAHI
- Mouloud Feraoun, écrivain assassiné il y a 50 ans. Animée par Tewfik HAKEM, avec
Mohand DEHMOUS, Martine MATHIEU-JOB et Dominique LURCEL.
● 4 tables-rondes (d’une durée d’1 heure 30), consacrées respectivement à :
- l’actualité : « Cinquante ans après, où en est l’Algérie ? » animée par Nadjia
BOUZEGHRANE, avec Madjid BENCHEIKH, Ahmed DAHMANI et Aïssa KADRI.
- l’histoire : « Les "Justes" du Maghreb entre 1939 et 1945 » animée par Akram BELKAÏD,
avec Mohammed AÏSSAOUI, Derri BERKANI et Michel TARDIEU.
- l’intégration : « De l’écriture au spectacle, une banlieue très cultivée ! », animée par Nadia
HATHROUBI-SAFSAF, avec Ahmed MADANI, Rachid SANTAKI et Zahia ZIOUANI
- la littérature : « Cinquante ans d’écriture algérienne au féminin », animée par Djilali
BENCHEIKH, avec Maïssa BEY, Christine DETREZ et Bouba TABTI.
5
► Des « espaces » originaux : revues et jeunesse
- l’espace-revues, organisé par Sadia BARÈCHE-MESSAOUI, permet d’accueillir une dizaine de
revues françaises et maghrébines.
- l’espace-jeunesse (en partenariat avec le secteur pédagogique de l’Institut du monde arabe que
dirige Radhia DZIRI), où enfants et adolescents peuvent rencontrer lecteurs, bédéistes, calligraphes
et conteurs.
► Des expositions et des artistes
Ce secteur artistique est organisé par Tewfic BENKRITLY entre la salle des fêtes et la galerie des
Arcades. On y retrouve :
- un calligraphe (Brahim KARIM) et des dessinateurs de presse (GYPS, ELHO alias Cheikh
Sidi Bémol, Halim MAHMOUDI et SLIM)
- des peintres et des photographes qui y exposent leurs oeuvres. Il s’agit, cette année, de : Adel
AKREMY, Wassim GHOZLANI, NOUTAYEL, Henri DUCOLI (artistes tunisiens ayant exposé
récemment au Musée du Montparnasse), Mariame BAJOU (peintre), Tewfik BENDAOUD
(photographe) et Djilali KADID (peintre).
► Un lieu de forte convivialité avec le café-maure
Vieille tradition du Maghreb des livres et qui en renforce la convivialité : on peut « faire une
pause » au café-maure, y boire, se restaurer et poursuivre les conversations et les rencontres avec
les auteurs et les amis retrouvés.
Cent-trente-huit auteurs de France, du Maroc, de Tunisie ... et bien sûr d’Algérie, (les lettres
algériennes sont à l’honneur cette année) ont confirmé leur présence. On ne peut les citer tous
ici. En voici 50, parmi les plus connus (ordre alphabétique) : Mustafa Alaoui, Iman Bassalah,
Azouz Begag, Tahar Bekri, Esther Benbassa, Djemila Benhabib, Tahar Ben Jelloun, Feriel
Benmahmoud, Anouar Benmalek, Rachid Benzine, Maïssa Bey, Mahi Binebine, Fawzi Boubia,
Farid Boudjellal, Chochana Boukhobza, Habib Boularès, Malek Chebel, Aziz Chouaki, Zakya
Daoud, Christian Delorme, Jacques Ferrandez, Azza Filali, Jean-Pierre Filiu, Nathalie Funès,
Louis Gardel, Salah Guemriche, Bernard Guetta, Mathieu Guidère, Nadia Henni-Moulaï,
Pierre Joxe, Abdellatif Laabi, Waciny Laredj, Fouad Laroui, Michel Levallois, Benamar
Mediène, Karim Miské, Fadéla M'Rabet, Mohamed Nédali, Tareq Oubrou, Jean-Noël
Pancrazi, Nourredine Saadi, Marie-Christine Saragosse, Leïla Sebbar, Benjamin Stora, Wassyla
Tamzali, Habib Tengour, Sylvie Thénault, Lucette Valensi, Marion Vidal-Bué et Amin Zaoui.
Contact général : Mourad Bouaziz et Jean-Baptiste Gaillard [association@coupdesoleil.net]
Contacts presse : Samia Messaoudi [messaoudis@wanadoo.fr] - tél. 06 09 47 08 16 [Réduire] |
Du 06 au 07 Juin 2013 :
| |
Création, recréation et distorsion de l’image dans les littératures francophones Paris (France) - UniversitéParis-Sorbonne.1, rue Victor Cousin, 75005 Paris Colloque annuel ACLF, Association Chercheurs en Littératures Francophones
Avec le soutien du CIEF, Centre International d’Études Francophones
Université Paris-Sorbonne
7 et 8 juin 2013
Dans un monde de plus en plus influencé par les représentations visuelles, la littérature en tant... [Afficher la suite] Colloque annuel ACLF, Association Chercheurs en Littératures Francophones
Avec le soutien du CIEF, Centre International d’Études Francophones
Université Paris-Sorbonne
7 et 8 juin 2013
Dans un monde de plus en plus influencé par les représentations visuelles, la littérature en tant qu’expression privilégiée de l’homme et des humanités se positionne et évolue dans un rapport étroit à l’image. Création marquée par l’œil de l’écrivain, l’œuvre littéraire élabore et propose au lecteur des images comme représentations du monde, de soi et de l’autre. En ce sens, les images mises en discours, façonnées et véhiculées par la littérature sont susceptibles d’être déformées par la subjectivité et l’intention de l’écrivain.
Si l’on peut considérer la littérature comme un corps textuel, l’œil, tant du point de vue de l’image décrite que de ses « re-présentations », fait état de distorsions à plusieurs degrés, qui sont autant de significations sémantiques et graphiques. Le texte se fait corps de passage des images, du groupe social et de l’auteur lui-même, livrant au lecteur une image distendue, déformée. À travers quels procédés discursifs ces images, passées au prisme du corps textuel, sont-elles « rendues » au monde ? Quel pouvoir leur attribuent les écrivains ? Quels rapports entretient la littérature avec les autres expressions artistiques qui se tournent naturellement vers l’élaboration des images ?
Les littératures francophones ont été depuis leur naissance des témoins perméables de grands bouleversements du monde. Que ce soit pendant les périodes de découvertes guidées par les mouvements colonisateurs ou lors des changements majeurs qu’ont connus les sociétés tout au long du XXe siècle, les écrivains francophones ont porté leur regard sur les imaginaires. L’extrême contemporain dans lequel s’inscrivent ces productions littéraires confirme la possibilité d’y étudier l’évolution continue du traitement textuel de l’image.
Voici quelques pistes de réflexion :
- Approches théoriques : discours et mise en texte dans les représentations de l’image dans la littérature et les arts, quelle théorie pour penser l’image en littérature ?
- Image et psychisme dans le texte littéraire : images de l’inconscient, hallucinées, ou façonnées par la schizophrénie, l’expression de l’aliénation par le biais de l’image.
- L’écriture littéraire comme image métatextuelle : entre texte et calligraphie, le corps textuel en mouvement, la création d’une mise en abyme comme image textuelle.
- La littérature et les arts tournés vers l’image : la théâtralité du texte littéraire, l’aller-retour entre le texte littéraire et l’expression cinématographique, l’hypotypose comme expression littéraire de la peinture.
- Musique et récit : élaboration de la synesthésie, écriture, musique et oralité dans la construction d’une image.
- Littérature, documentaires et reportages : le travail de déconstruction et/ou reconstruction du réel ; la force du récit dans les images d’époque ; la photographie : récits d’images fixes ?
La publication des actes du colloque est envisagée.
Les propositions (300 mots), accompagnées d'une notice bio-bibliographique, sont à envoyer, au plus tard le 15 février 2013, à Claudia Canu et Victoria Famin, à l’adresse suivante :
colloque.aclf@gmail.com
Une fois la proposition acceptée, les frais d'inscription au colloque, de 50 €, sont à envoyer à l'ordre de l'ACLF, 1, rue Victor Cousin, 75005 Paris. [Réduire] |
Du 04 au 05 Juin 2013 :
| |
Colloque en hommage à Tahar Djaout Que reste-t-il de son œuvre 20 ans après ? Tizi Ouzou (Algérie) - Université Mouloud Mammeri À l'aube du 20e anniversaire de l'assassinat de Tahar Djaout, la faculté des lettres et langues de l'université de Tizi Ouzou, avec le soutien scientifique de la Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines (CICLIM) organise un colloque en hommage à ce romancier ... [Afficher la suite] À l'aube du 20e anniversaire de l'assassinat de Tahar Djaout, la faculté des lettres et langues de l'université de Tizi Ouzou, avec le soutien scientifique de la Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines (CICLIM) organise un colloque en hommage à ce romancier de génie, à ce poète fulgurant, à ce journaliste de talent et à cet homme si proche des préoccupations de ses concitoyens.
Toutefois, « revisiter l’œuvre de Djaout, écrit Toubal dans Passerelles de mai 2011, ne doit pas nécessairement s'inscrire dans une perspective symbolique motivée par un devoir de commémoration. Il s'agit en premier lieu de la relecture d'une écriture achevée, par un besoin de lire naissant. » En témoignent de ce besoin les nombreux travaux (essais, thèses, mémoires, articles, etc.) consacrés à son œuvre qu'une simple recherche sur le site limag.com permet de mettre au jour.
Parmi ces travaux, nous pouvons citer l'essai majeur de l'écrivain-critique-journaliste Rachid Mokhtari, Tahar Djaout un écrivain pérenne paru en 2010 et la thèse de l'universitaire Ahmed Boualili soutenue en 2009 et éditée aux Éditions Universitaires Européennes en 2010, sous le titre De l'interdiscours à l'écriture hybride dans les écrits de Tahar Djaout : discours littéraire et discours journalistique ; mais aussi les hommages rendus à l'écrivain et au journaliste par l'équipe de recherche ADISEM de l'université d'Alger.
Le foisonnement des réflexions autour de l’œuvre de Djaout témoigne, si besoin est, de l'intérêt qu'on porte à son écriture, de la richesse et de la fulgurance d'une œuvre dont vingt années d'études n'ont pas encore fini de dévoiler tous les secrets.
Que dire alors d'une œuvre visitée sans cesse depuis plusieurs années ?
C'est la particularité du créateur qui fait que son œuvre soit si peu cernée. En effet, écrit encore Toubal, « le poète, le journaliste, le romancier ou le citoyen à l'écoute des mutations de sa société retrouve [à chaque fois] la parole et le sens anthropologique d'une œuvre flamboyante. Des territoires du sens libérés de la contrainte subjective s'offrent au défrichage des journalistes et des critiques qui, par leurs travaux, impriment une dynamique de « renaissance » à l’œuvre de Djaout qui se trouve ainsi exprimée par un mouvement de « sens », voire de « sens » en mouvement, dans une quête permanente de nouvelles signifiances qui l'inscrivent dans le registre des œuvres qui avancent... »
C'est dans cette dynamique que nous voulons inscrire ce colloque qui se présente comme un prolongement au colloque organisé en juillet 2009 à Béjaïa toujours en hommage à Djaout durant lequel l'accent a été mis sur l'itinéraire d'un exproprié et d'un vigile de l'Algérie qui avance. Par le présent colloque, nous voulons apporter un nouveau regard sur l’œuvre de Djaout toujours aussi « fraîche » à la lumière d'un contexte social ayant subi des mutations et d'approches aussi pertinentes que novatrices.
Il sera donc question de l'examen des écritures de Djaout sous le prisme de nouvelles données et de nouvelles approches pour mettre en valeur des pans entiers d'une œuvre non encore explorées. Le ton est donc donné, l'accent sera mis sur l'originalité de l'approche et la découverte de nouvelles pistes dans le projet d'écriture de Djaout. Nous envisagerons donc pour ce colloque trois grands axes :
1) Djaout et les genres brefs : le genre bref ou la forme brève est définie comme suit : « La forme littéraire brève est une forme d'écriture dont l'origine remonte même à celle de la littérature. L'écriture lapidaire, l'inscription dans un matériau difficile à travailler exigeant un maximum de concision, a une origine matérielle dont les conséquences furent, dès le départ, importantes sur la forme de l'écriture elle-même. (…) la brièveté, le laconisme sont souvent présentés comme un rempart contre l'effraction du vulgaire, un appel à l'activité du destinataire, aux talents, à l'imagination créatrice du lecteur. » Ces formes n'ont pas été suffisamment abordées dans les études critiques consacrées à l’œuvre de Djaout bien que ce sont là les premières expériences créatrices de l'auteur.
2) Djaout et la parole journalistique : les premiers pas journalistiques de Djaout ont marqué et traversé toute son œuvre. À travers cet axe, il sera question d'examiner le rapport entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Les propositions pourraient concerner l'une des deux écritures ou constituer un travail de comparaison entre les deux genres discursifs.
3) Djaout et les langues : des romans de Djaout comme Le dernier été de la raison ou L'invention du désert ont été traduits en anglais et sont très appréciés aux États-Unis ; d'autres comme Les vigiles ont été traduits en arabe ou en allemand, etc. En outre, Djaout entretient un rapport particulier avec les langues : avec la langue française tout d'abord qu'il voudrait réinventer, mais aussi avec le tamazight dont il voudrait la renaissance notamment dans ses poèmes.
Les propositions pour cet axe n'auront pas pour vocation de théoriser la traduction mais d'aller d'éléments précis de traduction. Il pourrait s'agir par exemple du déchirement de l'écrivain, de son ironie ou du ton élégiaque qu'il emploie pour évoquer la nature et ses paysages, etc. et de leur traduction dans une autre langue que la langue d'origine. Par ailleurs, ces éléments peuvent être approchés dans une seule langue : la langue d'origine ou la langue cible sans nécessité de comparaison. Les débats avec le public pourraient à ce moment-là être dirigés vers le rapport entre la version originale et la traduction. Les propositions concerneront aussi le rapport douloureux aux langues.
Dates importantes
Les propositions de communication doivent parvenir à l'adresse colloquedjaout@gmail.com au plus tard le 20 avril 2013.
La décision du comité scientifique sera notifiée le 05 mai 2013.
Le programme définitif sera publié le 15 mai 2013.
Le colloque se tiendra à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou les 5 et 6 juin 2013.
A retenir
1) Les actes du colloque seront publiés par la faculté des lettres et langues de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou ou dans un numéro spécial d'Expressions Maghrébines. Les consignes de rédaction seront communiquées ultérieurement.
2) Les langues de communication retenues sont le français, le tamazight, l’arabe et l'anglais [Réduire] |
Le 01 Janvier 1970 :
| |
PRESENCE DE NOUVELLES VOIX CULTURELLES EN MEDITERRANEE. DU GLOBAL AU LOCAL ORAN (Algérie) - CRASC Les bouleversements socio-culturels dans le monde ont marqué de nouvelles générations d’artistes et de créateurs en Méditerranée. Ils ont eu à innover dans les domaines artistiques et tenté de rendre compte de la complexité des sociétés dans lesquelles ils vivent et des nouveaux enjeux ... [Afficher la suite] Les bouleversements socio-culturels dans le monde ont marqué de nouvelles générations d’artistes et de créateurs en Méditerranée. Ils ont eu à innover dans les domaines artistiques et tenté de rendre compte de la complexité des sociétés dans lesquelles ils vivent et des nouveaux enjeux sociétaux qu’impliquent les différentes formes d’intégration à la mondialisation. Il ne s’agit pas tant de rendre compte du renouvellement générationnel qui est tout à fait prévisible que de pointer les changements qui redynamisent le champ artistique et qui manifestent un regard différent sur soi et les autres.
L’intérêt de cette rencontre, outre la mise en perspective d’expériences significatives, est de croiser des thématiques, de varier l’échelle des correspondances, de rendre surtout visible les connexions entre global et local. Il s’agira également de souligner les stratégies de conformation avec des manières de faire, de produire et de faire circuler les productions artistiques, de relever les dispositifs d’intégration dans des cercles de pairs et d’évaluer en particulier la pertinence des réseaux sociaux dans la constitution d’une communauté d’artistes et de publics (nationaux ? transnationaux ?) Les connexions avec les communautés diasporiques (artistes et/ou publics) sont évidemment une entrée essentielle pour définir le cadre flottant du global et du local. Enfin, la Méditerranée comme marqueur socio-historique s’incarne-t-elle dans ces échanges ? relève-t-elle du repère anthropologique ou de la simple évidence géographique ?
Equipe (PNR) : Champs culturels et mondialisations
Equipe projet d’établissement (CRASC): Patrimoines culturels et nouvelles technologies de la communication. Etudes comparée Algérie-Méditerranée [Réduire] |
Du 07 au 09 Mai 2013 :
 |
Safi (Maroc) - Faculté Pluridisciplinaire L’unité de recherche « Littérature, Culture et Imaginaire » relevant de la Faculté Pluridisciplinaire de Safi, Univeristé Cadi Ayyad au Maroc organise le colloque international Cinéma et Sacré dans le cadre de la 8ème édition des Journées Cinématographiques de Safi (JCS) les 08, 09 et ... [Afficher la suite] L’unité de recherche « Littérature, Culture et Imaginaire » relevant de la Faculté Pluridisciplinaire de Safi, Univeristé Cadi Ayyad au Maroc organise le colloque international Cinéma et Sacré dans le cadre de la 8ème édition des Journées Cinématographiques de Safi (JCS) les 08, 09 et 10 mai 2013.
Argumentaire
Déjà en 1951 Henri Agel avait posé les jalons d’une analyse quant au rapport qu’entretiennent le cinéma et le sacré, et pourquoi pas le sacré et le cinéma. L’ordre du syntagme est problématique en soi. Le ton est donné.
De sa septième position dans le podium des arts, le cinéma, et ce depuis sa naissance, va ravir à ses prédécesseurs, surtout la peinture et la sculpture, cette relation privilégiée qu’ils avaient avec le religieux et le sacré. Si les deux figeaient un événement ou un épisode religieux, le film par contre, va le vivifier en le donnant à voir, à écouter, à apprécier, à déprécier… Lister tous les effets est une rude tâche. Ceci est du côté du religieux. Du côté de l’artistique, le film exige un travail sur le technique, sur l’ordre de l’art parce qu’« Avant d'être religieux, un film, parce que film, doit d'abord être valable sur le plan esthétique. »
A cette relation qui unit le cinéma et le sacré, des questions légitimes se lèvent : comment un art qui relève du domaine du profane a-t-il approché le sacré dans le sens le plus large ? Cette approche a-t-elle une raison d’être, une légitimité ? Qu’apporte le cinéma au sacré quand il l’aborde, le met en scène, l’insinue… ? Quels sont les risques qu’encourent cet art et ses adeptes lors du traitement de telles thématiques ? Y a-t-il des limites à tracer, à respecter ou à ne pas franchir vu la spécificité de ce sujet ? L’art cinématographique reste-il fidèle à lui-même en tentant de conquérir ces zones ?
C’est pour répondre à ces interrogations que l’unité de recherche « Littérature, Culture et Imaginaire » de la Faculté Polydisciplinaire de Safi, Univeristé Cadi Ayyad au Maroc organise ce colloque international dans le cadre de la 8ème édition des Journées Cinématographiques de Safi (JCS).
Les interventions, en arabe ou en français, tourneront autour de cette thématique en se guidant par les axes suivants donnés à titre indicatif et non exhaustif :
L’esthétisation du religieux ;
Islam et cinéma ;
Cinéma et miracle ;
Cinéma et surnaturel (à caractère sacré) ;
Cinéma et profanation du sacré ;
Cinéma, sacré, censure et auto-censure ;
Islam et représentation du sacré…
Vous pouvez adresser vos propositions de communications jusqu’au 31 mars 2013 aux professeurs Abdelaziz Amraoui (amraouia@hotmail.com) ou Rachid Naim (rachid.naim@gmail.com) pour les textes en français. Pour les propositions écrites en arabe, veuillez vous adresser au Professeur Mounir ElBaskri (elbaskrimounir@yahoo.fr) en précisant votre nom, votre affiliation, le titre proposé pour votre communication, résumé d’une demi-page environ ainsi qu’une note bio-bibliographique.
Responsables : Pr. Abdelaziz Amraoui, Pr. Mounir ElBaskri, Pr. Rachid Naim
Les journées se dérouleront les 08, 09 et 10 mai 2013.
Les organisateurs prendront en charge les frais d'hébergement en pension complète.
Les frais de participation sont de 500 dh pour les intervenants du Sud et de 750 dh pour ceux du Nord à régler une fois sur place. [Réduire] |
Du 25 au 27 Septembre 2013 :
| |
Archive, Texte, Performance Congrès biennal international de l’APELA Bordeaux (France) - Université L’Association pour l’Étude des Littératures Africaines (APELA), fondée à Bordeaux en 1984, tiendra en septembre 2013 dans cette même ville, son congrès biennal qui sera accueilli par le laboratoire « Les Afriques dans le Monde » (CNRS, UMR 5115) de l'Université de Bordeaux. Cette associ... [Afficher la suite] L’Association pour l’Étude des Littératures Africaines (APELA), fondée à Bordeaux en 1984, tiendra en septembre 2013 dans cette même ville, son congrès biennal qui sera accueilli par le laboratoire « Les Afriques dans le Monde » (CNRS, UMR 5115) de l'Université de Bordeaux. Cette association internationale rassemble près de 150 chercheurs d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, unis par un même intérêt pour la question de la littérature et des textes en Afrique, au-delà des langues, des media (oral, écrit) et des époques.
La création africaine contemporaine, tant dans le domaine des arts de la scène que des arts plastiques, s’envisage aujourd’hui volontiers comme polymorphe, faisant voler en éclats les frontières génériques entre disciplines (études littéraires, artistiques et sciences humaines) et pratiques artistiques. Ce congrès voudrait faire dialoguer ces disciplines qui donnent chacune aux textes une place dans laquelle la littérature est toujours à réinventer. Nous souhaitons à cette occasion mettre en évidence la genèse et les modes de circulation du texte par l’interrogation des archives, la mise en scène des objets et des images, la création de narrations spécifiques à partir de ressources trop souvent négligées dans les études littéraires.
Tout un courant de l’anthropologie contemporaine étudie la constitution des textes et leur contribution à la création de corpus patrimoniaux ; les clivages dualistes du passage de l’oral à l’écrit cèdent face à des représentations du mélange des différents modes d’expression. Des thématiques centrales en sociologie politique telles que les capacités des acteurs locaux, l’articulation du local et du global, les dynamiques Sud-Sud et les façons d’entreprendre, sont ainsi interrogées à partir du nœud complexe qui relie archives, textes et performances, trois notions qui appartiennent à des univers différents mais dont la concaténation nous semble aujourd’hui porteuse de dynamiques originales et posséder une pertinence analytique nouvelle.
En couplant cette activité scientifique au projet artistique qui aura lieu au même moment (l’exposition du Musée Iwalewa de l’Université de Bayreuth dans quatre espaces d’exposition à Bordeaux), notre objectif est d’inciter la communauté scientifique, les étudiants et le grand public à prêter une attention particulière à la dimension historique et anthropologique des études littéraires, trop souvent occultée par la priorité accordée aux aspects strictement formels du texte écrit. Nous entendons ainsi élargir le champ d’action de notre association et tenir compte des croisements de plus en plus fréquents entre poètes, dramaturges et plasticiens, en tenant compte du fait que les études sur les textes, naguère relevant d’abord de la philologie, sont aujourd’hui le lieu d’une rencontre entre anthropologues, historiens, plasticiens, dramaturges, comédiens et évidemment écrivains.
La question de la textualité en Afrique, trop souvent envisagée d’un point vue strictement littéraire dans les études africanistes francophones, nous paraît mériter un nouvel examen. En effet, les actes concrets sous-jacents à la création ou la consécration des textes s’inscrivent dans la matérialité de lieux, de réseaux et de communautés spécifiques. Cette traçabilité du fait littéraire invite à penser les notions d'archive, de texte et de performance à la lumière des approches sociologique et anthropologique qui envisagent les textes comme des objets pris dans les dynamiques sociales et politiques propres aux sociétés dans lesquelles ils sont produits. L’étude approfondie de ce contexte complexe implique - pour une compréhension optimale des enjeux socio-politiques de la production artistique - la mise en œuvre d'une archéologie des discours qui habitent ou accompagnent les textes et les œuvres d’art.
Dans cette perspective, les archives constituent un ensemble textuel très riche souvent situé en amont de la recherche littéraire et de plus en plus souvent de la création artistique: de leur simple consultation à des fins documentaires à leur exploitation par des procédés de réappropriation artistique en passant par leur intégration dans un corpus primaire d'étude. L'intérêt grandissant pour les travaux de génétique textuelle et la multiplication des publications de fragments textuels « inédits » extraits des archives d'auteurs, nous conduisent à nous interroger sur le statut de l'archive : de son éventuelle mutation du matériau (source d’étude et matériau de création) au texte (objet d'étude en soi).
Des recherches sur la place de l'archive dans la constitution d'une mémoire collective et d'une littérature nationale en Afrique du Sud ont montré la dimension nécessairement politique de la constitution, la gestion, la conservation et l'usage de l'archive dans le contexte de l'apartheid (Carolyn Hamilton, Verne Harris, Jane Taylor, Michele Pickover, Graeme Reid & Razia Saleh, eds., Refiguring the Archive. Cape Town : David Philip, 2002, 368 p.).
Dans ce même volume, un article est consacré à l'analyse de l'archive comme source d'inspiration – et parfois support de création - des artistes contemporains comme en témoignent les nombreuses initiatives en ce sens, au cours des années 2000 : outre donc l’exposition de Johannesburg en 1999 (qui donna lieu à l’ouvrage susmentionné), « Congo Far-West » au Musée Royal d'Afrique Centrale de Tervuren en 2009 et en 2012-2013, « Distance and Desire : Encounters with the African Archive » au Walther Collection de New-York et Berlin et « C'est à ce prix que vous mangez du sucre » au Musée d'Aquitaine de Bordeaux.
Le recours aux archives coloniales par des artistes contemporains apporte un regard neuf sur la réappropriation d'un patrimoine commun sous la forme d’une mise en représentation publique, donc d’une performance. Elle peut aussi être comprise comme une forme de texte, au sens où l'entend Karin Barber pour qui la performance est toujours performance d'un texte, texte qui n'est lui-même qu'une citation d'un discours plus vaste qu'est la « tradition » (Karin Barber, « Text and Performance in Africa », Oral Tradition, 20 (2), pp. 264-277). L'archive d'une performance qui aurait fait l'objet d'une commande d'une organisation x, confère un éclairage nouveau à la création artistique en en exposant son contexte, la genèse et le cadre thématique voire idéologique de sa conception.
L'approche de la notion d'archive sera envisagée tant du point de vue de la pratique épistémologique que d'un point de vue plus conceptuel : l'archive comme texte, voire comme œuvre d'art d'un côté, et l'archive comme matériau de l'autre. Les contributions proposant des pistes de recherche sur les modalités de constitution des archives et leur usage par les chercheurs, à l'instar de la réflexion menée par Johannes Fabian dans son essai « méta-épistémologique » Ethnography as Commentary. Writing from the Virtual Archive (Durham & London: Duke University Press, 2008, 139 p.), seront les bienvenues. Les études de cas sur la recherche artistique menée à partir de l'archive ou sur les enjeux contemporains de la création et l'usage des archives de performances seront tout autant considérées.
Propositions d’ateliers :
- La peinture comme fiction narrative
- Le plasticien, le photographe et l’archive (la réappropriation des archives par les artistes plasticiens et photographes)
- Modalités et enjeux de la constitution d'archive sur l'Afrique (la question de l'archive virtuelle par exemple et la valorisation de l'archive par le l'édition critique)
- Le rapprochement entre archives et textes littéraires contemporains : l'archive comme intertexte ?
- Les archives d'écrivains : usage et pertinence
- L'archive : mémoire et nostalgie
- La place du texte dans le théâtre d’improvisation
- Spatialité du fait littéraire : ancrage des archives, mobilité des performances
- Performer l’archive
- La place de l’archive dans le processus d’élaboration du spectacle vivant
- Les archives de la vie quotidienne : le statut des « petites histoires » et témoignages divers qui prolifèrent sur la Toile
- La textualité de la mode
Les propositions de communication qui pourront être rédigées en français ou en anglais, devront comporter 1500 signes maximum et être adressées avant le 15 mars 2013 à :
- Alain Ricard : alainricard45@gmail.com
- Maëline Le Lay : m.le.lay@sciencespobordeaux.fr
Pour plus de renseignements sur l'APELA et le laboratoire LAM :
- site de l'APELA : http://www.apela.fr/
- site de LAM : http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/
--
UFR Lettres et langues
Ile du Saulcy
F - 57045 Metz cedex 1
http://www.apela.fr/
http://www.univ-metz.fr/recherche/labos/ecritures/
http://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN [Réduire] |
Du 16 Janvier au 06 Juin 2013 :
 |
Montpellier (France) - Salle Pétrarque Afin d'annoncer la Comédie du Livre, l'association Cœur de Livres propose au public un cycle de rencontres littéraires mensuelles autour des auteurs classiques du prochain pays mis à l'honneur lors de la manifestation. Ces rencontres sont l'occasion de se familiariser avec le patrimoine littéra... [Afficher la suite] Afin d'annoncer la Comédie du Livre, l'association Cœur de Livres propose au public un cycle de rencontres littéraires mensuelles autour des auteurs classiques du prochain pays mis à l'honneur lors de la manifestation. Ces rencontres sont l'occasion de se familiariser avec le patrimoine littéraire du pays invité et de découvrir ses auteurs classiques.
Pour le cycle 2013, ce sont donc certains des grands auteurs du Maghreb qui seront mis à l'honneur.
En partenariat avec l'IRIEC (Institut de Recherches et d'Etudes Culturelles), chaque rencontre donne lieu à un dialogue entre un romancier français en lien avec l'auteur classique mis en avant et un enseignant-chercheur de l'Université Paul Valéry.
En préambule de chaque rencontre, le public pourra trouver, dans les librairies partenaires de l'événement, une brochure d'une dizaine de pages présentant l'auteur classique mis à l'honneur et les différents auteurs présents lors de cette rencontre à travers leurs biographies, accompagnées d'une bibliographie exhaustive et de l'extrait d'une œuvre lu pendant la rencontre.
Afin d'être accessible au plus grand nombre, chaque rencontre est simultanément traduite en Langue des Signes mais également enregistrée par Radio Campus Montpellier, pour une diffusion sur leur antenne.
Le programme :
Jeudi 17 janvier : Isabelle Eberhardt avec Edmonde Charles-Roux
Jeudi 14 février : Kateb Yacine avec Kaoutar Harchi
Jeudi 14 mars : Driss Chraïbi avec Yann Venner
Jeudi 18 avril : Mohammed Khaïr-Eddine avec Jean-Paul Michel
Jeudi 16 mai : Ibn Khaldoun avec Albert Memmi
Vendredi 07 juin : Mohammed Dib (intervenants à confirmer)
Avec le soutien financier de la Ville de Montpellier et de la Région Languedoc-Roussillon [Réduire] |
Du 06 au 08 Novembre 2013 :
| |
Colloque international : Les Francophonies postcoloniales : textes, contextes Delhi (Inde) - Université Le Département d’études germaniques et romanes de l’Université de Delhi, Delhi, Inde, organise du 7 au 9 novembre 2013, un colloque international sur le thème Les Francophonies postcoloniales : textes, contextes.
Ce colloque a pour objet d’ouvrir le public indien aux littératures d’... [Afficher la suite] Le Département d’études germaniques et romanes de l’Université de Delhi, Delhi, Inde, organise du 7 au 9 novembre 2013, un colloque international sur le thème Les Francophonies postcoloniales : textes, contextes.
Ce colloque a pour objet d’ouvrir le public indien aux littératures d’expression française en provenance de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan indien qui se répercutent et se complètent à bien des égards dans la mesure elles donnent à penser ce que l’on pourrait nommer à la suite de l’anthropologue français Georges Balandier la « situation postcoloniale ».
Nous souhaitons lire ces nouvelles littératures traversées des croisements multiples, avec la puissance impériale comme avec la texture embrouillée des cultures et des histoires natives selon deux principales articulations; d’abord pour ce qu’elles disent d’elles-mêmes en tant que pratiques littéraires portant l’ancrage de leurs conditions sociales et littéraires ; mais aussi pour les débats théoriques et critiques dont elles ont fait l’objet depuis leur émergence et qui
aujourd’hui sont repris et retravaillés dans le cadre des travaux centrés sur le postcolonialisme.
Les communications se repartiront principalement selon quatre axes thématiques:
Ecrire en colonie/écrire la colonie
Ecriture littéraire et contextes politiques
Penser la France/vivre en France
Théoriser le postcolonial : quels enjeux pour l’enseignement et la recherche ?
Veuillez envoyer votre proposition de communication, accompagnée d’une biobibliographie 5 lignes maximum, au plus tard le 30 avril 2013 à l’adresse suivante : Kusumaggarwal@gmail.com
Comite scientifique
Justin K. Bisanswa, Université de Laval
Anthony Mangeon, Université Paul Valéry-Montpellier 3
Kusum Aggarwal, Université de Delhi [Réduire] Contact : Kusumaggarwal@gmail.com |
Du 23 au 25 Février 2013 :
| |
QUATRIEME EDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL KATEB YACINE VIE ET OEUVRE « KATEB YACINE ET LE MOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN » Guelma (Algérie) - Université Quoique dise la vieille espérance forçons les portes du doute.
Kateb Yacine, Soliloques.
Il y a un demi siècle que l’Algérie est indépendante. Une indépendance chèrement acquise, chèrement payée par les algériens. Le vingt-quatrième anniversaire de la mort de Kateb Yacine, et le quatr... [Afficher la suite] Quoique dise la vieille espérance forçons les portes du doute.
Kateb Yacine, Soliloques.
Il y a un demi siècle que l’Algérie est indépendante. Une indépendance chèrement acquise, chèrement payée par les algériens. Le vingt-quatrième anniversaire de la mort de Kateb Yacine, et le quatrième colloque international qui le commémore, coïncident avec cette date mémorable. Au-delà de l’aspect évènementiel, c’est une symbolique, forte, très forte, dans la marche de l’Algérie et de son élan vers l’universel.
Cette quatrième édition du colloque international, qu’organise l’Association de l’Action Culturelle et Touristique en collaboration avec le Département de Français de l’Université 8 mai 1945 de Guelma, et, s’inscrivant dans le contexte du cinquantenaire de notre indépendance, ne peut faire l’économie du rapport Kateb avec le mouvement de libération nationale. Rapport très étroit, lui qui, lycéen s’est trouvé dans les premières lignes pour revendiquer, le 8 mai 1945, la dignité de son peuple, et l’indépendance de sa patrie du joug coloniale ! Il fût prisonnier. Sa mère en est devenue folle. De l’engagement de Kateb aux luttes du peuple algérien, ce jour sanglant, il en a été un vivant témoin des crimes abominables que la France coloniale a perpétrés contre les femmes et les hommes de sa patrie. C’est là l’acte de naissance d’une prise de conscience de la noblesse de la cause de son peuple qui rejette la soumission et l’asservissement.
De cet évènement tragique, Kateb en sortira marqué, profondément marqué. Soliloques (1946), texte fondateur du jeune Kateb, doit sa matière à cette expérience tragique. Kateb l’écrivain est né ! Deux années plus tard, le 24 mai 1947, à Paris, la capitale de la France coloniale, le jeune Kateb prononce une conférence à la salle des Sociétés Savantes intitulée : Abdelkader et l’indépendance algérienne.
L’engagement, et la lutte de Kateb pour l’indépendance de l’Algérie sont portés, non seulement, par des idées politiques arrêtées. Il s’agit aussi d’un travail d’écriture que Nedjma, l’emblématique, publiée deux années après le déclenchement de la guerre de libération nationale, est en soit un acte dont la symbolique est très forte. Acte de guerre, cri déchirant d’un peuple opprimé surgissant du fin fond de la nuit coloniale !
Kateb Yacine, ce jeune écrivain, a réussi par la plume, par les lettres, à porter la parole d’un peuple, et fait parlé de son enracinement dans sa terre spoliée en se servant de cette arme redoutable : la langue française, dont il dira aux lendemains de l’indépendance, ce butin de guerre !
De 1945 à 1962, Kateb Yacine a écrit une quantité d’articles journalistiques. D’Alger républicain, à Forge, Simoun, Soleil, Terrasses, il a écrit sur l’Algérie, son peuple, ses souffrances et les atrocités du colonialisme. Sa seule détermination était une et unique : voire l’Algérie indépendante.
Cinquante ans après, l’Algérie indépendante rend hommage à Kateb Yacine, et, à travers lui, elle rend hommage aux Lettres algériennes.
Pour la quatrième fois, à Guelma, l’Association de l’Action Culturelle et Touristique, en partenariat avec le Département de Langue et Littérature Française de l’Université 8 mai 1945 de Guelma, appellent à collaborer, à contribuer à enrichir cette étape de la vie de Kateb.
Les organisateurs appellent les universitaires algériens ou étrangers à faire part de leurs recherches sur période de la vie de Kateb qui va de 1945 à 1962.
A cette fin, une fiche de renseignements est jointe à cet appel à renvoyer au coordinateur scientifique du colloque.
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Noms et prénoms…………………………………………………………………..
Grade………………………………………………………………………………….
Université/Laboratoire……………………………………………………………
Intitulé de la communication……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Résumé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A envoyer au coordinateur du colloque :
BELHASSEB MESSAOUD
E-mail : nacifnahla@yahoo.fr [Réduire] Contact : nacifnahla@yahoo.fr |
Du 15 au 16 Avril 2013 :
| |
L'Enseignement du Texte Littéraire à l’Université en Algérie. Réalité et perspectives./ Colloque international SETIF (ALGERIE) - Faculté des Langues et Lettres/UNIVERSITE SETIF 2 UNIVERSITE SETIF 2
Faculté des Langues et Lettres
Département de Langue et Littérature françaises
APPEL A COMMUNICATION
Colloque international
« L’Enseignement du Texte Littéraire à l’Université en Algérie. Réalité et perspectives. »
16 et 17 avril 2013
Argu... [Afficher la suite] UNIVERSITE SETIF 2
Faculté des Langues et Lettres
Département de Langue et Littérature françaises
APPEL A COMMUNICATION
Colloque international
« L’Enseignement du Texte Littéraire à l’Université en Algérie. Réalité et perspectives. »
16 et 17 avril 2013
Argumentaire
Le texte littéraire où se joue l’heureuse rencontre du plaisir et de la culture a suscité des réflexions qui ont mené à la grande diversité d’approches analytiques et didactiques tant pour parfaire sa lecture que sa pédagogie.
Objet vivant et palpable, et parce que doublement constitué : «en tant que discours, il est parole sur le monde ; par sa forme, il se donne à lire comme une réalité visuelle et sonore dont le pouvoir expressif va bien au-delà de la fonction référentielle» (Peytard, 1982), il est pris alors comme artéfact culturel, dans les deux sens de culture (la culture «cultivée » et la culture anthropologique) et se présente comme un lieu privilégie pour la rencontre avec l’Autre (Porcher, 1987), qu’il serait un outil incontournable dans l’éducation interculturelle des apprenants de la langue étrangère.
Or de nos jours, tous les biens fondés de la littérature se retrouvent «détournés», éloignés de leur objectif au profit d’un enseignement à peine initiatique et très loin des réels débats et analyses que mérite et nécessite un texte littéraire.
Le but de ce colloque appelle à la réflexion sur cette situation de l’enseignement du texte littéraire en déclin à l’université et dont les raisons sont certaines. Le constat le plus évident est le désarroi des enseignants confrontés à un auditoire d’apprenants démunis tant de la langue que de sa littérature, heurtés au problème majeur de la non maîtrise de l’outil d’expression auquel se rajoute la non motivation pour la lecture. Arrivés à l’université, de leur côté, ces apprenants découvrent un nouvel enseignement du texte littéraire, de nouvelles approches, ils sont de fait confrontés à leur tour à la difficulté de lire et d’écrire.
Cette situation doublement problématique nous interpelle en tant que didacticiens sur le déclin de l’enseignement de la littérature et nous interroge sur notre rôle et sur la finalité de notre mission : Que faire ? Comment faire ?
Pour orienter la réflexion quelques axes proposés :
• Que veut dire enseigner un texte littéraire de nos jours ?
• Quelle valeur et quelle importance de la littérature à l’ère des nouvelles technologies ?
• Comment justifier autrement la littérature comme objet d’enseignement et de recherche à l’université ?
• L’enseignement du texte littéraire dans ses réalités : des savoirs aux compétences et des compétences scientifiques aux compétences sociales.
• Le texte et la langue.
• Le texte littéraire et ses dimensions : esthétique, culturelle, interculturelle, idéologique…
Format des propositions :
Les propositions de communication (des résumés de 300 mots) accompagnées de mots clefs, quelques références bibliographiques et aussi des informations pratiques (nom, prénom, institution, adresse postale, téléphone et adresse électronique) doivent être envoyées avant le 20 Janvier 2013, à l’adresse suivante : boudjadja19@gmail.com
Principales échéances :
Date limite de la soumission des résumés : 20 janvier 2013
Réponse du comité scientifique : 05 février 2013
Date prévue pour le programme définitif : 10 avril 2013
Président d’honneur :
Pr Kheir GUECHI Recteur de SETIF 2
Président du colloque :
Dr Salah- Eddine ZARAL Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues
Coordinateur : Dr Mohamed BOUDJADJA
COMITE SCIENTIFIQUE :
Pr Hadj MILIANI Université de Mostaganem, ALGERIE
Pr Yamina Chafia BENMAYOUF Université Constantine I, ALGERIE
Pr Zoubida BELAGHOUEG Université Constantine I, ALGERIE
Pr Samir ABDELHAMID Université de Batna, ALGERIE
Pr Abdelouahab DAKHIA Université de Biskra, ALGERIE
Pr Fouzia BENDJELID Université d’Oran, ALGERIE
Pr Said KHADRAOUI Université de Batna, ALGERIE
Pr Marc GONTARD Université Rennes II, FRANCE
Pr Anne ROCHE Université Aix-Marseille I, FRANCE
Pr Martine MATHIEU JOB Université Bordeaux III, FRANCE
Pr Nacer IDRISSI Université Ibn ZOHR Agadir, MAROC
Dr Abdelghani BARA Université Sétif II, ALGERIE
Dr Fouzia REGGAD Université Sétif II, ALGERIE
Dr Chahrazed MOUDIR DAHER Université Sétif II, ALGERIE
Dr Mohamed BOUDJADJA Université Sétif II, ALGERIE
Dr Boubakeur BOUZIDI Université Sétif II, ALGERIE
COMITE D’ORGANISATION :
Dr Mohamed BOUDJADJA (SETIF 2)
M.AliBENSEMCHA (SETIF 2)
M. Kheireddine BECHMAR (SETIF 2)
M. Mustpha BOUREKHIS (SETIF 2)
Mme Souad BABA SACI (SETIF 2)
Mme Zahia HAMDI (SETIF 2)
Mme Salima RACHEDI (SETIF 2)
Mme Samira GUECHI (SETIF 2)
Responsable : Faculté des Lettres et des Langues, Université Sétif 2 /Algérie
Adresse : Faculté des Lettres et des Langues Sétif 2 ElHidhab, Sétif / Algérie [Réduire] |
Du 21 au 22 Avril 2013 :
| |
2èmeSéminaire International sur la Littérature Maghrébine d'Expression Française: STRATEGIES ET EXPERIENCE(S) SCRIPTURALES CHEZ Amine ZAOUI, Driss CHRAIBI & Rachid BOUDJEDRA Batna (Algérie) - Université de Batna L'un des objectifs de cette manifestation scientifique est de rendre compte des virtualités/virtuosités de la littérature Maghrébine d'Expression Française en s'interrogeant sur les techniques qu'elle met en œuvre et les éléments qui la constituent. Dès lors qu'est affirmé ce principe, la ... [Afficher la suite] L'un des objectifs de cette manifestation scientifique est de rendre compte des virtualités/virtuosités de la littérature Maghrébine d'Expression Française en s'interrogeant sur les techniques qu'elle met en œuvre et les éléments qui la constituent. Dès lors qu'est affirmé ce principe, la question des stratégies et expérience(s) scripturales, notamment au plan de la conscience linguistico-culturelle, des techniques romanesques, des signes et des genres s’avère problématique mais capable d’alimenter la recherche et d’animer des débats des plus prolifiques.
Il s'agit donc de développer une réflexion sur l'intertextualité, la
transculturalité, la polyphonie, l'identité littéraire, les registres et les techniques d'écriture, la démarcation stylistique et thématique, les espaces géographiques et culturels mouvants dont elle fait référence. De la sorte, s’approprier la langue française, la "maghrébiniser", ''la violer'', la ''transgresser'', la ''bouleverser'', lui ''tordre le cou'', l'innover'' et condamner sa dimension impératrice ne seraient- elles pas des stratégies scripturales et des procédés langagiers travaillés au-delà des régularités linguistiques ?
Cette réalité scripturale attestée par les spécialistes montre que les éléments du triptyque "Langue, Identité et Culture" se conjuguent, s’influencent et s'entrecroisent pour enfanter une littérature incontestablement originale. Prendre acte de ces indices, en expliciter les effets consiste à pointer la poétique et la textualité de la littérature maghrébine d'expression française. La question de la praxis langagière telle qu'elle est concrètement développée et réalisée au travers des techniques d'écriture novatrices nécessite arrêt et réflexion.
Entrer dans l'univers de la Littérature Maghrébine d'Expression Française c'est effectivement aller au-delà de l'usage de la langue pour s'ouvrir sur des « ailleurs » afin d'amorcer un regard critique et spécifique et, à terme, poser les jalons d’une anatomie de la Littérature Maghrébine d'Expression Française et même francophone. A cet effet, la lecture de l'œuvre romanesque de Chraïbi, de Boudjedra et de Zaoui autorise à affirmer que la langue est une condition nécessaire mais non suffisante de la compréhension. Conséquemment, nous approuvons : « qu’il n’existe pas d’usage linguistique sans croyance ou représentation, c’est à dire sans idées développées et organisées en système de références individuelles et/ou collectives ».
Par-delà la langue, voire du code langagier propre à la littérature en question, c'est donc tout un système de pensées, d'images et de représentations que les stratégies et expérience(s) interrogées dévoilent.
OBJECTIF DE LA MANIFESTATION
Au carrefour de l'interdisciplinarité, il parait fondamental de négocier la question des "stratégie et expérience(s) scripturales" en rapport avec l’altérité langagière liée au champ littéraire maghrébin d’expression française. L'objectif des débats et interventions attendus ne se rattacherait «pas seulement aux résultats et aux idées neuves qu’il (pourrait apporter), il se (mesurerait) aussi au nombre de problèmes qu’il (pourrait faire) naître, aux réflexions, voire aux objections qu’il (susciterait ) ».
AXES DU SÉMINAIRE
1- Modernité et éclatement des genres.
2- Subversion textuelle, Histoire et fiction.
3- Virtualités/ virtuosités et enjeux linguistiques.
4- Intertextualité, transculturalité, polyphonie et dialogisme.
5- Oralité et anthropologie.
SOUMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions de communications doivent se faire en document attaché Word et
envoyées à : seminaire.batna@gmail.com
Elles feront l’objet d’une évaluation anonyme.
CALENDRIER
Date limite de réception des propositions : 01 Mars 2013
Notification des propositions retenues : 15 Mars 2013
Date limite de réception des communications : 30 Mars 2013
PUBLICATION
La publication des actes du séminaire est prévue après sélection du comité
scientifique par la maison d'Éditions GUERFI
PRÉSIDENTS D’HONNEUR :
Pr. Tahar BENABID – Recteur de l’Université Hadj Lakhdar de Batna.
Pr. Abdesselam DIF – Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues.
PRÉSIDENTS DU SÉMINAIRE :
Pr. Saïd KHADRAOUI - Dr. Tarek BENZEROUAL
Président du comité scientifique du département de français:
Pr. Samir ABDELHAMID – Responsable EDAF- Antenne de Batna
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION :
Mr. Messaoud KAHLAT – Chef du département de français.
COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Pr. Samir ABDELHAMID – Université de Batna, Pr. Saïd KHADRAOUI - Université de Batna, Pr. Saddek AOUADI – Université d’Annaba, Pr. Gaouaou MANAA-Université de Batna, Pr. Driss ABLALI – Université de Lorraine –France, Pr. Foudil DAHOU – Université d’Ouargla, Pr. Bachir BENSALAH– Université de Biskra, Pr. Abdelouaheb DAKHIA - Université de Biskra, Pr. Farida BOUALIT- Université de Bejaia, Pr. Hadj MELIANI – Université de Mostaganem, Pr. Zoubida BELAGHOUEG – Université de Constantine, Pr. Ahmed CHENIKI – Université d'Annaba, Pr. Djamel KADIK – Université de Médéa, Dr. Med El Kamel BENZEROUAL - Université de Batna, Dr. Rachida SIMON – Université de Batna, Dr. Salah KHENNOUR - Université d’Ouargla, Dr. Rachid Dr. Mohamed BOUDJADJA - Université de Sétif, Dr. Boubakeur BOUZIDI –
Université de Sétif, Dr. Mourida AKAICHI. Université du Nord-Tunisie, Dr. Lakhdar KHARCHI-Université de M’sila.
COMITÉ D’ORGANISATION
Messaoud
Abdelkader Bouhidel- Université de Batna, ShirazAggoun - Université de Batna, Faten
Bentahar- Université de Batna, Radhia Aissi- Université de Batna, Amel Guetala -
Université de Batna, Samia Berkane - Université de Batna, Nassima Khandoudi -
Université de Batna, Redha Guerfi – Éditeur.
METATHA- Université de Batna, Dr. Tarek
RAISSI – Université d'Ouargla,
Kahlat- Université de Batna, Ammar
Zerguine- Université de Batna, [Réduire] |
Du 25 au 26 Avril 2013 :
| |
Les Valeurs éthiques et esthétiques dans la littérature et les arts Rabat (Maroc) - Ecole Normale Supérieure |
Du 23 au 25 Janvier 2014 :
| |
Colloque: Lire et faire lire Guelmime (Maroc) - Guelmime Appel à communication
La problématique de la lecture nous interpelle à maints égards au sein d’une société en mutation qui cherche encore sa voie/voix. Une association d’enseignants est indéniablement appelée à affronter cette question, à diagnostiquer l’état des lieux (aussi bien ... [Afficher la suite] Appel à communication
La problématique de la lecture nous interpelle à maints égards au sein d’une société en mutation qui cherche encore sa voie/voix. Une association d’enseignants est indéniablement appelée à affronter cette question, à diagnostiquer l’état des lieux (aussi bien au niveau des apprenants que de celui des professeurs), à s’interroger sur les méthodes et les corpus qui circulent, à suggérer des solutions… Le débat sur un sujet aussi épineux promet d’être houleux et nous l’espérons très constructif.
Nous suggérons à titre indicatif les axes suivants :
- Rapport à la lecture au Maroc
- Motivation à la lecture
- Lire: quand? Quoi? Comment? Pourquoi? Où?
- Articulation : lecture /écriture
Merci de faire parvenir vos propositions de communication (descriptif en ½ page et une notice bio-bibliographique) avant le 20 décembre 2013 à Abdellah Baïda : baidabdel@yahoo.fr
Le Comité scientifique donnera une réponse avant le 30 décembre2013. [Réduire] |
Du 02 au 04 Mars 2013 :
| |
Colloque international sur l’œuvre de Mouloud Mammeri De la Voix à la Lettre ou le dialogue des cultures : Du particulier à l’universel, du Même à l’Autre à travers Soi Tizi Ouzou (Algérie) - Maison de la culture/université Mouloud Mammeri La maison de la culture Mouloud Mammeri et l’université de Tizi Ouzou (Algérie) en partenariat avec la Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines (CICLIM) organisent un colloque international sur l’œuvre de Mouloud Mammeri.
L’œuvre de Mouloud Mammeri, q... [Afficher la suite] La maison de la culture Mouloud Mammeri et l’université de Tizi Ouzou (Algérie) en partenariat avec la Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines (CICLIM) organisent un colloque international sur l’œuvre de Mouloud Mammeri.
L’œuvre de Mouloud Mammeri, qui épouse des genres multiples (romans, nouvelles, pièces de théâtre, etc.), est tout à la fois spécifique et universelle ; elle se donne à lire comme une œuvre où s’inscrit en filigrane une éthique, celle de la tolérance et de la mutuelle compréhension, duelle et dialogale.
Préservatrice du Même/de Soi dans sa spécificité fondatrice et irréductible, elle n’est néanmoins jamais fermée sur elle-même, puisqu’ elle convoque l’Autre-que soi, qu’elle défend et accueille en frère, en semblable. L’auteur ne remarque-t-il pas dans La mort absurde des Aztèques que « quand une tribu australienne abdique par le fait d’une violence concrète ou symbolique, ce ne sont pas Les Maoris qui sont diminués, c’est l’humanité entière qui a subi une irréparable perte » ?
Puisant dans la culture orale dont elle se réclame, son œuvre n’en est pas moins célébration de l’Ecriture qu’elle cherche à induire et à ériger en modèle au travers des tentatives d’historicisation et de témoignage (carnets, journaux intimes, écrits épistolaires …)
Par l’abondante dynamique scripturale/épistolaire qui la parcourt (Lettre de Aazi, écrits épistolaires d’Arezki à Maître Poiré, échanges de lettres entre Ramdane et Bachir, lettres de ce dernier à Claude et à Itto, échange épistolaire qui clôt La Traversée, etc.) – signalons que Mammeri lui-même avait été le script de la Révolution - l’œuvre mammérienne semble être une invitation infinie au dialogue et aux échanges.
- Quelle est la place de cette double écriture/mise en abyme et sa fonction dans la conception de Mammeri ?
- Quelles significations pourrait-on donner à cette épistolarité récurrente ?
- En quoi cette épistolarité est-elle fondatrice de la conception mammérienne d’induire des mutations épistémologiques ?
- En quoi ces "ateliers" d’écritures sont-ils inducteurs de la nécessité de maintenir ouvert le lien entre l’univers de la parole et celui de l’écriture ?
En filigrane de ce questionnement se profilent trois axes de recherche qui peuvent être résumés comme suit :
1) Mammeri recourt au Même pour défendre l’Autre qui par là même contribue à la constitution du Même.
2) c’est en défenseur de l’oralité que Mammeri convoque l’écriture. Cette position qui peut paraître paradoxale semble constante dans son œuvre. Il s’agira d’étudier le rapport entre la Voix et la Lettre dans l’œuvre de Mammeri et de son impact sur l’entreprise littéraire de l’écrivain, sur ses recherches anthropologiques et sur ses écrits journalistiques et épistolaires.
3) c’est justement à ce dernier type discursif comme mise en abyme que sera consacré le dernier axe. Il sera question de l’étude de cette particularité mammérienne et de ses causes. En effet, il s’agira d’interroger cette constante convocation de l’écrit épistolaire dans l’œuvre littéraire.
Dates importantes
Les propositions de communication doivent parvenir à l’adresse suivante boualili99@gmail.com au plus tard le 10 février 2013.
L’avis du comité scientifique sera signifié le 20 février 2013.
Le programme sera publié le 28 février 2013.
Le colloque aura lieu les 3, 4 et 5 mars 2013 conjointement à la maison de la culture Mouloud Mammeri et à l’université de Tizi Ouzou.
Les articles définitifs doivent nous parvenir pour publication au plus tard le 30 mars 2013.
Comité scientifique
Charles Bonn, CICLIM/université de Lyon 2.
Yasmine Abbès-Kara, ENS de Bouzaréah.
Malika Kebbas, université de Blida.
Yamilé Heraoui-Ghebalou, université d’Alger 2.
Touriya Fili-Toulon, CICLIM/université Lyon 2.
Fatima Boukhelou, université de Tizi Ouzou.
Ahmed Boualili, CICLIM/université de Tizi Ouzou.
Comité d’organisation
Le staff de la maison de la culture
Lila Abdesselam, université de Tizi Ouzou.
Fatima Boukhelou, université de Tizi Ouzou.
Ahmed Boualili, CICLIM/université de Tizi Ouzou.
Mounir Ahmed Tayeb, université de Tizi Ouzou.
A retenir
Les actes du colloque seront publiés par la faculté des lettres et langues de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Les consignes de rédaction seront communiquées ultérieurement.
La langue de communication retenue est le français en raison de soucis logistiques (traduction simultanée notamment). [Réduire] |
Le 07 Decembre 2012 :
 |
Les printemps arabes, qu'en reste-t-il? Paris (France) - Université Paris VIII « Ce qui s’est appelé printemps arabe « a dégagé » le mot de sa dimension saisonnière pour le faire toucher à ce
qui s’est joué, se joue encore, comme un imprévisible, comme ce qu’on n’a pas vu venir, qu’on n’a pas pu prévoir.
Inouï, imprévisible et pourtant inévitable qu... [Afficher la suite] « Ce qui s’est appelé printemps arabe « a dégagé » le mot de sa dimension saisonnière pour le faire toucher à ce
qui s’est joué, se joue encore, comme un imprévisible, comme ce qu’on n’a pas vu venir, qu’on n’a pas pu prévoir.
Inouï, imprévisible et pourtant inévitable quand ça advient.
« Soudain la révolution », le titre de Fethi Benslama, pourrait être celui de cette saison des pays arabes de la zone
méditerranéenne.
Comme un feu, celui qu’allume de son corps Mohamed Bouazizi, comme un séisme, le printemps des peuples
gagne et fait bouger les séparations. La peur change de bord. Les peuples ne supportent plus, ils impulsent un
sens à leur histoire. Et la violence, subie comme un destin, jusqu’à son extrême, n’est plus inscrite dans le cycle
des ans.
Le printemps gagnerait-il d’autres lieux ? Deviendrait-il le nom de ce qu’il advient en d’autres lieux, sous d’autres
formes?
Le séisme est à l’oeuvre, comme métaphore, comme suite du phénomène naturel, en Haïti, au Japon… Ebranlements
en échos qui courent autour de la terre. Et maintenant ? Est-ce une nouvelle saison, qui inverserait le sens des
violences qui avaient été la marque des mondes du Sud ? Sur les rives Sud et Est de la Méditerranée et plus loin,
dans le monde arabe, quelles annonces et quelles perspectives ?
Le printemps comme séisme, est-ce l’annonce d’un autre temps ?
Nous sommes à l’un de ces moments où « ça bouge », partout dans le monde. Le printemps, qui peut être
automne des révolutions pour certains, ouvre les perspectives de l’inouï, de ce qu’il faut « absolument » inventer.
Nous proposons de réfléchir autour des notions de printemps et de séisme comme changements inattendus, sur
les situations actuelles et sur d’autres.
• BAYARD, Pierre: Ouverture de la journée
• ALI-BENALI, Zineb: Introduction
• MESTIRI, Soumaya Mestiri: Genre et post-révolution
• KADRI, Aissa: Et l’Algérie ?
• ALI-BENALI, Zineb : De l’image furtive au cri sur la place publique. Femmes « arabes » par temps extrêmes.
• M. Mohammed : C’est ça l’histoire
• BEKRI, Tahar: Le poète et le printemps, Je te nomme Tunisie [Réduire] |
Du 03 au 05 Avril 2013 :
| |
La poétique du plurilinguisme Budapest (Hongrie) - Université Eötvös Loránd Le colloque se concentre sur les principes de création poétiques, métriques et linguistiques des textes bilingues et multilingues. Son but est la présentation de l’interaction des traditions métriques et poétiques différentes, avec leurs contraintes spécifiques, et la façon dont les texte... [Afficher la suite] Le colloque se concentre sur les principes de création poétiques, métriques et linguistiques des textes bilingues et multilingues. Son but est la présentation de l’interaction des traditions métriques et poétiques différentes, avec leurs contraintes spécifiques, et la façon dont les textes plurilingues appliquent les ou s’opposent aux règles de composition traditionnelles.
Les sujets à traiter incluent, mais ne sont pas limités aux suivants :
 plurilinguisme et la naissance des langues vernaculaires
 alternance de code dans les textes plurilingues
 imitation métrique, rythmique et poétique dans les poèmes plurilingues
 classification générique des textes plurilingues dans les traités de poétique
 plurilinguisme et musique polyphonique
 plurilinguisme et glossolalie
 adoption d’usages poétiques étrangers par l’intégration des langues étrangères
 performance orale et lecture à haute voix des textes plurilingues
 plurilinguisme et style formulaire
 plurilinguisme en tant que contrainte formelle : l’Oulipo et la pluralité des langages
Nous attendons des propositions concernant toutes les langues et périodes littéraires ; néanmoins une attention particulière sera tournée vers les littératures européennes du Moyen Âge et de la Renaissance et vers l’époque contemporaine.
Conférenciers invités:
Jacqueline Cerquiglini-Toulet (Université de Paris-Sorbonne)
Jacques Roubaud (Oulipo)
Iván Horváth (Université Eötvös Loránd, Budapest)
Dominique Billy (Université de Toulouse – Le Mirail)
Les résumés sont attendus pour des présentations de 40 minutes suivies d’un débat de 10 minutes. Nous prions les intéressés d’envoyer leurs résumés d’une page (avec références) sous format .doc et .pdf à l’adresse poeticsofmultilingualism@gmail.com avant le 31 Décembre 2012.
Date limite des candidatures à participation: 31 Décembre 2012
Notification of acceptance: 30 Janvier 2013
Date limite d’enregistrement: 15 Février 2013.
-
Pas de frais de participation
-
Comité d’organisation: Levente Seláf (Université Eötvös Loránd, Budapest, courriel : selaf.levente[at]btk.elte.hu) et Patrizia Noel (Otto Friedrich-Universität, Bamberg, courriel : patrizia.noel[at]uni-bamberg.de)
Site web du colloque :
http://www.uni-bamberg.de/germ-ling1/the-poetics-of-multilingualism-la-poetique-du-plurilinguisme/. [Réduire] |
Du 23 Novembre 2012 au 24 Janvier 2013 :
 |
Prix Universitaire de Narration en langue française Naples (Italie) - Université de Naples L'Orientale Bonjour!
Mme Giovannella Fusco Girard, professeur de Littérature française à l'Université de Naples "L'Orientale" en Italie vous signale la 3e édition du Prix de Narration « Napoli racconta Naples raconte » en langue française, organisé en 3 sections : écrivains français, franc... [Afficher la suite] Bonjour!
Mme Giovannella Fusco Girard, professeur de Littérature française à l'Université de Naples "L'Orientale" en Italie vous signale la 3e édition du Prix de Narration « Napoli racconta Naples raconte » en langue française, organisé en 3 sections : écrivains français, francophones ou ayant le français comme langue d'adoption ou de choix. En vous envoyant l'avis de concours, elle vous prie de le diffuser le plus possible et d'encourager la participation des écrivains.
Les 2 éditions précédentes ont connu un bon succès international avec la participation d'écrivains français, suisses, belges, tunisiens, libanais, marocains, bulgares, haïtiens, portugais, , tchadiens, chinois, israéliens, canadiens, du Mali, de la Nouvelle Calédonie, . Les récits ont été étudiés et analysés dans le Cours de Littérature moderne et contemporaine, traduits en italien par les étudiants du Master , sous la direction de Mme Fusco Girard, soumis à un jury mixte de professeurs universitaires et d’étudiants et ensuite publiés. Pour les lauréats il est prévu un prix en argent qui sera remis au cours d'une cérémonie officielle, encouragée et soutenue par les Ambassades des Pays concernés.
Toutes les informations nécessaires pour la participation sont dans l'avis de concours joint à cette lettre.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ultérieur.
En vous remerciant pour votre attention, nous vous prions d'agréer nos salutations les plus distinguées.
Emilia Surmonte
Sarah Pinto
collaboratrices de la Chaire de Littérature française
Université de Naples "L'Orientale"
Mél : napoliracconta@unior.it
Contact
Mme Giovannella Fusco Girard
professeur de Littérature Française
Université de Naples "L'Orientale"
Palazzo Santa Maria Porta Coeli,
via Duomo n. 219 stanza n. 315
tél: 0039 3474777685
mél: giofuscogirard@unior.it [Réduire] |
Le 23 Novembre 2012 :
| |
Dijon (France) - Théâtre Dijon Bourgogne, Centre dramatique national Un montage de textes inédits de Kateb Yacine
mise en scène Kheireddine Lardjam
SALLE JACQUES FORNIER
sam 24 novembre à 17h
1h10
dans le cadre du festival Nuits d'Orient |
Du 20 au 23 Novembre 2012 :
| |
Les littératures du Maghreb et d’Afrique subsaharienne : lectures croisées Aachen (Allemagne) - RWTH Aachen Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH),
Aachen/Aix-la-Chapelle, 21-24 novembre 2012
Internationaler Kongress
Les littératures du Maghreb et d’Afrique subsaharienne :
Lectures croisées
organisé par
Anne Begenat-Neuschäfer (RWTH, Aix-la-Chapelle),
Khalid Zekri (Universit�... [Afficher la suite] Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH),
Aachen/Aix-la-Chapelle, 21-24 novembre 2012
Internationaler Kongress
Les littératures du Maghreb et d’Afrique subsaharienne :
Lectures croisées
organisé par
Anne Begenat-Neuschäfer (RWTH, Aix-la-Chapelle),
Khalid Zekri (Université Moulay Ismaïl, Meknès, Maroc),
Tânia Celestino Macedo (Universidade de São Paulo, Brésil)
Daniel Delas (U. Cergy-Pontoise, France)
Programme
Mercredi 21 novembre (salle de conférence à la maison des invités, Melatener Str. 31)
9:30 h : Accueil des participants
10:00 h : Ouverture officielle
Prof. Dr. Will Spijkers, doyen de la faculté des lettres ;
Prof. Dr. Helmut Siepmann, Deutsche Gesellschaft für die Afrikanischen Staaten Portugiesischer Sprache (DASP) ;
Dr. Luís de Almeida Sampaio, l’ambassadeur de Portugal ;
Michel Giacobbi, Consul Général de France ;
Fernando Tati, attaché de l’Ambassade d’Angola ;
11:30 – 12:30 h : Allocution d‘ouverture par
Anne Begenat-Neuschäfer, Khalid Zekri, Tania Macêdo, Daniel Delas
Pause déjeuner
Début des conférences :
Subjectivités postcoloniales
14:30 – 16:30 h : Modérateur : Anouar Ouyachchi
Daniel Delas, Fanon : engagement et croisement de cultures ;
Kahina Bouanane, L’esthétique des lectures croisées à travers des romans
algériens d’expression française ;
- Débat –
Pause café
17:00 – 19:00 h : Modératrice : Salima Khattari
Maria Benedita Basto, Pages, images, paysages (propices) : cinéma et littérature chez
Ruy Duarte de Carvalho et Ondjaki ;
Rachid Benlabbah, Le corps autre, diabolisé ou transfiguré dans l’œuvre littéraire
africaine ;
Flavio Quintale, José Craveirinha : de La Fontaine à luta de classes ;
- Débat -
Jeudi 22 novembre (salle de conférence à la maison des invités, Melatener Str. 31)
Postures
09:00 – 11:00 h : Modérateur : Helmut Siepmann
Ineke Phaf-Rheinberger, Uma « modernidade a longo prazo » e as linhas de espuma na
literatura lusófona da Costa Oeste da África ;
Chantal Zabus, Devoirs de violence transsahariens : guérillas linguistiques et
manipulations langagières dans le roman d’expression anglaise, française
et arabe ;
Khalid Zekri, Penser la langue : Maghreb/Afrique subsaharienne;
- Débat -
Pause café
11:30 – 13:30 h : Modérateur : Khalid Zekri
Fouad Laroui, Peut-on vraiment lire un auteur du Maghreb ? ;
Helmut Siepmann, Paralleles Erzählen – Zur Erzählsituation bei Boualem Sansal und
Agualusa
- Débat -
Petite pause déjeuner
14:30 – 15:15 h : Visite guidée de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle
15:30 – 17:30 h : Modératrice : Susanne Gehrmann
Antonio Dimas, Primeiro Congreso dos Africanistas em Paris 1956 ;
Anouar Ouyachchi, Ecrire la mémoire au Maghreb et en Afrique subsaharienne ;
- Débat -
Pause café
18:00 – 19:00 h : Table ronde
Modératrice : Anne Begenat-Neuschäfer
Nina Bücker, présentation de sa thèse : La condition noire en France: conflits
identitaires des jeunes nés de l’immigration négro-africaine ;
Anne-Catherine Luther, présentation de sa thèse par Anne Begenat-Neuschäfer: Vues
sur les positions féministes actuelles: L’exemple de Werewere-Liking.
Vendredi 23 novembre (salle de conférence à la maison des invités, Melatener Str. 31)
Lectures
09:00 – 11:00 h : Modératrice : Anne Begenat-Neuschäfer
Susanne Gehrmann, Approche comparative des écritures autobiographiques
sérielles : Ken Bugul et Assia Djebar ;
Tania Celestino Macêdo, Luanda: Literatura e História de Angola;
Hervé Sanson, Du témoin littéraire : M. Dib et A. Kourouma ;
- Débat -
Pause café
11:30 – 13:00 h : Modérateur : Daniel Delas
Selma Pantoja : Les récits sur la reine Nzinga : entre l'Histoire et la Littérature ;
Salima Khattari, L’image de l’Autre dans l’écriture de Fouad Laroui et Alain Mabanckou ;
Mohammed Ourasse, Le rire littéraire : Fouad Laroui et Alain Mabanckou ;
- Débat -
Pause déjeuner
15:00 – 17:00 h : Table ronde
Modératrice : Tania Celestino Macêdo
Aziza Lounis, présentation de sa thèse : Jean Mouhoub Amrouche – Pour une théorie de la décolonisation. Réflexions sur l’image de soi et portraits du colonisé et du colonisateur;
- Débat -
Samedi 24 novembre (salle de conférence à la maison des invités, Melatener Str. 31)
09:00 – 10:30 h : Modératrice : Ana Mafalda Leite
Martin Neumann, La perspective de l’enfant: Stratégies subversives de
critique sociale dans le roman angolais contemporain (Manual Rui, Ondjaki) ;
Anne Begenat-Neuschäfer, Figuras femininas de passagem nas literaturas africanas;
- Débat -
Pause café
11:30 – 13:00 h : Modérateur : Jean-Marie Kouakou
Ana Mafalda Leite, Reescrever a História para repensar a Nação;
Meriem Elbouami, Enjeux de mémoire afro-arabe ;
Julie Peghini et Walid Mtimet, La problématique des regards croisés
sur les cultures pour une université populaire en Tunisie ;
- Débat -
13:00 – 13:30 h : UNILAB
Selma Pantoja : Petite présentation d’UNILAB
Kurt Schetelig (Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie der RWTH Aachen)
14 :00 : Conclusion du colloque [Réduire] |
Le 21 Novembre 2012 :
| |
LE GENRE ET LES DOMINATIONS POSTCOLONIALES, LES IMPENSES DU SAVOIR MAJORITAIRE EN FRANCE PARIS (FRANCE) - UNIVERSITE PARIS8 SAINT-DENIS Journée d'étude sur le genre et les dominations postcoloniales, donner la parole aux oubli(e)s du savoir majoritaire en France. Programme assez intéressant avec des interventions pointues sur des thématiques d'actualité. |
Le 12 Mars 2013 :
| |
L'auteur et ses personnages au miroir de la littérature mondiale RENNES (FRANCE) - Université Rennes 2 Groupe Φ, CELLAM EA 3206, Université Rennes 2
13 mars 2013
L’auteur et ses personnages au miroir de la littérature mondiale
La question de l’auteur, de son statut et de ses représentations, longuement discutée par la critique littéraire du XXe siècle, demeure au cœur d... [Afficher la suite] Groupe Φ, CELLAM EA 3206, Université Rennes 2
13 mars 2013
L’auteur et ses personnages au miroir de la littérature mondiale
La question de l’auteur, de son statut et de ses représentations, longuement discutée par la critique littéraire du XXe siècle, demeure au cœur des réflexions sur la littérature et ses enjeux dans la période contemporaine : en témoignent, ces dernières années, non seulement le renouveau des approches sur la notion d’auteur mais aussi – et surtout – les œuvres littéraires elles-mêmes en quête de nouvelles formes de représentation de l’auteur. Déclaré « mort » pour l’interprétation des textes, l’auteur reste pourtant incontournable dans le système de promotion des livres, engagé dans la construction d’une « posture » (Meizoz) ou d’une « scénographie auctoriale » (Maingueneau, Diaz) dans le champ littéraire jusque dans la fiction narrative. Au fur et à mesure que l’analyse des figures publiques de l’auteur se précise, en prenant alors la mesure des représentations imaginaires qui les imprègnent, se multiplient en effet les récits qui mettent en scène des personnages d’écrivain, telles les fictions d’auteur, les fictions biographiques, les autofictions, entre autres, pour mieux interroger les ambiguïtés de l’auteur contemporain.
L’étude des postures auctoriales et celle des représentations fictionnelles de l’auteur ont connu un fort développement dans le domaine des littératures européennes et américaines. De leur côté, les études sur les littératures dites postcoloniales se sont appuyées sur la notion de « scénographie » pour cerner la manière dont les écrivains élaborent dans l’œuvre un lieu d’énonciation et se forgent ainsi une place dans le champ littéraire (Moura). La présence de personnages d’écrivain dans les romans est là aussi de plus en plus fréquente, comme Lydie Moudileno l’a étudié dans le roman antillais, signe d’une profonde réflexion sur le statut d’auteur, sans doute catalysée par des manifestes tel le fameux « Pour une littérature-monde en français ».
Cette journée entend articuler ensemble ces perspectives d’analyse afin d’ouvrir l’étude des représentations de l’auteur, tant dans ses postures que dans ses mises en scène littéraires, à la littérature-monde. Il s’agira de se demander si un rapprochement des stratégies auctoriales des littératures européennes et américaines contemporaines et des littératures postcoloniales est éclairant et dans quelle mesure les créations littéraires s’entrecroisent dans leur recherche de formes pour s’affronter à la question de l’auteur, que la réflexion sur la force et la vertu de la littérature face à l’histoire immédiate rend d’autant plus aiguë. Par exemple, les jeux postmodernes sur la figuration de l’auteur traversent-ils l’ensemble des littératures contemporaines ? Les scénographies postcoloniales construites par les œuvres s’inscrivent-elles en rupture des autres scénographies auctoriales ? Leurs enjeux doivent-ils être distingués ou retrouve-t-on des dynamiques communes dans l’appréhension de l’identité, de la réalité contemporaine et du champ littéraire ? En quoi les formes narratives hybrides qui se multiplient ces dernières décennies, jouant de la frontière entre fiction et réalité, interrogent-elles les postures auctoriales et permettent-elles aux écrivains d’affronter les contradictions auxquelles ils font face ?
Bibliographie
BOUJU Emmanuel (dir.), L’Autorité en littérature, Rennes, PUR, coll. Interférences, 2010.
DIAZ José-Luis, L’écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Honoré Champion, 2007.
MAINGUENEAU Dominique, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin (collection U), 2004.
MEIZOZ Jérome, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine Érudition, 2007.
-La fabrique des singularités. Postures littéraires II, Genève, Slatkine Érudition, 2011.
MOUDILENO Lydie, L’écrivain antillais au miroir de sa littérature : mises en scène et mise en abyme du roman antillais, Paris, Éditions Karthala, 1997.
-Parades postcoloniales : la fabrication des identités dans le roman congolais, Paris, Éditions Karthala, 2006.
MOURA Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Presses universitaires de France, « Écritures francophones », 1999.
PLUVINET Charline, Fictions en quête d’auteur, Presses universitaires de Rennes, « Interférences », 2012.
Les propositions (un titre et un résumé, d’une page maximum, accompagnés d’une notice bio-bibliographique) devront être envoyées, avant le 17 décembre 2012, à yolaine.parisot@free.fr et à charlinepluvinet@yahoo.fr
Calendrier
Date limite pour l’envoi des propositions : 17 décembre 2012
Réponse des organisateurs : 11 janvier 2013
Journée d’étude : 13 mars 2013
Coordination : Yolaine Parisot, Charline Pluvinet.
Comité scientifique : Emmanuel Bouju, Yolaine Parisot, Charline Pluvinet. [Réduire] |
Du 29 au 30 Novembre 2012 :
| |
Interprétations postcoloniales des littératures mondiales Nanterre (France) - Université colloque international
30 novembre / 1 décembre 2012
bât V, salle R14
Colloque organisé dans le cadre du pôle Tout-Monde / projet « Postcolonial et transculturalité ».
Le projet « Postcolonial et transculturalité » se propose dʼenquêter sur les relations entre les cultures, l... [Afficher la suite] colloque international
30 novembre / 1 décembre 2012
bât V, salle R14
Colloque organisé dans le cadre du pôle Tout-Monde / projet « Postcolonial et transculturalité ».
Le projet « Postcolonial et transculturalité » se propose dʼenquêter sur les relations entre les cultures, les
littératures et les langues à travers le prisme des notions de « postcolonial » et « transculturel ». Deux notions
qui proposent un nouveau récit sur lʼhistoire, lʼhomme, le monde et ses géographies (politiques, sociales et
culturelles), nous obligeant à repenser nos catégories et nos méthodes dʼanalyse.
INTERPRÉTATIONS
POSTCOLONIALES
DES LITTÉRATURES
MONDIALES
Avec le soutien des unités de recherches : Etudes Romanes / EA 369 (CRIIA Centre de recherches ibériques
et hispano-américaines, CRILUS Centre de recherches lusophones, CRIX Centre de recherches italiennes),
Centre des sciences de la littérature française / EA 1586, CEREG Centre d'études et de recherches sur
l'espace germanophone.
VENDREDI 30 NOVEMBRE
9h00 / salle R14
Ouverture des travaux
Silvia CONTARINI, coordinatrice du projet « Postcolonial et transculturalité »
9h30-12h45 / salle R14
président de séance Silvia Contarini
Ferial J. GHAZOUL (Université du Caire)
Postcolonial Shakespeare
Yves CLAVARON (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)
Études postcoloniales et littérature comparée
pause
Sergia ADAMO (Université de Trieste)
Postcolonial Positions : Italian Frames
Mónica QUIJANO (UNAM Université Nationale de Mexique)
Modernité/Colonisation/décolonisation : les théories postcoloniales en Amérique latine
Roberto VECCHI (Université de Bologne)
Countries of the future, empires of the past : luso-tropical geographies
of the Portuguese colonial desire
débat
déjeuner
14h30-17h30 / salle R14
président de séance Françoise Aubès
Myriam GEISER (CIELAM Université Aix-Marseille)
Approche postcoloniale des littératures germanophones de la migration
Alessandro PORTELLI (Université La Sapienza)
Expressions of multicultural Italy : the rise of African-Italikan literature
and the presence of migrant music
pause
Dirk GÖTTSCHE (Université de Nottingham)
Postcolonialism in a German Context : Postcolonial Memory, Postcolonial Literature,
Postcolonial Studies
Crystel PINCONNAT (Université d’Aix-Marseille)
Penser les ethnic literatures en contexte francophone
débat
SAMEDI 1 DÉCEMBRE
9h30-12h45 / salle R14
président de séance Idelette Muzart Fonseca dos Santos
Gonzalo PORTOCARRERO (PUCP, Université Catholique du Pérou)
Le rejet du métissage comme prémisse de nouvelles rencontres culturelles
Omar Ribeiro THOMAZ (UNICAMP, Université de Campinas)
Deux petites filles blanches : mémoires coloniales
Christine MEYER (Université d’Amiens)
Les adaptations shakespeariennes de Feridun Zaimoglu,
ou le positionnement paradoxal d’un écrivain d’origine turque
dans le contexte littéraire allemand
pause
Véronique PORRA (Université Johannes Gutenberg, Mayence)
La posture postcoloniale des auteurs de langue francaise au XXI siècle
Jean-Marc MOURA (Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
Institut Universitaire de France),
Entre études postcoloniales et travaux sur la mondialisation :
les « Oceanic studies »
débat
déjeuner
14h30-16h30 / salle R14
TABLE RONDE
animée par Lucia Quaquarelli et Katja Schubert
avec
Françoise Aubès
Silvia Contarini
Jean-Marc Moura
Isabelle Muzart Fonseca dos Santos
et tous les intervenants au colloque
RER / Ligne A (St-Germain-en-Laye) : Nanterre Université
SNCF / gare Saint Lazare : Nanterre Université
VOITURE / bld circulaire de la Défense, dir. Nanterre (1ère sortie), droite, sortie Nanterre Université
INTERPRÉTATIONS POSTCOLONIALES
DES LITTÉRATURES MONDIALES
30 NOVEMBRE / 1 DÉCEMBRE, UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
200, avenue de la République, 92001 Nanterre
bâtiment V / salle R14
> COMITÉ SCIENTIFIQUE Françoise Aubès
Silvia Contarini
Jean-Marc Moura
Idelette Muzart Fonseca dos Santos
Lucia Quaquarelli
Katja Schubert [Réduire] |
Du 28 au 30 Mai 2013 :
 |
Terre d'exils, terres d'accueil: identités Santana (Brésil) - Université Exodes, fuites, immigrations, déplacements sont mouvements inhérents à l’histoire de l’humanité. En fait, qu’il s’agisse de l’exode biblique ou de celle de la diaspora africaine dont la narration invite à un nécessaire regard attentif, ces déplacements hors d’un territoire d’ori... [Afficher la suite] Exodes, fuites, immigrations, déplacements sont mouvements inhérents à l’histoire de l’humanité. En fait, qu’il s’agisse de l’exode biblique ou de celle de la diaspora africaine dont la narration invite à un nécessaire regard attentif, ces déplacements hors d’un territoire d’origine, d’un terroir reconnu en tant que lieu de la tradition, espace familier, restent des mouvements qui impliquent toujours, et de manière tragique, la perte des références affectives et culturelles les plus chères.
En effet, des foules sont poussées à abandonner leur foyer, leur terre natale et sont contraintes à affronter l’inconnu, partant, souvent, sans aucune garantie d’un futur meilleur, sans la certitude de recevoir l’hospitalité sur la terre d’accueil, ni même l’assurance qu’il soit possible d’arriver dans un lieu sûr. Il suffit que nous nous rappelions tout d’abord l’errance du peuple élu de Dieu dans la Bible. Nous avons également en mémoire ces déplacements de populations qu’ont provoqués l’esclavage ou les génocides. Nous assistons enfin de nos jours à ces mouvements de dispersion de centaines d’exilés qui fuient la terreur imposée par des milices armées dans différentes régions d’Afrique ou du Moyen Orient (Mali, Soudan, Rwanda, Lybie, Syrie…), ou même à l’intérieur de ce qu’on nomme le « premier monde ».
Enfin, pour des raisons les plus diverses, une partie de l’humanité migre, par terre, mer ou air, laissant derrière elle souvenirs et sentiments, biens et possessions. Des milliers d’individus partent à la recherche d’espaces nouveaux où ils peuvent reconstruire leurs histoires personnelles et collectives.
Bien sûr que nous savons qu’un autre grand contingent – visiblement hybride, car désireux d’intégrer l’extraterritorialité – refusant toute idée de frontière, adhérant, à la façon du caméléon, aux lieux et aux circonstances, se sentant toujours chez lui, bouge lui aussi, se déplaçant entre des mondes différents. Bien que nous n’ignorions pas ce fait, notre plus grand intérêt va pour les migrations dans lesquelles de grands contingents humains, parce qu’ils vivent dans des conditions inhumaines, cherchent à traverser les frontières, fuyant leur terre natale provisoirement perçue comme dystopie.
Aussi, l’errance qui nous intéresse est celle éprouvée et vécue par ceux qui sont amenés à abandonner les balises des traditions et qui vont entrer dans ce terrain mouvant, mûris par l’inconnu, l’inattendu, l’imprévu qui sont tant représentés dans la notion d’exil. Ainsi, nous l’avons compris, l’exil est cette circulation involontaire qui pousse un individu à plier sous le poids d’un passé récent, mais un passé qui semble toujours déraper, devenant trop fluide, puisque les anciennes certitudes deviennent ténues et que les souvenirs des visages aimés paraissent se défaire .
Une fois perdus les liens d’appartenance ou de solidarité, l’ancien territoire berceau de la sécurité et de l’hospitalité devient distopique, donc inhospitalier. Dès lors, le besoin de se rechercher une nouvelle utopie pousse à partir, à laisser derrière soi un passé chargé de valeurs affectives et culturelles. Commence ainsi la recherche d’une terre promise, d’une terre d’asile, d’une terre d’accueil, d’une terre des possibles, où l’on puisse reconstruire la vie, la famille, une identité, une nouvelle communauté, des nouvelles traditions, tout en ré-élaborant le passé, en reconstruisant les rites et les rêves.
Comment concilier les anciennes traditions apportées d’une terre d’exil avec celles trouvées dans les terres d’accueil ? Quelles valeurs garder et perpétuer avec soin ? Lesquelles seraient à éliminer, ré-élaborer, à se réapproprier ? Quelles seraient, dans ce cadre, les possibilités de refondation des pactes sociaux offertes à l’errant qui trouve une terre d’accueil ? Quel est le prix à payer pour son intégration, son acceptation, donc son inclusion sociale ? Qu’est-ce qu’on attend de lui sur cette nouvelle terre à partir du moment même où lui offre l’hospitalité si recherchée ?
Si la mobilité des populations, la reconstruction des communautés et des identités, individuelles et collectives, est une permanence de la réalité humaine que peuvent constater les historiens, les géographes et les économistes, les linguistes, les sociologues, les administrateurs…, celle-ci trouve une place toute particulière dans la littérature. Comment les écrivains mettent-ils en évidence ces reconstructions des terres d’exils et des terres d’accueil ? Ainsi donc, le Xe Séminaire de la Francophonie et le IIe Colloque des Études comparées, qui se tiendront du 29 au 31 mai 2013, sur le thème Terres d’exil, terres d’accueil: identités, à l’Université d’État de Feira de Santana (Brésil), vont permettre de mieux saisir les innombrables solutions proposées dans divers champs de connaissances ayant la littérature comme interface majeure.
Les propositions de communications sont reçues jusqu’au 31 décembre 2012, dernier délai. Elles doivent comprendre, dans l’ordre, les éléments suivants :
- Prénoms et noms
- Adresse e-mail
- Institution et pays d’origine
- Le titre de la communication
- Un texte de proposition de communication d’une vingtaine de lignes
- Une bio-bibliographie d’une vingtaine de lignes (maximun )
Pour les propositions de communication et pour toute autre renseignement, veuillez contacter
- celcfaam@uefs.br ou
- Humberto De OLIVEIRA, humbert_oliveira@yahoo.com.br,
- Marie-Rose ABOMO-MAURIN, abomomvondo@aol.com
- Maurice AMURI Mpala-Lutebele, amurcle@yahoo.fr
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Departamento de Letras e Artes
Centro de Estudos em Literaturas e Culturas franco-afro-americanas
Curso de Especialização Vozes da Francofonia em Língua francesa e Literaturas francófonas
Xe Seminário da Francofonia e II Colóquio internacional de estudos comparados
Terras de exílio, terras de acolhida: identidades
Data: 29,30 e 31 de maio de 2013
Local: UEFS – Campus universitário
Êxodos, fugas, migrações são deslocamentos humanos inerentes à história da humanidade. De fato, quer se trate do êxodo bíblico ou da diáspora africana cuja narração convida a um necessário e atento olhar, essas movimentações para fora do território de origem, de um chão reconhecido como lugar da tradição, espaço familiar, são movimentos que implicam sempre, e de maneira trágica, na perda dos mais caros referenciais culturais e afetivos.
De fato, multidões são levadas a abandonarem seus lares, sua terra natal e são impelidas a enfrentar o desconhecido, partindo, portanto, em geral, sem nenhuma garantia de um futuro melhor, sem a certeza de receber a hospitalidade na terra de acolhida, nem mesmo a certeza de que seja possível chegar a um lugar seguro. Basta lembrarmos antes de tudo da errância do povo eleito de Deus na Bíblia. Sem nos esquecermos dos deslocamentos de populações provocados pela escravidão ou pelos genocídios. A contemporaneidade nos mostra esses movimentos de dispersão de centenas de exilados que fogem do terror imposto por milícias armadas em diferentes regiões da África ou Oriente Médio (Mali, Sudão, Ruanda, Libia, Síria...), ou até mesmo no interior do que se chama o “primeiro mundo”. Enfim, por razões as mais diversas, uma parte da humanidade, por terra, mar ou água, deixa atrás de si lembranças e sentimentos, bens e haveres. Milhares de indivíduos partem em busca de espaços novos onde possam reconstruir suas histórias pessoais e coletivas.
Claro que sabemos que outro grande contingente - visivelmente híbrido, posto que desejoso de integrar a extraterritorialidade- recusando qualquer ideia de fronteira, aderindo, à maneira do camaleão, aos lugares e às circunstâncias, sentindo-se sempre em casa, esse contingente também se move, desloca-se entre mundos diferentes. Se bem que não ignoremos esse fato, nosso maior interesse se volta para as migrações nas quais grandes contingentes humanos, por viverem em condições inumanas, buscam atravessar as fronteiras, fugindo de sua terra natal provisoriamente percebida como distopia.
Portanto, a errância que nos interessa é aquela experimentada e vivida por aqueles que são levados a abandonar as balizas das tradições e que vão entrar nesse terreno movediço, confrontados ao desconhecido, ao inesperado, ao imprevisto e que são tão bem representados pela noção de exílio. Assim, tal como o compreendemos, o exílio é esta movimentação involuntária que leva o indivíduo a se dobrar sob o peso de um passado ainda recente, mas que parece deslizar, tornando-se fluido demais, pois que as antigas certezas tornam-se tênues e as lembranças dos rostos amados parecem desfazer-se .
Uma vez perdidos os laços de pertença e de solidariedade, o antigo território berço da segurança e da hospitalidade torna-se distópico,logo inospitaleiro. Daí então a necessidade de procurar uma novela utopia impele à partida, a deixar atrás um passado carregado de valores afetivos e culturais. Começa, assim, a busca por uma terra prometida, terra de asilo, terra de acolhida, terra de possíveis, onde se possa reconstruir a vida, a família, uma identidade, uma nova comunidade, novas tradições, e reelaborando o passado, reconstruam-se ritos e sonhos.
Como conciliar as antigas tradições trazidas de uma terra de exílio com aquelas encontradas nas terras de acolhida? Quais valores guardar e perpetuar com cuidado? Quais valores a eliminar ou reelaborar? Quais deveriam ser reapropriados? Neste quadro, quais seriam as possibilidades de refundação de pactos sociais oferecidas ao errante que encontra uma terra de acolhida ? Qual o preço a pagar por sua integração, sua aceitação, logo sua inclusão social? O que espera dele esta terra de acolhida no momento em que lhe oferece a tão buscada hospitalidade?
Se a mobilidade das populações, a reconstrução das comunidades, das identidades individuais e coletivas, é uma permanente na realidade humana como podem constatar os historiadores, os geógrafos e os economistas, linguistas, sociólogos, administradores....o trânsito da humanidade encontra um lugar privilegiado na Literatura. Como os escritores colocam em evidência essas reconstruções de terras de exílio e de terras de acolhida? A fim de melhor compreender as inúmeras soluções propostas pelos vários campos de conhecimento e de « saberes », tendo a Literatura como interface maior, o CELCFAAM- Centro de Estudos em Literaturas e Culturas franco-afro-americanas convida a participar das atividades do X Seminário da francofonia e do II Colóquio de Estudos Comparados: Terras de exílios, terras de acolhida: identidades que serão realizados no período de 29, 30 e 31 de maio de 2012, na Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil) .
As propostas de comunicações serão recebidas até 31 de dezembro de 2012 (prazo final). Os resumos devem compreender, por ordem, os seguintes dados:
- Prenome e nome
- endereço eletrônico
- Instituição e país de origem
-título da comunicação
- texto contendo entre 15 e 20 linhas
-uma biobibliografia com o máximo de 20 linhas
Para maiores esclarecimentos, favor contatar
celcfaam@uefs.br ou
- Humberto de OLIVEIRA, humbert_oliveira@yahoo.com.br
- Marie-Rose ABOMO-MAURIN, abomomvondo@aol.com
- Maurice AMURI Mpala-Lutebele, amurcle@yahoo.fr [Réduire] Contact : celcfaam@uefs.br ou - Humberto De OLIVEIRA, humbert_oliveira@yahoo.com.br, - Marie-Rose ABOMO-MAURIN, abomomvondo@aol.com - Maurice AMURI Mpala-Lutebele, amurcle@yahoo.fr |
Du 21 au 26 Avril 2013 :
 |
Premier Forum universitaire maghrébin des arts Rabat (Maroc) Le Bureau Maghreb de l’Agence Universitaire de la Francophonie à Rabat se propose de réaliser, du 22 au 27 avril 2013 le Premier Forum Universitaire Maghrébin des Arts. Cette initiative s’adresse aux étudiants des universités et autres institutions d’enseignement supérieur de la région ... [Afficher la suite] Le Bureau Maghreb de l’Agence Universitaire de la Francophonie à Rabat se propose de réaliser, du 22 au 27 avril 2013 le Premier Forum Universitaire Maghrébin des Arts. Cette initiative s’adresse aux étudiants des universités et autres institutions d’enseignement supérieur de la région Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) membres de l’AUF. Elle constitue une opportunité pour ces étudiants, accompagnés par leurs enseignants, de mettre en valeur leur capacité de création en produisant des œuvres originales.
Le projet - porté en partenariat avec les Universités Mohamed V/Agdal-Rabat, Mohamed V/Souissi-Rabat, Ibn Tofail-Kénitra, Hassan II-Mohammadia et Chouïab Doukkali-El Jadida – veut contribuer aux efforts des universités maghrébines désireuses de favoriser l’épanouissement intégral des étudiants par le soutien à leur créativité artistique, et quelle que soit leur discipline d’étude. Les œuvres présentées devront traiter ou évoquer le thème retenu pour ce premier Forum : le campus universitaire idéal.
Justification du thème du Forum
Si l’Université est reconnue par tous comme un lieu de production, de transmission et d’extension du savoir, elle n’épuise pas toute sa raison d’être dans cette triple fonction.
Comment méconnaître, en effet, son potentiel d’expressivité culturelle et, plus précisément, de créativité esthétique ? Parmi les étudiants, combien de talents artistiques à l’état manifeste ou latent !
Dans la présente conjoncture, marquée par une interrogation, souvent angoissée, de la jeunesse sur son destin, il semble opportun de prêter une attention particulière aux messages véhiculés par les formes et les œuvres où nos étudiants projettent leur volonté de sens.
La notion d’utopie semble la plus apte à interpeler la jeunesse étudiante en lui permettant de porter sa réflexion à la limite et de libérer sa créativité. Car si l’idée d’utopie, interprétée non pas comme mirage ou chimère, mais prise dans son sens positif de modèle humain, voire d’hypothèse scientifique, exerce un tel attrait sur l’esprit, c’est que, puissance de contestation du réel, elle appelle chacun à l’exploitation du champ du possible.
L’avenir, s’il doit être meilleur que le présent, a besoin de toutes les forces de l’imaginaire et de l’art non moins que des ressources de la science et des techniques - pour autant qu’il existe encore une frontière absolue entre ces domaines naguère distincts.
Dans un souci de meilleur ciblage thématique, les étudiants, de toute discipline, guidés et stimulés par leurs professeurs, sont invités à élaborer des projets novateurs, uni- ou pluridisciplinaires, autour de la relation ville/université, le campus idéal (dans son rapport avec la nature et la société) devant servir de concept directeur.
Objectifs du Forum
Le Bureau Maghreb de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a formé le dessein de réaliser un « Forum des Arts » à partir des meilleures productions, quels qu’en soient le support et les moyens (artisanaux ou technologiques), issues des Institutions partenaires. Les départements d’études artistiques sont, à l’évidence, les premiers intéressés - mais ils ne sont, bien sûr, pas les seuls à pouvoir témoigner de la créativité esthétique des étudiants. Le premier objectif du Forum est de rappeler l’importance de l’expression artistique dans la formation universitaire.
Un objectif supplémentaire de notre projet est de former un réseau inter-universitaire maghrébin de la culture et des arts propre à assurer la pérennité de ce genre de manifestations.
A la suite du premier Forum sera élaboré un catalogue regroupant les réalisations des étudiants et qui permettra un suivi de leurs recherches.
Champs couverts
En vue d’articuler un vaste panel de disciplines (étant entendu que le thème à traiter - le campus idéal- engage à peu près tous les savoirs, de la sociologie à la médecine, du management aux sports…), les moyens et domaines d’expression seront répartis en quatre grandes catégories :
- Axe 1 - Les arts de la main : Peinture, poterie, sculpture, bande dessinée, photo, divers artisanats, etc.
- Axe 2 - Les arts du langage : Théâtre, cinéma (court-métrages) et arts vidéo, contes et nouvelles, poésie, musique, etc.
- Axe 3 - Les arts de la pierre : Patrimoine, urbanisme, architecture, etc.
- Axe 4 - Les arts de l’ordinateur : Inventivité technologique, productions par ordinateur, graphisme, webdesign, etc.
Déroulement du Forum
Le Forum s’articulera en trois volets :
1.Expositions/Spectacles :
Les œuvres qui auront été sélectionnées seront exposées ou présentées dans des espaces choisis à cet effet à l’intérieur ou à l’extérieur des universités marocaines partenaires à Rabat, Kénitra, Mohammadia ou El Jadida.
2.Ateliers/Tables-rondes :
L’organisation d’ateliers de découverte interactive des différentes disciplines regroupées autour d’un même projet répondra au souci de vulgariser certaines notions, d’impliquer au maximum les observateurs et les participants, de tisser un lien entre les intervenants et leur public, de favoriser une coopération future. L’organisation de tables-rondes autour de la présentation des réalisations exposées sera l’occasion, pour chacun, de faire partager ses expériences propres et, pour tous, de dessiner les lignes directrices des actions futures de l’AUF et de ses membres dans le domaine de la création artistique.
3.Colloque de clôture sur le thème du Forum (Utopie)
Processus de candidature
Les universités membres de l’AUF désireuses de participer à cette manifestation, sont invitées :
- à confirmer, avant le 15 octobre 2012, leur accord de principe ainsi qu’à communiquer les coordonnées d’une « personne ressource » qui rendra compte de l’évolution des projets au sein de son université ;
- à diffuser le présent appel auprès des étudiants et du corps professoral ;
Les étudiants souhaitant prendre part au Forum pourront présenter des productions individuelles ou collectives réalisées sous la supervision des enseignants de leur Université. Ils devront communiquer, avant le 15 janvier 2013, au Bureau Maghreb de l’AUF, la fiche descriptive de leur projet dûment complétée, en version papier et en version électronique.
Le Bureau Maghreb de l’AUF fera connaître la liste finale des œuvres et projets retenus pour le Forum le 15 février 2013.
PDF - 29.6 ko
Fiche descriptive - Projet Forum des Arts [Réduire] |
Du 05 au 06 Decembre 2012 :
| |
La guerre d’Algérie, une guerre comme les autres ? Paris (FRANCE) - Institut du Monde Arabe
, Salle du Haut Conseil, 9e étage
, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e ; Bibliothèque nationale de Colloque international organisé par Catherine Brun (EAC 4400 - Écritures de la modernité, littérature et sciences humaines) en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, l’Institut du Monde Arabe, l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Parce que la guerre d’Algérie n’... [Afficher la suite] Colloque international organisé par Catherine Brun (EAC 4400 - Écritures de la modernité, littérature et sciences humaines) en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, l’Institut du Monde Arabe, l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Parce que la guerre d’Algérie n’a été officiellement reconnue telle que tardivement, en 1999, elle est souvent appelée, encore aujourd’hui, la « guerre sans nom ». En France, on en fait l’emblème d’un consensus du silence, des tabous de l’histoire, du refoulé de la pensée, de la création, de la mémoire. Et pourtant, les productions de tous ordres sur le sujet sont massives. Davantage que d’un déficit de désignation, cette guerre semble avoir souffert de l’abondance de ses appellations concurrentes. En outre, sa perception a été brouillée par la réminiscence d’autres conflits, dont les représentations sont venues se télescoper à ses réalités propres ou, en aval, par son instrumentalisation au profit de nouveaux affrontements.
C’est à interroger la catégorisation de ce conflit qu'intellectuels, historiens, linguistes, politistes, littéraires s’attelleront, pour mieux démêler l’écheveau de ses représentations historiques, littéraires, philosophiques, et médiatiques.
Deux axes seront retenus. Le premier, diachronique, invitera à s’interroger sur la manière dont les représentations de cette « guerre » entrent en résonance avec d’autres conflits, passés ou à venir. Quelles ombres portées par ces autres guerres sur la «guerre d’Algérie» et, réciproquement, quelles disséminations de la guerre d’Algérie ?
Le second, synchronique, s’attachera, toujours à partir des représentations, à repenser la pertinence de la désignation « guerre d’Algérie » en regard d’autres. Il s’agira de contextualiser ces options verbales, d’en saisir les implications et les attendus, sans négliger de penser ce que ces variations-distorsions, cosmétiques ou autoritaires, font à la langue. [Réduire] |
Le 05 Decembre 2012 :
| |
Hommage à Mohamed Loakira Kénitra (Maroc) - Université Les travaux de cette journée porteront sur l’ensemble de la production poétique et narrative de Mohamed Loakira.
Je vous prie de me faire parvenir vos propositions avant le 20 novembre à l’adresse suivante :
Coordinatrice de l’activité
Sanae Ghouati :
gsanae@yahoo.fr Contact : gsanae@yahoo.fr |
Du 22 au 26 Avril 2013 :
 |
Appel à participation pour le Festival International du Théâtre Universitaire de Marrakech 7ème édition Marrakech (Maroc) - Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales - Université Cadi Ayyad Pour sa 7éme édition et dans le cadre de son programme annuel d’activités para-universitaires, la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Marrakech organisera, sous la tutelle de l’Université Cadi Ayyad, le Festival International du Théâtre Universitaire, du 23 au 27 av... [Afficher la suite] Pour sa 7éme édition et dans le cadre de son programme annuel d’activités para-universitaires, la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Marrakech organisera, sous la tutelle de l’Université Cadi Ayyad, le Festival International du Théâtre Universitaire, du 23 au 27 avril 2013.
Cette manifestation avait comme ambition , depuis sa première édition, de fournir aux étudiants universitaires et au public intéressé par les questions du théâtre en général, et universitaire en particulier, un espace de rencontre, d’expression et d’échange à travers les pièces de théâtre présentées, les ateliers de formation et les tables rondes organisées tout au long du festival.
Ainsi, les six premières éditions ont connu un front succès et une affluence remarquable du public, vu la diversité et la richesse du programme présenté. A cet effet, le festival a connu la participation d’universités de quatre continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe) et d’artistes de renommée.
En outre, le festival, rend hommage à une des figures du théâtre national en guise de reconnaissance, pour sa contribution au champ culturel marocain.
Les troupes marocaines et étrangères, qui désirent participer à cet événement international, sont Invitées à envoyer leurs
dossiers de candidature contenant les documents suivants
1- Demande de participation au festival signé par le Doyen ou le Directeur de l’établissement.
2- Le formulaire de participation dûment rempli avec soin.
3- fiche technique de la pièce théâtrale proposée + (nombre des participants avec leurs rôles)
4- L’enregistrement sur CD ou DVD de la pièce théâtrale proposée.
5- Photos de la pièce théâtrale proposée
6- Coordonnées du responsable de la troupe (tél personnel + fax et adresse électronique)
Des prix seront décernés dans sept catégories
A cet effet, nous serions ravis de recevoir votre dossier de candidature avec, notamment, toute documentation présentant l’ensemble de vos spectacles avant le 30 Décembre 2012. Les candidatures peuvent se faire entièrement en ligne sur l’Email suivant :
fitumarrakech@gmail.com
abdoufk@gmail.com
Pour de plus amples informations, contacter le Directeur du festival:
FAIK Abderrahim
Tél : +212668864893
Page facebook : https://www.facebook.com/fitumarrakech
Notre groupe sur facebook : https://www.facebook.com/groups/fitum
Le dossier est à envoyer par poste et par email à la direction du festival.
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Marrakech - MAROC
Daoudiate B.P. 2380 : Marrakech - MAROC-
Tél. : +212-524-30-30-32/+212-524-30-33-95
Fax : +212-524-30-32-65 [Réduire] |
Du 06 au 08 Mars 2013 :
| |
Ecrire à travers le visuel/virtuel : inscrire la langue, la littérature et la culture en Afrique francophone et dans les Caraïbes Rutgers (New Brunswick) (Canada) - Rutgers University Date limite : 1 novembre 2012
Ecrire à travers le visuel/virtuel : inscrire la langue, la littérature et la culture en Afrique francophone et dans les Caraïbes
7-9 Mars 2013
Ces deux jours de colloque à l’Université de Rutgers (New Brunswick) ont pour objectif de favoriser une compr�... [Afficher la suite] Date limite : 1 novembre 2012
Ecrire à travers le visuel/virtuel : inscrire la langue, la littérature et la culture en Afrique francophone et dans les Caraïbes
7-9 Mars 2013
Ces deux jours de colloque à l’Université de Rutgers (New Brunswick) ont pour objectif de favoriser une compréhension transdisciplinaire de
l’interaction complexe qui existe entre les domaines de la langue, de la littérature, des arts et du visuel/virtuel de la culture d’expression
en Afrique francophone et dans les Caraïbes. Seront explorés les divers motifs de création ainsi que de pratiques culturelles et scripturales
qui émergent des forces contemporaines et historiques ayant impacté les peuples et les cultures de cette région transatlantique, qui comprend
notamment les pays suivants : l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, les Iles Comores, Congo Brazzaville, la République Démocratique du Congo,
la Dominique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, la Louisiane (E-U), le Mali, la Martinique, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Sénégal, les Seychelles.
Un intérêt particulier sera donné à la manière dont les écritures, alors qu’elles paraissent être exclusivement décoratives, sont souvent employées
par les artistes et interprètes dans la production culturelle matérielle et non-matérielle, afin de transmettre des messages d’une grande signification,
ainsi que de permettre aux mots et aux images, d’interagir de manière à ce qu’une synthèse créative se forme et lie avec innovation, le local et le mondial,
le « classique » et le « populaire ».
Les sujets possibles pour le colloque (mais non limités à ceux-là) sont les suivants :
A. Symboles graphiques et mémoire collective
B. La politique de la mode/ pagnes politiques/ proverbes sur pagnes
C. Espace féminin d’écriture (sur les murs, les marmites, le sol, etc.)
D. Les bandes dessinées, les livres, les films et l’alphabétisation
E. L’art corporel (tatouages, cicatrices) par l’usage du henné, de l’ancre
F. Interpréter le relief, l’écriture de surface, les sujets tactiles, vèvè et vaudou,
G. Inscrire l’oralité : l’histoire, le Hip-Hop et le rap
H. Ecritures : Bagam, calligraphie, graffiti, idéogrammes
I. Création, publication, consommation, consumérisme
J. Langue vernaculaire/langue véhiculaire : créole, wolof, lingala/français, arabe
K. Communication intra-culturelle/interculturelle et les nouvelles technologies : blogs, Facebook, Twitter
L. Langues en contact : créolisation, traduction, et dynamismes transnationaux
Les propositions sont acceptées dans toutes les disciplines pour des articles individuels ou pour des panels. Pour les articles doivent être communiqués,
le nom de l’auteur, le titre de l’article, un résumé de l’article et une biographie concise de l’auteur. Les propositions de panels doivent inclure le nom du
responsable du panel, la liste de 4 panélistes au maximum, un résumé du thème du panel (1 page), de courtes biographies des panélistes et les résumés
des articles proposés par ces-derniers. Les artistes sont notamment invités à exhiber leurs objets d’art. Le colloque comprendra notamment des projections
de films, des exhibitions artistiques, des défilés de mode.
Veuillez soumettre sous forme électronique un résumé (100 à 200 mots) et/ou une proposition de panel avant le 1er novembre 2012, à l’adresse suivante
writing_through_the_visual_virtual_2013@email.rutgers.edu
Responsable : Rutgers University Center for African Studies
Url de référence :
http://ruafrica.rutgers.edu [Réduire] |
Le 27 Septembre 2012 :
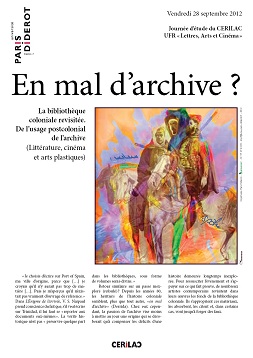 |
En mal d'archive? La bibliothèque coloniale revisitée. De l'usage postcolonial de l'archive (Littérature, cinéma et arts plastiques) Paris (France) - Université Paris Dideot (Paris 7) https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=20ed14e458&view=att&th=139ed09b9f694af2&attid=0.2&disp=safe&zw |
Du 09 au 11 Decembre 2012 :
| |
Lyon (France) - Ecole Normale Supérieure Le Centre d'Études et de Recherches Comparées sur la Création (CERCC) vous convie au colloque Traduire sans papiers qui se tiendra à l’École Normale Supérieure de Lyon (France) du 10 au 12 octobre 2012.
Ce colloque invite à interroger le présupposé selon lequel « la traduction favoris... [Afficher la suite] Le Centre d'Études et de Recherches Comparées sur la Création (CERCC) vous convie au colloque Traduire sans papiers qui se tiendra à l’École Normale Supérieure de Lyon (France) du 10 au 12 octobre 2012.
Ce colloque invite à interroger le présupposé selon lequel « la traduction favorise la compréhension entre les peuples et la coopération entre les nations » (Unesco, Nairobi, 1976), car il masque la réalité du processus de traduction comme acte énonciatif historiquement situé. Ce fonctionnement n’est pas davantage pris en compte par le paradigme traductif qui s’impose dans les Humanités. Dans un contexte où l’on constate un repli frileux sur les frontières et les identités nationales, il y a une certaine urgence à rendre à la traduction sa force de subversion : questionner les identités instituées loin des pensées binaires et de leurs dichotomies.
Les cinq conférenciers qui interviendront comme keynotes ont critiqué la réduction de l’acte de traduire à un passage qui mènerait d’une « langue source » à une « langue cible » aussi opposées que les deux rives d’un fleuve. Les différents intervenants discutent les enjeux de la traduction à partir de perspectives complémentaires (sociologiques, anthropologiques, éthiques, etc.), même si la poétique reste au cœur de la réflexion. La littérature n’est pas seulement repensée à partir de la traduction : elle constitue également un terrain privilégié pour observer en acte le processus traductif.
Nous avons voulu lier la poétique au politique aussi directement que possible. C’est pour cette raison que nous sommes particulièrement heureux d’accueillir des artistes, des militants et des représentants d’associations qui nous aideront à ouvrir le débat par-delà l’institution universitaire.
Que vous soyez chercheur(e), étudiant(e) ou simplement curieux, n’hésitez pas à venir écouter les conférenciers, à participer aux tables rondes ou à assister aux spectacles – l’entrée est libre… et on ne vous demandera pas vos papiers !
Myriam Suchet et Éric Dayre [Réduire] |
Du 02 au 03 Decembre 2012 :
| |
Colloque EDAF 2012: Hommage à Nadia Ouhibi Ghassoul Oran (Algérie) - Univerité d'Oran Es-Senia à Maraval Colloque ouvert à tous les chercheurs, quelle que soit
leur discipline.
Les propositions de communication devront intégrer
le n° de l'axe de l'intervention (cf. page suivante), un
intitulé et un résumé de 1 500 à 2 000 signes
Les actes du colloque feront l'objet, après expertise,
d... [Afficher la suite] Colloque ouvert à tous les chercheurs, quelle que soit
leur discipline.
Les propositions de communication devront intégrer
le n° de l'axe de l'intervention (cf. page suivante), un
intitulé et un résumé de 1 500 à 2 000 signes
Les actes du colloque feront l'objet, après expertise,
d'une publication dans un numéro spécial de la revue
Résolang.
Pour permettre l’élaboration du programme, les
intervenants sont expressément invités à envoyer
leurs proposition avant le 1er novembre 2012 à :
colloquemaraval@gmail.com
Le professeur Nadia Ouhibi-Ghassoul nous a quittés cette année et
l'ensemble des chercheurs concernés par le traditionnel colloque de
décembre, auquel elle participait régulièrement, ont décidé de
consacrer celui de 2012 à la mémoire de cette brillante et généreuse
collègue dont l'objectif depuis plus de 20 ans a été de créer “l’école
critique d’Oran”. Ce colloque, qui se tiendra en français, est donc
ouvert à tous les chercheurs, quelle que soit leur discipline.
Au delà du témoignage que certains ne manqueront pas de porter
sur Nadia au cours des deux journées, les interventions porteront
sur les centres d'intérêt que Madame Ouhibi-Ghassoul avaient mis
en place par sa recherche et son enseignement :
Axe 1 : narratologie et lecture critique des textes
Axe 2 : modernité et postmodernité
Axe 3 : l’enseignement de la littérature
Axe 4 : l'œuvre de Boudjedra
Comité scientifique :
Fewzia Sari, Hadj Miliani, Rahmouna Mehadji, Fouzia Bendjelid,
Boumediène Benmousset, Lelloucha Bouhadiba, Fatima-Zohra
Chiali-Lalaoui, Belkacem Mebarki, Charles Bonn, Bruno Gelas,
Michel P. Schmitt.
Président:
Monsieur Chahed, Recteur de l'Université d'Oran.
Comité d'organisation :
Rahmouna Mehadji, Nabila Hamidou, Abdelkader Ghellal, Dihia
Belkhous, Anne-Marie Mortier.
Informations pratiques :
• Dates et lieu du colloque : 3 & 4 décembre 2012, Université d’Oran,
campus Maraval.
• Les propositions de communication (n° de l'axe concerné, intitulé
et résumé de 1 500 à 2 000 signes) devront parvenir avant le 1er
novembre à l’adresse : colloquemaraval@gmail.com
• Les actes du colloque feront l'objet, après expertise, d'une publication dans un numéro spécial de la revue Résolang. [Réduire] |
Du 09 au 11 Decembre 2012 :
| |
Les Assises Nationales de la Littérature Algérienne Ecritures algériennes, de la revendication à la contestation Alger (Algérie) - Université Alger 2 A l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance, une rétrospective des lettres algériennes permettrait de rendre compte du cheminement de la littérature au prisme de l’Histoire nationale contemporaine et de l’évolution sociétale marquée par des modes de pensée porteurs de changement... [Afficher la suite] A l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance, une rétrospective des lettres algériennes permettrait de rendre compte du cheminement de la littérature au prisme de l’Histoire nationale contemporaine et de l’évolution sociétale marquée par des modes de pensée porteurs de changement, voire de rupture.
La littérature algérienne née dans son versant francophone, comme cela est admis, de la contestation coloniale s’est d’abord voulue témoignage à des fins de dénonciation de l’Autre et de revendication de légitimité du Même. En même temps, la littérature en langue arabe adoptait des formes littéraires empruntées à l’Occident pour dire la même revendication identitaire et assurer la continuité des aspirations nationales. De son côté, la littérature orale, tant en arabe vernaculaire qu’en tamazigh perpétuait le dire des bardes et en renouvelait la thématique en faisant une large place à la revendication nationale et la monstration des conditions de vie sous le joug colonial.
Dans cette démarche, de plus en plus affirmée au cours du temps, l’écrivain s’est voulu Hérault du peuple révolutionnaire. Durant une longue période fleurissent les écritures de combat et se multiplient les œuvres sur la guerre. Un même discours d’engagement alimente autant la poésie et le théâtre que l’essai, le roman ou le récit. Pour les besoins de la glorification nationale la littérature a tantôt épousé le code du réalisme socialiste et tantôt bouleversé les codes préexistants pour faire une entrée intempestive dans l’univers de la modernité telle que propagée par l’Occident sur la scène littéraire de plus en plus mondialisée. Nedjma de Kateb Yacine est l’exemple emblématique de cette innovation.
Parallèlement le souci de l’affirmation de soi se traduisait par la quête identitaire, préoccupation existentielle qui a induit la réactivation de la littérature de l’oralité porteuse de culture ancestrale. Le texte littéraire offre, alors, en plus de ses qualités esthétiques, un document anthropologique de première source. Cependant, dans l’engouement de la reconquête de soi, attitudes passéistes et exotisme interne n’ont pas manqué.
L’autre scène qui s’est dessinée, est celle du tragique de l’entre-deux. Comment accéder à la modernité, se projeter dans l’avenir sans trahir la personnalité originelle et tout en acceptant de se transformer en empruntant aux autres. La réflexion d’ordre ontologique se problématise : que devient l’authenticité dans un monde qui bouge et se métamorphose ? Avec la question subsidiaire : comment prendre place dans le cercle qui définit les règles de ‘‘l’universalité’’ au lieu de se les laisser imposer du dehors
Dans ce cadre, l’écrivain désormais en quête d’universalité devient passeur de frontières. La littérature de l’exil prospère avec l’affirmation d’un double sentiment de perte et de renaissance.
L’autarcie persistante de la société endogène favorise le procès de l’autocritique et l’expression du désenchantement, particulièrement forte dans les années 80. Mais déjà, bien avant, quelques écrivains rebelles ont poussé un cri de révolte contre la violence engendrée par les systèmes sclérosés qui régissent la société. Qu’ils aient adopté une attitude plus ou moins violemment iconoclaste (comme Rachid Boudjedra, Rachid Mimouni ou Tahar Djaout, par exemple) ou qu’ils aient pris le parti de la critique interrogative qui donne à voir les dérives politiques et sociales pour les donner à juger (comme l’ont fait Mohammed Dib, Tahar Ouettar, Djilali Khellas ou Waciny Laredj, par exemple) ; tous avaient le souci d’alerter le lecteur sur les dangers du « prêt-à-penser » et de la paresse intellectuelle, porteurs de régression, voire de fanatisme.
Avec l’amorce du libéralisme, au lendemain des révoltes juvéniles d’octobre 1988, la violence explose dans les années 90 donnant lieu à une littérature de l’horreur qui persiste à ce jour en une traînée diffuse, annonciatrice, peut-être, d’autre chose qui pointe.
A présent, les écrits littéraires se diversifient et semblent vouloir emprunter diverses directions. Même si on peut noter une prédominance du ton de la contestation radicale (tournée vers soi, cette fois-ci, comme pour annoncer un rendez-vous avec l’heure des comptes à rendre) ; d’autres possibles s’ouvrent devant les nouveaux auteurs : le goût des écritures intimistes, le besoin de la méditation philosophique sur des récits de vie, la multiplication des mémoires, l’attirance pour des exercices gratuits qui retrouvent un bonheur de raconter comparable à celui que les conteuses dispensaient autrefois aux enfants etc.
Dans ce panorama esquissé à grands traits, de la production littéraire, il y a lieu de considérer son autre versant, celui de sa réception. L’état de la critique et des références conceptuelles qui l’accompagnent permettra certainement de mesurer l’intérêt scientifique qui lui est accordé et par là même de s’interroger sur l’existence d’une critique littéraire algérienne indexée sur le savoir critique qui s’élabore à l’étranger mais capable de produire des outils adaptés à son propre champ culturel et qui sauvegarde sa relative autonomie. Ceci implique une attention portée sur le paysage éditorial, sur ses ressorts de fonctionnement que l’on souhaiterait voir non inféodés aux seules lois du profit, sur le travail effectué (ou pas) pour sa professionnalisation, sur l’analyse du lectorat potentiel etc. L’autre aspect majeur de cette investigation concerne le questionnement du système éducatif avec la place qu’il fait à l’enseignement de la littérature tout au long de la scolarité, les méthodes qu’il élabore (ou pas), les manuels qu’il produit etc. Car, ne l’oublions pas, de ces question ressort la visée de la formation de l’Algérien de demain puisque la production, la diffusion, l’enseignement de la littérature (et plus largement des arts) constitue le socle culturel sur lequel repose la formation du citoyen humaniste, lucide et psychologiquement bien équilibré que toute société a intérêt à produire. Plus concrètement, il s’agit de s’interroger sur l’influence du discours littéraire sur les projets de société à construire et dans lesquels on ne peut désormais ni obérer la présence des femmes ni ignorer la nécessité de redéfinir l’exercice interactionnel des différents pouvoirs qui constituent le fonctionnement d’une société moderne.
La littérature algérienne qu’elle soit appréhendée sous l’angle historique, sociologique ou anthropologique, est d’abord une production scripturale sans cesse renouvelée par un travail d’innovation sur la langue qui va de la préciosité la plus classique au syncrétisme le plus débridé autant que par le (re)maniement des codes et des genres. Véritable théâtralisation de l’écriture assurément dégagée de l’empreinte de tout conformisme. Liberté de la forme qui s’accommode de la liberté du dire et le renforce. A cet égard une attention particulière sera portée à l’écriture dramaturgique, qui, après une période de gloire, peine de nos jours à trouver le langage tant verbal, que gestuel et scénique susceptible de créer l’adhésion immédiate du spectateur. Déficit d’autant plus préjudiciable que la forme théâtrale est à même de toucher un large public qui englobe un large public, élitiste et populaire. Il s’agira donc de savoir pourquoi le théâtre est devenu le parent pauvre des lettres algériennes, alors qu’il avait connu une belle expansion dans les années 1980 et tandis que les autres genres sont en pleine expansion.
Pour synthétiser, les communications s’inscriront dans l’un des axes suivants :
1-Littérature et histoire :
- Littérature et guerre de libération.
- Littérature et engagement des années 70.
- Littérature et désenchantement des années 80.
- Littérature de violence dite de ‘’l’urgence’’ des années 90.
2- Littérature et société :
- Littérature et voix féminines.
- Littératures et pouvoir(s).
- Littérature et enseignement.
- Questions de critique littéraire/ Problématiques et réception.
3- Les registres d’écriture :
- Littérature : langue(s) et traduction(s).
- Littérature et oralité.
- Littérature d’aujourd’hui : ses codes et ses genres.
La frontière entre ces axes n’est pas étanche mais il conviendrait de mettre l’accent sur l’un des paramètres cités.
Membres du comité de rédaction :
Ismaïl ABDOUN, Saléha AMOKRANE, Afifa BERERHI, Assia KACEDALI,
Ahmed MENOUR, Brahim SAHRAOUI, Mohamed SARI
Conditions de participation :
- Réception des résumés à la date limite du 20 octobre 2012.
- Annonce des résumés acceptés 15 novembre2012.
- Remise des articles définitifs le 05 décembre 2012.
- Fiche biobibliographique succincte de l’auteur.
- Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’université Alger 2.
- Frais de transport à la charge du participant.
Envoyez vos propositions avec vos coordonnées aux contacts suivants:
Propositions en langue française : Afifa Bererhi- ‘’departfr@hotmail.com’’
Proposition en langue arabe : mohamed sari - mohasari@yahoo.fr et ccomuniv.alger2@gmail.com [Réduire] Contact : Propositions en langue française : Afifa Bererhi- ‘’departfr@hotmail.com’’ Proposition en langue arabe : mohamed sari - mohasari@yahoo.fr et ccomuniv.alger2@gmail.com |
Du 11 au 17 Novembre 2012 :
 |
Festival du livre roman(s) à Romans 12e édition : Littératures du monde arabe Romans-sur-Isère (France) - Drôme 26 Nous avons choisi de mettre à l’honneur, Les littérature(s) du monde arabe.Nous allons faire découvrir au grand public, aux élèves, aux professeurs, aux professionnels de la lecture publique, la richesse de ces littératures. La ville de Romans a depuis des années une coopération très rich... [Afficher la suite] Nous avons choisi de mettre à l’honneur, Les littérature(s) du monde arabe.Nous allons faire découvrir au grand public, aux élèves, aux professeurs, aux professionnels de la lecture publique, la richesse de ces littératures. La ville de Romans a depuis des années une coopération très riche avec la Tunisie (El Djem), le Maroc (Taroudant), et la Palestine (Beit Sahour).
En compagnie des invités, auteurs, éditeurs, et médiateurs des deux rives de la Méditerranée, nous tenterons de rendre compte des littératures du monde arabe, d’hier à aujourd’hui, sous le prisme des rêves, des évolutions, et révolutions, entre réalités et fictions.
Dans la littérature du monde arabe c'est le pluriel qui s'impose. Cette vaste galaxie littéraire se compose d'un ensemble de textes aux identités et résonances multiples, variant selon le lieu de naissance de leur auteur, mais dont le dénominateur commun est la participation à un même imaginaire : celui d'une littérature dont l'histoire s'écrit depuis plus de 17 siècles.Nous allons, grâce à tous nos invités, parcourir ces territoires littéraires! Nos invités : Kaouther Adimi,André Cohen Aknin, Azouz Begag, Yahia Belaskri,Kamal Ben Hameda, Anouar Benmalek, Fatima Besnaci-Lancou, Maïssa Bey, Charles Bonn, Geneviève Briot, Sandrine Charlemagne, Elisabeth Daldoul, Anne Châtel-Demenge, Nicole de Pontcharra, Nadir Dendoune, Mourad Djebel, Leïla Hamoutene, Kaoutar Harchi, Mustapha Harzoune, Salim Jay,Riad Kaddour, Yesmine Karray, Fatima Kerrouche, Lazhari Labter,Colette Lambrichs,Fouad Laroui, Nabil Louaar, Habiba Mahani,Yamen Manaï,Saïd Mohamed, Mabrouck Rachedi,Khaled Osman,Cécile Oumhani, Olivier Ravanello, Marie-Paule Richard, Nadia Roman, Khaled Roumo, Majid Sagatni,Sapho, Catherine Simon, Wassyla Tamzali, Janine Teisson, Habib Tengour, Behja Traversac. [Réduire] |
Du 11 au 12 Avril 2013 :
| |
L'humour dans le bassin méditerranéen: contacts linguistiques et culturels Tozeur (Tunisie) - Université de Gafsa-Institut Supérieur des Etudes Appliquées aux Humanités de Tozeur Département de français Le Bassin Méditerranéen, carrefour des civilisations depuis l’Antiquité, a toujours été un lieu de croisement, d’hétérogénéité et d’échanges de toutes sortes. Le brassage culturel et les contacts linguistiques ont souvent été une source de création dans les domaines artistique et... [Afficher la suite] Le Bassin Méditerranéen, carrefour des civilisations depuis l’Antiquité, a toujours été un lieu de croisement, d’hétérogénéité et d’échanges de toutes sortes. Le brassage culturel et les contacts linguistiques ont souvent été une source de création dans les domaines artistique et littéraire. Le colloque international de l’université de Gafsa aura lieu à Tozeur en Tunisie en avril 2013, il a pour thème l’« Humour et le contact des langues dans le Bassin Méditerranéen », qui est en harmonie avec tout un fond culturel populaire de cette région méditerranéenne. En effet, les gens de la région du Djérid sont connus, entre autres, pour leur humour, visant à tourner en dérision l’ordre établi, voire certains tabous. C’est bien le propre de l’humour de remettre en cause l’Ordre et de transgresser l’inter-dit : dire ce que l’on n’a pas le droit de dire. Cette ambigüité de l’humour fait de lui un genre difficilement contournable, comment le décrire ? Par quels procédés, littéraires, sociologiques, linguistiques, voire psychanalytiques ? Et surtout comment le distinguer du « rire », de « l’ironie » et du « comique » ? Il est désormais question d’un genre hybride lequel fait croiser d’autres genres et de multiples approches. Les recherches sur l’humour sont plurielles, mais, au-delà des axes et des sujets habituels, que devient l’humour à l’ère du numérique, lorsque le « lol » et le « lulz » (rire gentil et rire méchant) émergent auprès des communautés électroniques ? A force des « mdr » (mort de rire), l’humour à en mourir devient un sujet d’actualité à travers les réseaux sociaux. Des questions se posent ainsi sur ses limites, si l’humour en connaît.
2
Vu la complexité de ses thèmes et la multiplicité des genres auquel il peut appartenir,
l’humour nécessite une approche pluridimensionnelle convoquant des méthodes et des outils
liés à des domaines variés comme l’analyse linguistique, la critique littéraire, l’analyse
psychanalytique et autres. Outre des réflexions théoriques, les propositions de communication
peuvent porter sur les thèmes suivants :
- Humour et interculturalité.
- Humour et métissage linguistique.
- Humour au féminin et au masculin dans le Bassin Méditerranéen.
- Humour et interdit (tabous, censure, etc.).
- Humour et caricature.
- Humour et bande dessinée.
- Humour et peinture.
- Humour et TIC.
- Humour et e-réputation
- L’humour en littérature.
- L’humour dans le sketch et le one-man-show.
- L’humour et la politique dans les médias depuis le printemps arabe.
- L’humour et les philosophes méditerranéens.
- L’humour au cinéma.
L’organisateur
Le département de français (ISEAH Tozeur, Université de Gafsa)
Les partenaires
- L’Unité de Recherche « Linguistique de la communication et de l'arabe tunisien »
(Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba)
- L’Association pour le développement des recherches sur le Comique, le Rire et l’Humour
(CORHUM)
- L’Institut Français de Tunisie
Modalité de participation
Date limite de la soumission des résumés d’une page au maximum, mots clefs et quelques
références bibliographiques à envoyer à : mogf2000@gmail.com avant le 15 octobre 2012
Réponse du comité scientifique : le 15 novembre 2012
Date prévue pour le programme définitif : le 30 janvier 2013
3
Comité scientifique : Driss Ablali (Université de Franche-Comté) Zinelabidine Benaissa (Université de la Manouba) Malika Boussahel (Université de Sétif) Jean-Marc Defays (Université de Liège) Jean-Pierre De Giorgio (Université de Clermont-Ferrand) Dominique Ducard (Université de Paris 12) Nelly Feuerhahn (CNRS) Françoise Gadet (Université de Paris Ouest, Nanterre) Corinne Giordano (Université de Montpellier III) Jean-François Jeandillou (Université de Paris Ouest Nanterre) Samia Kassab (Université de Tunis) Mohamed Khélifi (Université de la Manouba) Francis Lacoste (Université de Bordeaux III) Sylvain Loiseau (Université de Paris 13) Mongi Madini (Université de Franche-Comté) Marie-Anne Paveau (Université de Paris 13) Frédéric Pugnière-Saaverdra (Université de Bretagne Sud) Mokhtar Sahnoun (Université de la Manouba) Judith Stora-Sandor (Université de Paris 8) Frédérique Sitri (Université de Paris Ouest Nanterre) Comité d’organisation : Olfa Abdelli (Université de Tunis) Anis Abrougui (Université de Gafsa) Hassen Bkhairia (Université de Gafsa) Mokhtar Farhat (Université de Gafsa) Corinne Giordano (Université de Montpellier III) Léda Mansour (MoDyCo, Université de Paris Ouest Nanterre) Dorsaf Nahdi (Université de Gafsa) [Réduire] Contact : mogf2000@gmail.com |
Du 04 au 05 Decembre 2012 :
 |
Toponymie et anthroponymie en Algérie : politique et pratique. 50 ans après l’indépendance Oran (Algérie) - CRASC Le Crasc et l’Université d’Alger II organisent, dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, au travers des trois Projets PNR :
- Toponymie et normalisation des noms de lieux : usages et orthographes officiels en Algérie
- Anthroponymie et é... [Afficher la suite] Le Crasc et l’Université d’Alger II organisent, dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, au travers des trois Projets PNR :
- Toponymie et normalisation des noms de lieux : usages et orthographes officiels en Algérie
- Anthroponymie et état civil : nomination et écriture(s) des patronymes en Algérie
- Les prénoms algériens : mode d’attribution et socialisation
Un séminaire national sur la toponymie et l’anthroponymie algérienne.
Depuis l’indépendance, des efforts nationaux sont fournis pour mettre en place des systèmes de dénomination nationale intégrée. Beaucoup de ces actions ont été, d’abord et surtout, en réaction à une large entreprise historique de déstructuration et restructuration des modes de nomination traditionnelle algérienne et / ou maghrébine menée par l’armée et l’administration coloniales.
La présente rencontre a pour centre d’intérêt les volets historique, linguistique, géographique, sociologique, psychologique, anthropologique et littéraire de cette articulation multiforme qu’est la toponymie ou les noms de lieux, l’anthroponymie ou les noms de personnes.
Il faut rappeler que la toponymie et l’anthroponymie couvrent la grande masse des noms de lieux et de personnes avec toutes les catégories qu’elles supposent : les oronymes (noms de montagnes), les hydronymes (noms de cours d’eau), les odonymes (noms de rues), les patronymes, les prénoms, les surnoms, les sobriquets, les pseudonymes, etc.
Il faut aussi gérer cette masse de désignations, plusieurs millions de noms propres de lieux et de personnes, non seulement comme objet d’étude pour les historiens et les géographes par exemple, mais aussi pour les fonctions économiques, sociales, culturelles, patrimoniales qu’elle remplit : culture, tourisme, sécurité, secours, aviation, cadastre, communication, économie, territoire, postes, etc. Sa législation fait l’objet dans tous les pays du monde d’une large concertation entre les institutions pour sa préservation, son recensement périodique, son enrichissement, et particulièrement pour sa normalisation.
Sur un plan institutionnel, le premier rôle de la toponymie et de l’anthroponymie est de permettre l’identification, le repérage rapide, et en toute sécurité, d’un lieu ou d’une personne donnés. C’est pourquoi des règles bien établies consacrent l’attribution, la modification, le changement des noms propres de lieux et de personnes. Il devait en être de même pour leur(s) écriture (s). Dans le contexte de la mondialisation, autant la mobilité des hommes et des biens est permise, autant la mobilité orthographique n’est plus tolérée.
La normalisation de l’écriture des noms de lieux et de personnes est soumise, depuis quelques années, à de fortes
tensions économiques, commerciales, sécuritaires, géopolitiques et géostratégiques, de plus en plus soutenues par
un arsenal technologique de pointe : Google Earth, Euronames, GPS, pièces d’identité biométriques, etc.
Des efforts nationaux à caractère institutionnel, scientifique et technique ont été enregistrés au cours des dernières
années tels que la création d’une structure nationale d’expertise (Commission permanente spécialisée de
toponymie) sous l’égide du CNIG en 1998, l’inscription de la toponymie parmi les axes prioritaires dans les PNR
(Programmes nationaux de recherche) en 1999 et 2010 ; la réalisation d’une série d’actions au niveau de l’Institut
National de Cartographie et de Télédétection (INCT), une banque de données des toponymes officiels (Crasc), la mise
en place de plusieurs équipes de recherche (Oran, Constantine, Tlemcen…) et la réalisation de travaux à caractère
universitaire sur l’onomastique (toponymie, anthroponymie, enseignes commerciales, dénomination des produits,
contrefaçon, onomastique littéraire, etc.) : ouvrages, articles, mémoires de licence et de magister, thèses de
doctorat. La dernière action, unique en son genre, est la création officielle d’une Unité de recherche sur les systèmes
de dénomination en Algérie (RASYD/Crasc).
Le présent séminaire va permettre, à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie:
- premièrement, de rassembler tous les chercheurs algériens ayant travaillé sur les questions de
de/nomination ;
- deuxièmement, de dresser un état de l’art, rétrospectif d’abord et prospectif après, sur les politiques et les
usages de la toponymie et de l’anthroponymie en Algérie, toutes disciplines confondues, en faisant ressortir
les invariants structurants de cette identité nationale onomastique, dont la « filiation est établie depuis la
plus haute antiquité » (Lacheraf, 1999), dans ses dimensions plurilingues, multilingues, culturelles et
symboliques les plus fécondes. Y seront également soumis à l’analyse les types de dysfonctionnements
structurels et conjoncturels qu’il faut constamment revisiter, eu égard à l’apparition de nouveaux
comportement dénominatifs (formels et/ ou informels), à l’avènement de nouveaux résultats de recherche
mais également suite à l’introduction de technologie moderne dans la gestion des noms de personnes et des
lieux ;
- troisièmement, de recentrer le débat en apportant un éclairage sur les raisons historiques relatives à la
multiplicité des écritures des noms de lieux et de personnes en Algérie, que d’aucun considère comme
source de dysfonctionnements institutionnels, donc de préjudices économique, administratif mais aussi
social et psychologique (état civil, notariat, justice, sécurité routière…).
Le présent séminaire se fixe comme objectifs :
1. d’établir un bilan de l’état des noms de lieux et de personnes en Algérie, de leurs gestions
institutionnelles (juridique, administrative, linguistique, technique…) : mode de création, transmission,
changement, transcription, translittération…
2. d’exposer les résultats des travaux de recherche universitaire sur la toponymie et l’anthroponymie
algérienne (CRASC, Universités de Mostaganem, Oran, Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif, Constantine, Tlemcen,
Alger, Sidi Bel Abbes…) au travers des différentes approches mises en oeuvre : linguistique,
géographique, historique, anthropologique, juridique, sémiotique, littéraire…
3. de mettre à niveau les institutions nationales utilisatrices de la toponymie sur les dernières dispositions
en matière de législation internationale (système de translittération arabe) ;
4. de créer la société savante « Société algérienne d’onomastique ».
Les axes de réflexion
- Le patrimoine algérien des noms propres
- La gestion coloniale du patrimoine onomastique algérien
- Les institutions nationales et les écritures des noms propres algériens
- La toponymie et l’anthroponymie algériennes: quelques résultats de recherche
- L’onomastique dans la littérature algérienne (avant et après l’indépendance)
- La toponymie et les SIG
- Toponymie, état civil et territoire
- Etat civil et écriture des anthroponymes algériens
- La normalisation des noms de lieux : les expériences internationales
COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION :
BENGHABRIT REMAOUN NOURIA
HENNI ABDELKADER
BENRAMDANE FARID
YERMECHE SADATE OUERDIA
BOUMEDIENI DADOUA NEBIA
BRAHIM ATOUI
Date limite d’envoi des propositions de communication : 15 septembre 2012
Pour tout contact, s’adresser :
f-benramdane@univ-mosta.dz
ouerdiayermeche@yahoo.fr
dadouanebia@yahoo.fr
www.crasc-dz.org [Réduire] |
Du 27 au 28 Septembre 2012 :
 |
La question du paysage dans les littératures africaines Paris (France) - Université Paris-3 Organisées par Xavier Garnier et Pierre Halen, ces journées auront lieu vendredi 28 septembre à la Maison de la Recherche de Paris 3 (4 rue des Irlandais 75005 Paris) et samedi 29 septembre à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, salle Las Vergnas (3e étage) .
Considérant que le pays... [Afficher la suite] Organisées par Xavier Garnier et Pierre Halen, ces journées auront lieu vendredi 28 septembre à la Maison de la Recherche de Paris 3 (4 rue des Irlandais 75005 Paris) et samedi 29 septembre à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, salle Las Vergnas (3e étage) .
Considérant que le paysage est aussi une façon de donner de la mémoire à un lieu, ou de constituer le lieu en lieu de mémoire, il sera intéressant d’étudier comment le paysage (colonial/post-colonial) a pu servir, sur le long terme, à la fois à donner une visibilité au continent et à spécifier son africanité. [Réduire] |
Du 08 au 15 Juin 2013 :
| |
27e Congrès du Conseil International d’Études Francophones Grand Baie (Ile Maurice) |
Du 14 au 15 Mars 2013 :
| |
« Voyage(s)», Xe Colloque International d’Études Francophones, Timisoara (Roumanie), CIEFT, les 15-16 mars 2013 Timisoara (Roumanie) - Université de l'Ouest de Timisoara, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie Argumentaire
On a longtemps vu traiter le voyage dans une perspective strictement géographique et territoriale ou, dans le meilleur des cas, comme aventure de l’esprit, accompagnée d’enrichissement de connaissances.
Le colloque de Timisoara souhaite mettre en lumière les réseaux humains, ... [Afficher la suite] Argumentaire
On a longtemps vu traiter le voyage dans une perspective strictement géographique et territoriale ou, dans le meilleur des cas, comme aventure de l’esprit, accompagnée d’enrichissement de connaissances.
Le colloque de Timisoara souhaite mettre en lumière les réseaux humains, l’autoscopie, les démarches scripturales et psychologiques, les configurations / les métaphores de la route (de la chaussée, du chemin, de la voie, du sentier) et les connexions conceptuelles qui expliquent la métamorphose du voyage en une transversalité aussi intérieure qu’extérieure qui permette un abord au moins interdisciplinaire, sinon transculturel. Le sens de cette transformation est que voyager chez les romantiques n’est pas la même chose que chez les postmodernes, tout comme le voyage du mot / de la parole en sémantique n’équivaut pas toujours à la circulation des vocables d’une langue à l’autre.
Le colloque va réunir, espérons-le, des spécialistes du thème du « voyage », ainsi que d´autres experts des domaines de la littérature et de la culture qui jusqu´ici se sont moins penchés sur ce sujet.
La problématique de cette réunion continue en quelque sorte le thème généreux de l’édition 2012 du colloque, « Passeurs de mots », qui a ébauché des figurations possibles du voyageur, du guide, du messager, de l’éclaireur, du médiateur, du traducteur, etc. illustrés par des lectures d’œuvres représentatives du vaste corpus littéraire d’expression française ou dans des recherches lexicographiques ou terminologiques.
Nous envisageons le voyage dans une lecture plurielle et polygonale, invitée à être faite de manière non-exclusive :
• Comme aventure dans des itinéraires touristiques de plaisir, dans des espaces climatiques et géographiques délimités ;
• Comme aventure de l’esprit ;
• Comme le dernier voyage / le trépas au-delà ;
• Comme aventure picaresque ;
• Comme chemin vers les tréfonds de l’âme, auto-interrogation et autoscopie ;
• Comme eau coulante, fleuve, rivière, source ;
• Comme occasion de connaître l’autre : aimer l’autre par le voyage intérieur vers lui ;
• Comme nomadisme, déplacements, altérité dans le corpus littéraire francophone ;
• Comme devenir du personnage (démarche scripturale) ;
• Comme devenir de l’homme (démarche psychologique) ;
• Comme déterritorialisation, immigration et identités ;
• Configurations / métaphores de la route, du chemin, de la voie, du sentier, du fleuve, de l’embouchure des eaux coulantes et dormantes ;
• Comme acquisitions de connaissances (entrée didactique) : la démarche pédagogique que l’enseignant propose à l’apprenti.
Une attention particulière sera accordée aux typologies des formes de voyages :
• Voyage intérieur vs. extérieur ;
• Voyage des paroles et des écritures / des gens / des choses, des marchandises ;
• Voyage dans ce monde et / ou vers l’au-delà.
Une carte anthropologique du voyage ne sera pas complète sans
• les « institutions » du voyage (en particulier la réception du livre, la traduction, la communication, la confession, etc.) et
• les moyens du voyage.
Concrètement, le programme du colloque proposera, après les conférences plénières d’ouverture, d´aborder la dimension culturelle du voyage dans des sections divisées en plusieurs sous-parties, en adoptant des perspectives diverses axées sur la transdisciplinarité.
- Littératures
- Linguistique
- Didactique du FLE/FOS /FOU
- Traductologie
- Communication
Orateurs invités confirmés :
• Mohamed Daoud, CRASC Oran, Algérie
• Trond Kruke Salberg, Université d’Oslo, Norvège
D’autres conférenciers seront ajoutés à cette liste dans les prochaines semaines.
Présidente d’honneur du colloque
Mme Eugenia Arjoca-Ieremia, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timisoara
Comité scientifique
Eugenia Arjoca-Ieremia, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Brigitte Bercoff Denker, Maître de conférences, Université Aix-Marseille, France
Mohamed Daoud, Professeur des universités, CRASC Oran, Algérie
Snežana Gudurić, Professeur des universités, Université de Novi Sad, Présidente ALAS, Serbie
Emilie Hilgert, Maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne, France
Elena Ghiţă, Maître de conférences, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Mircea Morariu, Professeur des universités, Université d’Oradea, Roumanie
Floarea Mateoc, Maître de conférences, Université d’Oradea, Roumanie
Anda Radulescu, Professeur des universités, Université de Craiova, Roumanie
Trond Kruke Salberg, Professeur des universités, Université d’Oslo, Norvège
Maria Tenchea, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Estelle Variot, Maître de conférences, Université Aix-Marseille, France
Raïa Zaïmova, Professeur des universités, Université « Saint Clément d’Ohrid » de Sophia, Bulgarie
Présidente du colloque
Ramona Malita, Université de l’Ouest de Timişoara
Comité d'Organisation
Andreea Gheorghiu, Ramona Malita, Mariana Pitar, Ioana Marcu, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara.
Secrétaire du colloque
Dana Ungureanu
Modalités
Il y a deux façons de faire des propositions sur un thème ou sur une section dans le colloque:
1. Proposer une communication individuelle.
2. Proposer une session complète (3-4 participants) qui consiste à choisir un axe d’étude proposé dans l’argument du colloque et d’y insérer 3-4 titres touchant à la même problématique. Veuillez indiquer le titre de votre session complète entre parenthèses.
Calendrier
– 15 septembre 2012 : envoi des propositions de titres de communication et des résumés, ainsi que du formulaire d’inscription (fiche personnelle).
– 1er octobre 2012 : notification d’acceptation.
Bulletin d’inscription
à renvoyer par courriel à
• gheorghiu.andreea@gmail.com (pour les propositions concernant la didactique, la communication et la traductologie)
• malita_ramona@yahoo.fr (pour les propositions concernant la littérature)
• pitarmariana@yahoo.fr (pour les propositions concernant la linguistique)
avant le 15 septembre 2012
Nom:
Prénom:
Intitulé de la communication:
Section du colloque :
Affiliation:
Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) :
E-mail:
Adresse professionnelle:
Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos : Oui ou non
Résumé en français (200 - 250 mots)
Notice bio-bibliographique (10 lignes)
Frais d’inscription au colloque :
• 50 euros (payables en RON pour les participants de Roumanie). Les frais d’inscription comprennent la participation au Colloque, la documentation, les pauses-café, deux déjeuners, ainsi que la publication des actes du Colloque.
À noter
• Le temps prévu pour chaque communication est de 20 minutes, suivie d’une discussion de 10 minutes.
Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique.
• La langue de travail du Colloque est le français.
• Les renseignements complémentaires sont accessibles sur le site du Colloque et dans la deuxième et la troisième circulaires du colloque.
http://www.litere.uvt.ro/publicatii/CIEFT/index.htm
• Pour toute question sur le Colloque, merci de contacter Mme Dana Ungureanu danamariaungureanu@yahoo.com [Réduire] |
Du 18 au 20 Septembre 2012 :
| |
Saint-John Perse, Aimé Césaire, Edouard Glissant : Regards croisés Paris (France) - UNESCO, BN, Maison de l'Amérique Latine Colloque international organisé par l’Institut du Tout-Monde
sous le haut patronage de l’UNESCO
UNESCO / Bibliothèque nationale de France / Maison de l'Amérique Latine
Sous la direction de Loïc Céry. La date d’ouverture du colloque, le 19 septembre, coïncide avec la date anniversaire ... [Afficher la suite] Colloque international organisé par l’Institut du Tout-Monde
sous le haut patronage de l’UNESCO
UNESCO / Bibliothèque nationale de France / Maison de l'Amérique Latine
Sous la direction de Loïc Céry. La date d’ouverture du colloque, le 19 septembre, coïncide avec la date anniversaire du Congrès des
Ecrivains et Artistes noirs de 1956. Au frontispice de nos travaux, nous nous devions de commémorer
cet événement majeur dont Césaire et Glissant furent des acteurs essentiels et qui marqua les
consciences pour longtemps.
Le colloque mettra en regard de manière inédite les oeuvres de Saint-John Perse, Césaire et Glissant.
Le déroulement prévu pour les séances durant les trois journées d’études déclinera la perspective comparatiste choisie comme mode d’appréhension des oeuvres : décryptage des implications
éthiques, confrontation à la richesse des entrelacs de trois visions du monde (de l’universalisme
persien et césairien à la Relation glissantienne), herméneutique d’une mise en dialogue intertextuelle,
puis considérations esthétiques.
Notre colloque s’achèvera le 21 septembre, autre date anniversaire importante, celle de la naissance
d’Edouard Glissant. En guise d’hommage aux trois poètes, nous avons prévu de clôturer ces journéespar une grande soirée poétique à la Maison de l’Amérique latine, une « Traversée des archipels de laparole » qui célébrera la poésie et son incandescence. [Réduire] |
Du 17 au 18 Avril 2013 :
| |
"DES LIEUX ALTERNATIFS". Colloque international pluridisciplinaire Rabat (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Rabat DES LIEUX ALTERNATIFS
Exil- exotisme- colonisation…
Mémoire – identité – hégémonie…
Colloque international pluridisciplinaire
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Rabat
18-19 Avril 2013
Organisé par le Département de Langue et de Littérature Françaises :
G... [Afficher la suite] DES LIEUX ALTERNATIFS
Exil- exotisme- colonisation…
Mémoire – identité – hégémonie…
Colloque international pluridisciplinaire
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Rabat
18-19 Avril 2013
Organisé par le Département de Langue et de Littérature Françaises :
Groupes de recherche : « Littérature et Histoire » (GRLH), « Littérature Française, Francophone et Comparé » (LIFFEC), « Arts et Littérature » (GRAL)
En partenariat avec
Le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Cultures en Contact (GRICC) –
Université de Moncton - Canada
La question du territoire propre et du territoire de l’autre semble avoir marqué, depuis toujours et sous différentes formes et actualisations, la conscience littéraire, philosophique et artistique. Dans sa dimension symbolique et ses implications éminemment culturelle, historique et politique, cette question se laisse mieux cerner à travers la notion de lieu, qui permet de croiser diverses perspectives dans les sciences humaines, et dont on peut formaliser ici certaines manifestations, autour de trois motifs abstraits : quête, conquête et perte de lieu.
L’archétype Odysséen, récit des origines s’il en était, de l’exil et du retour à la terre natale, demeure à ce titre un motif premier qui préside à de nombreuses expériences de représentation où le passage par des lieux autres réveille la nostalgie d’un lieu, unique et irremplaçable, avec lequel le sujet confond son identité, au risque de la perdre. Or, celle-ci est-elle une donnée invariable que l’on laisse derrière soi, et dont le retour au lieu d’origine favoriserait le recouvrement ? La mémoire n’empêcherait-elle pas peut-être la rencontre et l’identification avec d’autres lieux possibles? La quête poétique du vrai lieu serait-elle un dépassement du lieu tangible comme métaphysique aliénante ? Dans le même sillage, comment la Raison pratique, qui peut s’affirmer dans la pensée la plus éclairée, peut s’opposer à de tels élans créatifs et ramener l’identité aux critères de territoire et de frontières ?
Inversement, dans la démarche exotique et/ou hégémonique, telles qu’elles se dégagent surtout des récits à caractère ethnographique, et malgré les différences qui les caractérisent, un jeu de superposition des lieux est à l’œuvre, soit pour célébrer une différence radicale, aux antipodes des habitudes du regard qui note et s’étonne, soit pour ramener cette différence à une référence irréductible et centrale. Derrière le jeu de célébration de la différence lui-même, on peut parfois reconnaître une attitude de décentrage de l’autre lieu qui trahit une centralité foncière du lieu référentiel et une posture d’hégémonie. La constatation de la diversité et la fascination qu’elle peut provoquer s’accompagnent-elles pour autant d’une reconnaissance de la différence et de l’éventualité d’autres lieux et modes d’être ? Aussi, le regard colonial n’est-il pas dans son essence une mise en crise, par interférence et transposition, de l’identification du colonisé à son propre lieu ? Décoloniser l’imaginaire, comme ce fut le projet de nombreux auteurs et penseurs du Sud, ne revient-il pas à restituer le lien absent au lieu présent, im-médiatement saisissable ?
L’expérience du lieu peut encore prendre la forme complexe du décalage et de la mise en suspens. Le sujet porteur de cette conscience problématique du lieu opère une sorte de double négation : de l’espace d’origine comme de l’espace de destination. Il le fait soit par choix responsable de flottement identitaire (exil volontaire par exemple), soit par déterminisme historique (le cas des écrivains issus de l’immigration). Surgissent dès lors des formes inédites de non-appartenance : ambigüité culturelle ou hybridité, maintien stratégique dans l’entre-deux ou quête de la troisième voie, celle du non-lieu notamment (universalisme, devenir-monde, créolisation globale).
Ces trois modes expérientiels du lieu, eux-mêmes issus de divers contextes historiques, culturels et politiques disions-nous, ponctuellement déterminables, affectent à leur tour l’art et la littérature - si ces derniers ne les devancent et ne les annoncent pas, comme c’est souvent le cas avec des auteurs visionnaires. Ils en sont la problématisation la plus aboutie et la plus parlante. Aussi, convient-il dans le cadre de ce colloque de restituer au lieu sa véritable dimension de cadre de pensée et d’horizon de création. C’est-à-dire d’enjeu majeur, d’hier, d’aujourd’hui comme de demain. Sans réduire la notion de lieu à son acception spatiale première, nous nous demanderons éventuellement comment différents écrivains, artistes et praticiens des sciences humaines ont pensé le lieu ou se sont laissés dominer par les multiples aspects et effets du ou des lieux. Comment la prégnance de cette notion de lieu, sous son jour énonciatif, se laisserait-elle saisir à travers les diverses productions discursives, politiques et médiatiques notamment, trahissant des jeux de domination, de rejet ou de stigmatisation, soit en somme des jeux de privation de lieu ? Comment, en définitive, ces productions discursives peuvent elles-mêmes être productrices de territoires et de lieux, plus comme savoirs construits que comme données empiriques ?
Plusieurs axes transversaux, possibles et non exhaustifs, sont ici à envisager:
- Les effets du lieu : Départ vs retour – répulsion vs nostalgie, célébration vs occultation, identification vs distanciation, assignation vs libération, etc.
- Récits et représentations du lieu : mémoire, généalogie, oublis, etc.
- Lieu, discours et altérité : fascination – tentation – domination, substitution, superposition, transfiguration, etc. ;
- Lieu et tension identitaire : neutralité – ambiguïté – ambivalence discursive - « dés-appartenance » - marquage et démarquage ethnique - entre-deux, globalité, etc.
Objectif du colloque :
Ce colloque se veut pluridisciplinaire ; il a pour objectif de conjuguer des perspectives pertinentes et d’inciter à un débat constructif autour d’une problématique au carrefour des pratiques et des savoirs.
Comité d’organisation :
Hassan Moustir - Mourad Ali-Khodja - Ijou Cheikh Moussa - Jamal Eddine El Hani - Jean Morency - Houda Benmansour - Salima Khattari
Comité scientifique :
- Driss ABLALI (CREM, Université de Lorraine – France)
- Mourad ALI-KHODJA (GRICC, Université de Moncton - Canada)
- Rhida BOURKHIS ( Professeur au Département de Français, Université de Sousse – Tunisie)
- Pascale CASANOVA (CRAL-EFISAL , EHESS, Paris - France)
- Ijou CHEIKH MOUSSA (LIFFEC, Faculté des Lettres de Rabat - Maroc)
- Fathallah DAGHMI, (Migrinter - Université de Poitiers – France)
- Jamal Eddine EL HANI (GRLH, Faculté des Lettres de Rabat - Maroc)
- Hafid GAFAÏTI (CMLL, Université de Texas - USA)
- Miyna KAPTAN-BELKORA (GRAL, Faculté des Lettres de Rabat - Maroc)
- Salima KHATTARI (LIFFEC, Faculté des Lettres de Rabat - Maroc)
- Fouad LAROUI (Chair Group Romanic Languages and Cultures, Université d’Amsterdam – Pays-Bas)
- Jean MORENCY (Professeur au Département d'études françaises, Université de Moncton - Canada)
- Hassan MOUSTIR (GRLH, Faculté des Lettres de Rabat - Maroc)
- Youssef OUAHBOUN (GRAL, Faculté des Lettres de Rabat - Maroc)
- Régine ROBIN (Département de sociologie, UQAM - Canada)
- Tarik SABRY (CAMRI, Université de Westminster, Londres, Royaume-Uni)
- Mohammed SALHI (Vice-doyen chargé des études supérieures, de la recherche scientifique et de
la coopération, Faculté des Lettres de Rabat – Maroc)
Modalité de soumission des propositions :
- Un résumé en rapport avec l’un des axes du colloque (de 250 mots environ) et une brève notice biobibliographique (fonction actuelle, aperçu sur le parcours académique, principales publications en rapport avec le sujet du colloque :10 lignes max.) sont à envoyer à l’adresse colloque.des.lieux.alternatifs@gmail.com avant le 05 janvier 2013
- Afin de faciliter le travail du comité scientifique, il serait souhaitable d’envoyer les propositions bien avant cette date.
Notification d’acceptation ou de refus :
- La décision du comité scientifique sera communiquée aux auteurs des propositions autour du 15 février 2013
- Le délai de rigueur pour l’envoi des textes des communications, en vue de la publication des actes, sera annoncé dans l’avis d’acceptation, avec un complément d’information sur l’organisation du colloque.
Prise en charge :
Les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par les organisateurs. Par contre, les frais de voyage et de déplacement sont à la charge des participants ou de leurs laboratoires d’attache.
Inscription au colloque :
Les frais d’inscription au colloque, payables sur place, sont de l’ordre de :
- 100 euros pour les participants de l’extérieur du Maroc (75 pour les doctorants)
- 500 dhs pour les nationaux (300 dhs pour les doctorants)
Pour toute information complémentaire sur le colloque, contacter : moustir@hotmail.com [Réduire] |
Du 30 Juin au 06 Juillet 2012 :
| |
Alger (Algérie) - Complexe culturel Laadi Flici Mercredi 4 juillet
«En compagnie de l’homme, de tous
les hommes».
9h-11h
Modérateur : Abdeltif Rebah
Intervenants :
Mohamed Hafez Dyab (Egypte)
La leçon de Fanon : mémoire non
sujette à l’oubli
Lies Boukra (Algérie)
Identité et conscience nationale
chez Fanon
Githa Hariharan ... [Afficher la suite] Mercredi 4 juillet
«En compagnie de l’homme, de tous
les hommes».
9h-11h
Modérateur : Abdeltif Rebah
Intervenants :
Mohamed Hafez Dyab (Egypte)
La leçon de Fanon : mémoire non
sujette à l’oubli
Lies Boukra (Algérie)
Identité et conscience nationale
chez Fanon
Githa Hariharan (Inde)
Résistance par l’écriture : évoquer Fanon
en contexte indien
Aminata Dramane Traoré (Mali)
Actualité de la pensée de Frantz Fanon
11h30-13h
Modérateur : Abdelhak Benouniche
Intervenants :
Mohamed Bouhamidi (Algérie)
De l’aliénation chez Fanon
Idriss Terranti (Algérie)
Fanon et la naissance de la psychiatrie
algérienne
Alice Cherki (France)
Orphelins de Fanon ?
13h00-14h00 : Débat
14h00 : Clôture de la rencontre
Esprit Frantz Fanon
Du 6 au 9 juillet 2012
Dans le cadre magnifique et historique
de Dar Abdellatif, des rencontres inédites
sur les traces de Frantz Fanon, à travers
des lectures littéraires et l’échange d’idées.
Des romanciers et poètes présentent leurs
oeuvres et les mettent en correspondance,
en miroir ou en écho avec des textes
du grand penseur et militant, lequel a
influencé et inspiré maints auteurs dans
le monde. Des soirées dédiées à sa
mémoire sur les registres de la réflexion
et de l’émotion.
Vendredi 6 juillet
17h -18h 30
« Il ne suffit pas de rejoindre le peuple dans
ce passé où il n’est plus (...)»
Modératrice : Samia Zennadi
Tierno Monénembo (Guinée)
Eugène Ebodé (Cameroun)
Jean-Luc Raharimanana (Madagascar)
Githa Hariharan (Inde)
Yabrir Smail (Algérie)
Samedi 7 juillet
17h -18h 30
« Reprenons la question
de l’homme (…) »
Modérateur : Youcef Merahi
Alice Cherki (France)
Asmaa Azaiza (Palestine)
Sami Tchak (Togo)
Fawzi Karim (Irak)
Iskandar Habach (Liban)
Esprit Frantz Fanon, Rencontres
d’Alger, du 2 au 4 juillet 2012
« Non, nous ne voulons rattraper
personne. Mais nous voulons marcher tout
le temps, la nuit et le jour, en compagnie
de l’homme, de tous les hommes ».
Lundi 2 juillet
8h - 9h
Esprit Frantz Fanon
Inauguration de la manifestation
Ouverture de la rencontre
« Nous ne voulons rattraper personne…»
9h30 - 11h
Modérateur : Omar Lardjane
Intervenants :
Samir Amin (Egypte)
Frantz Fanon en Afrique et en Asie
Aijaz Ahmed (Inde)
Frantz Fanon : le philosophe
révolutionnaire
Mireille Fanon Mendès-France
(France)
Les bombes à retardement du colonialisme,
une lecture de Fanon
11h30 - 13h
Modérateur : Mohamed Hennad
Intervenants :
Ehsan Shariati (Iran)
L’Algérie comme modèle universel
de libération, selon Fanon
Tarik Ali (Pakistan)
Fanon, Guevara : «médecins
sans frontières»
Tierno Monénembo (Guinée)
Le blues de l’indigène
13h00 - 14h00 : Débat
Mardi 3 juillet
«Nous voulons marcher tout le temps…»
9h-10h30
Modérateur : Daho Djerbal
Intervenants :
Georges Corm (Liban)
Relire Fanon pour mieux comprendre
le monde arabe
Bernard Founou-Tchuigoua
(Cameroun)
Auto-décolonisation :
Fanon avait-il raison ?
Prabir Purkayashta (Inde)
La nation à l’heure de la mondialisation
11h-12h30
Modérateur : Zoubir Arous
Intervenants :
Helmy Shaaraoui (Egypte)
Les révoltes populaires actuelles
à la lumière de Fanon
Padmanabhan Krishna Murthy
(Inde)
Fanon : le penseur révolutionnaire
universaliste
Khairi Mansour (Palestine)
Fanon : l’idée d’une révolution audacieuse
12h30 – 13h30 : Débat
Complexe culturel Laâdi Flici [Réduire] |
Du 30 Juin au 02 Juillet 2012 :
| |
Algérie 50 ans après: libérer l'histoire Alger (Algérie) - Bibliothèque nationale PROGRAMME
Dimanche 1 juillet 2012
OUVERTURE : 08H30
Séance 01 : 09h00-11h00
Présidente : KHADDA Naget
ELSENHANS Hartmut : Illusions françaises dans la guerre d'Algérie et nostalgies d'antan dans son historiographie versus structures d'une décolonisation inévitable.
DIAWARA ... [Afficher la suite] PROGRAMME
Dimanche 1 juillet 2012
OUVERTURE : 08H30
Séance 01 : 09h00-11h00
Présidente : KHADDA Naget
ELSENHANS Hartmut : Illusions françaises dans la guerre d'Algérie et nostalgies d'antan dans son historiographie versus structures d'une décolonisation inévitable.
DIAWARA Manthia : De la Nation au panafricanisme.
EL KORSO Mohamed : Libérer l’histoire : une question de méthode.
SIBLOT Paul : Nécessité et conditions d’une réflexion commune sur l’histoire des rapports franco-algériens
ABANE Belaïd : L'indépendance 50 ans après. Comment aller au-delà des deux moments fondateurs de l'état national algérien moderne : Novembre et la Soummam ?
Pause café
Séance 02 : 11h30-13h00
Président : MONNOYER Jean - Maurice
BENAOUM Ahmed : Mémoire, identité, sciences du passé et pouvoirs
BANCEL Nicolas : Réception en France des études postcoloniales.
BOUMAZA Nadir : Réflexion sur les processus d'historicisation du fait colonial et de la guerre de libération.
TOUILI Mohammed : Exemplarité et actualité du combat du F.L.N durant la Guerre de libération nationale (1954-1962).
SIARI- TENGOUR Ouanassa et SOUFI Fouad : Les mémoires de l’Histoire.
Pause déjeuner
Séance 03 : 14h30-16h00
Président : BANCEL Nicolas
PERRENOUD Marc : Historiographie suisse sur la guerre d’Algérie.
TAUBERT Fritz : Contribution à la recherche sur le phénomène de décolonisation : la situation diplomatique entre RFA, RDA, France et Algérie en guerre.
MELASUO Tuomo : La Guerre d’Algérie et la sensibilisation des pays nordiques à la décolonisation.
AZIZA Mimoun : Le Maroc et la guerre d’indépendance algérienne.
BEKKOUCHE Hédi : La Tunisie et la guerre d’indépendance algérienne.
Pause café
Séance 04 : 16h30-18h30
Président : EL KORSO Mohamed
CHACHOUA Kamel : Emigration vers la France et structures coloniales en Algérie.
CARLIER Omar : La réunion des 22, sociologie de groupe et logique de l'action.
CHEKKAT Rafik : Tradition des opprimés, histoire et critique de la notion de progrès chez Frantz Fanon et Walter Benjamin.
FANON Olivier : Pourquoi Frantz Fanon dérange-t-il 51 ans après ?
SALEM Jean : L'Algérie dans le parcours d'intellectuels français : (Derrida, Labica …)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lundi 2 juillet 2012
Séance 05 : 09h00-11h00
Présidente : BENDANA Kmar
LASZLO Nagy : L’indépendance : renaissances nationale et sociale. Quel projet de société pour l’Algérie et les pays du tiers-monde dans les années 1960 ?
GUIGNARD Didier : Appréhender la colonisation foncière au-delà du face à face franco-algérien.
BESSAOUD Omar : La paysannerie algérienne dans l'agriculture coloniale
ALI-BENALI Zineb : Les femmes d’Algérie dans les luttes et les résistances nationales. Quel genre d’histoire?
PALLADINO Paola : Mémoire et silence sur la participation des femmes à la lutte de libération nationale
Pause café
Séance 06 11h30-13h00
Président : MELASUO Tuomo
DERRAS Omar : Participation sociale et vitalité associative en Algérie.
BELAÏD Habib : La "société civile", en Tunisie : rupture et continuité (époque coloniale et postcoloniale)
FATES Youcef : L'état des lieux du mouvement sportif en 1962: héritage et reconstruction
AÏT-EL-DJOUDI Dalila : Le cas des prisonniers de l'ALN
BELHADEF Soraya : Sur les manifestations de décembre 1960
Pause déjeuner
Séance 07 14h30-16h00
Président : AZIZA Mimoun
MANCERON Gilles : La nécessaire reconnaissance par la France des crimes de la colonisation et la remise en cause des histoires officielles
MAUSS- Copeaux Claire : Au delà des représentations partisanes et des dénis actuels, comment construire un récit historique ? L’exemple du 20 août 1955 et de ses suites.
MONNOYER Jean - Maurice : De l'état de guerre à l'Etat souverain : réflexion sur la souveraineté dans le cadre de l'histoire algérienne depuis 1830".
BENDANA Kmar : Les mémoires politiques : naissance et contours d’un genre
MEDJAOUI Abdel'alim : Itinéraire d’un universitaire dans les rangs du Front et de l’Armée de libération nationale
Pause café
Séance 08 16h30-18h30
Président : MANCERON Gilles
BROWER Benjamin : Le Hadj durant la période coloniale.
MEBAREK BEN ALLEL Sid Ahmed : Récit de la mort de Mohammed Ben Allel le 11 nov. 1843
KCHIR Khaled : Lectures d’Ibn Khaldoun aux XIX et XXème siècles.
CHIBOUH Brahim : Que reste-t-il des tribus décrites par Ibn Khaldoun ?
Mardi 03 juillet 2012
Séance 09 09h00-11h00
Président : SIBLOT Paul
DIAKHATE Lydie : L'histoire pour mémoire et l'autonomie de l'art.
MEDIENE Benamar : Arts vivants comme représentations de la société et de l'Algérien.
CHOMINOT Marie : L'indépendance par l'image.
CHOUKROUN Jacques : Cinéma de la guerre
DENIS Sébastien : Des images pour libérer l'histoire
Pause café
Séance 10 11h30-13h00
Président DIAWARA Manthia
YELLES-CHAOUCH Mourad : Identité nationale et patrimoine littéraire en Algérie
KHADDA Naget : les écrivains de la décennie 50 : écrivains de la conscience nationale.
TENGOUR Habib : Parcours de poésie en Algérie de 1972 à 1994
BOUAYED Anissa : Le don des peintres à l’Algérie en 1964 : espoirs et déconvenues d’une internationale de l’art ?
MAUROUARD Elvire : La Présence d'Haïti au Premier Festival Panafricain d'Alger de 1969
Pause déjeuner
Séance 11 14h30-16h00
Président : ELSENHANS Hartmut
HADDAB Mustapha : Pour une histoire de la question linguistique
BENRAMDANE Farid : Dénomination, Transition et institutions en Algérie
ATOUI Brahim : Sur la toponymie
YERMECHE Ouarda : Patronymie : du syndrome nominal à la carence nominative.
ZEMOULI Yasmina : Etat civil et patronymisation.
Pause café
Séance 12 16h30-18h30
Président BEKKOUCHE Hédi
MERDACI Abdelmadjid : La question du départ des Pieds-Noirs en 1962
DAUM Pierre : Les « Pieds-Noirs » restés en Algérie en 1962
JEBAHI Mabrouk : La jeunesse et la perception du nationalisme en Tunisie
HADJ ALI Smaïl : Le traitement de la « crise algérienne » de la décennie 1990 par la sphère savante française.
SAMARA ADEL :
Clôture des travaux
1 [Réduire] |
Du 28 au 30 Mai 2013 :
| |
Situations des poésies de langue française Cergy-Pontoise (France) - Université APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque 29-30-31 mai 2013
Situations des poésies de langue française
Centre de Recherche Textes et Francophonies (EA1392) – Université de Cergy-Pontoise
Comité organisateur : Corinne Blanchaud (M.C.F. U.C.P. CRTF (EA1392)), Cyrille François (Docteur U.C.P. C... [Afficher la suite] APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque 29-30-31 mai 2013
Situations des poésies de langue française
Centre de Recherche Textes et Francophonies (EA1392) – Université de Cergy-Pontoise
Comité organisateur : Corinne Blanchaud (M.C.F. U.C.P. CRTF (EA1392)), Cyrille François (Docteur U.C.P. CRTF (EA1392)), Serge Martin (M.C.F.H.D.R. U.C.B.N. LASLAR (EA 4256))
Comité scientifique : Christiane Chaulet Achour (Professeure – U.C.P.), Violaine Houdart-Mérot (Professeure – U.C.P.), Daniel Lançon (Professeur – U. Stendhal-Grenoble III), Jacques Paquin (Professeur – U. Trois-Rivières, Québec, Canada), Patrick Quillier (Professeur – U. Nice-Sophia Antipolis), Alain Ricard (CNRS – LLACAN/UMR 8135), Matthias Zach (Post-doc. U. Tübingen, RFA).
Argumentaire :
La littérature de langue française des pays du Sud comme du Nord est le plus souvent appréhendée à travers la prose romanesque, premier champ d’investissement à la fois de l’engagement éditorial à la mesure de l’attente du public , et de la critique universitaire et journalistique. Cependant, la poésie demeure très vivante et diffusée, soit presque « intimement », par les voies secrètes de petites maisons d’édition ou de revues qui s’y consacrent, soit, avec plus d’éclat, par la consécration enfin accordée par de grandes maisons d’édition gloires souvent posthumes ou bien trop tardives pour les poètes , ou grâce aux retombées des modes musicales dont elle bénéficie peu ou prou quoiqu’avec force confusion, soit, enfin, à travers des sites internet créés le plus souvent par les poètes eux-mêmes qui trouvent dans ce nouveau média une occasion de faire entendre leur voix de façon autonome.
Ce colloque a donc pour objectif, d’une part, d’attirer l’attention sur des productions poétiques singulières et en grande partie ignorées du public, et dont la mise en lumière permettrait de modifier l’appréhension critique d’un patrimoine littéraire de langue française (patrimoine local, national, déterminé par zones géographiques ou périodes de l’Histoire), d’autre part, de présenter, dans leur diversité, les rapports que la poésie entretient avec les pouvoirs économique (le marché du livre), culturel (la grande diffusion, notamment à travers l’oralité : musique et diverses manifestations publiques), politique (l’institutionnalisation et la patrimonialisation, la résistance, l’engagement, etc.).
Quatre axes d’étude sont proposés :
1. État des lieux théorique et critique : cet axe invite à interroger l’histoire récente de la production théorique et critique (auctoriale, universitaire et journalistique) des deux dernières décennies sur la poésie. On s’intéressera, par exemple, à l’influence théorique et critique, dans l’appréhension de ce genre, des discours de la négritude, de la créolisation, ou de divers manifestes (Manifeste du Groupe du lundi, Légitime défense, Refus global, etc.).
2. Parcours de la poésie de langue française : cet axe abordera les œuvres et leurs auteurs selon des perspectives poétiques et/ou d’histoire de la littérature, tout en éclairant le domaine théorique et critique constitué à partir des œuvres (cf. axe 1). Ayant pour objet de livrer un aperçu singulier de la production poétique des différents pays (ou zones géographiques) concernés, il privilégiera l’intérêt porté à des œuvres – et des auteurs peu ou mal connues, peu ou mal diffusées.
3. La diffusion écrite et la réception, revues, maisons d’éditions et productions matérielles : cet axe sera consacré au champ éditorial concerné par la poésie, au statut et à la diffusion variables selon les pays. L’étude de la genèse des revues ou des maisons d’éditions, de leur évolution et de leur impact (les publics), mais aussi des choix éditoriaux qui déterminent autant la matérialité que la fréquence de la présence de la poésie sur le marché du livre (livres d’artistes à diffusion sélective, collections consacrées à la poésie, anthologies…etc.) sera son principal objet. Celle des publics et des modes de réception devrait également éclairer la diversité des approches culturelles déterminées par l’histoire spécifique à chaque pays (telle la place particulièrement importante accordée à la poésie au Québec, par exemple).
4. Politique et poésie : cet axe d’étude est proposé dans la continuité du précédent. Il entend approfondir les relations que la poésie entretient avec la société en s’intéressant autant à l’institutionnalisation et la patrimonialisation d’œuvres poétiques qu’à leur diffusion à grande échelle par le biais de manifestations collectives consacrées. Il étudiera tout particulièrement l’appréhension inévitablement restreinte et politiquement (culturellement) orientée d’une œuvre qu’engendrent de telles consécrations.
Les propositions de communication doivent parvenir à :
coblanchaud@yahoo.fr
cyrille.francois@laposte.net
serge.martin@unicaen.fr
Avant le 30 septembre 2012. [Réduire] Contact : coblanchaud@yahoo.fr |
Du 28 au 30 Mai 2012 :
| |
Situations des poésies de langue française Cergy Pontoise (France) - Université APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque 29-30-31 mai 2013
Situations des poésies de langue française
Centre de Recherche Textes et Francophonies (EA1392) – Université de Cergy-Pontoise
Comité organisateur : Corinne Blanchaud (M.C.F. U.C.P. CRTF (EA1392)), Cyrille François (Docteur U.C.P. C... [Afficher la suite] APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque 29-30-31 mai 2013
Situations des poésies de langue française
Centre de Recherche Textes et Francophonies (EA1392) – Université de Cergy-Pontoise
Comité organisateur : Corinne Blanchaud (M.C.F. U.C.P. CRTF (EA1392)), Cyrille François (Docteur U.C.P. CRTF (EA1392)), Serge Martin (M.C.F.H.D.R. U.C.B.N. LASLAR (EA 4256))
Comité scientifique : Christiane Chaulet Achour (Professeure – U.C.P.), Violaine Houdart-Mérot (Professeure – U.C.P.), Daniel Lançon (Professeur – U. Stendhal-Grenoble III), Jacques Paquin (Professeur – U. Trois-Rivières, Québec, Canada), Patrick Quillier (Professeur – U. Nice-Sophia Antipolis), Alain Ricard (CNRS – LLACAN/UMR 8135), Matthias Zach (Post-doc. U. Tübingen, RFA).
Argumentaire :
La littérature de langue française des pays du Sud comme du Nord est le plus souvent appréhendée à travers la prose romanesque, premier champ d’investissement à la fois de l’engagement éditorial à la mesure de l’attente du public , et de la critique universitaire et journalistique. Cependant, la poésie demeure très vivante et diffusée, soit presque « intimement », par les voies secrètes de petites maisons d’édition ou de revues qui s’y consacrent, soit, avec plus d’éclat, par la consécration enfin accordée par de grandes maisons d’édition gloires souvent posthumes ou bien trop tardives pour les poètes , ou grâce aux retombées des modes musicales dont elle bénéficie peu ou prou quoiqu’avec force confusion, soit, enfin, à travers des sites internet créés le plus souvent par les poètes eux-mêmes qui trouvent dans ce nouveau média une occasion de faire entendre leur voix de façon autonome.
Ce colloque a donc pour objectif, d’une part, d’attirer l’attention sur des productions poétiques singulières et en grande partie ignorées du public, et dont la mise en lumière permettrait de modifier l’appréhension critique d’un patrimoine littéraire de langue française (patrimoine local, national, déterminé par zones géographiques ou périodes de l’Histoire), d’autre part, de présenter, dans leur diversité, les rapports que la poésie entretient avec les pouvoirs économique (le marché du livre), culturel (la grande diffusion, notamment à travers l’oralité : musique et diverses manifestations publiques), politique (l’institutionnalisation et la patrimonialisation, la résistance, l’engagement, etc.).
Quatre axes d’étude sont proposés :
1. État des lieux théorique et critique : cet axe invite à interroger l’histoire récente de la production théorique et critique (auctoriale, universitaire et journalistique) des deux dernières décennies sur la poésie. On s’intéressera, par exemple, à l’influence théorique et critique, dans l’appréhension de ce genre, des discours de la négritude, de la créolisation, ou de divers manifestes (Manifeste du Groupe du lundi, Légitime défense, Refus global, etc.).
2. Parcours de la poésie de langue française : cet axe abordera les œuvres et leurs auteurs selon des perspectives poétiques et/ou d’histoire de la littérature, tout en éclairant le domaine théorique et critique constitué à partir des œuvres (cf. axe 1). Ayant pour objet de livrer un aperçu singulier de la production poétique des différents pays (ou zones géographiques) concernés, il privilégiera l’intérêt porté à des œuvres – et des auteurs peu ou mal connues, peu ou mal diffusées.
3. La diffusion écrite et la réception, revues, maisons d’éditions et productions matérielles : cet axe sera consacré au champ éditorial concerné par la poésie, au statut et à la diffusion variables selon les pays. L’étude de la genèse des revues ou des maisons d’éditions, de leur évolution et de leur impact (les publics), mais aussi des choix éditoriaux qui déterminent autant la matérialité que la fréquence de la présence de la poésie sur le marché du livre (livres d’artistes à diffusion sélective, collections consacrées à la poésie, anthologies…etc.) sera son principal objet. Celle des publics et des modes de réception devrait également éclairer la diversité des approches culturelles déterminées par l’histoire spécifique à chaque pays (telle la place particulièrement importante accordée à la poésie au Québec, par exemple).
4. Politique et poésie : cet axe d’étude est proposé dans la continuité du précédent. Il entend approfondir les relations que la poésie entretient avec la société en s’intéressant autant à l’institutionnalisation et la patrimonialisation d’œuvres poétiques qu’à leur diffusion à grande échelle par le biais de manifestations collectives consacrées. Il étudiera tout particulièrement l’appréhension inévitablement restreinte et politiquement (culturellement) orientée d’une œuvre qu’engendrent de telles consécrations.
Les propositions de communication doivent parvenir à :
coblanchaud@yahoo.fr
cyrille.francois@laposte.net
serge.martin@unicaen.fr
Avant le 30 septembre 2012. [Réduire] |
Le 28 Juin 2012 :
| |
Littérature et révolution dans le monde Paris (France) - Université Paris 13 CENEL (Centre d'Etude des Nouveaux Espaces Littéraires) Ce projet vise à penser à travers des textes littéraires les événements étonnants qui ont marqué le début du XXI℮ siècle à l’échelle globale. Notre but est de valoriser l’apport des œuvres littéraires à notre compréhension des transformations internationales. Via l’his... [Afficher la suite] Ce projet vise à penser à travers des textes littéraires les événements étonnants qui ont marqué le début du XXI℮ siècle à l’échelle globale. Notre but est de valoriser l’apport des œuvres littéraires à notre compréhension des transformations internationales. Via l’histoire des années 1971-2011, nous essayerons de mieux comprendre les rapports entre production culturelle et mouvements socio-politiques comme éléments annonciateurs d’une future révolution. Ci-dessous quelques pistes de réflexion :
1. Débuts et fins de l’idée révolutionnaire : quels sont les idées clés qui ont dirigé les révolutions de 2011 ? Quel rapport ont-elles avec les révolutions du 20e siècle ?
2. Comment les écrivains ont-ils accompagné les événements ? Quel avenir pour les écrivains dans le processus de démocratisation ?
3. Qu’en est-il de l’engagement littéraire aujourd’hui ? La littérature peut-elle être une arme politique ?
4. L’humour révolutionnaire a-t-il un avenir littéraire ?
5. Journalisme, nouveaux médias et littérature
6. Les écrivains communistes
7. Eros et révolution
8. Littérature contre préjugés
9. Littérature et patriarcat occidental
Participants: Ziad Elmarsafy (Université de York) ; Anne Larue (Paris 13-CENEL), Marc Kober (Paris 13-CENEL), Guillaume Bridet (Paris 13-CENEL), Alain Messaoudi (EHESS), Mustapha Ben Taïbi (Paris 5); Bénédicte Letellier (Université de la Réunion).
Lieu : Université Paris 13, Campus Villetaneuse, LSHS, Salle D. 116 RDC couloir D (à droite entrée)
99, Avenue J.B. Clément 93430 Villetaneuse.
Transport : Ligne transilien H Gare du Nord, direction « Luzarches » ou « Pontoise ». Arrêt « Epinay-Villetaneuse ». un train tous les 15 mn. Durée : 8 mn. Bus navette 156 (356) arrêt « Université Paris 13 » 5mn.
Contact : marc.kober@wanadoo.fr ou ziad12@gmail.com
Tél : 06 89 49 78 29
Site du CENEL : http://www.univ-paris13.fr/cenel/index.php [Réduire] |
Du 17 au 19 Avril 2013 :
| |
Interpréter selon les genres Marrakech (Maroc) - Université Interpréter selon les genres
18-20 Avril 2013
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Driss ABLALI, CREM, Université de Lorraine (France)
Sémir BADIR, FNRS, Université de Liège (Belgique)
Ayoub BOUHOUHOU, Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc)
Dominique DUCARD, CEDITEC, Université ... [Afficher la suite] Interpréter selon les genres
18-20 Avril 2013
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Driss ABLALI, CREM, Université de Lorraine (France)
Sémir BADIR, FNRS, Université de Liège (Belgique)
Ayoub BOUHOUHOU, Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc)
Dominique DUCARD, CEDITEC, Université de Paris-Est (France)
Ouidad TEBBAA, Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc)
Ce colloque a pour objectif de répondre à la question du genre, longtemps cantonnée aux intérêts
taxinomiques, de manière à en faire une catégorie essentielle pour l’interprétation. Pourquoi avonsnous
besoin des genres ? Comment cette catégorie est-elle construite par l’esprit humain pour
comprendre des films, des émissions de télévision, des tableaux, des spots publicitaires, des articles de
presse, des textes littéraires, des discours publics, des messages dans des réseaux sociaux, parmi bien
d’autres productions langagières ?
Certes, la réponse à cette question varie en fonction du point de vue théorique adopté. Le concept de
genre s’est développé en effet dans de nombreuses disciplines en sciences humaines, avec des
pratiques qui ne se posent pas les mêmes problèmes épistémologiques ni heuristiques. Rares cependant
aujourd’hui sont les disciplines à n’y avoir pas recouru. Notamment, la notion est utilisée et discutée
de longue date dans les études littéraires, en histoire de l’art et en théorie du cinéma ; elle a également
refait surface avec une certaine vigueur ces dernières années en sciences du langage et en sciences de
l’information et de la communication. Le but du colloque sera d’abord de délimiter le champ théorique
de la notion de genre telle qu’elle a été produite par la pratique scientifique des sciences humaines,
telle aussi qu’elle bute encore devant des problèmes théoriques variés, suivant les différentes
disciplines. Il s’agira moins de définir des règles de production ou de déterminer des catégories
définitoires et classificatoires que de poser la question du genre dans le processus de reconnaissance et
d’interprétation, en orientant la réflexion et les études de cas du point de vue de la réception (horizons
d’attente, habitudes, préconstruits culturels, cadre cognitif, circuit de communication,…), le genre
étant alors envisagé comme un ensemble de contraintes ou de conditions de possibilités du sens.
En sciences du langage, les théories linguistiques, sémiotiques, sociolinguistiques et didactiques
partent généralement du postulat selon lequel le genre textuel outrepasse les limites du visible.
« Suprasegmental », « intertextuel » ou « transtextuel », le genre est une construction mentale,
objectivable selon l’analyste à travers des traces, des configurations structurelles, des connexions entre
le texte et son entour. Dans tous les cas, le genre fait brèche sur la clôture du texte. Quels sont les
principes essentiels qui, dans les différents cadres théoriques, régissent son dégagement objectif ? En
dehors du postulat mentionné ci-dessus, on constate que les disciplines ne font pas intervenir les
mêmes catégories descriptives pour lier genre et interprétation : ancrage social, régularités
syntaxiques, caractéristiques énonciatives et stylistiques, marqueurs discursifs et lexicaux, facteurs
compositionnels, contraintes techniques et situationnelles, etc.
Le disparate des propriétés susceptibles de définir le genre s’accroît encore quand on envisage d’autres
produits culturels que les textes écrits. Bien qu’il constitue indéniablement un outil heuristique
particulièrement opératoire, le genre suppose une ouverture au monde au delà de l’analyse de l’oeuvre
considérée. Ainsi, dans les théories littéraires, les études cinématographiques comme dans les modèles
interprétatifs issus des sciences de l’information et de la communication, le genre invite à considérer
des catégories aussi étendues que celles de la culture, de la cognition, de l’idéologie, des lois sociales,
de l’esthétique, ou de la technique.
On souhaite que ce colloque international et pluridisciplinaire rende compte des enjeux et des objectifs
propres aux théories en sciences humaines cherchant à lier, systématiquement ou subtilement,
interprétation et genre dans l’analyse des oeuvres. Ce colloque sera aussi l’occasion de revenir sur la
genèse de cette notion, d’en interroger les usages, et de dégager ses limites.
Plusieurs questions particulières, mentionnées ici sans exclusive, peuvent être envisagées comme
source d’interaction entre interprétation et genre :
– Le genre est-il une catégorie homogène ?
– La catégorie du genre est-elle pertinente pour toutes les formes sociales et culturelles
d’herméneutique ?
– Le sous-genre aide-t-il lui aussi à l’interprétation ou est-il un simple moyen taxinomique ?
– Y a-t-il des oeuvres sans genre ?
– Qu’en est-il des textes poly-génériques ?
– Que devient le genre dans l’histoire de la transformation interprétative des textes et des images
(réécriture, traduction, adaptation, transposition) ?
– Sur quels observables se base-t-on pour l’attribution du genre ?
– Comment les variables linguistiques de l’usage, de la variété et des registres de langue
peuvent-elles devenir des marqueurs sociaux propres au genre dans lequel les locuteurs
communiquent ?
– Quelle est la place des genres en didactique comme outil d’enseignement et d’apprentissage de
la langue et de la littérature ?
– Dans les études cinématographiques, à côté des découpages par auteurs, mouvements et styles,
que peut apporter une catégorie comme le genre ?
– Quelle est la part des classes génériques de l’histoire des arts dans le commentaire interprétatif
d’une oeuvre artistique (par ex. en peinture les genres constitués en référence à la religion, la
mythologie, l’histoire, la vie sociale et domestique, le paysage)?
– Genre, discours, média, pratique : quels rapports ?
– Comment interpréter dans les nouveaux dispositifs de communication (forums, blogs, réseaux
sociaux, chats, etc.) l’émergence de nouvelles pratiques langagières ?
Autant de questions, théoriques et pratiques, qui sont dans le droit fil du rapport entre interprétation et
genre. Ce colloque cherchera à rendre compte de l’état de l’art du travail accompli, de sa diversité,
mais aussi, en s’appuyant sur des propositions théoriques et heuristiques, à proposer de nouvelles
catégories descriptives nécessaires à la quête du sens.
Comité scientifique
Paul Aron, Université Libre de Bruxelles, Belgique
Guy Achard-Bayle, Université de Lorraine, France
Anouar Ben Msila, Université Moulay Ismail de Meknès, Maroc
Alpha Ousmane Barry, Université de Franche-Comté, France
Jean-Pierre Bertrand, Université de Liège, Belgique
Anne Beyaert-Geslin, Université de Bordeaux III, France
Jacqueline Billiez, Université de Stendhal Grenoble III, France
Ivã Carlos Lopes, Université de São Paulo, Brésil
Claude Cortier, Université de Lyon II, France
Fathallah Daghmi, Université de Poitiers, France
Emmanuelle Danblon, Université Libre de Bruxelles, Belgique
Patrick Haillet, Université de Cergy-Pontoise, France
Jean-François Jeandillou, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, France
Hayat Kertaoui, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc
Nathalie Kremer, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, France
Massimo Leone, Université de Turin, Italie
Juan Manuel López Muñoz, Université de Cadix, Espagne
Leila Messoudi, Université Ibn Toufeil de Kénitra, Maroc
Hadj Miliani, Université de Mostaganem, Algérie
Raphaëlle Moine, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, France
Sophie Moirand, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, France
Hassan Moustir, Université Mohammed V, Maroc
Lena Mouratidou, Université de Paris Nord, France
Marie-Anne Paveau, Université Paris Nord, France
André Petitjean, Université de Lorraine, France
Stéphan Polis, Université de Liège, Belgique
Olivier Pulvar, Université des Antilles et de la Guyane, La Martinique
François Provenzano, Université de Liège, Belgique
Alain Rabatel, Université de Lyon I, France
Nathalie Roelens, Université de Luxembourg, Luxembourg
Abdelhai Sadiq, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc
Françoise Sullet-Nylander, Université de Stockholm, Suède
Ouidad Tebbaa, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc
Gian Marie Tore, Université de Luxembourg, Luxembourg
Conférenciers invités :
Patrick CHARAUDEAU, Université de Paris Nord, France
Dominique COMBE, ENS, Paris, France
Jacques FONTANILLE, Université de Limoges, France
François JOST, Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle, France
Institutions organisatrices :
Le laboratoire de recherche, Culture, Patrimoine et Tourisme, Université Cadi Ayyad de Marrakech.
Le pôle Praxitexte du CREM, Université de Lorraine.
L’équipe de recherche CEDITEC, Université de Paris-Est Créteil.
Le laboratoire Sciences du langage et Rhétorique, Université de Liège.
Modalités de soumission des communications :
Les propositions de communication devront être adressées par voie électronique à :
genre.marrakech2013@gmail.com avant le 20 octobre 2012.
Les articles soumis décriront un travail original et novateur. Les contributions devront contenir un état
de l’art et des références à des travaux antérieurs pertinents. Le résumé sera accompagné d’une page
de renseignements pratiques comprenant : nom, affiliation, téléphone, adresse postale et électronique.
Les résumés (ne dépassant pas 3000 signes) doivent être en Times 12 avec interligne simple et en
format .doc (Word) ou .rtf. Les contributions feront l’objet d’une double évaluation anonyme par le
comité scientifique. Le retour des propositions de contributions sera communiqué le 20 janvier 2013,
et le programme du colloque sera diffusé le 1er mars 2013.
Langues des communications : français
Modalités d’inscription :
Le comité d’organisation a établi les tarifs suivants relatifs à l’inscription au colloque :
Plein tarif : 80 euros
50 euros pour les étudiants
Les frais d’inscription sont à régler le 1er jour du colloque. Ses frais comprennent :
la participation à toutes les séances du colloque
le cocktail d’accueil
les 3 déjeuners
les pauses cafés
Contact colloque :
Comité d’organisation : genre.marrakech2013@gmail.com [Réduire] Contact : genre.marrakech2013@gmail.com |
Du 25 au 26 Septembre 2012 :
| |
Journées d’études Francophonie – Rapports de puissance, rapports de pouvoir & Francophonie – Identités et appartenances Lyon (France) - Université Lyon 3 Programme provisoire
Mercredi 26 septembre 2012
Francophonie - Rapports de puissance, rapports de pouvoir
9h30 : Accueil des participants
Conférence introductive : Christian Philip - Le multilinguisme et le forum mondial de la langue
française
10h-13h15 : Première table ronde « Puissance, ... [Afficher la suite] Programme provisoire
Mercredi 26 septembre 2012
Francophonie - Rapports de puissance, rapports de pouvoir
9h30 : Accueil des participants
Conférence introductive : Christian Philip - Le multilinguisme et le forum mondial de la langue
française
10h-13h15 : Première table ronde « Puissance, influence et prédominance en Francophonie »
Présidence : Frédéric Ramel
Conférence introductive : Frédéric Charillon (à confirmer)
� Joseph Maïla - La Francophonie politique
� Frédéric Ramel - L’influence francophone
� François David - La rivalité entre l’influence française et américaine au Vietnam entre 1954 et
1960
11h15-11h30 : Pause
� Frédéric Turpin - Jacques Foccart et les méthodes d'une présence française en Afrique
� Khanh Toan Nguyen - Les valeurs culturelles traditionnelles et la légitimité comme sources de la
puissance du Vietnam pendant la deuxième guerre du Vietnam (1954-1973)
� Gwenaëlle Calcerrada - Le caractère idéologique du concept de « soft power »
12h30-13h : Débats
13h-14h30 : Déjeuner
14h30-17h30 : Deuxième table ronde « Espace francophone et institutions européennes »
Présidence : Bernard Bruneteau
Conférence introductive : Bernard Bruneteau
� Guillaume de Thieulloy - La France au sein des institutions européennes (Conseil européen,
Commission, Conseil de l’Union européenne et BCE)
� Guillaume Bernard - L’influence francophone au sein du Parlement européen
� Xavier North - La place de la langue française dans l’Union européenne
15h45-16h00 : Pause
� François-Xavier Priolaud - Que reste-t-il de l'influence francophone en Europe ? (à confirmer)
� Bernard Lecherbonnier - Les différentes voies de la politique d’influence (lobbying) dans le
processus européen recoupent-t-elles des fractures culturelles et linguistiques ?
� Christophe Réveillard - La gouvernance européenne comme outil d’influence conceptuelle.
Origine anglo-saxonne et sémantique d’entreprise
17h-17h30 : Débats
Jeudi 27 septembre 2012
Francophonie - Identités et appartenances
9h30 : Accueil des participants
10h-13h15 : Première table ronde « Francophonie et identités multiples »
Présidence : Guy Lavorel
Conférence introductive : Michel Guillou
� Caroline Piquet - L’identité nationale en Egypte
� Paul Kun - Les identités partagées en Roumanie et, en particulier, l’identité francophone en
Roumanie
� Alioune Dramé, Trang Phan - La composante francophone dans les identités sénégalaise et
vietnamienne
11h15-11h30 : Pause
� Leila Rezk - De l’ambigüité identitaire au repli culturel dans le Machrek arabe
� Trang Phan - Etude de la composante francophone des identités nationales des pays de la
Francophonie
� Guy Lavorel - Le problème des identités dans la littérature francophone d’Amérique du Nord
12h30-13h : Débats
13h-14h30 : Déjeuner
14h30-17h30 : Deuxième table ronde « Francophonie et appartenances partagées »
Présidence : Jacques Frémeaux
Conférence introductive : Jean Tabi Manga
� Aurore Sudre - Les appartenances partagées en Francophonie
� Christophe Réveillard, Philippe Delisle - De la Révolution tranquille aux Accommodements
raisonnables
� Albert Lourde - L’Université Senghor d’Alexandrie, à la croisée des appartenances partagées
francophones
15h45-16h : Pause
� Samia Kassab Charfi - Les appartenances partagées dans le monde arabo-musulman
� Sarah Boukri - Identités multiples et appartenances partagées au Maroc
� Joëlle Le Morzellec - Appartenances partagées en Europe centrale et orientale
17h-17h30 : Débats [Réduire] |
Du 15 au 16 Novembre 2012 :
| |
Ecrire la guerre, écrire le conflit Lille (France) - Université Lille 3 Écrire la guerre se réduit-il à écrire sur la guerre ? A faire du conflit ou de la lutte armée une thématique privilégiée ? Ecrire la guerre, n’est-ce pas se demander quelle part l’écriture elle-même prend au polemos antique ? C’est-à-dire au conflit fondamental qui semble constitu... [Afficher la suite] Écrire la guerre se réduit-il à écrire sur la guerre ? A faire du conflit ou de la lutte armée une thématique privilégiée ? Ecrire la guerre, n’est-ce pas se demander quelle part l’écriture elle-même prend au polemos antique ? C’est-à-dire au conflit fondamental qui semble constitutif de la nature (humaine) elle-même et de l’Histoire.
Proposer un tel sujet de réflexion en vue d’un travail de recherche réalisé en commun et en transversalité, appelé à se tenir à l’Université de Lille, a un sens dans une région qui a été un enjeu stratégique à l’échelle européenne depuis Charles Quint jusqu’à la Première Guerre mondiale. Par-delà l’hommage aux écritures de la guerre directement en prise sur le passé de la région, on cherchera surtout à explorer les aspects esthétiques, voire philosophiques et historiographiques d’une problématique qui, issue de la pensée métaphysique, se laisse également formuler en des termes transhistoriques.
Quelques pistes d’étude possibles peuvent être indiquées d’emblée de façon non limitative :
- Les rapports entre guerre et idéologie, la relation entre conflits et pensée, guerre et mémoire, la littérature du témoignage engendrée par les guerres et donc la question du savoir de la guerre ; et symétriquement, la question du non savoir, de l’informulable, de l’inarticulé véhiculés par le texte ; ou encore la manière dont les écritures de guerre mettent en œuvre, ouvertement ou sourdement, divers procédés destinés à contester, voire à invalider les discours qui prétendent à tort ou à raison rapporter l’expérience du conflit à l’horizon du vrai.
- Le rôle joué par la littérature dans le déroulement de la guerre, autrement dit l’impact des textes engagés (qu’ils soient bellicistes ou pacifistes), et l’éclairage ainsi jeté sur la dimension pragmatique de l’écriture, sur la littérature entendue comme modalité de l’action et sur la réponse qu’apporte la société, contemporaine ou non de la guerre.
- Le rapport entre la guerre et la problématique de la représentation. Les militaires parlent par métaphore du « théâtre des opérations » ; inversement, la guerre a traditionnellement fourni à la littérature une de ses thématiques privilégiées, que ce soit dans le genre épique, narratif ou dramatique ; ou encore à d’autres mediums comme le cinéma et la bande dessinée.
- La question du représentable et de ses limites : l’horreur contraint à penser le rapport entre la violence et sa représentation autrement qu’en termes de reproduction mimétique et/ou de prise de distance esthétisante, ce qui n’est pas sans entraîner des répercussions éthiques et politiques.
- La place de l’individu face à la guerre, le lien entre écriture de guerre et écriture de soi (autobiographie, autoportrait, autofiction, journal intime ou pratique épistolaire) ; la part de la charge affective impliquée dans le témoignage, celle de l’engagement en lien avec la question du sujet, de sa persistance face à l’adversité, de son auto-affirmation héroïque ou du pressentiment de sa finitude.
- La circulation des idées et leur réception spécifique en période de guerre, leurs effets sur les échanges culturels – du stéréotype propagandiste au discours littéraire. Dans quelle mesure ces transferts peuvent-ils se maintenir, voire se renforcer, et quels en sont les enjeux ?
Colloque organisé par les équipes d’accueil ALITHILA et CECILLE. Les interventions, après évaluation par le comité scientifique, pourront faire l’objet d’une publication par les laboratoires organisateurs.
Comité scientifique : Norah Dei Cas, Fiona McIntosh-Varjabédian, Joëlle Prungnaud, Toshio Takemoto, Serge Rolet, Bernard Bach, Mathieu Duplay, Bruno Monfort.
Comité organisateur : Fiona McIntosh-Varjabédian, Joëlle Prungnaud, Serge Rolet, Toshio Takemoto
Merci d’adresser votre proposition de contribution (200 à 300 mots) accompagnée d’un bref CV à fiona.mcintosh-varjabedian@univ-lille3.fr et serge.rolet@univ-lille3.fr
avant le 20 juin 2012
Pour tout renseignement supplémentaire : stephanie.debrandt@univ-lille3.fr
ou jean-francois.delcroix@univ-lille3.fr [Réduire] Contact : stephanie.debrandt@univ-lille3.fr ou jean-francois.delcroix@univ-lille3.fr |
Du 06 au 13 Juillet 2012 :
| |
Lagrasse (France) - L'Abbaye de Lagrasse Translations est le premier volet d’un programme d’échanges entre auteurs, chercheurs, traducteurs et étudiants américains, marocains et français, proposé par L’école de littérature. Il se déroulera successivement à Lagrasse, Casablanca et New York en 2012 et 2013. Il s’ouvre sur un... [Afficher la suite] Translations est le premier volet d’un programme d’échanges entre auteurs, chercheurs, traducteurs et étudiants américains, marocains et français, proposé par L’école de littérature. Il se déroulera successivement à Lagrasse, Casablanca et New York en 2012 et 2013. Il s’ouvre sur une résidence de traductions, du 7 au 14 juillet 2012, à Lagrasse en France.
Les candidats sélectionnés pour participer à cette résidence travailleront avec des traducteurs et des écrivains confirmés sur des textes ou des auteurs non encore traduits dans une ou deux des autres langues et sur des projets expérimentaux. Différents ateliers seront quotidiennement proposés, correspondant notamment aux diverses combinaisons possibles (arabe/français, français/anglais, anglais/arabe, etc.) Les participants pourront choisir, selon leurs intérêts et leurs compétences linguistiques, de suivre un ou plusieurs ateliers durant la semaine. Le programme exact de ces différents ateliers sera en ligne à la fin du mois d'avril.
Parallèlement à ces travaux, douze écrivains français, américains, marocains, répartis en quatre trios vont traduire leurs propres textes, pour une expérience originale de traduction collaborative. Certains de ces écrivains dirigeront en outre quelques-uns des ateliers proposés aux participants.
Des séances de réflexion collective sur les travaux en cours seront organisées chaque jour. Seront aussi proposées en fin de journée à destination du public des séances de lecture des traductions réalisées, des débats et des conférences sur la traduction, sur la circulation littéraire et les dynamiques de traduction entre le Maroc, les Etats-Unis et la France et sur différentes situations de la littérature contemporaine dans ces trois pays.
Cette résidence fera l’objet d’une publication.
Intervenants
Sinan Antoon, Latifa Baqa, Omar Berrada, Jocelyn Bonnerave, Siham Bouhlal, Abdelmoumen Chentouf, Robyn Creswell, Anissa Derrazi, Mohamed Elkhadiri, Mohamed Hmoudane, Bernard Hoepffner, Hugues Jallon , Laird Hunt, Sarah Riggs, Lily Robert-Foley, David Ruffel, Lionel Ruffel, Tiphaine Samoyault, Kenza Sefrioui, Eleni Sikelianos, Camille de Toledo, Hamid Zaid, Abdallah Zrika, etc. [Réduire] |
Du 13 au 21 Juin 2012 :
 |
FELIV D'ALGER festival du Livre Alger (Algérie) - Esplanade Riadh El Feth Algérie Dans le cadre du 5ème Festival International de la Littérature et du Livre de Jeunesse (FELIV) qui se tiendra du 14 au 22 juin 2012 à l’esplanade de Riad El Feth, un concours de nouvelles dans les trois langues (arabe, tamazight, français) est lancé à partir du 20 avril 2012 pour le... [Afficher la suite] Algérie Dans le cadre du 5ème Festival International de la Littérature et du Livre de Jeunesse (FELIV) qui se tiendra du 14 au 22 juin 2012 à l’esplanade de Riad El Feth, un concours de nouvelles dans les trois langues (arabe, tamazight, français) est lancé à partir du 20 avril 2012 pour les algériens et algériennes de 18 à 30 ans et résidant en Algérie. [Réduire] |
Le 08 Juin 2012 :
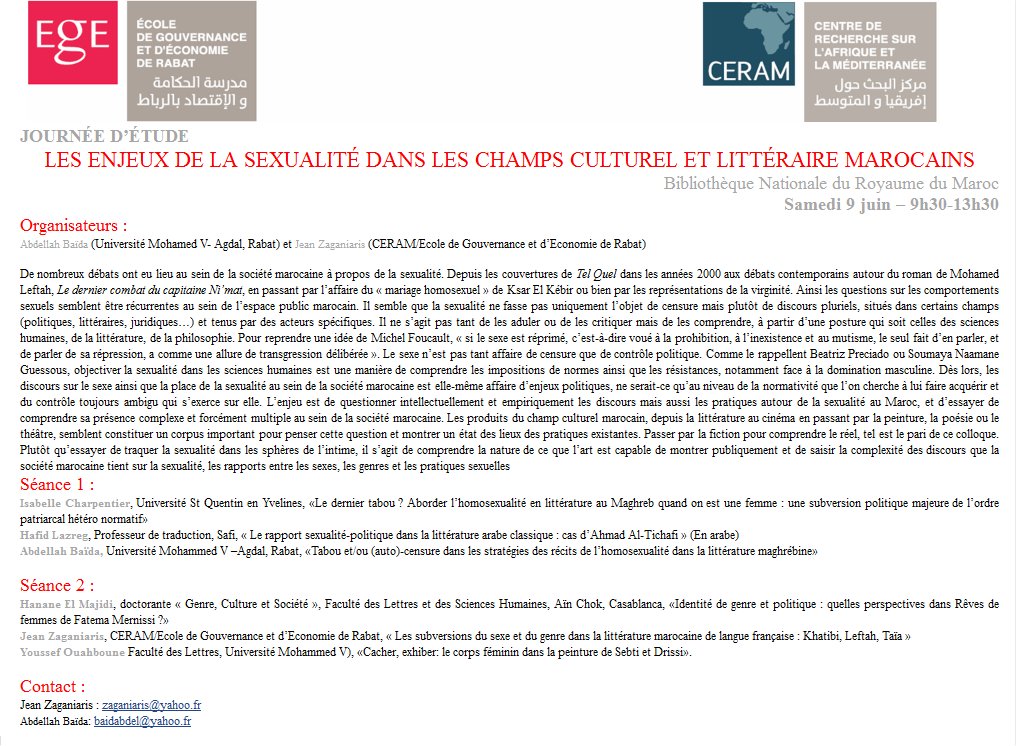 |
Les Enjeux de la sexualité dans les champs culturel et littéraire marocains Rabat (Maroc) - Bibliothèque Nationale (Salle de conférences) - Rabat samedi 9 juin2012 09:30 à 13:30
JOURNÉE D’ÉTUDE: LES ENJEUX DE LA SEXUALITÉ DANS LES CHAMPS
CULTUREL ET LITTÉRAIRE MAROCAINS
Organisateurs : Abdellah Baïda (Université Mohamed V- Agdal, Rabat) et Jean Zaganiaris (CERAM/Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat).
De nombre... [Afficher la suite] samedi 9 juin2012 09:30 à 13:30
JOURNÉE D’ÉTUDE: LES ENJEUX DE LA SEXUALITÉ DANS LES CHAMPS
CULTUREL ET LITTÉRAIRE MAROCAINS
Organisateurs : Abdellah Baïda (Université Mohamed V- Agdal, Rabat) et Jean Zaganiaris (CERAM/Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat).
De nombreux débats ont eu lieu au sein de la société marocaine à propos de la sexualité. Depuis les couvertures de Tel Quel dans les années 2000 aux débats contemporains autour du roman de Mohamed Leftah, Le dernier combat du capitaine Ni’mat, en passant par l’affaire du « mariage homosexuel » de Ksar El Kébir. Il semble que la sexualité ne fasse pas uniquement l’objet de censure mais plutôt de discours pluriels, situés dans certains champs (politiques, littéraires, juridiques…) et tenus par des acteurs spécifiques.Il ne s’agit pas tant de les aduler ou de les critiquer mais de les comprendre, à partir d’une posture qui soit celles des sciences humaines, de la littérature, de la philosophie. Pour reprendre une idée de Michel Foucault, « si le sexe est réprimé, c’est-à-dire voué à la prohibition, à l’inexistence et au mutisme, le seul fait d’en parler, et de parler de sa répression, a comme une allure de transgression délibérée ». Le sexe n’est pas tant affaire de censure que de contrôle politique. Plutôt qu’essayer de traquer la sexualité dans les sphères de l’intime, il s’agit de comprendre la nature de ce que l’art est capable de montrer publiquement et de saisir la complexité des discours que la société marocaine tient sur la sexualité, les rapports entre les sexes, les genres et les pratiques sexuelles
-Déroulement:
Séance 1 :
Isabelle Charpentier, Université St Quentin en Yvelines, «Le dernier tabou ? Aborder l’homosexualité en littérature au Maghreb quand on est une femme : une subversion politique majeure de l’ordre patriarcal hétéro normatif»
Hafid Lazreg, Professeur de traduction, Safi, « Le rapport sexualité-politique dans la littérature arabe classique : cas d’Ahmad Al-Tichafi » (En arabe)
Abdellah Baïda, Université Mohammed V –Agdal, Rabat, «Tabou et/ou (auto)-censure dans les stratégies des récits de l’homosexualité dans la littérature maghrébine»
Séance 2 :
Hanane El Majidi, doctorante « Genre, Culture et Société », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Aïn Chok, Casablanca, «Identité de genre et politique : quelles perspectives dans Rêves de femmes de Fatema Mernissi ?»
Jean Zaganiaris, CERAM/Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat, « Les subversions du sexe et du genre dans la littérature marocaine de langue française : Khatibi, Leftah, Taïa »
Youssef Ouahboune Faculté des Lettres, Université Mohammed V), «Cacher, exhiber: le corps féminin dans la peinture de Sebti et Drissi». [Réduire] |
Le 22 Novembre 2012 :
 |
Travail de mémoire et productivité de l’inattendu dans la création algérienne, à la lumière du « printemps arabe » Lyon (France) - Université Lumière Lyon 2 Nous avons tous été surpris par l’ampleur de ce qu’il est convenu d’appeler le « Printemps arabe », né à l’hiver 2010-2011 en Tunisie pour se prolonger en Égypte et dans de nombreux autres pays de la région. Quels que doivent être les développements politiques de ces séquences, el... [Afficher la suite] Nous avons tous été surpris par l’ampleur de ce qu’il est convenu d’appeler le « Printemps arabe », né à l’hiver 2010-2011 en Tunisie pour se prolonger en Égypte et dans de nombreux autres pays de la région. Quels que doivent être les développements politiques de ces séquences, elles bouleversent profondément notre regard sur le monde, ne déstabilisant pas moins l’assurance des discours convenus que leurs formes.
Devant cette brèche, on attend de la parole littéraire l’invention de nouveaux modes du dire : non pas tant des réponses échappant aux idéologies que le jaillissement de modalités langagières nouvelles. Car si, comme le roi soudain nu, les idéologies se révèlent impuissantes à rendre compte du réel, la littérature ne saurait, elle non plus, se contenter de modèles génériques bien connus.
Pourtant, là où la Tunisie a été le détonateur des « Révolutions du jasmin », l’Algérie s’est apparemment contentée de quelques revendications corporatistes, le plus souvent satisfaites au coup par coup : ne serait-elle donc pas concernée par ce « Printemps arabe » ?
En fait les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît. Non seulement l’avenir politique de l’Algérie reste à bien des titres une énigme, mais on sait que sa littérature pratique depuis longtemps (souvenons-nous de Kateb Yacine, parmi d’autres) cette subversion généralisée des genres, subversion aussi de ce qui les distingue les uns des autres, comme de ce qui distingue le « littéraire » du « non-littéraire », et s’interroge avec Mohammed Dib sur les pouvoirs du langage face aux défis d’un réel qui toujours lui échappe.
La postmodernité dans laquelle cette production est entrée depuis les années 80 va encore plus loin : la subversion formelle n’est même plus un exercice de littérarité, elle est au diapason d’une véritable submersion du dire par un réel qui balaye tous les supports rhétoriques sur lesquels la recherche d’un sens s’appuyait jusque là. Au reste, dans la production cinématographique, cette irruption du réel, en rupture avec la commémoration quelque peu figée de films emblématiques comme Chronique des années de braise (1975), se retrouve dans des productions plus récentes comme le Voyage à Alger d’Abdelkrim Bahloul (2010) ou La Chine est encore loin de Malek Bensmaïl (2008) qui font place à un inattendu en rapport avec le processus mémoriel. Les films de Tariq Téguia ont aussi, dès le début des années 2000, fait preuve d’un radical renouvellement des formes, jouant sur la temporalité, les dialogues, l’irruption intempestive du réel dans la fiction, la reconduction de discours sociaux opposés qui se télescopent ; en somme, la mise en œuvre d’un réel instable qui cherche sa direction et révèle, d’une certaine façon, le futur qui s’avance vers nous.
D’ailleurs même si leur résonance en nous est opposée, l’actuel « Printemps arabe » a au moins un point en commun avec le terrorisme des années quatre-vingt-dix en Algérie : nous empêcher de nous contenter des explications que nos idéologies nous proposent parfois encore. Plus que le sens, c’est bien le pouvoir des discours à le produire qui est ici en question. Et au-delà donc de ce pouvoir de produire le sens, la légitimité des rhétoriques sur lesquelles il s’appuyait jusque-là.
L’inattendu est certes dans ces événements que notre regard voilé par le prisme idéologique n’avait pas su prévoir, mais il est aussi dans l’écroulement des rhétoriques qui nourrissaient ce regard, même si on peut y voir aussi le résultat du télescopage des idéologies et des rhétoriques coprésentes dans le champ culturel, qui se donne à voir dans cette « incohérence » et cet émiettement du sens.
Cette journée d’études s’attachera donc à traquer, dans la production littéraire et cinématographique algérienne, cet inattendu que les bouleversements politiques récents nous ont fait découvrir en Tunisie puis en Égypte, alors même qu’il semble ne pas s’être manifesté sur le plan politique en Algérie. On pourra bien sûr y décrire les premiers textes que ce « printemps arabe » est en train de susciter, s’il y en a en Algérie. Mais peut-être aussi se demander si le bouleversement des formes auquel on assiste depuis les années 80, et même parfois depuis plus longtemps, ne préparait pas déjà, à notre insu, la survenue de cet inattendu et de ses défis. Ou encore, si on n’assiste pas à une remise en cause de la binarité sur laquelle reposent encore nombre de descriptions idéologiques de la décolonisation, là où la « condition postmoderne » suppose la dissémination, l’inattendu, et en tout cas la ruine d’une rhétorique binaire.
Elle pourra peut-être aussi s’appuyer sur une différence qui commence à se faire jour entre les textes publiés en France, chez des éditeurs de plus en plus nombreux, et ceux publiés au Maghreb par une jeune édition en pleine croissance, et qui sont souvent bien plus divers et inattendus, précisément, que les premiers : la lecture européenne de la littérature maghrébine n’est-elle pas, encore, tributaire d’une attente informée par l’histoire de la décolonisation, là où la jeune lecture maghrébine apparaît peut-être plus disponible à l’inattendu ?
Cette journée d’études consacrée à l’Algérie dans le cadre du cinquantenaire de l’Indépendance sera, enfin, le prélude d’un colloque à l’ambition plus vaste, qui se tiendra en 2013, sur l’inattendu dans la production littéraire et artistique de tout le Monde arabe, à la lumière de ce « Printemps ». C’est pourquoi elle se terminera par un débat sur les dimensions sociologiques et psychanalytiques de cette Révolution arabe, animé par Zohra Perret, entre Fethi Benslama, Cherif Ferjani, et Benamar Médiène, débat qui précisera les problématiques et les enjeux du colloque des 24-26 octobre 2013.
Programme
Matin
9h-12h : Projection de La Chine est encore loin, de Malek Bensmaïl, animée par Denise Brahimi
Après-midi(14h-16h30) communications. Atelier modéré par Benamar Médiène
FILI-TULLON, Touriya : (touriyafili@free.fr)
Au "petit bonheur" de l'inattendu dans Une Éducation algérienne, et Histoires minuscules des révolutions arabes de Wassyla Tamzali.
Aussi bien dans Une éducation algérienne que dans Histoires minuscules des révolutions arabes, Wassila Tamzali explore la mémoire à travers le petit trou de serrure de vies singulières, la sienne propre ou celle d’hommes et de femmes qui, chacun à sa mesure, contribuent à faire surgir l’inattendu comme ultime manière pour conjurer le tragique de la répétition. Le subjectivisme assumé de ces récits sera interrogé dans ce qu'il nous apprend des silences de l'histoire et de la manière dont il propose un retournement du su en insu. C’est ce savoir paradoxal proposé en grille narrative que nous essayerons d’analyser.
VALFORT, Blandine (blandine.valfort@hotmail.fr)
Jean Sénac et la nouvelle poésie algérienne, après l’indépendance : un événement littéraire inattendu?
La plupart des recueils de la guerre d’Algérie sont caractérisés par un souffle épique et un lyrisme patriotique qui ne subvertissent pas nécessairement les formes poétiques conventionnelles. Comme souvent dans les situations d’urgence, le poème se transforme en tract, en chant de combat : l’écrit est porteur d’un message et doit rencontrer son peuple, le toucher. Ce discours littéraire perdure, après l’indépendance, qui voit fleurir une poésie lyrique révolutionnaire, et de véritables martyrologes qui masquent le fossé séparant la réalité politique des idéaux exprimés pendant la guerre de libération. Après l’arrivée au pouvoir de Boumediene, en 1965, la récupération de la littérature nationale s’accentue, notamment à travers le monopole de la Société Nationale d’Edition et de Diffusion. Dans un contexte où l’édition était muselée et largement sous emprise étatique, il semblait impossible de créer l’événement littéraire, c’est-à-dire de répondre à la fondation d’un Etat libre par une poésie elle-même fondatrice d’une nouvelle expression algérienne. Il fallait donc encore conquérir une liberté esthétique et idéologique, contre une logique passéiste et une littérature nationale de commande, anesthésiante. C’est dans ce contexte sclérosant que de jeunes poètes vont revendiquer un renouvellement des formes, une recherche esthétique. En effet, en 1971, neuf ans après l’indépendance et trois ans après la publication du manifeste « Mutilation » par Bey, Laghouati, Sebti et Touati, Jean Sénac publie une Anthologie de la nouvelle poésie algérienne. Ce renouveau peut être perçu, au regard du contexte, comme une forme d’inattendu littéraire, qui impose une rupture par rapport à l’ordre établi et aux mythes des aînés. L’anthologie distingue nettement le lyrisme révolutionnaire de 1954 et le « défi lancé à toutes les mutilations, le ton assuré et presque téméraire du nouveau citoyen qui sait, avec le soc de la parole, dans la lancée de ses frères, qu’il prépare une moisson constamment en péril . » En quoi consiste exactement cette nouveauté poétique ? Quelles sont ses caractéristiques ? S’agit-il vraiment d’un acte esthétique fondateur ou d’une étape symbolique exprimant avant tout un refus ? Si la « nouvelle poésie » renvoie peut-être davantage, à certains égards, à la jeunesse des acteurs qui l’animent qu’à un mouvement littéraire de grande ampleur, il ne faut pas négliger l’importance de telles formules dans l’imaginaire collectif. Il s’agit donc de mettre à l’épreuve des textes la validité de cet adjectif –« nouvelle »-, mais aussi d’analyser la réception de ces créations poétiques. En effet, comme le souligne Abdelmadjid Kaouah , l’inattendu est souvent perçu et reconnu bien après son élaboration : on constate fréquemment, en Algérie, un décalage entre la nouveauté de l’œuvre et sa réception. Victime d’une forme d’inertie des milieux critiques et du monde de l’édition, l’inattendu risque donc toujours de rater sa cible.
TEBBANI-ALLAOUACHE, Lynda-Nawel : (lyndanawel@hotmail.fr)
Étrangeté et singularité, l'inattendu nouveau roman algérien.
A l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, il demeure important et nécessaire de lier la création de l'Etat-Nation à son pendant artistique, notamment sa littérature. La richesse esthétique et poétique de la littérature algérienne permet de rendre compte d'étapes, de mouvements offrant un agencement concret dans l'appréhension de son Histoire. L'achèvement stratégique d'une telle lecture propose de nommer avec assurance son histoire littéraire. Cependant, le mouvement littéraire se définit par l'effet de surprise qu'il convoque, par le surgissement qu'il implique. Si l'on lit la littérature algérienne depuis sa quête de légitimité et de libération comme nécessaire pivot historique dans l'indépendance artistique de l'engagement poétique, il ne faut pas occulter les autres étapes qu'a pu connaître son histoire littéraire. Ainsi, trop souvent l'on impose le terme étape qu'aux décades passées : tantôt il s’agira de la littérature de la re-conquête, de littérature testimoniale ; tantôt de roman politique, d'enquête sociale. Cependant, dans cette norme appliquée à l'ébauche d'une cartographie des mouvements, est oublié le nouveau roman algérien. L'inattendu nouveau roman algérien qui se profile sous la plume de Mourad Djebel et d'El Mahdi Acherchour. En effet, ces auteurs quittant la norme, et ainsi la mode, propose une écriture-surgissement qui non seulement renouvelle, mais bien souvent réagence l'histoire littéraire algérienne. L'inattendu d'un tel roman pourra s'expliquer dans cette réinscription singulière et particulière de l'Algérie, non plus donnée dans un réalisme qui se veut vrai, mais dans une utopie qui se veut universelle. Si le nouveau roman algérien déploie depuis sa structure jusque dans sa poétique, une nouveauté étrange, c'est qu'il apparaît doublement dans l'étrangeté d'un regard qui rappelle que l'Algérie est à inventer, à créer. Et c'est peut-être là l'enjeu de cet inattendu qui s'impose : il nous demande à changer de regard sur ce qui, d'abord surprenant, s'avère être nouveau et changeant.
Il sera nécessaire par ailleurs, pour nous, de lier les romans djebeliens et acherchouriens au cinéma de Tariq Téguia. En effet, lui aussi, convoque dans un inattendu nouveau cinéma algérien, cette nécessaire utopie algérienne, qui permet au cinéaste de ne pas montrer l'Algérie, mais bien sa métonymie. Figure poétique pour utopie cinématographique, il s'agira pour nous d'exposer comment l'Algérie artistique aujourd'hui se présente dans une nouvelle stratégie : celle de la singularité de l'utopie.
BONN, Charles (bonn.charles@gmail.com)
Mes inattendus
Privilège du plus ancien : je vais ici parler de ma propre rencontre ébouriffée avec la littérature algérienne : inattendu radical pour le produit normé de l’école française que j’étais alors, mais aussi très vite écho à un désir de décentrement bien plus ancien, qui me faisait refuser cette norme au profit d’expressions considérées alors comme marginales. Fascination pour les dérèglements-remises en perspective d’épisodes révolutionnaires comme mai 68 ou les printemps arabes. Et peu à peu, découverte d’une nécessité non plus personnelle, mais épistémologique de ce décentrement : n’est-il pas, si l’on y réfléchit bien, la condition même d’une appréhension plus juste, tant de l’historicité de la société qui nous entoure, que de cet autre inattendu radical qu’est la littérarité ? Cette personnalisation du débat, qui revendique son outrecuidance, permettra ainsi peut-être, dans l’inattendu de cette outrecuidance même, de mettre en perspective quelques-uns des thèmes, quelques-unes des approches nouvelles qui sous-tendront le colloque d’octobre 2013.
Fin d’après-midi (17h-19h) : débat : Quel inattendu dans le « Printemps arabe » ?
Benamar Médiène, Cherif Ferjani et Fethi Benslama. Débat animé par Zohra Perret [Réduire] |
Du 21 au 22 Novembre 2012 :
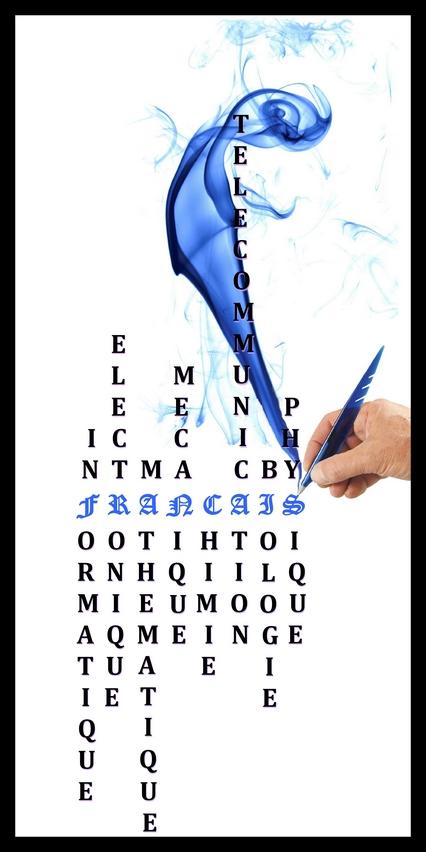 |
L’enseignement du Français dans les établissements universitaires de formation scientifique : état des lieux et perspectives. Meknès (Maroc) - Faculté des Sciences Le colloque sur « l’enseignement du Français dans les établissements universitaires de formation scientifique, état des lieux et perspectives » aura lieu les 22 et 23 novembre 2012 à la faculté des sciences-Meknès. L’objectif de cette manifestation est de rassembler enseignants, chercheu... [Afficher la suite] Le colloque sur « l’enseignement du Français dans les établissements universitaires de formation scientifique, état des lieux et perspectives » aura lieu les 22 et 23 novembre 2012 à la faculté des sciences-Meknès. L’objectif de cette manifestation est de rassembler enseignants, chercheurs et concepteurs de manuels de renforcement linguistique pour mener une réflexion sur les programmes, les acquis, les obstacles et les perspectives pédagogiques de l’enseignement du Français pour un public scientifique à l’université. [Réduire] |
Le 15 Mai 2012 :
 |
Retour sur l'oeuvre d'Edmond Amran El Maleh Rabat (Maroc) - Université Internationale de Rabat La Fondation Edmond Amran El Maleh et L’Université Internationale de Rabat (UIR)organisent le 16 mai prochain, au siège de l’UIR, un séminaire-débat portant sur l’œuvre d’Edmond Amran El Maleh.
Cette rétrospective regroupera des écrivains marocains et des spécialistes de l’œuvr... [Afficher la suite] La Fondation Edmond Amran El Maleh et L’Université Internationale de Rabat (UIR)organisent le 16 mai prochain, au siège de l’UIR, un séminaire-débat portant sur l’œuvre d’Edmond Amran El Maleh.
Cette rétrospective regroupera des écrivains marocains et des spécialistes de l’œuvre d’Edmond Amran El Maleh qui jetteront un nouveau regard sur les écrits de cet auteur.
Une exposition de photographies et une vente de livres seront organisées en marge de cette manifestation.
Le programme de cette rencontre se déroule comme suit :
09h00 – 09h30 / Séance d’ouverture :
- Monsieur Ahmed Ezbakh, Vice-président de l’Université Internationale de Rabat
- Monsieur André Azoulay, Conseiller de SM et Président de la Fondation Edmond Amran El Maleh
- Monsieur Driss Khrouz, Directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et Vice Président de la Fondation Edmond Amran El Maleh
09h30 – 10h00 / visite de l’exposition de photographies
10h - 11h00 /1ère séance :
Modération : Madame Myriem Khrouz
- Monsieur Mohamed Berrada : « témoignage sur l’écriture d’Edmond »
- Madame Assia Belhabib : “éloge du partage”
- Monsieur Anouar Ben Msila : « L'écriture de la diversité ou la mémoire à venir »
- Monsieur Abdellah Baïda: « La Méditation et son double à travers L’œil et la main ».
11h00 – 11h30 / débat
11h45- 13h00 / 2ème séance :
Modération : Madame Assia Belhabib
- Monsieur Hassan Bourkia : “lettre à Edmond Amran el Maleh”
- Monsieur Mustapha Bencheikh : “Le roman à rebours”
- Monsieur Kamal Toumi : « Edmond Amran El Maleh et la peinture : le cas de Khalil Ghrib »
- Rachid Khaless : "Edmond Amran El Maleh, le troisième oeil."
13h00 – 13h30 / débat [Réduire] |
Du 04 au 07 Decembre 2012 :
| |
Congrès International: "Ponts et passerelles" Tunis (Tunisie) Université de Manouba
Faculté des Lettres, des Arts
Et des Humanités
Laboratoire de Recherches : Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle
Congrès International : Ponts et passerelles
5, 6, 7 et 8 décembre 2012
Dans les guerres modernes, on commence p... [Afficher la suite] Université de Manouba
Faculté des Lettres, des Arts
Et des Humanités
Laboratoire de Recherches : Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle
Congrès International : Ponts et passerelles
5, 6, 7 et 8 décembre 2012
Dans les guerres modernes, on commence par les détruire afin de priver l’ennemi d’un atout majeur, tandis que le mot qui les désigne, dans les diverses langues du monde, revient souvent comme métaphore de la volonté des peuples et des hommes d’oublier ce qui sépare, disjoint ou éloigne. De l’avis d’Isaac Newton, « les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». À travers les siècles, les ponts ont toujours lié, rattaché, joint… ce que la géographie et l’Histoire rendaient inaccessible. Leur édification demeure un témoignage vivant du génie des civilisations et de leurs préoccupations majeures. Sans ponts, plusieurs villes du monde perdraient beaucoup de leur âme et l’essentiel de leur identité. De Paris à Amsterdam, de New York à Sidney, les architectes et les peintres en ont fixé les piliers et les contours.
De nos jours, un "pont wifi" réside dans les capacités d’interconnexion qu’un matériel informatique rend possibles au sein d’un réseau. Il y est également question de passerelles : le suffixe diminutif n’enlève rien à l’importance de ce type de voie dans les divers types de “communication” humaine. Le vent de liberté qui traverse le monde arabe n’a-t-il pas emprunté les voies de ces "ponts" ? En fournissant aux jeunes Arabes les moyens de contourner le bouclier de la dictature-censure, le réseau Internet n’a-t-il pas servi de pont vers le monde libre ? Mais, si les voies qui donnent sur les rives du monde sont parfois "périphériques", elles n’en sont pas moins efficaces. De par ses dimensions, la passerelle s’avère décisive là où le pont encombre. La passerelle est ce qui reste de fonctionnel (d’opérationnel) lorsqu’il est impossible de passer par les ponts, les viaducs et autres voies d’accès. Elle est aussi le sentier qui mène aux endroits escarpés, le chemin sinueux qui donne sur certains secrets de l’être humain : « Entre un homme et une femme, l’amitié ne peut être que la passerelle qui mène à l’amour », disait Jules Renard dans L’Écornifleur. Les créateurs authentiques ne s’y trompent pas, puisque les ponts de l’art ont toujours relié des mondes et des abîmes que les réseaux virtuels peinent à interconnecter. Senghor le sentait déjà dans Éthiopiques : « Comme je mêle la Mort et la vie – un pont de douceur les relie ».
Les arts en général et la littérature en particulier reprennent le pont-symbole, la trajectoire de la passerelle et leurs idées-forces pour fonder un espace de rencontre et d’interaction des altérités, y compris les plus exacerbées. Guillaume Apollinaire en a immortalisé l’image dans la matière même de corps tendus l’un vers l’autre. Mais les architectes, les peintres, les historiens, les photographes, les cinéastes, etc. ont également immortalisé, chacun à sa façon, ces “ouvrages-œuvres” qui témoignent du génie des hommes et leur désir permanent d’unir les rives, les routes et les idées de ceux qui les empruntent. Vus sous cet angle, ponts et passerelles sont les voies incontournables de destins communs ou brisés. Voies d’un rêve de rencontre des extrêmes. Chemins frayés au milieu des débris d’un monde à reconstruire et d’une humanité à recomposer.
En brassant les cultures et les imaginaires le texte littéraire consacre la rencontre avec l’autre, le monde créé par l’écrivain est alors un pont vers des paysages et des mœurs que l’on explore au fil des mots. Le poids de l’Histoire et les “limites” de la géopolitique font souvent que l’édification de ces ponts devient problématique. Sur la carte du monde, les dess(e)ins des artistes contrecarrent ceux des stratèges de la macro-économie et des guerres préventives : « je veux restaurer deux mondes, mon but est de jeter un pont entre deux mondes », affirme Driss Chraïbi. Les ponts jetés par le langage refusent les impasses du réel et ses obstacles. Le propre de l’acte créatif est de recréer ce réel en y opérant des brèches : « là où la vie emmure l’intelligence perce une issue » (Marcel Proust). Le langage longuement travaillé par les métaphores (obsédantes) de la traversée et de la rencontre rapproche des rives dont les hommes et les cultures sont infiniment divers. Métamorphosés dans les formes changeantes du matériau utilisé par le plasticien, l’architecte, l’écrivain, le chercheur… ponts et passerelles prendront les formes les plus inouïes : « se taire ou dire l’indicible », dirait Kateb Yacine. Invités à en débattre et à en cerner la signifiance et la (les) sémiotique(s) dans un monde où tout a tendance à se (dis)joindre, les spécialistes de la question commenceront par jeter des ponts entre des champs d’application et des disciplines qui ont rarement interagi et communiqué.
Axes de recherche :
1-) Histoire(s) "monumentale(s)" et défis d’architectes : des pierres, des hommes, des ponts.
2-) Archéologie, fouilles et documentation : les ponts de l’Histoire.
3-) À la rencontre de l’autre : le pont des langues et des traductions.
4-) Le brassage des identités et des traditions en tant que “ponts culturels”.
5-) Le pont des arts : dialogue des formes d’expression artistiques.
6-) Les littératures de migration comme ponts vers soi, la terre et l’autre.
7-) Mythes, légendes et oralité comme ponts menant aux abîmes de l’être.
Les propositions de communication (ne dépassant pas une page) doivent être envoyées aux adresses électroniques suivantes :
habib.salha@yahoo.fr
adelbensh@yahoo.fr
Calendrier :
Dernier délai pour les propositions de communication : le 30 juin 2012.
Réponse du comité scientifique : le 30 juillet 2012.
Programme prévisionnel : le 25 octobre 2012.
Programme officiel : le 15 novembre 2012.
Comité scientifique :
Ali Abassi (Université de Manouba)
Habib Ben Salha (Université de Manouba)
Sadok Gassouma (Université de Manouba)
Hamdi Hmaïdi (Université de Manouba)
Fadhila Laouani (Université de Manouba)
Afifa Marzouki (Université de Manouba)
Mokhtar Sahnoun (Université de Manouba)
Comité d’organisation :
Faten Benaïssa (Université de Manouba)
Ibtihel Ben Hmed (Université de Manouba)
Sana Dahmani (Université de Sousse)
Adel Habbassi (Université de Tunis)
Hanène Harrazi (Université de Carthage)
Rym Kheriji (Université de Manouba)
Donia Maraoub (Université de Manouba) [Réduire] |
Le 03 Mai 2012 :
 |
Création féminine au Maghreb et au Moyen-Orient Paris (France) - Cercle des amis d'Assia Djebar Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine rencontre du Cercle aura lieu à Paris le vendredi 04 mai à 20h. Nous avons la joie de recevoir Mounira Chatti, maître de conférence et romancière tunisienne pour une rencontre qui s'intitule Création féminine au Maghreb et au Moyen-Orien... [Afficher la suite] Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine rencontre du Cercle aura lieu à Paris le vendredi 04 mai à 20h. Nous avons la joie de recevoir Mounira Chatti, maître de conférence et romancière tunisienne pour une rencontre qui s'intitule Création féminine au Maghreb et au Moyen-Orient. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le blog http://www.assiadjebarclubdelecture.blogspot.com
Nous espérons vous retrouver lors de cette prochaine soirée lecture.
Bien cordialement
--
Amel Chaouati
Le Cercle des amis d'Assia Djebar
Association Loi 1901
n°w953001584
BP 10143
Pontoise 95304 Cergy Pontoise Cedex
Tel:06 24 02 70 08
http://www.assiadjebarclubdelecture.blogspot.com [Réduire] |
Du 11 au 14 Juillet 2012 :
| |
Colloque International : Le dégoût Monastir (Tunisie) - Hôtel El Habib UNIVERSITÉ de MANOUBA
Faculté des Lettres, des
Arts et des Humanités
Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle
Laboratoire de Recherche
Colloque international : Le dégoût
12, 13, 14 et 15 juillet 2012
Il est communément admis que le goût procure le... [Afficher la suite] UNIVERSITÉ de MANOUBA
Faculté des Lettres, des
Arts et des Humanités
Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle
Laboratoire de Recherche
Colloque international : Le dégoût
12, 13, 14 et 15 juillet 2012
Il est communément admis que le goût procure le plaisir et manifeste le monde sensible dans toute sa gloire. Il est désir, jouissance et satisfaction. Qu’en est-il du dégoût ? La Métamorphose d’un Kafka ? La Peste d’un Camus ? La Nausée d’un Sartre ? Ou est-ce plutôt L’Histoire de l’œil d’un Bataille qui dit, avec délectation, le sang, le bas, le supplice et la mort ?
L’effondrement du moi, si l’on en croit Freud, prépare l’écroulement du monde et rejette l’art dans la proximité de l’immonde. Bataille postule que l’hétérogène est la « science de tout ce qui est autre ». La littérature serait alors négativité, rejet, refoulement. Kristeva quant à elle, précise que le désir de l’informe étouffe la forme, « invite et dissuade ». Elle ajoute que « le dégoût sollicite, inquiète, fascine le désir qui pourtant ne se laisse pas séduire. Apeuré, il se détourne. Ecoeuré, il rejette ». La complaisance pour l’excrémentiel devient une catégorie esthétique. Nietzsche n’affirme-t-il pas que « tous les corps éliminent sans cesse, rejettent ce qui dans l’être absorbé par eux ne leur est pas assimilable, ce que l’homme méprise, ce dont il a le dégoût, ce qu’il appelle mauvais, ce sont les excréments ». Le bas, le sale, le laid repoussent et fascinent et le dégoût n’est plus une émotion négative. Il est cette « sensation » baudelairienne qui le rachète à travers le goût même.
Contrairement au cynisme qui sévit, le dégoût, lui, « rend lucide » selon les dires de Valéry. Profanation et grotesque accompagnent l’homme dominé par sa libido dans la voie du laid. De Rabelais à Boudjedra, la littérature française et francophone regorge d’exemples où l’abject rejette le beau et adopte l’excretia dans un spectacle scatologique. Les contemporains de Rabelais ont été victimes de leurs goûts exacerbés de la gastronomie dont le fondement est traditionnel : argument de poids à une époque où la coutume sert de justification à tous les abus. Et c’est leur gourmandise devenue vice qui a exaspéré l’auteur du XVIe siècle, déclenchant son dégoût alimentaire, et, par conséquent, de la matière. C’est ainsi qu’il développe une vision négative de la gastronomie, en en faisant une maladie dont il faut guérir afin de purger son esprit de toute préoccupation humaine. Plus tard, Montaigne, analyste et moraliste en quête de sagesse dans Les Essais, s’interroge sur la matière, lui conférant une image problématique, particulièrement défavorable au développement de la pensée et du rapport critique à la connaissance. Au XIXe siècle, Balzac, dans La Femme de trente ans, grâce à la métaphore associant le mariage aux aliments, transforme le dégoût matrimonial, perçu comme vice, en goût, donc en vertu. Ainsi, répugnance, déplaisir et désenchantement ne deviennent-ils pas respect, considération et tolérance ? Plus proches de nous, Lautréamont, Bataille et Duras célèbrent tout négatif et confèrent à leurs œuvres d’art une beauté monstrueuse.
La littérature francophone, à son tour, excrète le goût et s’avère sensible au rejet, à la négativité en se résignant à un dégoût inextricablement lié à l’abject. Le dégoûtant ne dégoûte plus. Le déplaisir devient jouissance. L’excrément se hisse définitivement au niveau de la recherche artistique et convertit le thanatique en extatique : corps mutilés, ordures, crachats, déchets contaminent la production littéraire et se transforment en puissants réseaux de sens. Chez Boudjedra, Kheir-Eddine, Kourouma, et Labou Tansi, le rejet dans sa dimension hétérogénéisante est existentiel. Il tente d’abolir la nausée en l’opposant à la seule vérité nue de l’être, le Mal.
L’objectif de ce colloque sera donc d’essayer de définir le dégoût, d’observer ses modes d’expression et les différents domaines dans lesquels il se manifeste. Dans cette perspective, nous proposons les pistes de recherche suivantes :
- Le dégoût dans le lexique, les langues, les Arts, la médecine, la gastronomie.
- Le dégoût : de la politique à la poétique.
- Dégoût et interculturalité.
- Dégoût et traduction : est-il intraduisible ?
- Dégoût et recherche esthétique.
- Dégoût : jouissance, censure, subversion.
Les propositions de communication sont à envoyer, avant le 15 juin 2012, en fichier joint, au format Word, aux adresses mail suivantes : habib.salha@yahoo.fr ou www.fat02@hotmail.fr
Elles comporteront aussi des informations pratiques (nom, prénom, institution, numéro de téléphone et adresse électronique) et seront accompagnées d’une notice biobibliographique.
Comité d’organisation : Bessem Aloui, Faten Béjaoui, Ibtihel Ben Hamed, Sana Dahmani, Hanène Harrazi, Rym Kheriji.
Comité Scientifique : Ali Abbassi, Habib Ben Salha, Sadok Gassouma, Hamdi Hémaïdi, Fadhila Laouani. [Réduire] |
Du 17 au 22 Avril 2012 :
| |
Montréal (Canada) - Hôtel Opus Je me permets d'attirer votre attention sur un festival littéraire unique en son genre qui se tient actuellement à Montréal et qui permet notamment à des auteurs de toutes nationalités, dont françaises et arabes, de venir à la rencontre de leurs lecteurs. C'est un concept unique qui méritera... [Afficher la suite] Je me permets d'attirer votre attention sur un festival littéraire unique en son genre qui se tient actuellement à Montréal et qui permet notamment à des auteurs de toutes nationalités, dont françaises et arabes, de venir à la rencontre de leurs lecteurs. C'est un concept unique qui mériterait j'en suis convaincue que vous en fassiez mention dans vos pages et sur votre site.
Je vous invite à aller sur le site de ce festival formidable (metropolisbleu.org), basé sur la rencontre, la lecture, la discussion et l'amour des mots. Cette année, Leonora Miano, Eduardo Manet, Olivia Rosenthal, Ananda Devi nous font la joie de leur présence, mais aussi Leonardo Padura, Joyce Carol Oates et Ahdaf Soueif. L'an prochain, pour le 15e anniversaire de cet événement annuel, nous espérons fortement qu'une délégation française plus importante encore viendra célébrer cet anniversaire avec nous.
Pour sentir battre le pouls de ce festival, je vous encourage également à jeter un oeil sur les blogs que je rédige au fil des rencontres.
Merci de m'avoir lue. Puis-je espérer un message de retour? Bien à vous, en France, et au plaisir de vous rencontrer à Montréal! [Réduire] |
Le 18 Avril 2012 :
 |
LITTÉRATURE ET POSSIBILITÉS DE RÉSISTANCE En partenariat avec la Cité de l'Immigration Paris (France) - Institut du monde Arabe DANS LE CADRE DU 50E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE
19 avril 2012
Salle du Haut-Conseil - 18h30
LITTÉRATURE ET POSSIBILITÉS DE RÉSISTANCE
En partenariat avec la Cité de l'Immigration
A l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Indépendance algérienne, cette séanc... [Afficher la suite] DANS LE CADRE DU 50E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE
19 avril 2012
Salle du Haut-Conseil - 18h30
LITTÉRATURE ET POSSIBILITÉS DE RÉSISTANCE
En partenariat avec la Cité de l'Immigration
A l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Indépendance algérienne, cette séance sera un moment privilégiée pour réfléchir et débattre autour des notions de révolte, de désobéissance et de résistance, inhérentes à la pratique littéraire.
Au tournant des années cinquante, l’identité algérienne contemporaine était, dans une certaine mesure, tributaire du traumatisme colonial. Alors que les leaders politiques peinaient à dessiner les contours d’un horizon d’espérance, les écrivains, par leurs œuvres, ont su réinventer une histoire nationale emprunte d’humanisme, de liberté et d’universalité. Le roman Nedjma de Kateb Yacine en est, à cet égard, un exemple flagrant.
Au cœur de cette démarche : la résistance par le pouvoir de l’écriture. Comment, un demi-siècle plus tard, comprendre cet engagement ?
Avec : Aziz Chouaki, dramaturge et romancier, il est l’auteur d’une œuvre abondante, cynique et tendre à la fois, sur l’état du monde contemporain. Sa pièce Zoltan a dernièrement été jouée au Théâtre Nanterre-Amandiers.
Tassadit Imache, romancière, est l’auteure de plusieurs romans parmi lesquels Des Nouvelles de Kora, Presque un frère, Je veux rentrer, Le Dromadaire de Bonaparte. Romans parus aux Editions Actes Sud qui ont pour fil directeur la quête identitaire.
Mabrouck Rachedi, romancier ; après "La petite Malika" (éditions Lattès, 2010, co-écrit avec Habiba Mahany), son dernier livre s’intitule Le petit Malik.
Yahia Belaskri, est journaliste et écrivain. Auteur d’essais et de nouvelles, son dernier roman, si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut, a été couronné par le prix Etonnants Voyageurs.
Animé par : Kaoutar Harchi, romancière et enseignante, spécialiste des rapports art/société, son dernier roman, L’Ampleur du saccage, est paru aux éditions Actes-Sud et a été récompensé par plusieurs prix [Réduire] |
Du 02 au 03 Mai 2012 :
 |
LES CULTURES ARABES, entre ici et là-bas Lyon et Bron (France) - Croix-Rousse, Campus Université Lyon2, Bourse du travail L'association Circum al-dunyâ et ses partenaires proposent une série de manifestations culturelles pour aller à la rencontre des cultures arabes, les 3 et 4 mai 2012 à Lyon et à Bron.
Bâtir des ponts entre les rives de la Méditerranée et au delà, pour favoriser les échanges, l'innovation ... [Afficher la suite] L'association Circum al-dunyâ et ses partenaires proposent une série de manifestations culturelles pour aller à la rencontre des cultures arabes, les 3 et 4 mai 2012 à Lyon et à Bron.
Bâtir des ponts entre les rives de la Méditerranée et au delà, pour favoriser les échanges, l'innovation et la compréhension mutuelle, faire découvrir le patrimoine et la création contemporaine arabes et leurs interactions avec les autres cultures, tel est l'objectif de ces premières journées culturelles arabes inter-associatives.
Au programme, rencontres, conférences, projections de films (fictions et documentaires),set slam, musique et spectacle de conte, pour tous et entièrement gratuits. [Réduire] |
Du 17 au 23 Juillet 2013 :
 |
Congrès AILC 2013: Le comparatisme comme approche critique Paris (France) - Sorbonne L’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC/ ICLA) tiendra son XXème Congrès à Paris, du 18 au 24 juillet 2013, où elle sera accueillie par l’Université de Paris-Sorbonne. Autour de cinq axes de réflexion, il s’agira d’interroger « Le comparatisme comme approche criti... [Afficher la suite] L’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC/ ICLA) tiendra son XXème Congrès à Paris, du 18 au 24 juillet 2013, où elle sera accueillie par l’Université de Paris-Sorbonne. Autour de cinq axes de réflexion, il s’agira d’interroger « Le comparatisme comme approche critique ».
Le Congrès sera organisé d’une part sous la forme de sessions et d’ateliers parallèles, qui permettront aux chercheurs du monde entier de présenter leurs travaux, et d’autre part sous la forme de 4 ou 5 conférences plénières de haut niveau. Près de 1000 participants, personnalités reconnues, chercheurs confirmés ou plus jeunes, et doctorants y sont attendus. [Réduire] |
Du 16 au 23 Aout 2013 :
| |
Cerisy la salle (France) - Centre international On a beaucoup parlé d'Albert Camus récemment, à l'occasion du cinquantenaire du prix Nobel de littérature
et du cinquantenaire de sa mort, et lors de la publication de ces outils majeurs que sont la nouvelle édition
de ses OEuvres complètes dans la Pléiade et le Dictionnaire Albert Camus. L... [Afficher la suite] On a beaucoup parlé d'Albert Camus récemment, à l'occasion du cinquantenaire du prix Nobel de littérature
et du cinquantenaire de sa mort, et lors de la publication de ces outils majeurs que sont la nouvelle édition
de ses OEuvres complètes dans la Pléiade et le Dictionnaire Albert Camus. L'accent a souvent été mis, alors,
sur le penseur, le journaliste, l'homme engagé. Or, Camus se définissait avant tout comme un artiste ;
plusieurs de ses textes en témoignent, dont ses Carnets et des « chroniques » d'Actuelles II. C'est à cet
aspect-là que la Société des Études camusiennes consacre un colloque en 2013, pour le centenaire de la
naissance de l'écrivain. En l'organisant à Cerisy-la-Salle, et en insistant sur sa dimension internationale, elle
s'inscrit dans le sillage du colloque de 1982, « Albert Camus : oeuvre fermée, oeuvre ouverte ? », où elle a
été fondée, et elle vise à donner une impulsion aux études camusiennes à venir, en France et à l'étranger. Il
s'agira d'analyser les rapports que Camus entretient avec l'art en général aussi bien qu'avec des arts en
particulier.
Quelques axes peuvent être proposés :
-les styles de Camus ;
-la question de « L'artiste et son temps », à laquelle il réfléchit longuement, bien avant la conférence d'Upsal
(1957) ; sa position d'artiste philosophe ;
-sa conception du rapport de l'art au réel ; la réflexion esthétique dans les essais ; ce qu'il entend par
« beauté » ;
-les figurations de l'artiste que propose son oeuvre ;
-son rapport à la musique, à la peinture, à l'architecture ; sa pratique de la critique littéraire et de la critique
picturale ; les raisons pour lesquelles il admire tel ou tel artiste, se reconnaît tel ou tel modèle ;
-son rapport à l'écriture tel qu'il apparaît par exemple dans les Carnets.
Les propositions sont à envoyer pour le 15 avril 2012 conjointement aux trois organisatrices :
agnes@spiquel.net ; Sophie.Bastien@rmc.ca ; anne.prouteau@orange.fr.
Elles seront examinées par un Comité scientifique, composé des Professeurs Raymond Gay-Crosier, Pierre
Masson et Pierre-Louis Rey, et des trois organisatrices – qui établira la liste des vingt-quatre propositions
retenues.
Précisions importantes :
-un colloque de Cerisy étant une aventure intellectuelle à vivre en commun, il est très important que les
communicants restent sur place quelques jours ;
-une partie des frais d'hébergement et l'intégralité des frais de voyage sont à la charge des communicants.
Agnès SPIQUEL, professeur émérite à l'Université de Valenciennes (France)
Anne PROUTEAU, maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest (Angers, France)
Sophie BASTIEN, professeure agrégée au Collège Militaire Royal du Canada (Kingston, Ontario) [Réduire] Contact : agnes@spiquel.net ; Sophie.Bastien@rmc.ca ; anne.prouteau@orange.fr. |
Du 13 au 15 Octobre 2012 :
 |
Oran (Algérie) - CRASC En raison de la portée exemplaire et symbolique de l’indépendance de l’Algérie,
1962 est un moment clé des histoires algérienne et française, auxquelles il ne saurait
cependant se réduire. Le colloque transdisciplinaire « 1962, un monde », qui aura
lieu à Oran, en Algérie, du 14 au... [Afficher la suite] En raison de la portée exemplaire et symbolique de l’indépendance de l’Algérie,
1962 est un moment clé des histoires algérienne et française, auxquelles il ne saurait
cependant se réduire. Le colloque transdisciplinaire « 1962, un monde », qui aura
lieu à Oran, en Algérie, du 14 au 16 octobre 2012, se propose dès lors de penser 1962
comme événement matriciel, narration, système de significations plurielles et
antagonistes. Autrement dit de le voir comme point de bascule d’un ensemble de
mouvements tiers-mondistes, panafricanistes, socialistes, féministes ou encore
juvéniles. Il s’agira d’identifier, à la croisée de plusieurs disciplines, les articulations,
les circulations, les contradictions, les mises en abyme, les tensions, les tracés
sensibles, les avatars de 1962 comme un monde.
1962, A World
The symbolic and exemplary resonance of Algeria’s independence escapes the limits
of either Algerian or French history. The interdisciplinary colloquium “1962, A
World,” – which will take place in Oran, in Algeria, October 14-16, 2012 – aims to
analyze and describe 1962 as a matrix of events; stories and histories; as a system of
multiple and antagonistic meanings. In other words, making visible ignored links,
contradictions, and repetitions, tensions, touchy subjects, avatars of 1962 perceived
as a world.
Comité d’organisation
Aicha Benamar, Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle – CRASC – Oran ; Giulia
Fabbiano, CADIS-EHESS – Paris / Idemec – Université Aix-Marseille ; Mustapha Medjahdi, CRASC – Oran ;
Amar Mohand Amer, CRASC– Oran ; Abderahmen Moumen, CRHiSM –Université de Perpignan ; Karim Ouaras,
Centre d’Etudes Maghrébines en Algérie – CEMA – Oran ; Robert P. Parks, CEMA – Oran ; Malika Rahal, Institut
d’Histoire du Temps Présent/CNRS – Paris ; Todd Shepard, Johns Hopkins University – Baltimore.
Comité Scientifique
Lila Abu-Lughod, Columbia University ; Anissa Bouayad, MuCEM, SEDET Paris ; Catherine Brun, Université
Sorbonne Nouvelle - Paris III ; Laetitia Bucaille, Université de Bordeaux II ; Catherine David, RMN ; Daho
Djerbal, Université d’Alger- Bouzareah ; Ramon Grosfoguel, UC-Berkeley ; Nacira Guénif, Université de Paris
Nord ; Nadira Laggoune-Aklouche, Ecole des Beaux-Arts d’Alger ; Emmanuel Laurentin, France culture ; Neil
MacMaster, East Anglia University ; Zahia Rahmani, INHA, Paris ; Hassan Remaoun, Université d’Oran /
CRASC ; Damon Salesa, Centre of Pacific Studies, University of Auckland, New Zealand ; Ryme Seferdjeli,
University of Ottawa ; Fouad Soufi, CRASC; Gayatri Spivak, Columbia University ; Sylvie Thénault, CHS, CNRS -
Paris 1 ; Trinh T. Minh-ha, UC-Berkeley ; Mara Viveros, Université Nationale de Colombie ; Tassadit Yacine,
EHESS, Paris
Keynote speakers
Najat Rahman, Université de Montréal ; Hassan Remaoun, Université d’Oran, CRASC ; Fouad Soufi, CRASC ;
Trinh T. Minh-ha, University of California – Berkeley
________________________________________________________________
Contacts :
proposals: 1962unmonde@rizeway.com
Giulia Fabbiano : gfabbiano@hotmail.com
Malika Rahal : malika.rahal@ihtp.cnrs.fr [Réduire] Contact : 1962unmonde@rizeway.com |
Le 01 Janvier 1970 :
| |
Un récital de poésie dédié au Printemps arabe Paris (France) - IISMM – 1er étage France |
Le 27 Mars 2012 :
| |
Thagaste-Souk Ahras, patrie de saint Augustin Alger (Algerie) - salle polyvalente de l'Institut Culturel Italien d'Alger Saint Augustin, une icône de la chrétienté, auteur du premier récit autobiographique dans le monde: Les confessions, natif de Thagaste (Aujourd'hui Souk Ahras), est une figure incontournable dans le patrimoine spirituel et culturel algérien. Nacera Benseddik, spécialiste connue revient sur cet... [Afficher la suite] Saint Augustin, une icône de la chrétienté, auteur du premier récit autobiographique dans le monde: Les confessions, natif de Thagaste (Aujourd'hui Souk Ahras), est une figure incontournable dans le patrimoine spirituel et culturel algérien. Nacera Benseddik, spécialiste connue revient sur cet homme et sur sa ville.
La conférence sera animée par Nacera Benseddik, docteur d’État en histoire ancienne (Le culte d'Esculape en Afrique, Université Paris IV - Sorbonne, 1995) [Réduire] |
Du 08 Novembre 2011 au 02 Mai 2012 :
 |
Ecrire les modernités arabes. Lyon (France) - ENS (École normale supérieure) de Lyon Ce séminaire est un séminaire de recherche susceptible d’être validé dans trois Masters de l’ENS de Lyon, eux-mêmes cohabilités avec Lyon 2 et Lyon 3 : le Master d'histoire moderne et contemporaine, le Master de Littérature comparée et francophonie et le Master Langues et littératures �... [Afficher la suite] Ce séminaire est un séminaire de recherche susceptible d’être validé dans trois Masters de l’ENS de Lyon, eux-mêmes cohabilités avec Lyon 2 et Lyon 3 : le Master d'histoire moderne et contemporaine, le Master de Littérature comparée et francophonie et le Master Langues et littératures étrangères (option arabe). Il s’est donné pour objet l’histoire sociale et culturelle des sociétés arabes contemporaines depuis le XIXe siècle. Il est ouvert au public et à tous les étudiants du pôle universitaire lyonnais, et il s'est aussi greffé à une séance du séminaire : Genre et société du LARHRA. N'hésitez donc pas à y associer vos réseaux.
Voici, avant publication, le programme 2011-2012 du séminaire (les deux premières séances sont passées). Les séances sont en principe, à quelques exceptions près, le jeudi de 14h à 16h :
Merci d'avance de vérifier la date et le titre prévus pour votre intervention. Et merci à celles ou ceux qui ont leur contact de communiquer ce courriel aux collègues suivants : Samar Yazbek, Hamid Bozarslan, Farouk Mardambey, Thomas Eich, Sophie Bessis.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, de bonnes vacances et une bonne fin d'année 2011.
Bien cordialement
Frédéric Abécassis
- Mercredi 9 novembre 2011 : Elias Khoury, L’itinéraire d’un écrivain arabe — Et le renouvellement de son œuvre De Beyrouth aux villages de Galilée
- Jeudi 10 novembre 2011 : Habib Kazdaghli : La révolution du Jasmin : l'historien, le citoyen et le temps présent
- Jeudi 19 janvier 2012 : Makram Abbes, MCF ENS de Lyon, Jihad et jihadisme dans la pensée politique arabe contemporaine
- Jeudi 26 janvier 2012 : Frédéric Abécassis : Enjeux historiographiques et mémoriels de l'histoire du judaïsme dans le monde arabe
- Jeudi 9 février 2012 : Gonzalez Alcantud (université de Grenade) : Le patrimoine immatériel : une notion problématique et "labyrinthique".
- Jeudi 16 février 2012 (14h-17h) : La Syrie aujourd'hui : histoire contemporaine, société, littérature, avec Fabrice Balanche (sous réserve), Samar Yazbek, Rania Samara, Hamid Bozarslan, Farouk Mardambey,
- Jeudi 1er mars 2012 : Daniel Lançon, PU Grenoble 2 : Le récit de voyage politique au travers de l'exemple de Roger Vailland emprisonné en 1952 sous Nasser
- Jeudi 8 mars 2012 : Gilles Ladkany, ENS de Lyon : La question du retour chez Mahmoud Darwich
- Jeudi 15 mars 2012 : Thomas Eich, professeur d’islamologie à l’Université de Hambourg : Bioéthique islamique contemporaine
- Mercredi 21 mars 2012 : les révolutions arabes à l'épreuve du genre, Randi Deguilhem (MCF, Université d’Aix-Marseille) : « Les femmes syriennes : des militantes de longue date ? » (titre provisoire), Sophie Bessis (IRIS et FIDH) : « les femmes dans la révolution tunisienne, lecture à la lumière de l'histoire »
- Jeudi 29 mars 2012 : Tourya Filli, MCF Lyon 2 : Littérature d'avant-garde et journalisme francophone au Maroc et Laura Abou Haidar MCF St Etienne : Système éducatif marocain, francophonie et plan d'urgence
- Jeudi 5 avril 2012 : Élodie Gaden, Doctorante, Grenoble : La naissance du féminisme littéraire égyptien
- Jeudi 19 avril 2012 : Audition des masterants, Dalia Khalil, M2 d'histoire moderne et contemporaine sur la crise de Suez dans l'historiographie et Roman Thieltges (M2 franco-allemand) : A la découverte de l'espace de l'autre : trajectoires de migrants en villes, réalités et représentations
- Jeudi 26 avril 2012 : Karine Bennafla, IEP Lyon, Espaces frontaliers dans le monde arabe, entre intégration et développement (cas du Liban et du Maroc)
- Jeudi 3 mai 2012 : Elena Chiti Doctorante, Aix-en Provence : Littérature et politique : à propos de quelques écrivains et du "printemps arabe".
--
Frédéric Abécassis
Maître de conférences en histoire contemporaine
École normale supérieure de Lyon - LARHRA
Courriel : frederic.abecassis@ens-lyon.fr
15 parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon CEDEX 07
Bureau R 224
Tél : +33 (0)4 37 37 63 24
Mobile : +33 (0)6 23 16 87 78
--
Frédéric Abécassis
Maître de conférences en histoire contemporaine
École normale supérieure de Lyon - LARHRA
Courriel : frederic.abecassis@ens-lyon.fr
15 parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon CEDEX 07
Bureau R 224
Tél : +33 (0)4 37 37 63 24
Mobile : +33 (0)6 23 16 87 78 [Réduire] |
Le 29 Avril 2012 :
| |
Journée d’étude « Raconter l’Algérie coloniale et post-coloniale » Mascara (Algérie) - Université Si tout le monde s’accorde à affirmer que l’Histoire demeure une source intarissable de laquelle puise la littérature et vice versa. Persistent, toutefois, des questions relatives à la nature du lien entre le fait historique et les productions fictionnelles. En effet, on ne peut que se fourvo... [Afficher la suite] Si tout le monde s’accorde à affirmer que l’Histoire demeure une source intarissable de laquelle puise la littérature et vice versa. Persistent, toutefois, des questions relatives à la nature du lien entre le fait historique et les productions fictionnelles. En effet, on ne peut que se fourvoyer quand on tente de démêler, avec un dogmatisme de la vraisemblance, les références de la production littéraire qui, même lorsqu’elle s’adonne au témoigne, ne peut représenter qu’une sensibilité hybride où coïncident fantasme, mythe, oralité etc. C’est pourquoi il est fondamental de s’interroger sur des notions, déjà galvaudées, voire dépravées, telle que le réalisme, l’authenticité, fidélité du texte, etc. Afin de pallier cet écueil, il serait opportun de faire appel aux théories modernes qui se sont attelés à répondre aux interrogations que l’on pose quand on affronte le problème de la relation Histoire/littérature.
Afin de mettre en évidence l’importance de la question du lien entre écrit littéraire et l’Histoire, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : Comment se manifeste l’Histoire dans la littérature, notamment la littérature algérienne ? De quelle manière l’Histoire fait-elle appel à la production littéraire ? Quel sens pouvons-nous donner à l’Histoire à l’aune des théories modernes ? Y a-t-il des genres liés plus que d’autres à l’Histoire ou c’est un simple leurre que d’affirmer cette gradation – dosage historique relatif à la référence historique – qui hiérarchise les productions littéraires en s’appuyant sur des idées reçues et des conceptions très simplistes ?
NB : Nous nous focaliserons plus sur la littérature algérienne, car le corpus est plus accessible aux étudiants.
Les buts scientifiques de la journée :
Les buts scientifiques :
• Aborder le lien fusionnel et problématique entre l’Histoire, le mythe et la littérature algérienne ;
• Evoquer les théories modernes relatives à la littérature factuelle ;
• Donner un nouvel éclairage sur la littérature algérienne et apporter des éléments de lecture du corpus où la référence à l’Histoire est très explicite.
Les buts didactiques :
• Expliquer aux étudiants le lien subtil et complexe entre l’Histoire, le mythe et la littérature ;
• Expliciter la complexité du fait littéraire et montrer aux étudiants que toute tentative de restitution mécanique du fait historique à partir de productions fictionnelles ne peut que conduire à un réductionnisme incommode et partial.
• Donner aux étudiants l’opportunité de relier les problématiques générales évoquées pendant les cours (de littérature maghrébine entre autres) et les théories les plus récentes.
Les axes :
Axe théorique :
• Les genres factuels et l’Histoire ;
• Fiction et fictionalité ;
• Interaction mythe et histoire dans la littérature ;
• Le mythe et la littérature de témoignage.
Littérature algérienne :
• Littérature algérienne et l’Histoire ;
• Le mythe et l’Histoire dans la littérature algérienne ;
• L’Histoire dans les écrits de la période dite mimétique ;
• L’Histoire dans les écrits dits ethnographiques ;
• Histoire et littérature d’urgence.
Contact :
Nous invitons les chercheurs intéressés par cet argumentaire à envoyer via l'adresse électronique suivante : abc_mus@yahoo.fr les propositions de communication en français ou en arabe. Les propositions devraient inclure (préférablement sur un seul document) un titre, un résumé et les coordonnées de l’intervenant.
Dernier délai d’envoi des propositions : 05 avril 2012
Notifications d’acceptation : 10 avril 2012 [Réduire] Contact : abc_mus@yahoo.fr |
Du 11 au 14 Avril 2012 :
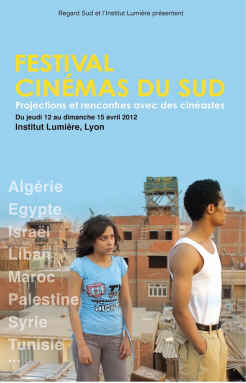 |
Festival des Cinémas du Sud Lyon (France) - Institut Lumière Festival organisé par Regards Sud et l'institut Lumière, avec cette année un hommage au cinéma syrien |
Du 29 au 30 Mars 2012 :
 |
L'Indépendance de l'Algérie, 50 ans après Lyon (France) - Théâtre des Asphodèles, Lyon 3ème Vendredi 30 Mars
18H30 – 20H : La légitimité du soulèvement (thawra) de 1954
avec Smaïl Goumeziane, spécialiste de l’Algérie et de la Méditerranée. Il a publié, entre autres, Algérie : L’histoire en héritage (2011) et Fils de Novembre (2004) et Wassyla Tamzali, écrivaine et mil... [Afficher la suite] Vendredi 30 Mars
18H30 – 20H : La légitimité du soulèvement (thawra) de 1954
avec Smaïl Goumeziane, spécialiste de l’Algérie et de la Méditerranée. Il a publié, entre autres, Algérie : L’histoire en héritage (2011) et Fils de Novembre (2004) et Wassyla Tamzali, écrivaine et militante. Elle a notamment écrit Une femme en colère (2010) et Une éducation algérienne, de la révolution à la décennie noire (2007).
20H30 – 22H30 : Hommage à Frantz Fanon
En présence de Mireille Fanon-Mendès France, de psychiatres, d’historiens… Cette rencontre sera ponctuée par des lectures musicales de textes de Frantz Fanon. Soirée organisée en partenariat avec l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP).
Samedi 31 Mars
10H30 – 12H30 : Combats anticolonialistes et solidarités franco-algériennes 1954-1962
avec Julien Hage (agrégé et docteur en histoire, spécialiste de la presse et des éditions, il consacre ses études au rôle du livre et de l’imprimé politique) et Tramor Quemeneur (enseignant, auteur de la thèse Une guerre sans « non » : insoumissions, refus d’obéissance et désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie (2007).
14H00 – 16H00 : Guerre de libération algérienne et connexions Afrique / Asie
avec Ganda Camara, coordinateur de l’ONG RADDHO Diaspora (Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme) et Pierre Journoud, chercheur à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire où il collabore à l’étude des enjeux stratégiques en Asie orientale depuis 1945.
16H15 – 18H15 : L’Algérie indépendante : bilan en France et en Algérie
avec Jérémie Piolat, philosophe et réalisateur, il est l’auteur de Portrait du colonialiste – L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions (2011) - Gilbert Meynier, historien de l’Algérie, auteur, co-auteur ou directeur de plusieurs livres dont Histoire intérieure du FLN 1954-1962 (2002) et Alger, Casbah (2003) et Ahmed Dahmani, docteur en sciences économiques, militant du collectif « Pour un Maghreb des Droits de l’Homme ». Parmi ses publications : Algérie, violations des droits économiques, sociaux et culturels (2001), L’Algérie à l’épreuve. Économie politique des réformes (1999).
18H30 Trio Bassma / Concert / A la croisée des mémoires… Algérie
Le trio a puisé dans toute la diversité de la musique algérienne (classique, folklorique, chaâbi ou encore diwane) pour réunir dans un répertoire d’une heure et demie, quelques perles du patrimoine algérien : Cheikh El Mohamed El Anka, Yacine Ouabed, Othmane Bali… :
avec Chems Amrouche (chant et guitare), Hassan Abdalrahman (oud) et David Bruley (percussions).
Informations pratiques >
Lieu : Théâtre des Asphodèles, 17 bis Impasse Saint Eusèbe – Lyon 3è
Participation aux frais : 5 € (sur réservation, jauge limitée)
Informations et inscriptions : Maison des Passages / 04 78 42 19 04 ou maisondespassages@orange.fr
Bar et petite restauration sur place.
Accès TCL : Métro D / Saxe Gambetta puis C11 direction Laurent Bonnevay / Arrêt Carry [Réduire] |
Du 23 au 24 Avril 2012 :
 |
Stratégies et expériences scripturales chez Amine Zaoui, Driss Chraïbi et Rachid Boudjedra Batna (Algérie) - Université " Les hommes vivent dans un monde où ce sont les mots et non les actes qui ont du pouvoir,
où la compétence ultime, c'est la maîtrise du langage."
Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, Gallimard, 2006, p.74.
L'organisation de ce séminaire international s'inscrit dan... [Afficher la suite] " Les hommes vivent dans un monde où ce sont les mots et non les actes qui ont du pouvoir,
où la compétence ultime, c'est la maîtrise du langage."
Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, Gallimard, 2006, p.74.
L'organisation de ce séminaire international s'inscrit dans le prolongement de celui organisé le 01 et 02 décembre 2010 autour de la problématique du : POURQUOI ET POUR QUI ECRIT-ON LA LITTERATURE MAGHREBINE D'EXPRESSION FRANCAISE ? La problématique du séminaire répond, d'une part, à l'une des recommandations du séminaire de 2010 et, d'autre part, à la mouvance de la littérature. Adaptable, variable et modulable, la littérature maghrébine d'expression française, comme toute littérature, reflète la variation, la diversité et la pluralité des stratégies et des expériences d'écriture. Comme acte de communication, la littérature est, à la suite de Dominique Maingueneau, " un corpus voué à être commenté de multiples manières et le développement d'une analyse du discours littéraire ne saurait de toute façon prétendre à quelque monopole." C'est dire, qu'il est impensable de rendre compte de la valeur d'une littérature sans s'interroger sur les techniques qu'elle met en œuvre et les éléments qui la constituent. La question des stratégies scripturales, notamment au plan de la langue, des techniques romanesques, des genres et de la culture est dès lors séduisante.
L'ambition de ce séminaire est de sélectionner un ensemble de réflexions sur l'intertextualité, la transculturalité, la transgénéricité, la polyphonie, l'identité littéraire, les registres et les techniques d'écriture, la démarcation stylistique et thématique, les espaces géographique et culturel mouvants dont elle fait référence, le dit et le dire… et bien d'autres questions laissées à l'initiative des intéressés par la problématique du séminaire. Le champ d'intervention et d'investigation est donc fort riche. Il provoque et incite une somme de réflexions et de savoirs.
L'intérêt de cette rencontre scientifique consisterait à enrichir la réflexion sur la pensée littéraire maghrébine d'expression française et mettre en relief la singularité et la complexité de la textualité de cette littérature. L'importance prise par la notion de stratégies et expérience scripturales s'explique par la conjonction de différents facteurs allant jusqu'à évoquer la question de la caractérisation, de la poétique et de la littérarité de la littérature maghrébine d'expression française. La question de la praxis langagière telle qu'elle est concrètement développée et réalisée à travers des techniques d'écriture bien particulières nécessite, à son tour, une réflexion. A ce titre, l'existence de relations entre finalité (l'objectif que tout écrivain s'assigne) et stratégies est à débattre.
Parler de stratégies n'a de sens qu'en référence à une conception ouverte de la littérature comme activité mentale constructive de l'individu. La notion de stratégie est alors considérée comme un point capital dans la réflexion, car l'une des fonctions essentielles des stratégies en question est de valider deux principes :
1. La diversité et la pluralité des stratégies scripturales.
2. La présence de procédés particuliers.
La lecture de l'œuvre romanesque de Chraïbi, de Boudjedra et de Zaoui autorise à dire que la caractéristique "linguistico-culturelle" s'offre comme marque distinctive des stratégies en question. Cette caractéristique symbolise le dialogue qu'ouvre la littérature entre soi et l'autre, entre le génie singulier du soi et l'apport linguistico-culturel. Dire qu'elle est un outil de dévoilement, un dispositif de démarcation, une manifestation de l'identité et de l'altérité, c'est se demander sur la finalité des stratégies en question.
Au carrefour de l'interdisciplinarité, il parait essentiel de négocier le terme de "stratégie" dans la littérature maghrébine d'expression française. L'objectif serait donc de voir si réellement il existe des stratégies particulières à cette littérature la distinguant non seulement des autres littératures étrangères d'expression française mais aussi des écrits en arabe des écrivains concernés par la problématique.
1. La littérature maghrébine d'expression française : Stratégies scripturales / stratégies de communication?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Quelles frontières scripturales? Contraintes ou transgressions?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Intertextualité, transculturalité, transgénérécité?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Polyphonie et dialogisme?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Quelles stratégies pour quels lecteurs?
----------------------------------------------------------------------
6. Poétique et littérarité?
---------------------------------------------------------------------------------- [Réduire] |
Du 21 au 31 Mars 2012 :
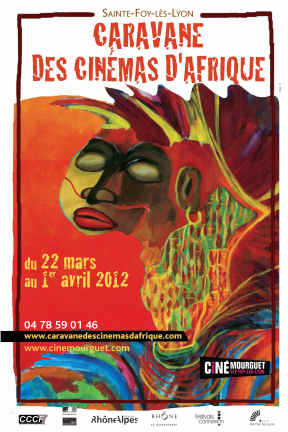 |
Caravane des cinémas d'Afrique Région Rhône-Alpes (France) - Divers cinémas |
Le 16 Mars 2012 :
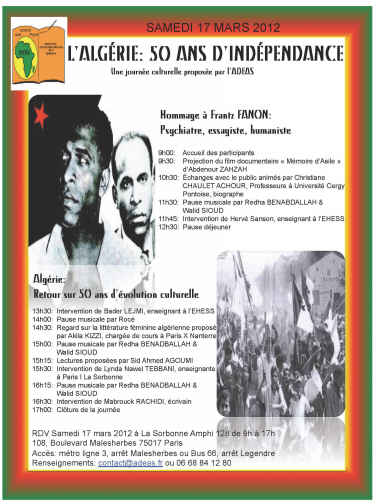 |
L'Algérie: 50 ans d'indépendance. Hommage à Frantz Fanon Paris (France) - Sorbonne Hommage à Frantz FANON:
Psychiatre, essayiste, humaniste
RDV Samedi 17 mars 2012 à La Sorbonne Amphi 128 de 9h à 17h
108, Boulevard Malesherbes 75017 Paris
Accès: métro ligne 3, arrêt Malesherbes ou Bus 66, arrêt Legendre
Renseignements: contact@adeas.fr ou 06 68 84 12 80
Algérie:
Ret... [Afficher la suite] Hommage à Frantz FANON:
Psychiatre, essayiste, humaniste
RDV Samedi 17 mars 2012 à La Sorbonne Amphi 128 de 9h à 17h
108, Boulevard Malesherbes 75017 Paris
Accès: métro ligne 3, arrêt Malesherbes ou Bus 66, arrêt Legendre
Renseignements: contact@adeas.fr ou 06 68 84 12 80
Algérie:
Retour sur 50 ans d’évolution culturelle
9h00: Accueil des participants
9h30: Projection du film documentaire « Mémoire d’Asile »
d’Abdenour ZAHZAH
10h30: Échanges avec le public animés par Christiane
CHAULET ACHOUR, Professeure à Université Cergy
Pontoise, biographe
11h30: Pause musicale par Redha BENABDALLAH &
Walid SIOUD
11h45: Intervention de Hervé Sanson, enseignant à l’EHESS
12h30: Pause déjeuner
13h30: Intervention de Bader LEJMI, enseignant à l’EHESS
14h00: Pause musicale par Rocé
14h30: Regard sur la littérature féminine algérienne proposé
par Akila KIZZI, chargée de cours à Paris X Nanterre
15h00: Pause musicale par Redha BENADBALLAH &
Walid SIOUD
15h15: Lectures proposées par Sid Ahmed AGOUMI
15h30: Intervention de Lynda Nawel TEBBANI, enseignante
à Paris I La Sorbonne
16h15: Pause musicale par Redha BENADBALLAH &
Walid SIOUD
16h30: Intervention de Mabrouck RACHIDI, écrivain
17h00: Clôture de la journée [Réduire] Contact : contact@adeas.fr |
Du 01 Mars au 24 Mai 2012 :
 |
Créer et diffuser en francophonie Paris (France) - Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm Vendredi 2 mars, 17h-19h, salle Beckett
« La francophonie dans la République: évidence ou contradiction? »
Entretien avec Pascal Blanchard, historien (CNRS), et Robert Chaudenson,
linguiste (Université de Provence) par Alexis Diagne Thevenod (doctorant Paris IV).
Vendredi 13 avril, 16h30-18... [Afficher la suite] Vendredi 2 mars, 17h-19h, salle Beckett
« La francophonie dans la République: évidence ou contradiction? »
Entretien avec Pascal Blanchard, historien (CNRS), et Robert Chaudenson,
linguiste (Université de Provence) par Alexis Diagne Thevenod (doctorant Paris IV).
Vendredi 13 avril, 16h30-18h30, salle Cavaillès (Attention changement de date!)
« La place du français dans le marché international des
traductions. »
Conférence de Gisèle Sapiro, sociologue, directrice d'études à l'EHESS.
Vendredi 27 avril, 14-19h, salle Beckett
En partenariat avec le séminaire « Littératures et théories postcoloniales ».
Journée d'étude « Ecritures des Caraïbes : traversées littéraires. »
Entretien avec les écrivains Jean-Philippe Dalembert et Daniel Maximin par
Ombeline de Saint Louvent (Paris III) ;
Conférence-débat avec Achille Mbembé (chercheur en histoire et science politique)
et Aude Dieudé (doctorante Duke University);
Table ronde animée par Lise Guilhamon (Versailles-St Quentin) et Laetitia Zecchini
(CNRS).
Vendredi 25 mai, 17h-19h, salle Weil
« La place des littératures francophones contemporaines dans les
relations culturelles internationales : la stratégie de l'Institut
Français. »
Conférence-débat avec Marcella Frisani (doctorante CSE/EHESS) et Paul de
Sinéty (Directeur du Département Livre et Promotion des savoirs, Institut Français
de Paris).
Consultez notre site www.francophonie-ens.org pour les mises à jour et modifications, et
inscrivez-vous pour partager des informations sur la recherche sur la francophonie en Ile de
France.
Rejoignez-nous sur facebook: francophonie-ens.
Contact: tristan.leperlier@normalesup.org [Réduire] Contact : tristan.leperlier@normalesup.org |
Le 07 Mars 2012 :
| |
Journée d'étude: « L’écriture, lieu du dé-voilement du féminin » Guelma (Algérie) - Université 08 mai 1945 -Guelma Le Département de Français
Et le club scientifique « Dézartitude »
Organisent :
« Escales littéraires et artistiques »
Cycle de séminaires et de débats sur la littérature et les arts
Première rencontre le 08 mars 2012
Thème :
« L’écriture, lieu du dé-voilement du fémi... [Afficher la suite] Le Département de Français
Et le club scientifique « Dézartitude »
Organisent :
« Escales littéraires et artistiques »
Cycle de séminaires et de débats sur la littérature et les arts
Première rencontre le 08 mars 2012
Thème :
« L’écriture, lieu du dé-voilement du féminin »
Amphi 9
Programme :
- 9h00 : Houda Hamdi, enseignante au département d’anglais, sujet : « Elles pèsent toujours leur pesant de poudre… Femmes et écritures, entre hier et aujourd’hui »
- 9h15 : Amel Bourenane et Amel Ksouri, étudiantes en master1, sujet : « La vie et l’œuvre de George Sand »
- 9h30 : Loubna Chouial, Dora Bouguenoun, étudiantes en master 1, sujet : « Le personnage féminin dans Nedjma de Kateb Yacine »
- 9h45 : Asma Djaghout et Bouchra Laraba, étudiantes en master1, sujet : «Le statut de la femme algérienne dans Bleu blanc vert de Maïssa Bey»
- 10h00 débat
- 10h10: Pause musicale
- 10h15 : Merouane Necib, enseignant au département de français, sujet : « Zola et la femme fatale, entre mythe et écriture naturaliste »
- 10h30 : Somia Djebar, étudiante en master 1, sujet : « L’image de la femme dans l’œuvre d’Assia Djebar »
- 10h45 : Malika Guebailia, étudiante en master 2, sujet : « Littérature maghrébine; figures féminines »
- 11h 00: Lecture de textes : présentée par Amel Bensalem, étudiante en master 1.
- 11h15 : Amel Maafa, enseignante au département de français, sujet : « Les femmes-muses dans la littérature et les arts »
- 11h 30: débat
- Pause musicale
- 12h00 Pause déjeuner
+++++++++++++++++++++++++++++++
- 13h00 : Projection du long métrage : Rachida, réalisé par : Yamina Bachir-Chouikh [Réduire] |
Du 14 au 16 Mars 2012 :
| |
Alger (Algérie) - Université P R O G R A M M E
15 mars 2012
Matinée d’hommage officiel en présence de madame la ministre de la culture
10h : ouverture du colloque à la BN
- Allocution de bienvenue et ouverture des travaux par Monsieur Slimane HACHI, directeur du CNRPAH
- Allocution de madame la ministre
- Hommage du ... [Afficher la suite] P R O G R A M M E
15 mars 2012
Matinée d’hommage officiel en présence de madame la ministre de la culture
10h : ouverture du colloque à la BN
- Allocution de bienvenue et ouverture des travaux par Monsieur Slimane HACHI, directeur du CNRPAH
- Allocution de madame la ministre
- Hommage du fils au père : parole de Ali Feraoun
- Présentation du colloque par madame Naget Khadda et monsieur Youcef Nacib, organisateurs scientifiques du colloque
Première section : Feraoun : un intellectuel algérien du XXème siècle
11h Première séance : Présidence : M. Salah DEMBRI, universitaire et diplomate
Mme Zineb ALI BEN ALI, université de Paris VIII
M. Feraoun, témoin d’un temps, intellectuel en mutation
Mme Denise BRAHIMI, université de Paris VII
La guerre d’Algérie et l’émergence exemplaire d’un intellectuel organique selon Gramsci
M. Ahmed LANASRI, université de Lille
Un pionnier peut en cacher un autre
Déjeuner
14h30 : Deuxième séance : Présidence M. Gilbert GRANDGUILLAUME
الدكتور شعيب مڤنونيف:(جامعة بوبكر بلقايد تلمسان)
" تجليات البعد الوطني في كتابات مولود فرعون "الدروب الوعرة أنموذجا "
M. Benamar MEDIENE, Université d’Aix - Marseille
Un triangle humaniste : Amrouche / Fanon / Feraoun
M. Aïssa KADRI, université de Paris 8
Les instituteurs algériens dans la guerre de libération
Mme Farida AÏT FERROUKH, anthropologue, EHESS Paris
L'œuvre de M. Feraoun comme lieu de mémoire
Mme Fanny COLONNA, CNRS
Un cas particulier : Feraoun vu par lui-même
Débat
Pause café
Deuxième section : L’aventure du roman
16h. Première séance : Présidence : M. Charles BONN
Mme Arlette ROTH, CNRS
La réception en France de la littérature algérienne de langue française
Mme Khedidja KHELLADI, université d’Alger
Mythe et identité chez Feraoun
- الأستاذ الدكتور عبد الحق زريوح:(جامعة بوبكر بلقايد تلمسان)
" خصوصية الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية قراءة في بعض النماذج "
M. Benaouda LEBDAÏ, université du Mans
Le sujet colonial dans l’œuvre de fiction de Mouloud Feraoun
Débat
Vendredi 16 mars
Deuxième section (suite) : L’aventure du roman
9h : deuxième séance : Présidence : Mme MORTIMER
Mme Anne ROCHE, professeur émérite, université de Provence, France
Relire Feraoun à la lumière de "Les Français fictifs" de Renée Balibar
M. Charles BONN, professeur émérite de l’université de Lyon
Le tragique comme remise en cause de la lecture de Feraoun et des écrivains fondateurs réputés ‘ethnographiques’
Mme Elisabeth AREND, université de Brême, Allemagne
"Lorsque le Kabyle revient dans sa montagne ...": Réflexions sur "La Terre et le sang"
Mme Mildred MORTIMER, université du Colorado, USA
Du Fils du pauvre à The Poor Man’s Son : Est-ce que le texte abrégé trahit le projet littéraire ?
Débat
Pause –café
11h : Troisième séance : Présidence : Mme Denise BRAHIMI
M. Saltani BERNOUSSI, Université de Fès, Maroc
L’étranger de l’intérieur
M. José LENZINI, Journaliste essayiste
Albert Camus/ Mouloud Feraoun : une amitié difficile.
M. Kanté NIANGUIRY
La structure familiale traditionnelle malienne comparée à la structure familiale dans « Le fils du pauvre »
Débat
Déjeuner
14h30 : Quatrième séance : Présidence Mme Elisabeth AREND
M. Jean Maurice MONNOYER, université de Marseille
Ecriture pseudo-scolaire ou l’art de rendre le français étranger à lui-même
Mme Naget KHADDA, universités d’Alger/Montpellier
L’écriture en chantier : un détournement subreptice du code réaliste
Mme Afifa BERERHI, Université d’Alger
Mouloud Feraoun : la troublante transparence d’une écriture
- الباحثة أيت موحند نورية (CNRPAH)
" توظيف التراث الشعبي في روايات مولود فرعون"
Débat
Pause - café
16h30 : Cinquième séance : Présidence M. Jacques GIRAULT
M. Ali CHIBANI, université de Paris 4
Le Journal chez Mouloud Feraoun et Jean El Mouhoub Amrouche : le journal comme « asile de paix » en plein drame spirituel.
M. Satoshi UDO, Chercheur, Société japonaise pour la promotion des sciences
Portrait du jeune homme dans le roman fondateur : Mouloud Feraoun et Sôseki Natsume
Mme Sabéha BENMANSOUR, université de Tlemcen
Féraoun/Dib : deux écritures ancrées dans l’Algérie profonde
Mme Amina BEKKAT, Professeure, université de Blida
Représentation de l’école dans les romans de formation du Maghreb et d’Afrique subsaharienne
Débat
17 mars : Troisième section : Du côté de l’école
9h : Première séance : Présidence : M. Mohammed SARI
M. Youssef NACIB, professeur de socio- anthropologie
Feraoun dans l'acculturation
M. Emmanuel SACRISTE, université de Toulouse ?
L’histoire du système éducatif colonial en Algérie au regard de l’œuvre de Mouloud Feraoun
M. Jacques GIRAULT, Université de Paris 13.
A propos des enseignements et des enseignants du second degré en Algérie des années 1920 – 1960
M. Gilbert GRANDGUILLAUME, EHESS
A propos des inspecteurs des Centres Sociaux
Débat
Pause café
Quatrième section : Audience de Feraoun
11h Première séance : Présidence M. Saltani BERNOUSSI
M. Yusuf SHAABANE, université du Caire
Traduction et réception des livres de Feraoun en Egypte
Ecrire en arabe
Mme Djohar AMHIS, enseignante, Alger
Parcours d’une œuvre : comment rendre Feraoun accessible à un public de jeunes
M. Mohamed SARI, université d’Alger
Réception de Feraoun dans le lectorat arabisant en Algérie et traduction(s)
A mettre en arabe, il communiquera en arabe
Débat
Déjeuner
14h30 : Deuxième séance : Témoignages. Présidence : M. Mohamed SARI
- M. Sid Ahmed Dindane
- M. Moula HANNOUNE, Alger : sur Feraoun instituteur
- M. Ramdane OUAHES
- M. Jean Maurice Monnoyer : relation de Feraoun avec le journaliste ami, Maurice Monnoyer
- Témoignage d’un témoin oculaire : Sid Ahmed Dindane
CD de France Culture sur Feraoun
Pause-café
16h Table ronde d’écrivains : modérateur M. Benamar MEDIENE
Participants :
- Rachid Boudjedra
- Waciny Laredj
- Arezki Métref
- Nourredine Saadi
- Brahim Tazaghart
- Zhor Ounissi
- Mohammed Sari
18h : Clôture des travaux [Réduire] |
Du 16 Janvier au 16 Mars 2012 :
| |
Grenoble (France) - Bibliothèque municipale centre ville L'exposition autour de Mohammed Dib aura lieu du 17 Janvier au 17
mars à la Bibliothèque Centre Ville de Grenoble
elle sera composée
- de photos de Mohammed Dib publiées en 1994 (Ed.La revue noire)
" TLEMCEN, OU LES LIEUX DE L'ÉCRITURE" Mohamed Dib, Philippe Bo
rdas
Texte ... [Afficher la suite] L'exposition autour de Mohammed Dib aura lieu du 17 Janvier au 17
mars à la Bibliothèque Centre Ville de Grenoble
elle sera composée
- de photos de Mohammed Dib publiées en 1994 (Ed.La revue noire)
" TLEMCEN, OU LES LIEUX DE L'ÉCRITURE" Mohamed Dib, Philippe Bo
rdas
Texte et photographies de Mohamed Dib (Algérie) et Philippe Bo
rdas (France) et essai littéraire de M. Dib sur la photographie
et la mémoire de l'écriture.
- de manuscrits inédits ou annotés et remaniés appatenant à la
famille Dib
- de lettres d'écrivains : Albert Camus, Gaston Bachelard Jean
Daniel etc
- d'extraits ce cet essai littéraire sur la mémoire de l'écri
ture
Le vernissage aura lieu le 19 janvier 2012 à 18h30:
la soirée comprendra :
une conversation avec monsieur Habib Tengour, universitaire,
responsable entre autres, de l'édition des poésies complètes de
M.dib aux Editions de la Différence et de la préface de la rédit
ion d'"Habel" qui parait le 19janvier toujours à la Différence!
des lectures de poèmes par jean-Pierre Chambon selon le voeu de
Madame Dib [Réduire] |
Du 04 au 06 Novembre 2012 :
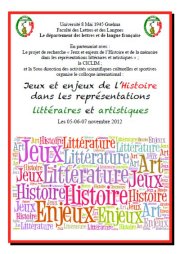 |
Jeux et enjeux de l’Histoire dans les représentations littéraires et artistiques Guelma (Algérie) - Université Le département de français de la Faculté des lettres et des langues étrangères de l'Université du 8 mai 1945 de Guelma, en partenariat avec le projet de recherche : « Jeux et enjeux de l’Histoire et de la mémoire dans les représentations littéraires et artistiques » et la Coordination I... [Afficher la suite] Le département de français de la Faculté des lettres et des langues étrangères de l'Université du 8 mai 1945 de Guelma, en partenariat avec le projet de recherche : « Jeux et enjeux de l’Histoire et de la mémoire dans les représentations littéraires et artistiques » et la Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures du Maghreb (CICLIM) organise le colloque international :
« Jeux et enjeux de l’Histoire dans les représentations littéraires et artistiques »
Les 05-06-07 novembre 2012
L’argumentaire :
L'art et tout particulièrement la littérature impose souvent d'être situé dans son jeu stratégique dans un rapport essentiel à l'espace social, politique, historique (voire économique) qui sembleraient lui conférer un sens. Cette analyse touchant tout à la fois la sociologie de l'art et la théorie postcoloniale propose d'appréhender, d'étudier et d'interpréter l'œuvre loin de son aspect autonome qui ne peut être détaché du contexte dans lequel elle évolue et qui demeure repérable entre ses lignes. Pour ces ceux approches critiques, l'œuvre se donne même la mission de le critiquer, de l’illustrer ou d’en décrire les constituants. Le roman serait ainsi le document par excellence pour lire l’Histoire et l’événement.
L'histoire et l’Histoire sont présentes dans la littérature « dans la mesure où l'œuvre, pour apparaître, avait besoin de cette histoire, qui est son seul principe de réalité, (…) ». Paradoxes et jeux particuliers de cette polysémie caractérisant le rapport historique inhérent à l’œuvre. De la diachronie à la synchronie, le roman peut apparaître comme l’espace privilégié de la lecture de l’Histoire : par son agencement (Ricoeur), son rapport à la mémoire collective (Nora) et sa nécessaire remémoration (Deleuze). Cette réalité historique est traduite par un écrivain, par un groupe social, voire par une époque dans des éléments indiscutables de l’élaboration d’une fiction. L'Histoire qui se déploie dans le roman ne fait qu'appuyer sa présence, sa propension à changer le cours des évènements voire à se projeter dans l’avenir.
Notre colloque vise à enrichir le débat sur les jeux et les enjeux de l’Histoire dans les représentations littéraires francophones, voire non francophone, afin de reconstituer le(s) sens lu(s), écrit(s) et crée(s) dans une écriture qui tend non seulement à la créativité mais aussi à l’exposition de faits et de réalités vérifiables, contestées ou réécrites. Il s’agira d’interroger dans le roman les JEUX de l’Histoire comme stratégie discursive et ses Enjeux comme méthode analytique à travers les axes suivants:
* (Ré) écriture de l'Histoire dans les littératures francophones ou la relation entre Histoire et histoire dans le récit.
*Mythes, fictions et Histoire
*Mémoire individuelle, mémoire collective
*Histoire et identité
*Objectivité et subjectivité dans le récit historique
*Littérature, Histoire et cinéma.
*Littérature comparée
Les langues du travail du colloque sont le français, l’anglais et l’arabe. Les propositions de contribution, (max. 300 mots) mentionnant le nom de l'Université d'appartenance et une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer au plus tard le 31 mai 2012 aux deux adresses suivantes:
colloquehistoireguelma@gmail.com
maafa_amel@yahoo.fr
Comité scientifique :
Pr. Abbes BAHOUS, Université de Mostaganem, Algérie.
Pr. Charles BONN, Professeur émérite à l’Université Lyon 2, France.
Pr. Ahmed CHENIKI, Université d’Annaba, Algérie.
Pr. Hadj MILIANI, Université de Mostaganem, Algérie.
Pr. Yazid BENJEDDOU, Université d’Annaba, Algérie.
Dr. Salah BOUREGBI, Université d’Annaba, Algérie.
Dr. Hocine MAOUI, Université d’Annaba, Algérie.
Madame Lynda-Nawel TEBBANI-ALAOUACHE, Universités Lyon 2- Paris Sorbonne, France
Mlle Houda HAMDI, département d’anglais, université de 08 mai 1945, Guelma, Algérie
Mlle Amel MAAFA, département de français, université de 08 mai 1945, Guelma, Algérie.
Comité d’organisation :
Mlle Amel MAAFA, département de français, université 08 mai 1945, Guelma, Algérie.
Mlle Houda HAMDI, département d’anglais, université 08 mai 1945, Guelma, Algérie.
M. Raouf ALIOUI, département de français, université 08 mai 1945, Guelma, Algérie.
Mme Amira AMRANI, département de français, université 08 mai 1945, Guelma, Algérie.
Programme:
Programme
Le 05 Novembre 2012 (1ère journée)
(09h-09h30) Cérémonie d’ouverture
(09h30-10h40) Première séance : L’écriture de l’Histoire dans le roman algérien. Présidente : Houda HAMDI.
1. Charles BONN, Université Lyon 2, (France), « La production de l'Histoire par les premiers romans algériens »
2. Mounir HAMMOUDA, Université de Biskra, « Pour une mythogenèse contemporaine d’une Histoire primordiale »
3. Radia BENSLIMANE, Université d’Alger 2, « Les ruptures des contrats narratifs dans La femme sans sépulture d’Assia Djebar. »
(10h40-11h50) Deuxième séance : L’Histoire entre l’individuel et le collectif. Présidente : Jeanne FAUVERNIER-FOUET.
1. Zoubida BELAGHOUEG, Université de Constantine, « Quand l’Histoire déborde le générique et le géographique. »
2. Rim TRIKI, Université Tunis El-Manar, (Tunisie) “Immigrants’ Autobiographies and the Understanding of History”
3. Kahina BOUANANE, Université d’Oran, « Esthétique de l’écriture de l’Histoire : une nouvelle dynamique des jeux et enjeux dans La disparition de la langue française d’Assia Djebar. »
Pause Déjeuner
(14h00-15h10) Troisième séance : Littérature anglophone et Histoire. Président : Hocine MAOUI.
1. Ladi TOULGUI et Abdelhak ELAGGOUNE, Université de Guelma, “ “Uncle Tom” Outside his “Cabin”: Stowe’s Novel between Historical Icon and Rhetorical Target.”
2. Fella BENABED, Université d’Annaba, “Historiographic Metafiction and Narrative Identity in Postmodern Literature: Illustrations from Native American Novels.”
3. Narjes BEN YEDDER, Institut Supérieur des Langues de Tunis, (Tunisie) “Dead Certainties (Unwarranted Speculations): The Novella as Memorial.”
(15h10-16h40) Quatrième séance : Rapport entre Histoire et histoire (I). Présidente : Zoubida BELAGHOUEG
1. Fouzia AMROUCHE, Université de M’sila, « La secte des Assassins ou comment l’histoire évoque l’Histoire dans Les Sirènes de Bagdad de Yasmina KHADRA ? »
2. Messaoud BELHASSEB. Université de Guelma, « Les Morts conscientes de Camus ».
3. Latifa SARI MOHAMMED, Université de Tlemcen, « Intersection entre fiction et réalité ou comment l’Histoire se mêle de/à l’histoire ? dans Samarcande d’Amine Maâlouf. »
Le 6 Novembre 2012 (2ème journée)
(08h30-09h40) Première séance : L’Histoire dans l’art et la littérature noire africaine. Président : Salah BOUREGBUI.
1. Rodrigue Homero Saturnin BARBE, Université Laval Québec – (Canada), « Le théâtre populaire en Afrique noire postcoloniale: souvenir, identité et révolution. »
2. Hocine MAOUI, Université d’Annaba, “Writing a New Oppositional Historical Discourse: The Case of Some Postcolonial African Writers”
3. Ourida IDRESS, Université d’Annaba, “Historical dimension in Achebe and Ngugi’s Novel.”
(09h40-10h20) « La CICLIM présente le site LIMAG. »
(10h20-10h30) Pause café
***********************************
(10h30-12h00) Deuxième séance : Rapport entre Histoire et histoire (II). Président : Fayçal BENSAADI.
1. Houda MELAOUHIA BEN HAMADI, Institut Supérieur des Langues de Tunis, (Tunisie) « Le roman historique : écrire autrement l’histoire. »
2. Ghassan LUTFI, Université de Constantine, « Le récit biographique comme lecture-écriture et composition de l’Autre : l’image de la femme dans Aicha la bien-aimée du Prophète de Geneviève Chauvel. »
3. Sonia HAÏNE, Université de Constantine, « Nedjma de Kateb Yacine ou la fonctionnalisation de l’Histoire du mouvement national algérien. »
4. Samir OUARTSI, Université de Guelma, « Le roman historique chez Amin Maalouf : un genre de crise. »
(12h00-14h00) Pause déjeuner
(14h00-15h10) Troisième séance : Dire l’Histoire, l’oppression, et la violence. Présidente : Edwige ZAGRE /KABORE
1. Amina BENZERARA, Université d’Annaba, “Nigerian Civil War in Soyinka’s Season of Anomy.”
2. Houda HAMDI, Université de Guelma, « New History or new Historiography : Gloria Naylor tells herstory in Linden Hills »
3. Jeanne FAUVERNIER-FOUET, Université de Franche-Comté, (France), « Document ou monument? Interrogations sur le statut du témoignage historique comme source de la fiction romanesque, à partir des écrits des survivants du bagne de Tazmamart. »
***********************************
(15h10-15h20) Pause café
***********************************
(15h20-16h50) Quatrième séance : l’Histoire dans l’Art. Président : Messaoud BELHASSEB.
1. Konstantza GEORGAKAKI, Université d’Athènes (Grèce), « L’usage théâtral de l’histoire sous la dictature des colonels » (1967-1974)
2. Salah BOUREGBI, Université d’Annaba, “Art Vs. Identity: Between Authenticity and Elusive Representation.”
3. Leila MAGHMOUL, Université de Guelma, “The Arabs’ image between the Long History of Orientalistic Fiction and the Ongoing Cinematic Representation.”
4. Edwige ZAGRE /KABORE, Université de Koudougou (Burkina Faso), « L’Histoire dans l’art africain. »
Le 07 Novembre 2012 (3ème journée)
(09h00-10h35) Première séance : Les (en) jeux de l'Histoire dans le roman algérien d'après-l'indépendance. Président : Charles BONN
1. Samira SOUILAH, Université d’Annaba, « L'enjeu de l'Histoire dans le texte boudjedrien. »
2. Amel MAAFA, Université de Guelma, « La temporalité éclatée et son inscription dans l'Histoire chez Mimouni. »
3. Dalila BELKACEM, Université d’Oran, « Le Chaos des sens d’Ahlam Mosteghanemi ou l’écriture de l’Histoire par l’histoire. »
4. Fayçal BENSAADI, Université d’Oran, « Histoire, écriture et littérarité : la littérature à l’épreuve de l’Histoire. Autour du roman Le Rapt d’Anouar Benmalek. »
***********************************
(10h35-10h45) Pause café
***********************************
(10h45-12h00) Deuxième séance : l’Histoire dans la littérature européenne. Président : Amel MAAFA.
1. Djihane CHERIF, Université de Mascara, « Histoire en fiction, fiction d’une histoire à traves la grande intrigue de François Taillandier. »
2. Ouacila CHIHANI, Centre Universitaire d'El-Oued, « Pouvoir poétique et dimension socio-historique dans les nouvelles d’Isabelle Eberhardt. »
3. Yasmina LABED, Université de O.E.B, « « Paris de ma fenêtre » de Colette : L’occupation passée sous silence. Objectivité et subjectivité dans le récit historique. »
(12h00-12h30) Cérémonie de clôture.
(12h30-14h00) Pause déjeuner.
(14h00-18h00) Sortie touristique [Réduire] Contact : colloquehistoireguelma@gmail.com |
Le 09 Mars 2012 :
 |
Poésie & engagement: l'engagement se décline aussi en vers Saint-Denis (France) - Galerie Autres Regards Dans le cadre du Printemps des Poètes et du Printemps Culturel Tunisien, Collectif Culture Création et Citoyenneté en partenariat avec AIDDA, présente le samedi 10 mars 2012 à 15h30, "Poésie & engagement: l'engagement se décline aussi en vers" Lectures poétiques et autres... pl... [Afficher la suite] Dans le cadre du Printemps des Poètes et du Printemps Culturel Tunisien, Collectif Culture Création et Citoyenneté en partenariat avec AIDDA, présente le samedi 10 mars 2012 à 15h30, "Poésie & engagement: l'engagement se décline aussi en vers" Lectures poétiques et autres... plaisirs sonores, à la Galerie Autres Regards.
Avec la participation de
Thierry Sinda : Président du Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs
Mohamed Abaïd: Directeur artistique du Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs (accompagné au guembri)
Mohamed Bhar: Chanteur engagé tunisien (chantera les textes de Mohamed Foued Najm)
Ghani Alani: Calligraphe et poète irakien
Kamel Ghali: poète tunisien
Rym Sellami alias Yasmine El-Khadra: poétesse tunisienne
Houda Zekri: poétesse tunisienne (lectures bilingues)
Kamel Bouajila: poète tunisien
Safia Bouadan: auteure, metteur en scène et chanteuse française
Fayçal Bouzayen: poète et réalisateur tunisien
Mohamed Elmoubaraki: poète marocain
Mohamed Houssam Eddine Aouadi: poète tunisien
Aida Hamza: poétesse tunisienne
Ines Oueslati: poétesse tunisienne (lira des textes en dialecte tunisien)
Hélène Rollinde de Beaumont: auteure et éditrice française
Amar Meriech: poète algérien
Manel Bouabidi: poétesse tunisienne
Plus de renseignements: collectif3ccc@gmail.com / 06 43 93 20 48 - 06 74 79 93 71
http://www.facebook.com/pages/Collectif-Culture-Cr%C3%A9ation-Citoyennet%C3%A9/201155513307823 [Réduire] |
Le 23 Mars 2012 :
| |
Assemblée générale de l'Association française des arabisants Paris (France) - Maison des associations du 5ème arrondissement J’ai l’honneur de vous convier à la journée que nous organisons le Samedi 24 Mars 2012 de 10 h à 16h à la Maison des Associations du Vème arrondissement de Paris, 4 rue des Arènes, Paris Vème (Métro Monge).
En matinée, de 10h à 12h30, nous vous proposerons de faire ensemble un tour d�... [Afficher la suite] J’ai l’honneur de vous convier à la journée que nous organisons le Samedi 24 Mars 2012 de 10 h à 16h à la Maison des Associations du Vème arrondissement de Paris, 4 rue des Arènes, Paris Vème (Métro Monge).
En matinée, de 10h à 12h30, nous vous proposerons de faire ensemble un tour d’horizon de la situation actuelle de l’enseignement de l’arabe en France, et de ses perspectives d’avenir.
L’après-midi sera consacrée, de 14h à 16h, à l’Assemblée Générale de notre association, nous y procéderons notamment à l’élection du nouveau comité.
Pierre-Louis Reymond, président de l'AFDA
--
Association française des Arabisants - reconnue d'intérêt général - Collège de France - 52, rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris
http://afdarabisants.blogspot.com/ – mél : afda33@gmail.com [Réduire] |
Du 17 au 19 Octobre 2012 :
| |
L’EXTRATERRITORIALITE DES LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS : BILANS ET PERSPECTIVES Paris (France) - Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman (IMAGER, PRES Université Paris-Est) Colloque international, Paris, les 18, 19 et 20 octobre 2012
Organisé par l’Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman
(IMAGER, PRES Université Paris-Est),
avec le soutien de l’Institut Goethe Paris et la Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris.
Keyn... [Afficher la suite] Colloque international, Paris, les 18, 19 et 20 octobre 2012
Organisé par l’Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman
(IMAGER, PRES Université Paris-Est),
avec le soutien de l’Institut Goethe Paris et la Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris.
Keynote Speakers : Ottmar Ette, Abdelfattah Kilito, Hans-Jürgen Lüsebrink, Yoko Tawada
Langues de communication : français, anglais, allemand, espagnol
Organisation : Didier Lassalle et Dirk Weissmann (IMAGER)
Comité scientifique : Joëlle Aden, CREN/Université du Maine ; Bernard Banoun, EA3556 REIGENN/Université Paris-Sorbonne ; Corinne Bigot, CREA/Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense ; Papa Samba Diop, LIS/Université Paris-Est Créteil ; Claire Hancock, Lab’Urba/Université Paris-Est Créteil, Institut Universitaire de France ; Cécile Kovácsházy, EHIC/ Université de Limoges ; Florence Olivier, CERC/Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris-III ; Jean-Baptiste Velut, IMAGER/Université Paris-Est Marne-la-Vallée ; Maria Graciela Villanueva, IMAGER /Université Paris-Est Créteil
Notion juridique née au XIXe siècle et relevant du droit international public, l’extraterritorialité (ou l’exterritorialité) instaure d’abord le principe selon lequel une personne n’est pas forcément soumise aux lois du territoire sur lequel elle se trouve. Or, comme l’avait montré George Steiner (Extraterritorial, Papers on Literature and the Language Revolution, 1971), la notion peut être élargie et transposée dans le domaine culturel. Appliquée aux langues, littératures et civilisations, elle avance que, sous l’effet des bouleversements politiques du XXe siècle et de la mondialisation contemporaine, le territoire politique a perdu son ancienne puissance d’unification et de définition en matière culturelle.
En Europe et ailleurs, les mouvements nationalistes du XIXe siècle avaient porté à son paroxysme la territorialité des cultures. Dans le sillage des idées autour du ‘génie’ national et de la philosophie de Herder, l’équation « une nation = une langue = une culture » s’était érigée en modèle. Une certaine conception de l’historiographie et de la philologie a fortement promu cette approche, en lui permettant de devenir dominante, voire hégémonique. Si la territorialité reste aujourd’hui un principe crucial dans le domaine politique, l’idée d’une autochtonie des langues, littératures et civilisations est désormais contestée.
L’histoire montre que les acteurs de la vie intellectuelle et culturelle ont toujours été portés à la traversée et à la transgression des frontières territoriales. D’autre part, les guerres, colonisations, décolonisations et autres transformations politiques, sociales et économiques récentes ont favorisé les reconfigurations du cadre territorial. En particulier, elles ont déclenché des flux migratoires, des phénomènes d’exil et de diaspora qui ont engendré un déplacement massif des manifestations et expressions culturelles, leur ancrage territorial devenant incertain et instable.
Les confrontations culturelles, les formes d’hybridation et/ou de métissage résultant de ces déplacements sont souvent créatrices de dynamisme, d’innovation et de diversification (cf. Edouard Glissant, Poétique de la Relation, 1990). Il faut toutefois se garder de donner une image par trop idyllique de cette « déterritorialisation » (Gilles Deleuze), ou du « third space » (Homi K. Bhabha) ainsi créé, car le transfert ou l’exportation hors territoire engendre également des rapports de force et des phénomènes de nivellement. Dans cette perspective, la ‘territorialisation’ peut apparaître comme un moyen de protection et de préservation. Ainsi Régis Debray a récemment mis en garde contre l’abandon du concept de frontière qu’il s’agit, selon lui, de réhabiliter (Eloge des frontières, 2010).
Entre une ‘(re)territorialisation’ de type nationaliste et une globalisation uniformisatrice et sans frontières, comment situer l’extraterritorialité des langues, littératures et civilisations ? Quelles sont ses manifestations infra- ou supranationales ? Quels sont les modèles historiques, quelle est la genèse de ce phénomène ? Quels en sont les enjeux pour le monde contemporain ? Une cartographie ou une typologie en est-elle possible par-delà ou à travers la diversité des aires linguistiques et culturelles ?
IMAGER étant un groupe de recherche transdisciplinaire, la problématique sera abordée selon plusieurs axes disciplinaires (littérature, histoire, linguistique, sociologie, etc.), en privilégiant des approches « transaréales ».
Les contributions pourront s’inscrire dans plusieurs axes thématiques :
- actualité et limites de l’extra-territorialité
- entre ‘déterritorialisation’ et ‘reterritorialisation’ : quel territoire, quel dépassement ?
- constructions identitaires et imaginaires de l’extra-territorialité
- flux migratoires et communautés diasporiques
- littératures de l’exil, de la migration, de la postcolonialité
- sociétés/communautés plurilingues, langues en contact, langues coloniales et postcoloniales
- transferts culturels, circulation des textes et des savoirs, traduction
- cosmopolitisme, internationalisme, postnationalisme
- au-delà de l’extra-territorialité : littératures, langues et cultures sans territoire ?
On privilégiera les approches et les réflexions théoriques ancrées dans des problématiques contemporaines, tout en les inscrivant dans la moyenne ou la longue durée.
Les propositions de communication, sous forme d’un résumé d’environ 250 mots, accompagné d’une notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 1er avril 2012 à Didier Lassalle (didier.lassalle@u-pec.fr) ET Dirk Weissmann (weissmann@u-pec.fr).
Nous contribuerons au remboursement des frais de déplacement et de voyage des intervenants, dans la limite du budget du colloque. Une publication des meilleures contributions est prévue, les propositions envoyées étant elles-mêmes soumises à expertise. [Réduire] Contact : avant le 1er avril 2012 à Didier Lassalle (didier.lassalle@u-pec.fr) ET Dirk Weissmann (weissmann@u-pec.fr). |
Du 23 au 24 Septembre 2012 :
| |
LES POSSIBILITES D’UNE ILE TOUR D’HORIZON LITTERAIRE ET CULTUREL : APPROCHES THEORIQUES ET IDENTITAIRES FORUM DE L’APEF 2012 Madère (Portugal) L’insularité se trouve être au centre d’un riche foisonnement sémantique et d’un stimulant filon culturel, artistique et identitaire que ce colloque invite à mettre à profit, et ce, in loco, sur l’île de Madère.
Elle pointe un réseau sémantique des plus riches et complexes qui, out... [Afficher la suite] L’insularité se trouve être au centre d’un riche foisonnement sémantique et d’un stimulant filon culturel, artistique et identitaire que ce colloque invite à mettre à profit, et ce, in loco, sur l’île de Madère.
Elle pointe un réseau sémantique des plus riches et complexes qui, outre la situation géographique et le vécu physique de l’île, se signale aussi par les dérivés étymologiques, sémantiques, linguistiques et culturels de l’insularité : isoler, isolement, isoloir, presqu’île, péninsule…. Il en découle une pertinente approche des dynamiques du rester et du partir; de l’isolement et de la socialité ; du centre (qui légitime) et de la périphérie (souvent oubliée).
Qui plus est, l’insularité (et l’île) fournit un matériau conceptuel et métaphorique incontournable dans la mise en exergue de la construction de certains personnages (personnalités) aussi bien qu’un précieux outil théorique dans la définition des enjeux identitaires et sociaux de l’écriture francophone, mais aussi du monde actuel et global (cf. par exemple l’archipel chez É. Glissant) ou encore de l’espace utopique.
Aussi, l’Association Portugaise d’Études Françaises, en partenariat avec l’Université de Madère, est-elle heureuse d’annoncer ce forum APEF 2012 (www.apef.org.pt) qu’elle organise à Funchal, à l’Université de Madère, et en raison duquel elle lance cet appel à communications aux chercheurs que cette vaste thématique et cette réflexion transversale ne manqueront pas d'intéresser et d’interpeller d’un point de vue que nous souhaitons également comparatiste.
Dans le cadre général de ce rendez-vous, des axes de travail sont suggérés, dans le sens, notamment, de favoriser un croisement thématique, réflexif, critique et problématique, même si d’autres approches pourront s’avérer pertinentes :
1. Présence thématique de l’île dans les littératures de langue française et comparées ;
2. Représentations littéraires et symboliques de l’île ;
3. Réseau sémantique de l’isolement ;
4. Usage métaphorique et théorique de l’insularité ;
5. Usage utopique de l’île ;
6. L’insularité dans les sciences sociales ;
7. L’île et ses multiples traductions dans les arts ;
8. L’île et ses représentations culturelles et historiques ;
9. L’île dans la construction de l’Atlantique ;
10. La géographie des îles et ses cartographies affectives, imaginaires et
identitaires.
LANGUES DES COMMUNICATIONS :
Les langues de présentation des communications sont le français, le portugais, l’anglais et l’espagnol.
LANGUES POUR NOS DEMARCHES:
Le français et le portugais.
CALENDRIER :
15 avril 2012: date limite pour présenter des propositions de communication (20 minutes maximum) (résumé de 350 mots).
11 mai 2012: date limite pour la réponse du comité scientifique.
15 juin 2012 : programme définitif.
ORGANISATION :
Ana Clara Santos (Un. Algarve)
Ana Isabel Moniz (Un. Madère)
Leonor Coelho (Un. Madère)
Dominique Faria (Un. des Açores)
Maria de Jesus Cabral (Un. Coimbra)
José Domingues de Almeida (Un. Porto)
COMITÉ SCIENTIFIQUE:
Ana Clara Santos (Un. Algarve)
Ana Isabel Moniz (Un. Madère)
Ana Paula Coutinho Mendes (Un. Porto)
Cristina Robalo Cordeiro (Un. Coimbra)
Dominique Faria (Un. des Açores)
Gonçalo Vilas-Boas (Un. Porto)
José Domingues de Almeida (Un. Porto)
Leonor Coelho (Un. Madère)
Maria de Fátima Marinho (Un. Porto)
Maria Hermínia Amado Laurel (Un. Aveiro)
Maria de Lourdes Câncio Martins (Un. Lisboa)
Marta Teixeira Anacleto (Un. Coimbra)
Maria de Jesus Reis Cabral (Un. Coimbra)
Rosa Maria Baptista Goulart (Un. Açores)
ENVOI DES PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS :
Toutes les propositions de communication seront soumises à l’évaluation du Comité Scientifique du colloque. Prière d’indiquer l’axe de travail retenu. Les communications admises ne dépasseront pas les 20 minutes.
Afin de soumettre votre proposition de communication, sous forme d’un résumé de 350 mots accompagné d’un court CV, prière de nous joindre sur le courriel suivant : forumapef2012@gmail.com
INSCRIPTION
Jusqu’au 15 juin :
Membres de l'APEF avec communication : 45,00€
Autres avec communication : 70,00€
Doctorants avec communication : 30,00€
Après cette date :
Membres de l'APEF avec communication : 60,00€
Autres avec communication : 90,00€
Doctorants avec communication : 50,00€
Le paiement de l'inscription est un soutien à la publication du volume sur « Les possibilités d'une île » dans la collection « Exotopies » de l'APEF aux Éditions Le Manuscrit. Chaque auteur recevra un exemplaire du volume.
MODALITES DE PAIEMENT:
(Pour le Portugal) Virement bancaire : NIB: 0010 0000 34138130001 44
(Pour l’étranger) Virement bancaire : IBAN: PT50 0010 0000 3413 8130 0014 4
BIC: BBPIPTPL
(Photocopie du virement ATM envoyée à l’adresse ci-dessous, faisant foi)
José Domingues de Almeida (jalmeida@letras.up.pt)
Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
Via Panorâmica, s/n 4150-564 PORTO
Contact : forumapef2012@gmail.com
Lien : www.apef.org.pt [Réduire] |
Du 17 Février au 16 Mars 2012 :
| |
Les Berbères (Amazighs) dans le monde arabe ? LYON (FRANCE) - Espace multiculturel arts dreams Le Café Littéraire Arabophone est ravi de vous accueillir pour sa 5ème édition sur le thème :
Les Berbères (Amazighs) dans le monde arabe ?
Au programme :
De 18h30 à 19h30 : échanges spontanés et arrivée progressive des participants à la soirée. Thé à la menthe, dégustation... [Afficher la suite] Le Café Littéraire Arabophone est ravi de vous accueillir pour sa 5ème édition sur le thème :
Les Berbères (Amazighs) dans le monde arabe ?
Au programme :
De 18h30 à 19h30 : échanges spontanés et arrivée progressive des participants à la soirée. Thé à la menthe, dégustation de pâtisseries orientales.
19h30 : Présentation du 5ème Café Littéraire Arabophone
1ère partie :
- Ouverture de la soirée par un temps musical avec de la musique kabyle par Fodil Ouatah, chanteur et poète amazigh.
- Projection d’un court documentaire sur l’origine géographique des Berbères.
- Intervention de Abdoulahi Attayoub, Président de l’association Survie Touarègue-Temoust, qui nous parlera de la culture touarègue.
- Échanges, débats autour des questions :
« Les Berbères sont-ils une minorité ou une majorité dans le monde arabe ? »
« La culture berbère est-elle préservée, reconnue, menacée ? »
« Comment l’identité berbère est-elle représentée ? »
2ème partie :
Intervention de Abdelatif Errihani sur le rôle des associations berbères au Maroc et plus particulièrement son association de commerce équitable avec les femmes berbères et artisanes d’Essaouira.
PAUSE autour de dégustations orientales et stands d’artisanat berbère (huile d’argan et savon).
3ème partie :
Lecture de poèmes dans les 3 langues : arabe, langue kabyle et français.
Temps musical avec Rachid Diri, chanteur kabyle qui nous présentera le patrimoine musical berbère et son répertoire en langue amazigh, en acoustique.
On finira la soirée en musique avec la rencontre improvisée des deux musiciens invités.
Le Café Littéraire Arabophone
Son objectif ?
Favoriser des rencontres autour de thèmes artistiques et culturels. Ce café réunit tous les mois une trentaine de participants pour des échanges, des rencontres et des réflexions interdisciplinaires autour du monde arabe.
Pour plus d'informations:
Espace multiculturel Arts Dreams
15 bis rue Imbert Colomes 69001 Lyon.
E-mail : contact@arts-dreams.org Tel : 04 72 07 80 30
www.arts-dreams.org
adhésion annuelle au café: 2€ [Réduire] |
Du 23 au 25 Avril 2012 :
| |
Le discours critique littéraire contemporain Khenchela (Algérie) - Université Problématique
À la recherche de l’ordre dans le chaos discursif: le discours et le changement social.
Le 5ème colloque international Discours critique contemporain « linguistique appliquée et l’analyse du discours » est organisé par la Faculté des lettres et langues. Que l’on consid... [Afficher la suite] Problématique
À la recherche de l’ordre dans le chaos discursif: le discours et le changement social.
Le 5ème colloque international Discours critique contemporain « linguistique appliquée et l’analyse du discours » est organisé par la Faculté des lettres et langues. Que l’on considère comme prolongement des versions précédentes:
1er- Colloque inaugural « Discours critique » mai 2004
2ème- « la sociocritique » mai 2006
3ème- « la psychocritique » mai 2008
4ème- « lecture et réception » mai 2010
Le colloque aura lieu le 24-25-26 avril 2012, à l’Université Abbés LAGHROUR –Khenchela- Algérie.
Nous assistons à une phase effervescente de l’Histoire de l’humanité. Des voix sociales revendiquent le changement, l’économie échoue puis réagit à l’échec, la politique tantôt contrôle tantôt cède à la panique , et les nouveaux medias jouent des rôles étonnants.
Se présente ainsi à l’étude scientifique un tableau complexe et intéressant d’actes communicatifs. En effet, dans tout ce labyrinthe fiévreux de discours et d’interactions, un spécialiste en linguistique appliquée, en particulier un analyste du discours, observe et analyse délibérément et systématiquement à la recherche d’ordre dans le chaos et de structure dans la confusion.
Cet appel à communication est intéressé par les contributions discutant des thèmes présentés ci-dessous.
La grande extension du concept "Discours" le rend difficile à appréhender. Tantôt, il est synonyme de la parole; tantôt il désigne un message pris globalement, comme "toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière", comme il peut être un « langage en situation », ou une « utilisation d’énoncés en combinaison pour l’accomplissement d’actes sociaux » …etc.
S’il est difficile de circonscrire le discours à travers cette diversité de définitions, il y a néanmoins une évidence, qu’il « ne peut être défini comme une unité linguistique, mais qu’il résulte de la combinaison d’informations linguistiques et situationnelles ».
Aussi, concluons-nous que le discours implique un acte langagier d’où émergent un texte, un contexte et une intention. Il est donc une entité complexe ayant une dimension linguistique (en tant que texte), une dimension sociologique (en tant que production en contexte), une dimension communicationnelle (en tant qu’interaction finalisée), et une dimension cognitive (en tant que porteur des systèmes de connaissances/croyances des individus). Le discours peut être: Pédagogique, Didactique, Prescriptif, Subjectif, Dialogique et Polémique,
Les participants sont invités à présenter des communications sur des thèmes ayant trait à la linguistique appliquée et l’analyse du discours. Cet appel à communication est intéressé par les contributions discutant des thèmes présentés ci-dessous :
• Contribution du langage dans le contrôle et le changement sociaux.
• Analyse du discours des révolutions populaires.
• Contribution des nouveaux médias.
• Analyse du discours politique.
• Analyse du discours littéraire et polyphonie des textes.
Calendrier
• Date limite de réception des résumés 28 février 2012. (150 mots max.)
• Notification de l'acceptation des propositions de communications 15 mars 2012.
• Les présentations ne devront pas dépasser 20 minutes.
• Remise du texte intégral de la communication : av. 10/04/2012
• Les résumés devront inclure :
- Nom et prénom, Affiliation et adresse du participant
- Adresse électronique, Numéro du téléphone mobile
- Langues du colloque: Arabe, français, anglais.
Fiche de participation
Nom, Prénoms ……………………………….………………………………………
Adresse E-mail. Tél-Fax ………..………………..……………………………………………
…………….…………………………………………………………
Grade ……………………………………………………………………….
Fonction ……………………………………………………………………….
Etablissement ……………………………………………………………………….
Pays ……………………………………………………………………….
Titre de la communication ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Résumé ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Date et signature
Fiche d’inscription
Nom, Prénoms ……………………………….………………………………………
Adresse E-mail. Tél-Fax ………..………………..……………………………………………
…………….…………………………………………………………
Grade ……………………………………………………………………….
Fonction ……………………………………………………………………….
Etablissement ……………………………………………………………………….
Pays ……………………………………………………………………….
Titre de la communication ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Résumé ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Date et signature [Réduire] Contact : critiquecol@gmail.com |
Du 31 Janvier au 09 Mars 2012 :
 |
1ER CONCOURS D'ÉCRITURE IFA 2012 (Algérie) 1ER CONCOURS D'ÉCRITURE IFA 2012
« Jeunes écrivains francophones » - du mercredi 01 fevrier 2012 à 9h00 au samedi 10 mars 2012 à 18h00 -
3 séjours à gagner à Québec dans le cadre du « Forum Mondial de la langue française » (du 2 au 6 juillet 2012).
Pour ceux qui ont entre 18 et 30 ... [Afficher la suite] 1ER CONCOURS D'ÉCRITURE IFA 2012
« Jeunes écrivains francophones » - du mercredi 01 fevrier 2012 à 9h00 au samedi 10 mars 2012 à 18h00 -
3 séjours à gagner à Québec dans le cadre du « Forum Mondial de la langue française » (du 2 au 6 juillet 2012).
Pour ceux qui ont entre 18 et 30 ans et qui aiment manier la plume à leurs heures ''libres'', l'Institut Français d'Algérie, organise le 1er concours d'écriture francophone du 1er février au 10 mars.
3 séjours au Québec dans le cadre du « Forum mondial de la langue française », sont à gagner. [Réduire] |
Du 16 au 17 Mars 2012 :
| |
50 ans après les accords d'Evian. Sortir de la guerre d'Algérie: regards croisés, regards apaisés Evian (France) Entre novembre 1955 et le 14 mars 1962, veille de son
assassinat par l’OAS, Mouloud Feraoun, un des plus
grands écrivains algériens de sa génération, a tenu son
Journal, portrait bouleversant d’un homme déchiré entre
ses racines kabyles et sa culture française, entre sa haine
de tout... [Afficher la suite] Entre novembre 1955 et le 14 mars 1962, veille de son
assassinat par l’OAS, Mouloud Feraoun, un des plus
grands écrivains algériens de sa génération, a tenu son
Journal, portrait bouleversant d’un homme déchiré entre
ses racines kabyles et sa culture française, entre sa haine
de toute violence et son adhésion progressive à la lutte. Un
témoignage nique sur le passé, le présent… et l’avenir de
l’Algérie. Un témoignage à hauteur d’homme. Mais quel
homme !
Anne Camboulives (Le Dauphiné libéré) : « Une pièce
éblouissante dont on sort estomaqué ». Clarisse Fabre (Le
Monde) : « Un document passionnant pour comprendre
l’insurrection algérienne (…) que Samuel Churin incarne
avec force sur un plateau nu »
Pièce présentée grâce à l’association « Les amis de Max
Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons ».
Suivi d’un débat avec
zz Dominique Lurcel, metteur en scène.
zz Amar Mohand-Amer, Centre de recherches en
anthropologie sociale et culturelle (CRASC),
Université d’Oran,
zz Gilles Manceron, historien, LDH.
10h15 Clôture : Jean-Philippe Ould-Aoudia, président
de l’Association des amis de Max Marchand, de
Mouloud Feraoun et leurs compagnons et Pierre
Tartakowsky, président de la Ligue des droits de
l’Homme.
Informations pratiques
Plan de la ville, hébergement, restauration :
Office du tourisme
Place Porte d’Allinges
74 500 Evian
04 50 75 04 26
http://www.eviantourism.com
Contact
Organisation du colloque : Entre novembre 1955 et le 14 mars 1962, veille de son
assassinat par l’OAS, Mouloud Feraoun, un des plus
grands écrivains algériens de sa génération, a tenu son
Journal, portrait bouleversant d’un homme déchiré entre
ses racines kabyles et sa culture française, entre sa haine
de toute violence et son adhésion progressive à la lutte. Un
témoignage nique sur le passé, le présent… et l’avenir de
l’Algérie. Un témoignage à hauteur d’homme. Mais quel
homme !
Anne Camboulives (Le Dauphiné libéré) : « Une pièce
éblouissante dont on sort estomaqué ». Clarisse Fabre (Le
Monde) : « Un document passionnant pour comprendre
l’insurrection algérienne (…) que Samuel Churin incarne
avec force sur un plateau nu »
Pièce présentée grâce à l’association « Les amis de Max
Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons ».
Suivi d’un débat avec
zz Dominique Lurcel, metteur en scène.
zz Amar Mohand-Amer, Centre de recherches en
anthropologie sociale et culturelle (CRASC),
Université d’Oran,
zz Gilles Manceron, historien, LDH.
10h15 Clôture : Jean-Philippe Ould-Aoudia, président
de l’Association des amis de Max Marchand, de
Mouloud Feraoun et leurs compagnons et Pierre
Tartakowsky, président de la Ligue des droits de
l’Homme.
Informations pratiques
Plan de la ville, hébergement, restauration :
Office du tourisme
Place Porte d’Allinges
74 500 Evian
04 50 75 04 26
http://www.eviantourism.com
Contact
Organisation du colloque : la-salevienne@wanadoo.fr
Eugène Blanc 06 75 20 00 66 : eugene.blanc@free.fr
Eugène Blanc 06 75 20 00 66 : eugene.blanc@free.fr [Réduire] |
Du 10 au 11 Février 2012 :
 |
Paris (France) - Hôtel de Ville |
Le 24 Février 2012 :
| |
La notion de décentrement Sousse (Tunisie) - Faculté des Lettres Nous nous intéresserons à la dynamique des processus de transformation : luttes, passages, transferts, frontières, concernant aussi bien les individus, les institutions que les œuvres et les disciplines.
Les hommes, comme le dit l’Introduction à la psychanalyse, ont subi au cours de leur his... [Afficher la suite] Nous nous intéresserons à la dynamique des processus de transformation : luttes, passages, transferts, frontières, concernant aussi bien les individus, les institutions que les œuvres et les disciplines.
Les hommes, comme le dit l’Introduction à la psychanalyse, ont subi au cours de leur histoire trois grandes humiliations : avec Copernic, la terre n'est plus le centre du monde, il leur faut renoncer à l’idée de lieu ; avec Darwin, l'homme n'est plus fils de l'homme, c'est-à-dire descendant d'Adam, mais le produit d'une simple évolution, il leur faut renoncer à la généalogie, à l’histoire ; avec Freud, la raison n'est plus maîtresse, le psychisme échappe, il leur faut renoncer à la toute-puissance. Si l’on en croit cette récapitulation incisive, l’histoire des hommes est celle de leurs décentrements successifs. Si le terme d’humiliation marque ces grandes étapes comme autant de revers endurés, les conséquences de ces changements d’optique ont été d’une importance décisive et les connaissances en ont chaque fois grandement bénéficié.
Se mettre à la place de l’autre, voir avec ses yeux, c’est bouleverser les perspectives, découvrir d’autres modes d’approche, s’ouvrir à autrui et du coup avancer. Penser, c’est encore ôter le moi du centre, dissiper son image toujours envahissante et présomptueuse : humilier l’amour-propre, modifier la perspective qui nous place complaisamment au centre de notre propre monde, celui où nous prenons nos habitudes.
Les champs d’application de la notion de décentrement sont innombrables :
L’objet que se donnent la Psychanalyse, l’Ethnologie, l’Anthropologie, se fondant sur « un perpétuel principe d’inquiétude, de mise en question » (Michel Foucault, Les mots et les choses, 1966), produit un décentrement du sujet par rapport à ses propres références -le confrontant à l’étrangeté de la diversité culturelle-, par rapport à l’illusoire omniprésence et toute-puissance de sa conscience -lui faisant découvrir les profondeurs inconscientes de la psyché-.
Mais bien sûr, dans le domaine des Arts et de la Littérature toutes les réflexions portées sur le sujet comme moteur ou non de la création ont ici leur validité. En outre, le décentrement en littérature consiste dans les approches comparées, permettant de relativiser la perception que l’on peut avoir d’une littérature nationale. Donner une voix à ceux qui n’en ont pas, permettre l’accès à la parole aux femmes, aux hommes de toutes les origines sociales ou ethniques, revient donc à penser un pluralisme littéraire qui s’efforce d’arracher à sa position confortable une production régie par des intellectuels assumant en quelque sorte de droit la fonction de communication. La notion de décentrement a été largement utilisée par les études post-coloniales, en montrant comment certaines puissances impérialistes ont considéré les pays annexés comme des satellites, dont les productions ne pouvaient constituer que la forme mineure de leur propre production. La séparation absurde entre littérature francophone et littérature française en conserve la trace manifeste.
Songeons à cette pensée de Pascal qui affirme : « C’est là ma place au soleil : Voilà le commencement et l’image de l’usurpation de toute la terre ». S’il s’agit là d’une critique de la propriété, nous pouvons comprendre le mot dans son acception la plus large, et proposer qu’en Histoire, en Géographie, on s’interroge sur ce qui fonde les territoires et engendre l’exclusion. Les sociétés, les règnes se définissent toujours comme des centres, affichant mérite, voire excellence, jouissant toujours de la supériorité d’une appartenance et méprisant ou ostracisant ce qui n’en est pas. Des oppositions naissent, qui se doublent d’un jugement de valeur, Nord/Sud, Capitale/Province, Premier Monde/Tiers Monde… La liste infinie des différences sous-entend toujours le couple domination/subordination.
Toute enquête rigoureuse conduit l’enquêteur à quitter la situation confortable qui est la sienne pour accepter temporairement d’adopter un autre regard, par cette approche latérale, biaisée, détournée, oblique, mettant à mal les certitudes, provient la réelle découverte.
Pour revenir à notre introduction, c’est-à-dire aux conditions historiques concrètes de la Tunisie, les contributions à la revue doivent ainsi permettre la confrontation entre les points de vue internes et externes, pour que de ce heurt naisse une réflexion authentique.
N.B. : Les propositions de communication pour la participation à la journée d’étude de février 2012 doivent parvenir à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sousse avant le 15 janvier 2012, sous la forme d’un résumé de 10 à 15 lignes (les consignes précises quant au format pour la publication seront données à la suite de la rencontre). Les propositions d’articles –sans communication– sont également prises en considération pour la Revue. [Réduire] |
Du 13 au 15 Mai 2012 :
| |
Colloque international L’intertextualité dans la littérature et les arts Agadir (Maroc) Colloque international
L’intertextualité dans la littérature et les arts
14-15-16 mai 2012
APPEL A CONTRIBUTION
L’approche intertextuelle dans la littérature et les arts.
Colloque International organisé par Le groupe de recherche Langage Communication et argumentation de la Fac... [Afficher la suite] Colloque international
L’intertextualité dans la littérature et les arts
14-15-16 mai 2012
APPEL A CONTRIBUTION
L’approche intertextuelle dans la littérature et les arts.
Colloque International organisé par Le groupe de recherche Langage Communication et argumentation de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zohr, Agadir-Maroc en partenariat avec le C.M.U (le Centre des Médias Universitaire) Ibn Zohr Agadir.
Date limite de réponse à l’appel : 6 mars 2012
Responsable : M. Sad SLAMTI
Argumentaire
« Tout texte se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois la relecture, l’accentuation, le déplacement et la profondeur ». (Philippe Sollers)
Telle peut être la définition préliminaire qui servirait de repère à la lecture du texte littéraire ou, de façon plus globale, à l’interprétation de toute œuvre artistique. Aussi, le colloque que nous proposons cette année à la faculté des lettres Ibn Zohr revient sur le concept critique de l’intertextualité, vu le retour grandissant de cette approche sur la scène de la recherche en science du langage. Car en effet, on ne peut plus engager aujourd’hui l’interprétation d’une œuvre de façon autonome. Nous sommes appelés à la repenser à partir des infra textes ; ceux là même qui nous invitent à la lire dans son interaction avec les œuvres qui l’ont précédée mais, également, celles qui lui ont succédé ; de manière à mettre en lumière le processus de l’emprunt invoqué ou révoqué.
De ce fait, ces journées d’étude se proposent de réinterroger d’abord l’ensemble des définitions que requiert le terme intertextualité, et ce pour mieux l’encadrer et le circonscrire sur la plan théorique. Car les tentatives de classification opérées à son sujet ont brouillé aujourd’hui son acception, voir la perception que nous en avons faite depuis les travaux de Julia Kristeva. De même qu’elles feront l’épreuve de ces phénomènes d’influence en les travaux de Gérard Genette dans Palimpsestes, avec cet objectif affiché : débattre de cette ambigüité qui entache la frontière fragile qui sépare l’intertextualité de l’hypertextualité. Dans sa quatrième édition ce colloque se propose de réfléchir enfin sur cet inter à travers lequel un texte ou une œuvre d’art s’approprie un ou plusieurs œuvres. Seront privilégiées les approches transgénérique, interculturelle et transdisciplinaire, de même que le dialogue que tissent les œuvres avec la critique.
Axes du Colloque
• Allégorie, ironie et intertextualité.
• Histoire littéraire et intertextualité.
• La réception en tant que dimension principale de l’intertextualité,
• L’intertextualité comme champ des possibles des textes ou comme mémoire des œuvres.
• Le plagiat par anticipation, ou l’intertextualité par anachronisme.
• La stylistique, une clef indispensable dans le décodage de l’intertextualité inavouée.
• Intertextualité et altérité
• Intertextualité interculturelle
• Intertextualité de l’image dans la publicité, le cinéma, la bande dessinée et la peinture
• La mise en abîme et intertextualité.
COMITE SCIENTIFIQUE
Pr. ABRIGHACH Mohamed (Université Ibn Zohr)
Pr. BELGRA Hassan (Centre National de Formation des Inspecteur, Rabat)
Pr. BISSANI Atman (Faculté Multidisciplinaire Errachidia)
Pr. BOUATOUR Mohamed (Université Sfax)
Pr. BERREMI Abdellah (Faculté Multidisciplinaire Errachidia)
Pr. CHAIB Mohamed (Université Ibn Zohr)
Pr. LABARI Brahim (Université Ibn Zohr)
Pr. HESS Deborah (Drew University, New Jersey, U.S.A)
Pr. PILORGET Jean Paul (Classe préparatoire, Lycée Blaise Pascal, Paris)
Pr. SLAMTI Sad (Université Ibn Zohr)
Pr. WAHBI Mohamed (Université Ibn Zohr)
COMITE D’ORGANISATION
Pr. ABDOUH Omar
Pr. AHNOUCH Fatima
Pr. CHAIAB Mohamed
Pr. ELMAOUHAL Elmoukhtar
Pr. ESSAYDI Hanane
Pr. ISMAIL Hafid Alaoui
Pr. LACHHAB Mohamed
Pr. HMAYZ Hassan
Pr.QORCHI Azelarab
Pr. SAMARI Nezha
Pr. SLAMTI Sad
Pr. WAHBI Mohamed
Mr. OUTRAHOUT Rachid
COMITE D’ORGANISATION DES ETUDIANTS
JALLOUL Imane
ELBOUTOLY Semya
ABRAGH Nadia
SAKHI Ahmed
A CONTACTER
Slamti Sad
Tel : 0661855160
E-mail : de_saaade@hotmail.com
CONDITIONS DE PARTICIPATIION
Les propositions de communication (250 mots) accompagnées d'une notice biographique (où vous préciserez votre université d'attache et votre programme d'études) et d'une liste de cinq mots-clés doivent être envoyées avant le 6 mars 2012 à l’adresse suivante : de_saaade@hotmail.com
La possibilité d'une publication des actes du colloque, après sélection des articles par un comité de lecture, est envisagée.
CONDITIONS DE PARTICIPATIION
1-Obligation de s’engager à participer dans l’un de ces axes précités.
2-Envoie d’un résumé du travail de recherche avant le 6 mars 2012.
3-Date de communication de l’avis favorable : le 10 mars 2012
4-Le travail de recherche doit parvenir avant le 30 avril 20012
5-Langues du Colloque : Arabe, Français, Anglais, Amazighe.
Hay Dakhla BP: 29 / S Agadir – Maroc.Tel: (212)05.28.22.05.58 / 08.78 / 11.54
fax: 05.28.22.16.20. Site Web : www.flsh-agadir.ac.ma [Réduire] |
Du 06 au 08 Novembre 2012 :
 |
Champs littéraires et stratégies d'écrivains Oran (Algérie) - CRASC CRASC
Colloque international
Novembre 2012
Champs littéraires et stratégies d’écrivains
Que sont devenus les grands dispositifs de définition des pratiques, des ‘systèmes’(Halen) littéraires qui ont mobilisé ces dernières décennies études et conceptions des multiples univers dé... [Afficher la suite] CRASC
Colloque international
Novembre 2012
Champs littéraires et stratégies d’écrivains
Que sont devenus les grands dispositifs de définition des pratiques, des ‘systèmes’(Halen) littéraires qui ont mobilisé ces dernières décennies études et conceptions des multiples univers dédiés à la littérature ? Fondés en grande partie dans l’examen des configurations littéraires nationales (Bourdieu, Dubois, Anderson), les travaux théoriques ou empiriques ont peu à peu relativisé les frontières de l’activité littéraire, développé des formulations plus transversales : Le Tout Monde (Glissant/Chamoiseau); Littérature-Monde (Le Bris/Rouaud) ou carrément globalisantes : La République mondiale des Lettres (Casanova).
Les différentes approches du champ littéraire, qui ne sont pas exclusives des autres approches, tendent à prendre en charge les aspects textuels et contextuels de la production littéraire, définissant la position de l’auteur dans l’espace multiforme de production, (posture dans le champ national ou l’inscription dans une démarche de subversion transnationale à l’instar d’écrivains, tels que Joyce, Faulkner et Beckett). Il s’agit pour nous, lors de cette rencontre d’opérer un dévoilement des mécanismes instituant le champ littéraire dans le vaste marché des biens symboliques et d’essayer de porter un regard sur les différentes stratégies pratiquées par les écrivains pour s’assurer une présence éditoriale dans leur pays et/ou dans le monde.
Les apports dans la définition des nouveaux enjeux auxquels fait face la littérature ne seront pas en reste. Pour ce faire, la mobilisation des modèles d’analyse des champs et l’analyse des discours y afférant seraient d’une grande pertinence scientifique. L’objectif final est bien d’appréhender la littérature sous une double vision : la particularité et l’historicité, d’une part et d’autre part, le local et le transnational.
Axes généraux
1. Configurations locales, nationales, régionales et internationales de l’activité littéraire
2. Instances et institutions littéraires en action. Étude de cas
3. Les figurations de l’écrivain : individualité/collectif ; représentations sociales/représentations littéraires ; statut symbolique/statut professionnel
4. La littérature et ses écrivains face au défi de la médiatisation et des nouvelles technologies de la communication.
Repères bibliographiques
Becker Howard. S., Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988
Bonn Charles et Boualit Farida (dir), Paysages littéraires algériens des années 90 : Témoigner d’une tragédie ?, L’Harmattan, 1999
Bourdieu Pierre, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992
Casanova Pascale, La République mondiale des lettres, Paris, Éditions du Seuil, [1999], coll. Points, 2008
De Toledo Camille, Visiter le Flurkistan, ou les illusions de la littérature-monde, PUF 2008
Dubois Jacques, L’institution de la littérature. Nathan/Labor, 1978
Lahire Bernard, Frantz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire, Paris, Éditions La Découverte, 2010
Le Bris Michel et Rouaud Jean, Pour une littérature-monde, Paris, Éditions Gallimard, 2007
Miliani Hadj, Une littérature en sursis ? Le champ littéraire de langue française en Algérie (1970-2000), Paris, Éditions l’Harmattan, Collection ‘’Critiques littéraires’’, 2002
Mokhtari Rachid Le nouveau souffle du roman algérien. Essai sur la littérature des années 2000, Alger, Editions Chihab, 2006
Mokhtari Rachid, La graphie de l’horreur, Alger, Éditions Chihab, 2002
Poliak Claude, Aux frontières du champ littéraire. Sociologie des écrivains amateurs, Paris, Économica, coll. « Études sociologiques », 2006
Sapiro Gisèle, La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe –XXème siècle), Paris, Éditions du Seuil, 2011
Coordinateur du colloque : Mohamed DAOUD
Comité scientifique :
Président : Hadj MILIANI, Professeur, Université de Mostaganem, CRASC
Membres :
- Charles BONN, Professeur émérite, Université de Lyon 2 (France)
- Mohamed DAOUD, Professeur, Université d’Oran, CRASC.
- Fouzia BENDJELID, Maître de conférences, Université d’Oran, CRASC.
- Christine DETREZ, Maître de conférences, ENSLH, Lyon (France).
- Sonia ZLITNI-FITOURI, Maître de conférences, Université de Tunis (Tunisie)
- Ième VAN DER POEL, Professeur, Université d’Amsterdam (Pays-Bas)
- Hirèche BAGHDAD MOHAMED, Maître de conférences, CRASC.
- Ramona MALITA, Professeur, Université de Timisoara (Roumanie)
- Mohamed BACHIR BOUIDJRA, Professeur, Université d’Oran, CRASC.
- Ahmed Amine DELLAI, Chercheur permanent au CRASC.
- Ahmed EL JOUA, Professeur, Université de Sfax, (Tunisie)
- Najiba REGAIG, Maître de conférences, Université de Sousse (Tunisie)
- Dominique RANAIVOSON, Maître de conférences, Université de Metz, (France)
Comité d’organisation :
- Lahcen REDOUANE, Chercheur CRASC.
- Abdelkrim HAMOU, Chercheur CRASC.
- Sabrina FAHAS, CRASC.
- Yesma AOUEDJ, CRASC.
- Yasmine BENSAHLI, CRASC.
Les titres et résumes doivent parvenir au CRASC avant la fin juin 2012.
La sélection des propositions se fera avant la fin juillet 2012.
Le programme sera communiqué début septembre 2012.
Adresse électronique du colloque : champ.litteraire@gmail.com [Réduire] Contact : champ.litteraire@gmail.com |
Le 08 Février 2012 :
 |
HOMMAGE À OMAR FRANTZ FANON Paris (France) - Centre Culturel Algérien Hommage a Omar Frantz FANON marqué par la projection du film « Frantz Fanon : une vie, un combat, une oeuvre », de cheikh DJEMAÏ et d’une rencontre-débat avec la participation de Abdelkader BENARAB, auteur de « Frantz Fanon, homme de rupture », Liliane KASTELOOT, universitaire, spécialiste... [Afficher la suite] Hommage a Omar Frantz FANON marqué par la projection du film « Frantz Fanon : une vie, un combat, une oeuvre », de cheikh DJEMAÏ et d’une rencontre-débat avec la participation de Abdelkader BENARAB, auteur de « Frantz Fanon, homme de rupture », Liliane KASTELOOT, universitaire, spécialiste de l’histoire de la littérature négro-africaine, du cinéaste Cheikh DJEMAÏ et de Olivier FANON, fils de feu Frantz FANON. Jeudi 09 février 2012 à 18H30 [Réduire] |
Du 18 au 19 Janvier 2012 :
| |
Rencontre avec NABILE FARES "L'homme est une migration" Discutante : Anne Roche (CIELAM) Aix en Provence (France) - à 17 h au Salon bleu (C232) 29, avenue Robert-Schuman - Aix-en-Provence Université d'Aix-Marseille
Séminaire CIELAM "Passages de frontières"
Axe "Histoire littéraire et cultures dans l'espace méditerranéen"
Structure fédérative LITTT
En collaboration avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
Rencontre avec NABILE FARES ... [Afficher la suite] Université d'Aix-Marseille
Séminaire CIELAM "Passages de frontières"
Axe "Histoire littéraire et cultures dans l'espace méditerranéen"
Structure fédérative LITTT
En collaboration avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
Rencontre avec NABILE FARES "L'homme est une migration" Discutante : Anne Roche (CIELAM)
aura lieu
le jeudi 19 janvier à 17 h au Salon bleu (C232)29, avenue Robert-Schuman - Aix-en-Provence
Nabile Farès est né en Algérie en 1940. Son écriture adopte des formes multiples, hybrides : roman, journal de voyage, poème, théâtre, scénario, bande dessinée, et leur associe l’écoute de l’anthropologue et du psychanalyste. Algérien, Nabile Farès le reste dans l’éloignement et le nomadisme. Son œuvre, depuis Yahia, pas de chance, en 1970, accompagne l’entrée du pays dans le « nouveau monde ».
Quand la migration a-t-elle commencé ? Avec la colonisation ? Avec l’indépendance ? Avec les trajectoires des « migrés » ? Son mouvement est continu. D’un côté, il y a le village, la mémoire kabyle, de l’autre, la dislocation des repères d’individus abandonnés dans le lointain, aux prises avec l’amnésie et les blessures de l’Histoire. Nabile Farès écrit, dans Le miroir de Cordoue, en 1994 : « Tout ce qui se dit de nos immigrations ne m’a pas encore convaincu de mort : l’Andalousie reste ce lieu inachevé ». L’exil n’est pas celui d’un lieu perdu, mais d’une histoire qui pourrait être.
Le 20 janvier à 18 h 30, la rencontre se poursuivra à la Bibliothèque départementale (20, rue Mirès, Marseille), avec pour sujet la culture kabyle et les figures du féminin. [Réduire] |
Du 19 au 20 Janvier 2012 :
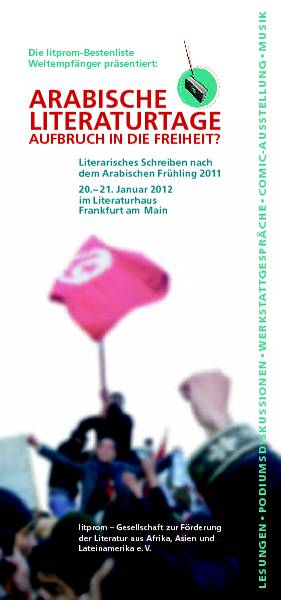 |
Arabische Literaturtage: Aufbruch in die Freiheit? Literarisches Schreiben nach dem Arabischen Frühling 2011 Francfort (Allemagne) - Literaturhaus, Schöne Aussicht 2, 60311 FRANKFURT/Main |
Du 10 au 11 Mai 2012 :
| |
Colloque : «Pour le peuple, par le peuple contre le peuple : l’imaginaire social du peuple dans les littératures francophones d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la Caraïbe» Montréal (Canada) - Université de Montréal • Université Concordia Recherches sur les littératures francophones
Colloque : «Pour le peuple, par le peuple contre le peuple :
l’imaginaire social du peuple dans les littératures francophones d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la Caraïbe»
Appel de communications
Université de Montréal • Universit... [Afficher la suite] Recherches sur les littératures francophones
Colloque : «Pour le peuple, par le peuple contre le peuple :
l’imaginaire social du peuple dans les littératures francophones d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la Caraïbe»
Appel de communications
Université de Montréal • Université Concordia
11-12 mai 2012
La littérature et le peuple font-ils bon ménage ? Ce que lit le peuple, est-ce de la littérature ? La littérature qui nous parle du peuple, quelle image de cet objet de son discours nous renvoie-t-elle ? Il est bien connu que les institutions ont depuis longtemps tracé une frontière entre la littérature «lettrée» et celle dite «populaire». Cependant, ces deux champs participent également à la production de l’imaginaire social et il y a lieu de se demander, à l’heure où l’on clame incessamment la nécessité des états du monde entier de cheminer dans les voies de la démocratisation, de quelles manières ces deux sphères du littéraire convoquent «le peuple». Les représentations du «monde d’en bas» se transforment-elles lorsque «les masses» prennent la parole au lieu de s’en remettre à quelques porte-parole issus de la haute société et qui sont censés s’exprimer au nom de ceux qui n’ont pas de voix ?
De telles questions ont déjà été traitées de divers points de vue par différentes approches disciplinaires mais elles méritent d’être examinées de près dans le champ spécifique des littératures francophones d’Afrique subsaharienne, de la Caraïbe et du Maghreb où les enjeux ne sont pas les mêmes. Il existe en effet dans ces littératures un corpus d’oeuvres appartenant aux genres populaires et comme ailleurs il été rapidement marginalisé par la critique littéraire institutionnelle. Qu’à cela ne tienne : l’on assiste actuellement à l’émergence d’une production accrue de romans ainsi rangés dans une certaine marge des canons littéraires en vigueur et, parallèlement, d’un lectorat populaire croissant, dans ces espaces francophones. En même temps, il n’y a pas que cette plus grande importance quantitative qui fait de ce corpus un objet méritant que la critique s’y intéresse de plus près. En effet, il s’avère que ces textes qu’on range dans des «sous-genres» comme le roman policier, le roman sentimental, le roman exotique, la science-fiction, etc., procèdent en fait à la modification de bon nombre des paramètres de ces genres populaires de sorte qu’on aboutit à des textes qui transgressent à la fois les conventions de ces genres et celles des canons littéraires dominants. Il semble ainsi probable que ces genres transgressent également les modalités antérieures de représentation de ce peuple lui-même, devenu lecteur sinon auteur d’une littérature dont il peut désormais être sujet et objet.
L’objectif du colloque sera donc de s’interroger sur ces constructions diverses de l’imaginaire social du peuple tel que traduit dans les littératures orales et écrites des régions ayant le français en héritage de l’époque coloniale. Lorsqu’une oeuvre est destinée à un lectorat populaire, quel langage emploie-t-elle pour parler à ce «peuple» de lui-même ? Autrement dit, quand on quitte le champ de la production restreinte pour évoluer dans l’espace des formes hybrides, transgressives, ou encore dans celui de la production dite «paralittéraire», les représentations des classes et de la culture populaires, le discours déployé pour parler du peuple au peuple sont-ils encore les mêmes ? Quand l’oeuvre littéraire s’ouvre à un lectorat plus large, se rapproche de «la masse», assiste-t-on pour autant à la textualisation de discours et représentations créés «par le peuple pour le peuple» ?
Les propositions de communication d’environ 250 mots, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, devront parvenir au plus tard le 15 janvier 2012 à l’adresse suivante : colloquepeuple@yahoo.ca
Blog : http://colloquepeuple.blogspot.com/
Comité organisateur : Françoise Naudillon, Christiane Ndiaye, Josias Semujanga [Réduire] |
Du 16 au 17 Avril 2012 :
| |
Pour une anthropologie des textes maghrébins et subsahariens Nouveaux enjeux pour l’ethnocritique Bejaïa (Algérie) - Université Laboratoire LAILEMM
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université A/MIRA - B ejaia
Faculté des Lettres et des langues
: Tél : 034/22/15/42
: Fax : 034 /22/15/47
Le département de français de la faculté des lettres et des langues de l’université ... [Afficher la suite] Laboratoire LAILEMM
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université A/MIRA - B ejaia
Faculté des Lettres et des langues
: Tél : 034/22/15/42
: Fax : 034 /22/15/47
Le département de français de la faculté des lettres et des langues de l’université Abderrahmane
MIRA-Bejaia, en collaboration avec le laboratoire des langues appliquées LAILEMM de ladite université, organisent
des journées d’études autour du thème :
Pour une anthropologie des textes maghrébins et subsahariens
Nouveaux enjeux pour l’ethnocritique
17 et 18 avril 2012
L’anthropologie littéraire ou ethnocrique est une démarche très récente qui propose d’appréhender le
texte littéraire dans sa relation intrinsèque et surdéterminante avec la culture. L’objectif qui lui est assigné est de
« reculturer la lecture mais sans la détextualiser pour autant. Il faut se garder de toute dérive ethnologiste qui
laisserait échapper ce que le récit doit à la réinterprétation que son auteur fait subir aux éléments primaires », écrit sa
co-fondatrice, Marie Scarpa (Pour une lecture ethnocritique de la littérature), en citant P. Bourdieu (Lectures,
lecteurs, lettrés, littérature). Cet intérêt porté à la relation qu’entretient la littérature avec la culture repose sur
l’hypothèse formulée par son autre co-fondateur, J.M. Privat, à savoir « qu’il y a du lointain dans le tout proche, de
l’étranger dans l’apparemment familier, de l’autre dans le même, de l’exotique dans l’endotique et réciproquement»
(« A la recherche du temps (calendaire) perdu», Poétique, 123) ; hypothèse illustrée à travers de nombreuses études
des textes de Zola (considéré comme l’écrivain-ethnographe de la société française), de Flaubert, etc.
Nous nous intéressons, pour notre part, au bénéfice que la critique littéraire peut tirer d’une lecture
ethnocrique des textes maghrébins et subsahariens, sachant qu’ils entretiennent une relation forte avec la culture et
l’histoire de leurs sociétés au point qu’ils sont souvent réduits à des documents sociologiques, ou anthropologiques,
voire historiques. Nous postulons que l’ethnocritique ainsi conçue est à même de cerner les formules d’où les textes
maghrébins et subsahariens tirent leurs principaux effets. Ainsi, nous voyons en l’ethnocritique non seulement une
opportunité scientifique de relire certains textes des années 50, décriés par la critique (idéologique) des années 60
pour leur dimension dite précisément « ethnographique », ou d’autres que cette même critique a encensés parce
qu’elle a considéré qu’ils étaient l’incarnation d’une résistance culturelle (donc identitaire) salvatrice. C’est aussi et
surtout une démarche qui permet d’étudier des textes maghrébins et subsahariens post-coloniaux dans leur
réappropriation spécifique d’un univers culturel autochtone irrémédiablement hétérogène. Et c’est à ce niveau, nous
semble-t-il, que l’ethnocritique du texte africain (mais pas seulement) rencontre la théorie postcoloniale selon des
modalités qui restent à définir.
Pour débattre de ces questions, nous avons retenu trois axes (à titre indicatif mais pas exclusif) :
- Réflexions théoriques autour de l’ethnocritique en tant que discipline (définition, objet, méthode,
notions, relations avec d’autres théories littéraires, avec d’autres disciplines scientifiques comme l’ethnologie,
etc.,…)
- Propositions de lectures ethnocritiques de textes maghrébins
- Propositions de lectures ethnocritiques de textes subsahariens
La distinction établie ici entre « textes maghrébins » et « textes subsahariens » est à ce stade aléatoire. Elle sera
confirmée ou infirmée par les travaux présentés et débattus durant ces journées d’études.
Les propositions de communication (résumé de 400 mots, mots-clés, bibliographie de base – police
new roman 12, interligne simple) accompagnées de fiches d’identification (minis CV) doivent parvenir au comité
scientifique via le site de la revue du laboratoire LAILEMM, Multilinguales, , avant le
15 mars 2012. Les réponses seront communiquées aux intéressés avant le 22 mars 2012, et le programme définitif
diffusé avant le 2 avril 2012. [Réduire] |
Du 23 au 24 Janvier 2012 :
 |
Autour des "Zoos humains" Paris (France) - Musée du Quai Branly Les 24 et 25 janvier 2012, à l'occasion de l'exposition Exhibitions, l'invention du sauvage, au musée du Quai Branly, une trentaine de spécialistes internationaux seront présents au théâtre Claude Lévi-Strauss pour partager quatre tables rondes thématiques portant un regard croisé sur le ph... [Afficher la suite] Les 24 et 25 janvier 2012, à l'occasion de l'exposition Exhibitions, l'invention du sauvage, au musée du Quai Branly, une trentaine de spécialistes internationaux seront présents au théâtre Claude Lévi-Strauss pour partager quatre tables rondes thématiques portant un regard croisé sur le phénomène des exhibitions à la fois de monstres et d'exotiques en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
Programme des tables rondes
MAR. 24 JANV. 2012
9h30 - 10h00 : Présentation générale du colloque par Lillian Thuram, Nanette Jacomijn Snoep et Pascal Blanchard.
10h00 - 13h00 : Table-ronde 1 : La construction de la race et d’un regard dans les exhibitions ethnographiques, l’invention de l’autre/The Invention of the Other: Constructing race and a critical gaze in ethnographic exhibitions. Présidée par Gilles Boëtschet Anne-Christine Taylor. Avec Claude Blanckaert, William Schneider, Sandrine Lemaire, Christian Joschke, Bernard Andrieu, André Langaney et Sylvie Chalaye du savoir scientifique à la fin du XIXe siècle.
14h30 - 17h30 : Table-ronde 2 : Images et imaginaires sur les "sauvages" dans les exhibitions, une histoire du regard. A History of the Gaze: Icons and images of the "savage" in exhibitions. Présidée par Nanette Jacomijn Snoep et Dominic Thomas. Avec Patricia Morton, Patricia Falguières, Eric Deroo, Zeynep Çelik, Marylène Patou-Mathis, Sadiah Qureshi et James Smalls.
MER. 25 JANV. 2012
9h30 - 10h00 : Présentation de la journée par Nanette Jacomijn Snoep, Commissaire scientifique de l’exposition EXHIBITIONS, responsable des collections Histoire du musée du quai Branly.
10h00 - 13h00 : Table-ronde 3 : Exhibition, colonisation et construction nationale, l’impact des exhibitions./ The Impact of Exhibitions: Exhibitions, colonisation, and nation-building Présidée par Pascal Blanchard et Nicolas Bancel. Avec Achille Mbembe, Catherine Coquery-Vidrovitch, Patrick Minder, Volker Barth, Nicola Labanca, Charles Fordsick et Robert Rydell
14h30 - 18h00 : Table-ronde 4 : Le sauvage, une construction ordinaire, enjeux contemporains/ Contemporary Debates: The savage, an everyday construct Présidée par Lilian Thuram et Elisabeth Caillet. Avec Michel Wieviorka, Doudou Diène, Elsa Dorlin, Françoise Vergès, Ninian Van Blyenburgh, Carole Reynaud-Paligot
18h00 - 18h15 : Conclusion du colloque par Pascal Blanchard, Commissaire scientifique de l’exposition EXHIBITIONS, historien, spécialiste du fait colonial, documentariste, chercheur associé au CNRS, président du Groupe de recherche Achac.
Pour savoir plus sur les tables rondes...
Dans notre prochaine lettre de l'Achac vous sera présenté la Colloque International de Lausanne (24-25 mai 2012) et les informations complémentaires sur le colloque Autour des zoos humains
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles,
en français et en anglais avec traduction simultanée
Renseignements :
Musée du quai Branly - 01 56 61 70 24
www.quaibranly.fr [Réduire] |
Du 16 au 17 Avril 2012 :
 |
GENRE, ETHNICITÉ ET RELIGIONS: LE CAS DES MIGRATIONS MAGHRÉBINES COMPARÉES FRANCE-QUÉBEC DE 1945 À NOS JOURS Paris (France) - Université Paris-3 Programme:
Mardi 17 avril 2012
9h00 Ouverture
Luc Bergeron, Premier Conseiller à la Coopération, Délégation Générale du
Québec à Paris
Pierre Civil, Vice-président du Conseil Scientifique de l’Université de la
Sorbonne Nouvelle-Paris 3
9h30-11h00 Présidente de séance : Mireille ... [Afficher la suite] Programme:
Mardi 17 avril 2012
9h00 Ouverture
Luc Bergeron, Premier Conseiller à la Coopération, Délégation Générale du
Québec à Paris
Pierre Civil, Vice-président du Conseil Scientifique de l’Université de la
Sorbonne Nouvelle-Paris 3
9h30-11h00 Présidente de séance : Mireille Calle-Gruber, Professeur, Centre de
Recherches en Études Féminines & Genres / Littératures Francophones
(CREF&G/LF – EA 4400, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CNRS)
I - Les Départs : « Un alphabet pour passer les frontières » Abdelkebir
Khatibi
Mohammed Kenbib, Professeur, Département d’Histoire (Université
Mohammed V, Maroc) : L’émigration des Juifs marocains. Contexte, pays
d’accueil, devenir
Yigal Bin-Nun, Chercheur (Université de Tel Aviv, Israël) : Les raisons sociales
et politiques du départ des Juifs du Maroc
Yolande Cohen, Titulaire de la Chaire d’études du Québec contemporain
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Professeur, Département d’Histoire
(UQAM, Canada) : Vus de Montréal : récits des départs de Juifs du Maroc
Frédéric Abécassis, Maître de conférences, Département d’Histoire (Université
de Lyon, ENS de Lyon et LARHRA) : Retour sur le colloque d’Essaouira : Le
départ des juifs du Maghreb, mémoire et historicités croisées
11h15-13h00 Président de séance : Marcel Fournier, Professeur, Département de Sociologie
(Université de Montréal, Canada)
II - Religion et ethnicité : « Pouvoir des mots, Pouvoir politique » Nicole
Brossard
Chantal Bordes-Benayoun, Directrice de Recherches au CNRS (Université
Toulouse Le Mirail et EHESS) : Religiosité et renouveau ethnique dans la
diaspora juive originaire du Maghreb
Nasima Moujoud, Maître de conférences, UPMF-LARHRA (Université de
Grenoble) : Dissimuler sa religion ou exposer sa laïcité dans l’espace associatif
féministe laïc. Maghrébines sans-papiers face au racisme
Mireille Calle-Gruber, Professeur, CREF&G/LF – EA 4400 (Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3 / CNRS) : « Isabelle l’Algérien ». Epouser l’autre langue l’autre
genre l’autre religion. Isabelle Eberhardt réinventée par Leïla Sebbar
Myriam Hachimi Alaoui, Maître de conférences, Département de Sociologie
(Université du Havre) et Simona Tersigni, Maître de conférences, Département
de Sociologie (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense) : Exilées et
« rejoignantes » : une mise en regard de deux expériences migratoires entre
la France et le Québec
Déjeuner
14h30-16h30 Présidente de séance : Sarah-Anaïs Crevier Goulet, Post-doctorante, Centre
d’études du Vivant (Université Paris 7-Diderot)
III - Les Migrations : « elle nomadise entre exaltation et mélancolie » Leïla
Sebbar
Kamila Sefta, Maître de conférences, Département de Français Langue
Etrangère (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : Destination France ou
Québec. Représentations du migrant (Utopie ou réalité). Quel(s) modèle(s)
d’intégration ?
Sabrina Fatmi-Sakri, Maître assistante, Département de Français (Université
Alger 2, Algérie) : Chronologie : l’Histoire littéraire de l’immigration maghrébine
en France
Houda Asal, Post-doctorante, Centre de Recherches Historiques (EHESS
Paris) : Histoire de l’immigration arabe au Québec, catégorisations et
dénominations
Rachida Azdouz, Psychologue, spécialiste en relations interculturelles,
Directrice des Services de Soutien à l’Enseignement (Université de Montréal,
Canada) : L’intégration des maghrébins d’implantation récente au Québec :
entre affirmation, repli et reconstruction identitaire
Noureddine Harrami, Professeur, Département de Sociologie (Université
Moulay Ismail, Rabat, Maroc) : Mobilités transnationales postcoloniales au
Maroc : une analyse comparée de deux phases de la migration marocaine en
Europe
17h00-18h30 Présidente de séance : Elsa Polverel, Doctorante, CREF&G/LF – EA 4400
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CNRS)
IV - Espaces et Habitat : « Je n’ai qu’une seule langue et ce n’est pas la
mienne » Jacques Derrida
Olivia Poussot, Doctorante, Institut de Recherche sur le Cinéma et
l’Audiovisuel (IRCAV – EA 185, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) et
Chargée de cours (École Supérieure d’Architecture de Casablanca, Maroc) :
Quartier Hay Mohammadi, Casablanca, 1960 : étude ethnologique d’espaces
habités par des migrants marocains issus de migrations internes ou de l’exode
rural
Amelia Lyons, Assistant Professor, Département d’Histoire (Université Central
Florida, États-Unis) : L’Instruction d’une « clientèle difficile et délicate » : Les
émissions radiophoniques et les cours d’adaptation pour les Algériens migrant
en métropole pendant la guerre d’indépendance (1954-1962)
Alfonso de Toro, Professeur, Centre de Recherches Francophones (Université
de Leipzig, Allemagne) : L’expérience du nomadisme transculturel. Hospitalité
et Diaspora, Corps - Désir - Émotion
Mercredi 18 avril 2012
9h00-10h45 Présidente de séance : Elodie Vignon, Doctorante, CREF&G/LF – EA 4400
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CNRS et Queen’s University, Canada)
V - Représentations : « Mon identité est une infinité de jeux » Abdelkebir
Khatibi
Clélia Barbut, Doctorante, Centre de Recherche sur les Liens Sociaux
(CERLIS, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et Université Laval, Canada) :
Corps, bordures, (dé)voilements
Hervé Sanson, Post-doctorant, IRIEC (Université Montpellier III, ITEM-CNRS) et
CREF&G/LF – EA 4400 (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CNRS) : Entre
refus et acceptation des appartenances chez Albert Memmi : judéité et
tunisianité de La Statue de sel au Scorpion
Simona Pruteanu, Professeur, Département de Langues et de Littératures
(Université Wilfrid Laurier, Canada) : Ecriture migrante en France et au Québec :
approche comparative. Le rôle de la filiation féminine dans l’arrivée à l’écriture
des personnages-femmes dans les romans de Malika Mokeddem et Abla
Farhoud
Abadlia Nassima, Doctorante et Maître Assistante, Département de Langues
et de Lettres françaises (Université Ferhat Abbas, Algérie) : Parcours
migratoires : Quelles stratégies d’écriture chez les auteurs maghrébins
immigrants en France et au Québec ? Lecture de La Rose des sables de Nadia
Ghalem et Ahmed de Bourgogne d’Azouz Begag
11h00-12h00 Présidente de séance : Chloé Delaporte, Docteure et ATER, Département de
Cinéma et Audiovisuel (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Présentation cinématographique
Yann Scioldo-Zurcher, Historien, CNRS, MIGRINTER (Université de Poitiers) :
Les rapatriés d’Algérie : images et représentations
Déjeuner
13h30-15h00 Présidente de séance : Yolande Cohen, Professeur, Groupe de recherche
Histoire, Femmes, Genre et Migrations (UQAM, Canada)
VI - Mémoire et histoire : « La mémoire est voix de femme voilée » Assia
Djebar
Emanuela Trevisan Semi, Professeur, Département d’Études asiatiques et
nord-africaines (Université de Ca’ Foscari, Venise, Italie) : Tyrannie de la
mémoire en migration : le Maroc revisité par Marcel Benabou, Ami Bouganim et
Sami Berdugo
Julien Walterscheid-Finlay, Master, CREF&G/LF – EA 4400 (Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CNRS) : La des-rives des langues
Aminata Aidara, Doctorante, École doctorale de Littérature française et
comparée (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : La réclusion solitaire :
Métaphore d’une génération de travailleurs maghrébins
15h15-17h15 Président de séance : Xavier Garnier, Professeur, CREF&G/LF – EA 4400
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CNRS)
VII - Les Droits des femmes : « Se forcer pour être normal[e], c’est être
colonisé[e] » Nicole Brossard
Martin Messika, Doctorant, Groupe de recherche Histoire, Femmes, Genre et
Migrations (UQAM, Canada et Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Genre et travail
social. Le suivi des juifs d’Afrique du Nord à Paris et à Montréal (1956-1976)
Fatma Oussedik, Professeur, Département de Sociologie (Université Alger 2) et
Directrice de Recherches Associée (CREAD, Algérie) : Harraga, même les
femmes s’y mettent
Muriel Cohen, Doctorante, Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et ATER (Université Paris Ouest-Nanterre-La
Défense) : Des familles indésirables. Politiques et pratiques administratives
françaises à l’égard de l’immigration familiale algérienne (1964-1976)
Joëlle Allouche-Benayoun, Psycho-sociologue, Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (CNRS) : Une migration sur place : la transformation des Juifs d’Algérie
de dhimmi en citoyens
17h30-18h30 Lecture : « Tout est essentiel : l’essentiel, c’est le quotidien » Albert Memmi
Lecture d’Albert Memmi (Auteur), présentée par Hervé Sanson
19h – 20h
Cocktail de clôture
Offert par la Délégation Générale du Québec à Paris [Réduire] |
Du 26 au 29 Juin 2012 :
| |
Masculinités maghrébines à négocier : conceptions littéraires et cinématographiques du masculin Mannheim (Allemagne) - Université « Je veux être un homme. Et je sais pourquoi. [...] Être en homme en Algérie c’est devenir
invisible. [...] L’Algérie est un homme » (2000: 37). C’est ainsi que Nina Bouraoui, dans son
texte autobiographique Garçon manqué a résumé ce phénomène qui veut que, dans une
société pa... [Afficher la suite] « Je veux être un homme. Et je sais pourquoi. [...] Être en homme en Algérie c’est devenir
invisible. [...] L’Algérie est un homme » (2000: 37). C’est ainsi que Nina Bouraoui, dans son
texte autobiographique Garçon manqué a résumé ce phénomène qui veut que, dans une
société patriarcale, la norme masculine s’avère être une catégorie non-marquée. Plutôt que
d’appréhender le masculin en tant que modèle naturel, notre Colloque se propose de renverser
la question : quelles sont, dans la littérature et le cinéma du Maghreb, les stratégies
esthétiques révélatrices des mécanismes qui produisent toutes formes de masculin et qui
développent en outre de nouveaux modèles narratifs de la subjectivité au masculin ?
En raison du poids de la tradition religieuse et en éludant la variété des pratiques genrées qui
ont existé au cours de l’Histoire, on suppose souvent que les cultures maghrébines n’ont pas
été en mesure d’établir de conceptions différenciées du masculin, à l’inverse de celles qui se
sont formées dans les cultures occidentales, de l’honnête homme au cyber-héro postmoderne.
Mais cette hypothèse est aisément réfutable, car la masculinité entre en crise au cours des
colonisations et continue à évoluer sous l’influence des structures globales. Néanmoins
l’observation de l’état actuel des choses montre bien que les représentations de la masculinité
ne se limitent pas à condamner les pères-seigneurs et leurs rôles sociaux mais tendent à initier
des processus d’individuation. Car, comme le remarque Abdelhak Serhane dans L’Amour
circoncis, les tensions qui déterminent l’élaboration d’identités genrées s’inscrivent dans « un
désir de libération, de liberté et d’autonomie » (P. 17) envers le groupe, c’est-à-dire d’agrandir
ses marges de manoeuvre à l’intérieur de structures sociales. D’autre part, le sujet textuel –
que l’écrivain soit un homme ou une femme – n’est pas la simple représentation d’un rôle
social, mais le résultat de processus symboliques qui permettent de transgresser les normes
ainsi que de façonner de nouveaux modèles. C’est pourquoi notre Colloque portera sur les
diverses manifestations alternatives du masculin produites à partir des années 1970. Le
cinéma maghrébin, par exemple, met en scène des hommes qui ne se limitent pas aux
frontières communément admises : par le biais du comique dans l’oeuvre d’Allouache, par une
vision de l’intérieur humain chez Bouzid ou dans les scénarios de Boughédir, Tlatli et Ben
Attia. Dans la littérature, l’androcentrisme n’est pas seulement critiqué à travers la mise en
récit du parricide symbolique, mais aussi par un recours aux modèles propagés par les médias
de masse (le playboy chez Chouaki), aux mécanismes islamistes (Marouane, Chouaki,
Boudjedra, Khadra), aux conceptions de l’androgyne (Ben Jelloun, Khatibi, Assima). D’autre
part, le masculin se trouve être féminisé (Bouraoui, Dib, Djebar, Sebbar). Nous proposons
donc de penser les masculinités maghrébines de manière inclusive (Eric Anderson) et de
réviser l’essentialisme des modèles religieux et coloniaux, des rôles sociaux et de leurs
représentations unidimensionnelles, tout en ouvrant de nouvelles perspectives, par exemple
sur la question de la femme ou sur les changements qui bouleversent actuellement les
sociétés.
Axes proposés
 Écriture et construction du corps masculin/féminin
 Homosexualité et hétéronormativité
 L'homme dans la famille
 Femmes masculines
 Orientalisme prolongé : le masculin comme projection
 Réfléchir le masculin en dehors des discours patriarcaux
 Le discours masculin dans la poésie
 Les masculinités dans la littérature et le cinéma de la migration
Vous êtes invité à soumettre vos propositions de communication (15 lignes) jusqu’au 20
décembre 2011 aux adresses suivantes : gronemann@phil.uni-mannheim.de
gebhard@phil.uni-mannheim.de
Organisation : Prof. Dr. Claudia Gronemann, Michael Gebhard et Wilfried Pasquier [Réduire] |
Du 13 au 14 Decembre 2011 :
| |
La littérature mauritanienne francophone : bilan et perspective Nouakchott (Mauritanie) Cet événement débutera mercredi 14 décembre à 9h30 par une cérémonie d’ouverture suivie d’une table-ronde réunissant les premiers chercheurs en littérature mauritanienne francophone : Idoumou Ould Mohamed Lemine, M’bouh Séta Diagana et Manuel Bengoéchéa.
Ould Mohamed Lemine fu... [Afficher la suite] Cet événement débutera mercredi 14 décembre à 9h30 par une cérémonie d’ouverture suivie d’une table-ronde réunissant les premiers chercheurs en littérature mauritanienne francophone : Idoumou Ould Mohamed Lemine, M’bouh Séta Diagana et Manuel Bengoéchéa.
Ould Mohamed Lemine fut (après Catherine Belvaude) le premier à en faire une présentation méthodique en collaboration avec Nicolas Martin-Granel, et Georges Voisset dans leur Guide de littérature mauritanienne, Une anthologie méthodique publié en 1992 chez L’Harmattan. M’Bouh Séta Diagana, pour sa part, après avoir publié un ouvrage sur le sujet (Eléments de littérature mauritanienne de langue française chez L’Harmattan-Mauritanie en 2008), est le premier Maître de conférences à l’Université à dispenser un cours entièrement dédié à ce sujet. Manuel Bengoéchéa a quant à lui présenté en 2006 une thèse panoramique sur l’ensemble des écrivains, écrits et genres littéraires mauritaniens francophones et enseigne cette matière à l’Ecole normale Supérieure de Nouakchott.
Ces trois spécialistes s’efforceront, avec pour modérateur Mamadou Kalidou Bâ, Maître de conférences à l’université et auteur d’un ouvrage intitulé Le Roman africain francophone post-colonial publié en 2009 chez L’Harmattan, à dresser un premier bilan de cette littérature et à en proposer les perspectives.
La première communication se situera entre le témoignage et la théorie. Abderrahmane N’Gaïdé, écrivain et poète mauritanien francophone (Epitaphe, Paris, Edifree, 2010 ; Dans le creux de l’errance, Paris, l’Harmattan, 2010 ; Le Bivouac suivi de Fresques d’exil, Dakar, L’Harmattan-Sénégal, 2010 ; Les voix abyssales de Bissau ou les douleurs de la mémoire, Paris, l’Harmattan, 2011) qui nous entretiendra de sa conception de la littérature mauritanienne de langue française fondée selon lui sur l’errance.
La suite du colloque verra se succéder des spécialistes mauritaniens et internationaux sur différentes thématiques liées aux auteurs et à leurs œuvres. La communication de l’ethnologue français Pierre Bonte, portera sur l’œuvre d’Odette du Puigaudeau alors que Mohamed Ould Bouleïba présentera son étude de la poétique de Moussa Ould Ebnou. De même, deux professeurs espagnoles spécialistes de littératures francophones, Ana Monleón Domínguez et Inmaculada Linares Lara nous parleront respectivement des oeuvres de Puigaudeau, Beyrouk et de l’algérienne Malika Mokeddem dans une approche comparatiste. Enfin l’intervention de l’ethnololinguiste malien Denis Douyon s’attelera à comparer une légende de Djenné à celle du Wagadu réécrite par Moussa Diagana. La conclusion du colloque sera en forme d’introduction puisqu’Elemine Ould Mohamed Baba nous lira le texte d’Abdel Weddoud Ould Cheikh qui préfacera la future édition des Mauritanides d’Habib Ould Mahfoudh.
L’entrée est libre.
L'équipe de coordination,
Mamadou Kalidou Bâ, M'Bouh Séta Diagana, Manuel Bengoéchéa. [Réduire] |
Le 23 Mars 2012 :
 |
2e Journée d’études doctorales Littératures et cultures du Sud (Afrique et Caraïbes) Metz (France) - Faculté des Lettres Centre de recherches
ECRITURES
2e Journée d’études doctorales
Littératures et cultures du Sud (Afrique et Caraïbes)
Appel à communication
Date : samedi 24 mars 2012
Lieu : Metz
En marge du colloque international « Les héros culturels : récits et représentations », qui aura lieu le... [Afficher la suite] Centre de recherches
ECRITURES
2e Journée d’études doctorales
Littératures et cultures du Sud (Afrique et Caraïbes)
Appel à communication
Date : samedi 24 mars 2012
Lieu : Metz
En marge du colloque international « Les héros culturels : récits et représentations », qui aura lieu les 22 et 23 mars 2012, une journée doctorale sera organisée dans le domaine des littératures et cultures relatives au pays du Sud (études postcoloniales, francophones, migrantes, etc.)
Cette rencontre scientifique est l’occasion pour les doctorants de présenter l’état de leur travail lors d'une journée d'échanges et de discussions, et de s'interroger sur leur démarche théorique et méthodologique. Le thème, qui pourra concerner tous les domaines des littératures du Sud (anglophone, francophone, lusophone…), pourra être abordé de diverses manières : études de cas, analyse d'une méthodologie ou de concepts, présentation d’un chapitre achevé, etc. Les jeunes chercheurs pourront ainsi profiter des discussions du colloque « Les héros culturels : récits et représentations », avant de débattre de leurs travaux avec d’autres doctorants et des enseignants-chercheurs.
Les propositions de communication sont à envoyer pour le 20 décembre 2011 sous la forme d'un texte de présentation de 2.000 à 3.000 signes (espaces comprises) ; cette présentation s’articulera en trois points : a) problématique ; b) corpus ; c) méthodologie de recherche. Une bibliographie sera jointe, ainsi qu’un bref CV.
A envoyer aux deux adresses suivantes
Arsène Magnima-Kakassa arsene.magnima@yahoo.fr
Pierre Halen pierre.halen@univ-metz.fr
Les réponses parviendront aux participants au cours du mois d’octobre. Les propositions seront sélectionnées par un comité scientifique composé de doctorants et d’enseignants-chercheurs.
Un des objectifs de cette rencontre étant, par ailleurs, la constitution d’un réseau régional de jeunes chercheurs dans les domaines concernés, la priorité sera réservée aux propositions émanant de doctorants inscrits dans les universités de l’espace régional, à savoir celles de l’Ecole doctorale transfrontalière (Luxembourg, Saarbrücken, Liège, Metz), et celles de la Grande Région (Nancy 2, Trier, Mainz…). Ceci, toutefois, sans exclusive. [Réduire] |
Le 16 Decembre 2011 :
| |
Colloque « L’Algérie et la France au XXIème siècle » Paris (France) - Assemblée nationale, salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 Paris Métro : Assemblée Nationale ou Solferino |
Du 30 Novembre au 01 Decembre 2011 :
 |
Colloque Edmond Amran El Maleh, Art, Culture et écriture. Meknès (Maroc) - Faculté des Lettres Maroc |
Le 30 Mai 2012 :
| |
LA FORCE (IN)TRANQUILLE DES ANNEES QUATRE-VINGT QUESTIONS POSEES A LA LITTERATURE FRANÇAISE Journée d’Étude APEF Porto – FLUP - 31 mai 2012 Porto (Portugal) - FLUP LA FORCE (IN)TRANQUILLE DES ANNEES QUATRE-VINGT
QUESTIONS POSEES A LA LITTERATURE FRANÇAISE
Journée d’Étude APEF
Porto – FLUP - 31 mai 2012
Par-delà le phénomène de mode consistant à redécouvrir, regretter, voire se ressourcer dans les images, les sons et les mots des années quatre-... [Afficher la suite] LA FORCE (IN)TRANQUILLE DES ANNEES QUATRE-VINGT
QUESTIONS POSEES A LA LITTERATURE FRANÇAISE
Journée d’Étude APEF
Porto – FLUP - 31 mai 2012
Par-delà le phénomène de mode consistant à redécouvrir, regretter, voire se ressourcer dans les images, les sons et les mots des années quatre-vingt, une réflexion semble s’imposer qui ferait le bilan d’une décennie riche en événements politiques, culturels et en coups médiatiques, mais qui n’est pas sans marquer durablement le champ littéraire français.
Certes, les années quatre-vingt seront fortement marquées par les deux septennats mitterrandiens que des slogans, tant politiques que culturels, ont fini par assurer : « La force tranquille », « Changer la vie ».
L’arrivée de la gauche au pouvoir, dont l’action intermittente, à la faveur des cohabitations, se signalera par des va-et-vient idéologiques et programmatiques avant de s’assagir et d’acter les changements des modèles sous lesquels nous avions vécu des décennies durant, est loin d’être le seul épiphénomène de cette époque.
En effet, à un moment de notre histoire où l’Est communiste résiste, voire se raidit sous la menace d’un Pape venu d’ailleurs, que la détente connaît des hauts et des bas sous Reagan et Thatcher ; que le chômage grimpe et que la croissance économique patine ou ne convainc pas, que les idéologies et les « métarécits » sont en panne alors que l’individualisme, si bien brossé dans L’ère du vide, s’affiche de plus en plus et préfigure l’avènement de la génération yuppie et du néo-libéralisme des années quatre-vingt-dix, plusieurs balises culturelles viennent opérer un rupture que le recul et la réflexion permettront de mieux mettre en lumière et qui constituent autant d’axes d’approche de cette décennie inoubliable.
Rappelons-le, cette période charnière assiste, sur le plan littéraire, au retour de la référence et de l’auteur, notamment chez des Nouveaux-Romanciers convertis, ainsi qu’à l’émergence de nouveaux écrivains et textes, notamment chez Minuit, qui marquent définitivement le champ littéraire (La salle de bain), (Le méridien de Greenwich), tout comme à l’essor de l’autofiction et à la prise en compte et évolution théoriques et taxinomiques des Littératures Francophones.
Inconsciente encore des mutations qui couvent (chute du Mur et effondrement des grands systèmes économiques et de pensée), elle ignore tout encore des progrès technologiques qui devaient bouleverser le monde, internet en tête, et des pragmatismes économiques et financiers qui devaient s’imposer plus tard à une Europe élargie et unifiée (uniformisée?) par la monnaie. Une décennie (in)tranquille en somme.
Aussi, l’Association Portugaise d’Études Française, en partenariat avec la Faculté des Lettres de l’Université de Porto, est-elle heureuse d’annoncer la Journée d’Étude APEF 2012 (www.apef.org.pt) qu’elle organise à Porto le 31 mai 2012 et en vue de laquelle elle lance cet appel à communications aux chercheurs que cette vaste thématique et cette réflexion transversale ne manqueront pas d'intéresser et d’interpeller sous forme de proposition de communication.
Les propositions de communications feront l’objet d’un tri très rigoureux selon des critères de pertinence et représentativité de la thématique ou de l’approche proposée. Les textes présentés feront, par ailleurs, l’objet d’une publication sur laquelle nous reviendrons.
Pour l’heure, nous proposons les axes d’approche suivants :
1. retour de la référence et de l’auteur, notamment chez des Nouveaux-Romanciers convertis ;
2. émergence de nouveaux écrivains et de textes, notamment chez Minuit, qui marquent définitivement le champ littéraire La salle de bain, Le méridien de Greenwich.
3. essor de l’autofiction ;
4. prise en compte et évolution théoriques et taxinomiques des Littératures Francophones.
LANGUE DES COMMUNICATIONS :
Français uniquement.
LANGUES POUR NOS DEMARCHES:
Français uniquement.
CALENDRIER :
30 décembre 2011: date limite pour présenter des propositions de communication (20 minutes maximum) (résumé de 150 mots).
20 janvier 2012: date limite pour la réponse de l’Organisation.
04 mars 2012 : programme définitif.
ORGANISATION :
Ana Paula Coutinho (Un. Porto – ILC Margarida Losa - APEF)
Maria de Fátima Outeirinho (Un. Porto – ILC Margarida Losa – APEF)
José Domingues de Almeida (Un. Porto – ILC Margarida Losa – APEF)
INSCRIPTION à : jalmeida@letras.up.pt
Membres associés de l’APEF : 30 €
Enseignants et chercheurs de la FLUP : 30 €
Autres avec communication : 50 €
Doctorants avec communication : 20 €
MODALITES DE PAIEMENT:
1. (pour le Portugal) virement bancaire : NIB: 0010 0000 34138130001 44
2. (pour l’étranger) sur place et en espèces.
CONTACT : jalmeida@letras.up.pt
LIENS :
www.apef.org.pt
www.flup.up.pt [Réduire] |
Du 15 au 16 Mars 2012 :
| |
« Passeurs de mots », IXe Colloque international d’études francophones - NOUVEAU CALENDRIER Timisoara (Roumanie) - Université de l'Ouest de Timisoara Dans le cadre des activités scientifiques et culturelles consacrées à la francophonie, la Faculté des Lettres de l’Université de l’Ouest de Timişoara (Département des Langues romanes) organise les 16 et 17 mars 2012 le Colloque international annuel d’études francophones portant sur... [Afficher la suite] Dans le cadre des activités scientifiques et culturelles consacrées à la francophonie, la Faculté des Lettres de l’Université de l’Ouest de Timişoara (Département des Langues romanes) organise les 16 et 17 mars 2012 le Colloque international annuel d’études francophones portant sur le thème :
Passeurs de mots
Le colloque propose de s’interroger, à partir d’un croisement d’approches scientifiques et méthodologiques, sur la dynamique de la transmission culturelle, littéraire et linguistique dans la francophonie en contexte plurilingue postmoderne.
À l’aune des paradigmes de leurs champs d’investigation respectifs, les chercheurs sont invités à identifier les acteurs de cette transmission, leurs modalités d’expression, leur situation dans l’entre-deux langues, générations, espaces géographiques, héritages culturels.
Problématiques du colloque, axes d’étude :
Les figurations possibles du passeur de mots (guide, messager, intermédiaire, éclaireur, médiateur, traducteur, interprète, communicateur) pourront être illustrées :
- par des lectures d’œuvres représentatives du vaste corpus littéraire d’expression française. La découverte de l’Autre (géographique, ethnique, religieux, etc.), que nous devons aux écrivains voyageurs ou exotes des siècles passés, est approfondie, contextualisée, investie par l’imaginaire des écrivains contemporains. La profusion littéraire francophone fait entendre des sonorités et des vocables étrangers, donne droit à la parole à des communautés méconnues, aide à franchir les frontières symboliques entre des espaces proches ou lointains. Entre l’enracinement et la mobilité, entre le recentrement identitaire et la poussée multiculturelle, entre la « métropole » et les « périphéries », entre les littératures « du terroir » et la « littérature-monde », l’écrivain francophone fait œuvre de (mé)tissage culturel : il transpose, translate, acclimate, « traduit » la différence. Il nous semble intéressant d’appréhender, par exemple, les retombées stylistiques et thématiques ; les questionnements identitaires ; les barrières à défier ; l’héritage transmis ou contesté ; le jeu des intertextualités, en synchronie et en diachronie.
- par des recherches lexicologiques ou terminologiques sur la circulation des mots, avec l’enrichissement mutuel des langues en contact et les éventuelles variations codiques qui en découlent.
- par des réflexions sur les stratégies didactiques en classe de langues (en tant que micro-contexte interculturel) permettant d’identifier les spécificités françaises (francophones) et d’en intérioriser les critères de norme/écart de nature culturelle.
Sections :
- Littérature
- Linguistique
- Traductologie
- Communication
- Didactique du FLE/FOS
Le temps de présentation de chaque communication est fixé à 20 minutes.
Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique.
Organisation
Département des Langues Romanes
Centre d’Études Francophones
Faculté des Lettres, Histoire et Théologie
Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie
Comité scientifique:
Eugenia Arjoca Ieremia (Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie)
Mohamed Daoud (Professeur des universités, président du CRASC, Université Es-Senia, Oran, Algérie)
Floarea Mateoc (Maître de Conférences, Université d’Oradea, Roumanie)
Mircea Morariu (Professeur des universités, Université d’Oradea, Roumanie)
Trond Kruke Salberg (Professeur des universités, Université d’Oslo, Norvège)
Maria Ţenchea (Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie)
Estelle Variot (Maître de Conférences, Université d’Aix-en-Provence, France)
Comité d’organisation:
Andreea Gheorghiu, Ramona Maliţa, Ioana Marcu, Mariana Pitar, Dana Ştiubea (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie).
Calendrier
– 1er décembre 2011 : envoi des propositions de titres de communication
– 1er février 2012 : date limite de réception du formulaire d’inscription (fiche personnelle et résumé).
– 1er mars 2012 : notification d’acceptation.
Bulletin d’inscription
à renvoyer par courriel à
gheorghiu.andreea@gmail.com et malita_ramona@yahoo.fr
avant le 1er février 2012
Nom:
Prénom:
Intitulé de la communication:
Section du colloque :
Affiliation:
Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) :
E-mail:
Adresse professionnelle:
Tél. (optionnel):
Résumé en français (200 - 250 mots)
Frais d’inscription au colloque :
40 euros participation au colloque et publication de l’article dans les Actes du colloque (Agapes francophones 2012). [Réduire] |
Le 14 Decembre 2011 :
 |
Mouloud Feraoun : Journal, 1955 - 1962 « Le Contraire de l'Amour » Lyon (France) - Maison des Passxages, 19h30 Romancier algérien de culture française, instituteur, ami de Camus, Mouloud Feraoun fut assassiné par l’OAS (Organisation de l'Armée Secrète) le 15 mars 1962. Il a laissé un Journal, commencé en 1955 et tenu jusqu’à la veille de sa mort. Un document unique : on y lit le quotidien le plus... [Afficher la suite] Romancier algérien de culture française, instituteur, ami de Camus, Mouloud Feraoun fut assassiné par l’OAS (Organisation de l'Armée Secrète) le 15 mars 1962. Il a laissé un Journal, commencé en 1955 et tenu jusqu’à la veille de sa mort. Un document unique : on y lit le quotidien le plus concret de la «Pacification», la peur et la torture, omniprésentes dès le début 1956, et la lente et irrésistible émergence de la dignité retrouvée de tout un peuple. Condamnation sans appel d’un siècle de colonisation, mais aussi prescience d’un avenir sombre pour son pays.
« Une partition à deux voix, texte et violoncelle intimement mêlés qui, puisse donner envie de découvrir cette œuvre, et donner à aimer cet homme et le faire revivre un peu à chaque représentation .»
[Dominique Lurcel, metteur en scène] [Réduire] |
Le 24 Novembre 2011 :
| |
"Le Jasmin l'emportera"* Artistes des insurrections du monde arabe Vitry sur Seine (France) - Théâtre Jean Vilar, 20 h. L'équipe de SIWA a le plaisir de vous inviter à la soirée
"Le Jasmin l'emportera"*
Artistes des insurrections du monde arabe
Projections vidéo et débat
Vendredi 25 novembre 2011, à 20 heures
La plateforme Siwa et la galerie Talmart proposent, conjointement, une expositio... [Afficher la suite] L'équipe de SIWA a le plaisir de vous inviter à la soirée
"Le Jasmin l'emportera"*
Artistes des insurrections du monde arabe
Projections vidéo et débat
Vendredi 25 novembre 2011, à 20 heures
La plateforme Siwa et la galerie Talmart proposent, conjointement, une exposition collective itinérante sous forme d'installations vidéo, en partenariat avec la revue Alawan et le Manifeste des libertés.
"Nous avons lancé un appel à de jeunes artistes du Maghreb, du Machrek et d'Iran ayant participé aux insurrections arabes et que ce moment de grand sens interpelle. Leurs vidéos réalisées soit au coeur de l'évènement, soit à l'écart, rendront compte des diverses interprétations et regards sur ces expériences de liberté. Un hommage à la Tunisie sera rendu."
le-jasmin-l-emportera.jpg
Théâtre Jean-Vilar
de Vitry-sur-Seine
Dans le cadre de
Al Wassl-Plateformes Art en Méditerranée
www.plateformes-alwassl.org
Merci de confirmer votre présence
par téléphone 06 45 13 23 55
ou par email : claire@siwa-plateforme.org
Pour la première fois, le public pourra découvrir les projections de vidéos de jeunes artistes témoins des insurrections du monde arabe :
Captain 5obza, Dani Abou Louh & Mohammad Omran, Mohammad al-Hawajri, Vincent Arturo, Ghassan el-Hakim, Simohammad Fettaka, Philip Horani, Said Rais, Mokhalled Rasem, Iyad Sabbah, Massinissa Selmani, Saad Yaseen.
Un débat, "Artistes des insurrections du monde arabe", prolongera la projection, avec la participation de Adel Haj Salem (revue Alawan, Tunisie), les metteurs en scène Myriam Marzouki (France-Tunisie) et Waleed al-Abd (Libye), le plasticien Mohammad Omran (Syrie).
Débat animé par Tewfik Allal (Manifeste des libertés).
Quels rapports entre la culture et les insurrections ? Quelles sont les formes culturelles et artistiques qui les ont accompagnées ? L'activité artistique est-elle fondamentalement insurrectionnelle ? Quels horizons peuvent ouvrir les insurrections malgré tout ? Quels sont les rapports entre la liberté d'expression et les insurrections ? Quels sont les nouveaux interdits, les nouvelles formes de censure ? Y-a-t-il des artistes qui se nourrissent de la censure ?
Avec la participation artistique de Shadi al-Zaqzouq et Hamida Guessab.
Navettes A/R depuis la place du Châtelet
Départ en face du café Sarah-Bernhardt, 1 heure avant le début de la représentation.
Sur réservation au 06 45 13 23 55 ou claire@siwa-plateforme.org
Comment venir :
En transports : métro Porte-de-Choisy + Bus 183 arrêt Hôtel-de-Ville /
métro Villejuif Louis-Aragon + Bus 180 / RER C Vitry + Bus 180
En voiture : À 10/15 mn de la Porte de Choisy. Par la N305 tout droit jusqu’à l’Hôtel de Ville de Vitry.
Le Théâtre Jean-Vilar est juste en face. Parking Mairie gratuit les soirs de spectacle.
www.siwa-plateforme.org www.talmart.com www.alawan.org
Siwa Plateforme 47, rue du Chemin-Vert, 75011 Paris + 33 (0) 6 45 13 23 55 info@siwa-plateforme.org
Direction artistique : Yagoutha Belgacem. Collaboration artistique : Marc Monsallier. Mise en espace : Michel Cerda. Administration de production : Claire Zerhouni. Communication : Sabah El Jabli.
* Le titre de la soirée est emprunté à l'installation vidéo de Massinissa Selmani, présentée dans ce programme. [Réduire] |
Du 21 au 22 Novembre 2011 :
| |
« Approche transversale des littératures et cultures en contexte plurilingue » Meknès (Maroc) - Faculté des Lettres |
Du 09 Novembre au 30 Decembre 2011 :
 |
Exposition «Regards croisés: Le Maroc vu par Vienne et Vienne vue par le Maroc» Vienne (Autriche) - Mairie du 20ème arrondissement Exposition «Regards croisés: Le Maroc vu par Vienne et Vienne vue par le Maroc»
eMarrakech .info le 16 Novembre 2011
Digg Reddit Y! Technorati Wikio Facebook MySpace Twitter LinkedIn
eMarrakech: La ville de Vienne présente une exposition bien singulière, mettant en oeuvre le croisement a... [Afficher la suite] Exposition «Regards croisés: Le Maroc vu par Vienne et Vienne vue par le Maroc»
eMarrakech .info le 16 Novembre 2011
Digg Reddit Y! Technorati Wikio Facebook MySpace Twitter LinkedIn
eMarrakech: La ville de Vienne présente une exposition bien singulière, mettant en oeuvre le croisement artistique des regards maroco-viennois. Il s'agit de l'exposition «Regards croisés: Le Maroc vu par Vienne et Vienne vue par le Maroc».
Vienne vue par Abdallah BOUHAMIDI
Ainsi, cette exposition présente deux artistes: Une artiste photographe viennoise, Christiane SCHMUTTERER qui propose sa vison personnelle du Maroc face au regard d’un artiste photographe marocain, Abdallah BOUHAMIDI sur la ville de Vienne.
Les deux photographes offrent aux public viennois un mariage sensuel puisqu'émanant de deux regards différents et pourtant si proches en excellence. Les deux photographes lancent un message culturel bien noble, celui du regard vers l'autre qui est, en réalité, un regard vers soi-même.
Christiane SCHMUTTERER est née en 1963 à Stuttgart, Allemagne de l’Ouest à l’époque. À partir de 1964, elle vient vivre avec ses parents à Pressbaum, près de Vienne et depuis 1988 elle vit Vienne-Brgittenau.
Elle est, depuis 1999, rédactrice du journal environnemental «Neue Argumente» appartenant à l’association «Arge»; et entame la pratique de la photographie digitale en 2005.
Abdallah BOUHAMIDI quant à lui est né au Maroc en 1946. De 1976 à 1996, il est psychologue auprès d’adolescents en difficultés sociale, familiale et personnelle dans la ville de Paris.
Il participe à la création du Service d’Orientation Spécialisée de l’association JCLT (Jeunesse Culture Loisirs et technique) service qu’il dirige de 1984 à 1996.
À partir de 1972, il commence à pratiquer la photographie et utilisera ce médiat plus tard dans sa pratique de la psychologie auprès des jeunes dont il aura la responsabilité.
L'exposition débute le jeudi 10 Novembre 2011 et a lieu dans la mairie de Vienne au 20ème arrondissement. [Réduire] |
Du 23 au 25 Novembre 2011 :
| |
Les nouvelles écritures du Moi dans les littératures française et francophone Sousse (Tunisie) - Faculté des Lettres Colloque
Les nouvelles écritures du Moi dans les littératures française et francophone
Faculté des Lettres et des Sciences humaines
Université de Sousse Tunisie
Jeudi 24 novembre 2011
9h Allocution de M. le Président de l’Université de Sousse
9h15 Allocution de M. le Doyen de l... [Afficher la suite] Colloque
Les nouvelles écritures du Moi dans les littératures française et francophone
Faculté des Lettres et des Sciences humaines
Université de Sousse Tunisie
Jeudi 24 novembre 2011
9h Allocution de M. le Président de l’Université de Sousse
9h15 Allocution de M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
9h30 Pause café
Séance 1 : L’autobiographie contemporaine : Un genre ? Une écriture ?
Présidence : Sylvie Camet
10h Sylvie LANNEGRAND National University of Ireland, Galway (Irlande)
Écriture de soi et hybridité générique : le cas d’Yves Navarre
10h20 Nesrine BOUKADI JALLOULI Université de la Manouba (Tunisie)
L’écriture du Moi dans À Présent (Brigitte Giraud, écrivain français d’origine algérienne) : situations et enjeux
10h40 Moncef KHADI Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
La présence atténuée du moi dans la poésie moderne
11h Najet TNANI Faculté des Lettres de Tunis (Tunisie)
La nouvelle autobiographie et le jeu lectoral dans L’Amant de Marguerite Duras
11h20 Discussion
12h30 Déjeuner
Séance 2 : Le moi de l’autobiographie : Personne et/ou Personnage ? Instance individuelle et/ou Instance collective ?
Présidence : Najet Tnani
14h30 Hajer BEN YOUSSEF Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Le lisible, le visible et le non-scriptible dans Entendez-vous dans les montagnes… de Maïssa Bey
14h50 Nadia BONGO Université de Provence (France)
L’écriture du moi dans les œuvres de Fatou Diome et Amélie Nothomb
15h10 Discussion
15h40 Pause café
Séance 3 : Le moi de l’autobiographie : Personne et/ou Personnage ? Instance individuelle et/ou Instance collective ?
Présidence : Sylvie Lannegrand
16h20 Auxence MASSIMA MOUDANGA Université Cergy-Pontoise (France)
Fabulation de Marie NDiaye et les spécificités de son écriture du Moi, d’Autoportrait en vert à Papa doit manger
16h40 Mokhtar BELARBI Faculté des Lettres de Meknès (Maroc)
Pour une théorie de l’autobiographie
17h20 Discussion
25 novembre 2011
Séance 4 : L’adulte, le souvenir et le regard rétrospectif
Présidence : Hajer Ben Youssef
9h Ridha BOURKHIS Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Le « Tu » énigmatique à la lisière du Moi en ruine dans la poésie lyrique de Lionel Ray
9h20 Béatrice N'GUESSAN LARROUX Université d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
L'écriture de soi dans L'Africain de Le Clezio
9h40 Annie DEMEYERE Nanterre (France)
Hélène Cixous, monologue à trois voix
10h Discussion
10h30 Pause café
Séance 5 : Autobiographie ou Autoportrait ?
Présidence : Annie Demeyere
11h Annie PIBAROT Université de Montpellier III (France)
L’autoportrait littéraire dans la littérature française de l’extrême contemporain
11h20 Souad KHLIF Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine (Tunisie)
Vies minuscules de Pierre Michon: Une autobiographie oblique et éclatée
11h40 Sylvie CAMET Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Hélé Béji, L’œil du jour… ou de la nuit ?
12h Discussion
12h30 Déjeuner
Séance 6 : Sujet / Subjectivité /Subjectivation
Présidence : Noureddine Sabri
14h30 Achraf BEN ARBIA Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
À propos du sujet et de son inscription textuelle dans Journal du dehors d'Annie Ernaux
14h50 Pierre GARRIGUES Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis (Tunisie)
De début de mois en fin du moi
15h10 Najiba REGAIEG Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Autobiographie et auto-analyse dans Nulle part dans la maison de mon père de Assia Djebar
15h30 Mokhtar BELARBI Faculté des Lettres de Meknès (Maroc)
Pour une théorie de l’autobiographie
15h50 Discussion
15h50 Pause café
26 novembre 2011
Séance 8 : Moi et histoire
Présidence : Annie Pibarot
9h Thouraya BEN SALAH Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Annie Ernaux ou le désir de se dire à travers les autres
9h30 Mohamed MAALEJ Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Le genre intime et l'auto-représentation du politicien
9h50 Mohamed BAHI Faculté des Lettres de Beni-Mellal (Maroc)
Une esthétique de la rupture dans Lettres à moi-même de Edmond Amran El Maleh
10h10 Noureddine SABRI Faculté des Lettres de Sousse (Tunisie)
Le recyclage du matériau autobiographique dans le roman judéo-maghrébin d’expression française : le cas de Nine Moati
10h30 Discussion
10h50 Pause café
Séance 9 : Les écritures du moi dans et contre le temps
Présidence : Pierre Garrigues
11h20 Marianne BERISSI IUFM Aix-Marseille (France)
La vitrine autobiographique
11h50 Guy LARROUX Université Toulouse II-Le Mirail (France)
Pour une définition du récit de filiation aujourd'hui
12h10 Imen EZZEDINE MAALEJ, Université de Monastir (Tunisie)
Les récits de filiation de Pierre Bergounioux : reconstruction du souvenir et construction de soi.
12h10 Discussion
12h30 Synthèse et clôture
13h Déjeuner [Réduire] |
|



.jpg)



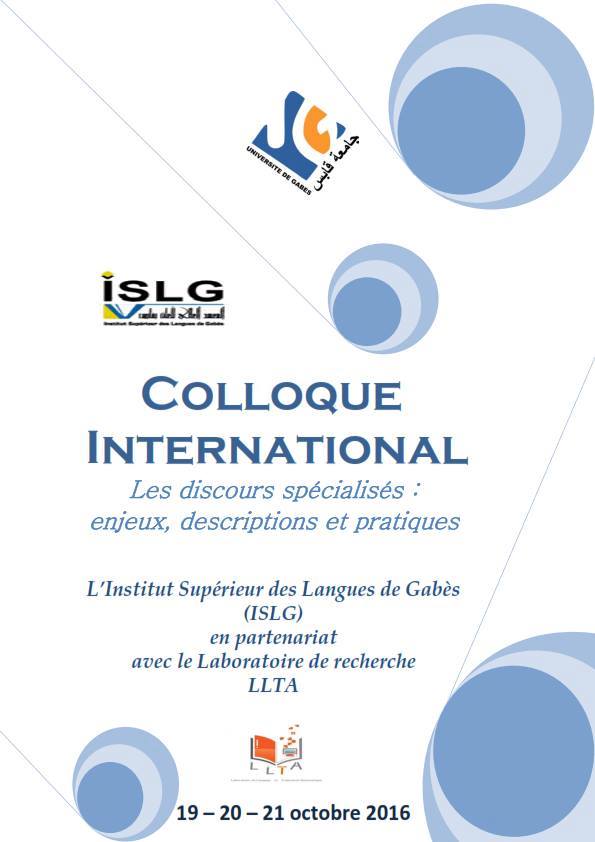



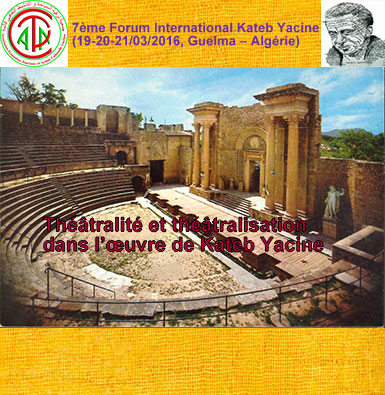


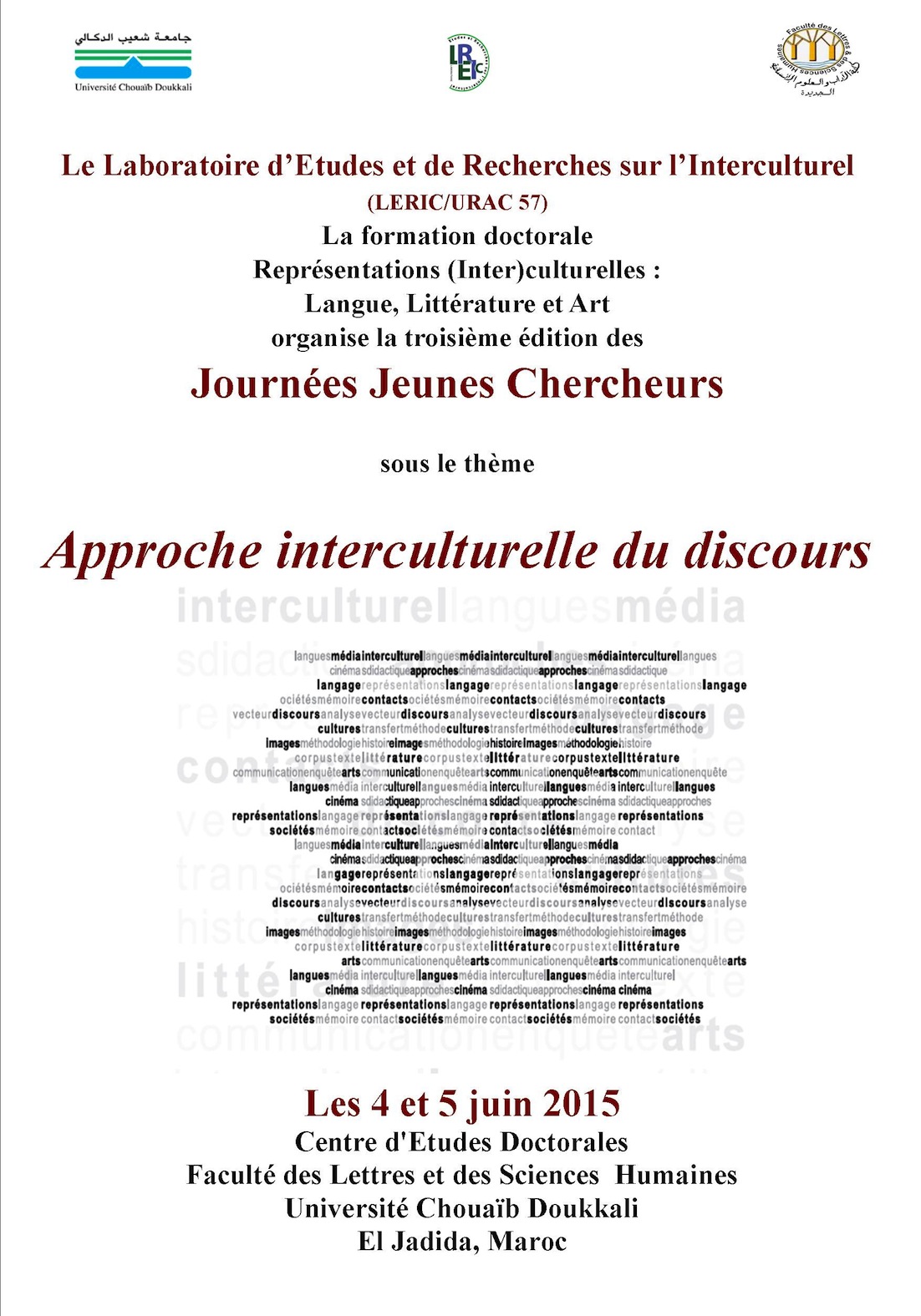




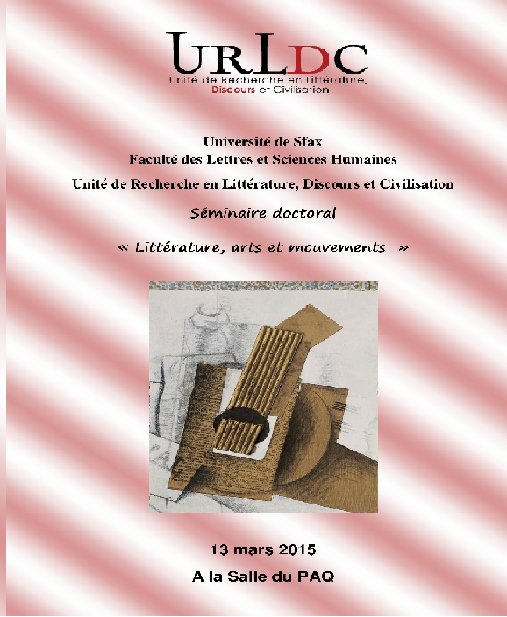




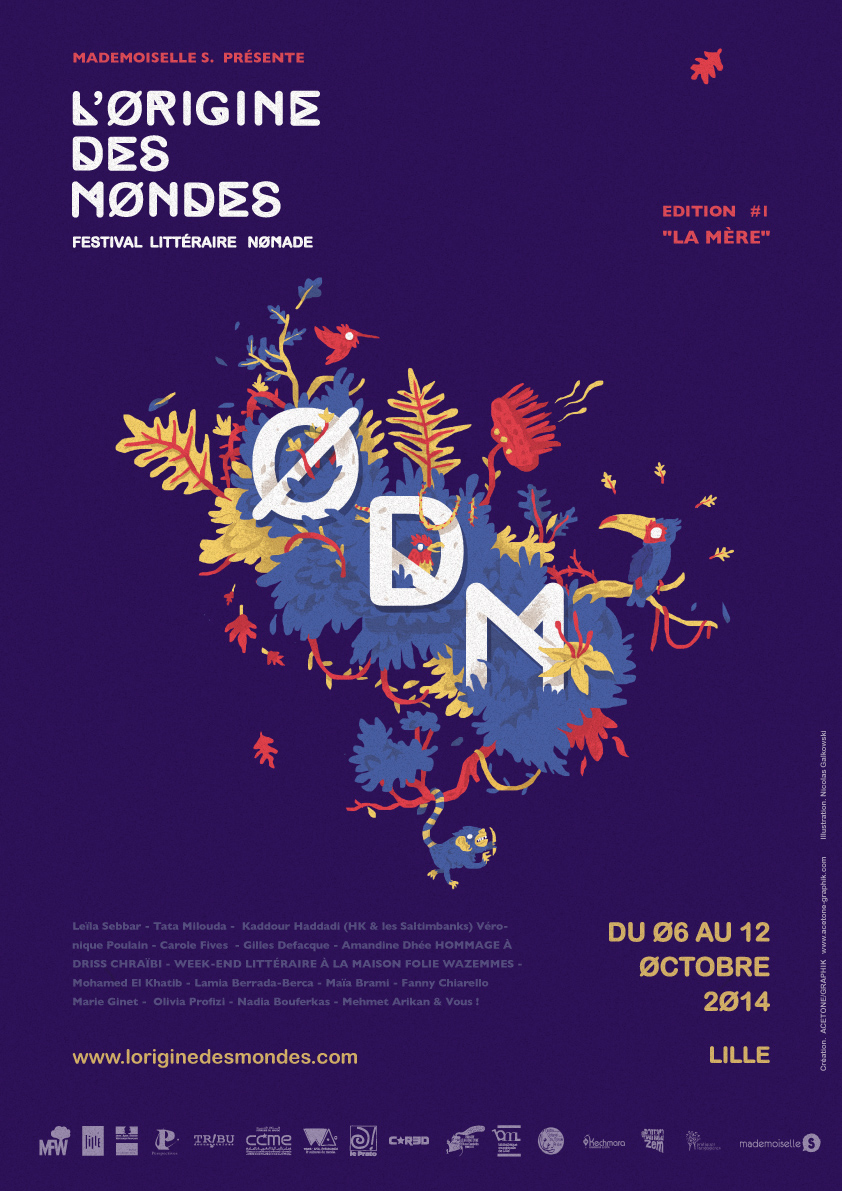


.jpg)