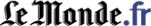Depuis la mort de François Mitterrand, homme politique issu de la
période de Vichy et de la Résistance, la "génération algérienne" est
aux commandes dans la vie politique française : ceux qui ont
fait la guerre d'Algérie, comme Jacques Chirac ou Jean-Pierre
Chevènement, qui y ont participé, comme Jean-Marie Le Pen, ou qui
l'ont combattu, comme Lionel Jospin.

L'historien français Benjamin Stora à
Rabat (Maroc) le 5 mai 2001 |
AFP |
L'effet de génération est
important pour comprendre toute l'ampleur des commémorations liées
au quarantième anniversaire des accords d'Evian. Mais il faut aller
plus loin.
Sur la guerre d'Algérie, le passage s'opère depuis quelques
années d'une sensation d'absence à une sorte de surabondance. Il ne
se passe pas un jour, ou une semaine, sans qu'on découvre (ou qu'on
feigne de découvrir) dans la presse ou à la télévision un épisode
lié à la guerre d'Algérie, une douleur, une souffrance qui tourne
autour de cette période.
Cette sensation d'absence, que j'avais pointée il y a dix ans
dans mon ouvrage La Gangrène et l'Oubli, semble dépassée
aujourd'hui. L'Algérie gît là comme une obsession, il n'est pas
possible de l'oublier. La sortie de la dénégation, du silence
commence vraiment et, désormais, l'oubli obsède. Cette volonté de se
remémorer sans cesse l'histoire de la guerre d'Algérie envahit
l'espace public. Mais y a-t-il eu vraiment oubli, ou avons-nous
assisté plutôt à une sorte de mise en scène de l'amnésie française
autour de l'Algérie, et de ce conflit ?
En fait, au sortir de la guerre d'Algérie, après 1962, personne
ne se sentait vraiment responsable ni coupable. Les Européens
d'Algérie avaient la sensation très nette d'avoir été trahis et
abandonnés par le pouvoir politique. Ils ne se sentaient pas
responsables de la situation coloniale, mais avaient toujours vécu
l'expérience de leur vie en Algérie comme des "pionniers" sur une
terre vierge, à défricher.
Ils "oubliaient" le sort inégalitaire réservé aux "indigènes".
Les soldats français du contingent avaient le sentiment très net de
n'être pas les responsables de la situation de guerre. Ils avaient
exécuté les ordres de leurs supérieurs, et se trouvaient pris dans
un engrenage. Les officiers français de la guerre d'Algérie
affirmaient avoir simplement obéi aux pouvoirs politiques. Ils
"oubliaient" les importants pouvoirs politiques dont ils
disposaient, notamment au moment de la fameuse "bataille d'Alger" en
1957. Les harkis également, ces soldats musulmans supplétifs qui ont
combattu aux côtés de l'armée française, ont été abandonnés. Ils ont
été massacrés, et ne pouvaient pas se sentir responsables.
Et la classe politique française ? La majorité de la droite
politique reconnaissait en de Gaulle son "sauveur", reconstituant
après 1962 un consensus politique autour de sa personne pour faire
oublier son attitude en faveur de l'Algérie française. La gauche
également reconsidère son histoire puisque elle avait approuvé les
"pouvoirs spéciaux" en mars 1956, dispositions envoyant le
contingent en Algérie. Jusqu'en 1960, la gauche française était pour
"la paix en Algérie". Elle ne se prononcera pour l'indépendance que
tardivement. Elle aussi reconstruira un récit mythologique lié à la
question de l'indépendance de l'Algérie, peut-être pour faire
oublier sa position antérieure. Celle d'une attitude classiquement
jacobine, pour l'amélioration des conditions de vie des "indigènes"
dans les colonies.
Lorsque la guerre se termine, personne n'est responsable. Et les
soldats, les pieds-noirs, les harkis, tous se considèrent comme des
victimes. La mise en scène de l'amnésie accompagne le processus de
victimisation, pour éviter d'évoquer toute culpabilité personnelle
et étatique sur l'Algérie et la guerre. Le statut de victime se
renforce dans les années 1980 où il vaut mieux apparaître en
victime qu'en combattant ou en militant. Les plaintes en nombre pour
"crimes contre l'humanité" s'inscrivent dans cette tendance. Autre
explication de l'oubli, la blessure du sentiment national. La fin de
l'Algérie française développe un sentiment très fort de l'amputation
d'une partie du territoire national. "L'Algérie, c'était la
France." Le conflit s'élabore comme une sorte de guerre civile
franco-française, où semble se jouer l'avenir tragique du pays.
L'indépendance de l'Algérie devient alors synonyme d'abaissement de
la nation.
L'installation dans une situation d'amnésie, à propos de
l'Algérie, conduit à une interrogation sur l'oubli. Après la
terrible période de la guerre, comment est-il possible de vivre
perpétuellement en état de mémoire frénétique, mélancolique,
envahissante ? Il faut peut-être aussi, quelquefois oublier
pour vivre. Et puis existe un autre oubli, organisé par les Etats,
qui instaure des amnisties, visant à dissimuler, à ne pas assumer
ses torts ou ses responsabilités. C'est un autre type d'oubli.
Derrière l'oubli nécessaire, celui de la sortie d'une guerre, se
dissimule l'oubli pervers visant à ne rien reconnaître de la
culpabilité qui s'est longtemps cachée dans la société
française.
Sur les circonstances du retour de la guerre d'Algérie dans la
société française d'aujourd'hui, un élément domine, le passage des
générations.
Celui qui a vécu un événement
décisif éprouve le désir de laisser une trace. Au soir d'une vie
apparaît la nécessité de se délivrer davantage d'un poids, d'un
secret ou d'un remords. De leur côté, les jeunes générations
éprouvent le besoin de s'inscrire dans une généalogie, dans une
filiation, de savoir quelle a été l'attitude du père ou du
grand-père dans cette guerre. Cette situation-là s'observe dans la
jeunesse française, mais aussi dans la jeunesse d'origine
algérienne.
Dans les générations politiques, le vote à l'Assemblée nationale
du 10 juin 1999, à la quasi-unanimité, reconnaissant "une
guerre" en Algérie est révélateur. Une majorité des députés étaient
des "anciens" d'Algérie, des gens qui avaient connu, ou fait, la
guerre d'Algérie. Le vote à l'Assemblée nationale et la présence de
personnages politiques au sommet de l'Etat expliquent la volonté
d'inscrire en des lieux de commémoration la mémoire de cette guerre.
Comme la construction d'un "Mur" à Paris à la mémoire de soldats
tombés en Algérie, ou la pose d'une plaque à la mémoire des victimes
algériennes du 17 octobre 1961. Bref, des cadres politiques de
la mémoire se mettent en place permettant à celle-ci de s'exprimer
davantage.
Un autre élément permet de comprendre ce retour : le détour
par ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Les enjeux brûlants de
la guerre d'Algérie en France s'inscrivent dans une mémoire en
miroir. De l'autre côté de la Méditerranée, depuis dix ans, une
guerre civile cruelle a fait des dizaines de milliers de morts. Dans
cette tragédie algérienne reviennent les souvenirs de la première
guerre d'indépendance. Des mots surgissent comme "terrorisme",
"fanatisme", "massacre", "violence", "bataille d'Alger".
Inévitablement, le souvenir de la guerre précédente vient perturber
celle du présent.
A travers la tragédie vécue, des figures qui avaient été écartées
de la scène politique pendant la guerre d'indépendance, ou au
lendemain de cette guerre, font retour. L'aéroport de Tlemcen
s'appelle désormais "aéroport Messali-Hadj" et l'université de Sétif
a pris le nom d'"université Ferhat-Abbas". Ces deux figures
fondatrices du nationalisme algérien sont longtemps restées dans
l'ombre. D'autres personnages occultés, comme Mohamed Boudiaf ou
Abane Ramdane, animateur central du congrès de la Soummam en
août 1956, ont fait leur "réapparition" à travers une série de
publications, colloques, ouvrages, polémiques.
Les Algériens éprouvent la nécessité de comprendre le secret de
la violence actuelle, en fouillant le déroulement de leur guerre
d'indépendance. Des récits d'atrocités, comme le massacre de Melouza
de mai 1957 où 374 villageois, soupçonnés de
sympathies messalistes, ont été égorgés par une unité de l'ALN, ont
été portés à la connaissance du public algérien. D'autres exactions
algéro-algériennes éclairent, en grande partie, l'archaïsme des
violences paysannes à l'œuvre aujourd'hui en Algérie. La violence
trouve aussi son ressort dans la fabrication d'un parti unique, à
visée hégémonique, qui a écarté tous ses concurrents, non seulement
les messalistes, mais aussi les communistes, les "berbéristes".
L'origine de l'islamisme politique est à chercher dans cette
violence portée par le parti unique et le communautarisme paysan. La
recherche s'oriente également sur le rôle de l'armée dans l'histoire
politique du nationalisme. Mais la question des harkis, ces paysans
en armes qui ont combattu avec la France, reste encore taboue.
D'autres débats ont vu le jour, sur la question berbère dans
l'histoire du mouvement nationaliste algérien. Tous ces
questionnements visent à nous dire une chose : l'Etat perd
progressivement le monopole d'écriture de l'histoire de la guerre
d'indépendance algérienne.
Il n'est pas possible d'envisager les retours de mémoire liés à
la question de l'Algérie en France indépendamment du travail qui
s'exerce de l'autre côté de la Méditerranée. La circulation, le
passage entre les différentes mémoires sont indispensables car en
France et en Algérie existent des récits imbriqués où se mêlent le
"face-à-face", mais aussi le "côte-à-côte". Les écritures en miroir
favorisent les retours d'histoire, les Algériens, eux aussi, tentent
de se débarrasser d'une mémoire falsifiée de leur guerre
d'indépendance.
La France se trouve en outre prise dans un mouvement mémoriel qui
s'exprime à l'échelle internationale, avec peut-être une restriction
du "temps de latence". Les traumatismes liés aux guerres entraînent
un long temps de latence pour essayer de regarder en face ce qui
s'est passé. Ce phénomène a pu s'observer autour de la question de
Vichy. Trente ou quarante ans sont quelquefois nécessaires pour
"assumer" des histoires douloureuses, passer de la mémoire à
l'histoire, trouver et désigner des coupables. La restriction du
"temps de latence" permet des mises en accusation judiciaires
rapides et la volonté de vite savoir. C'est une nouveauté. Il a
fallu attendre longtemps pour que se tienne le procès de Maurice
Papon, lié à son comportement sous Vichy. En revanche, en 1998, au
cours du procès, très vite le "Papon de 1942" de Bordeaux est devenu
un "autre Papon", celui d'octobre 1961, lorsqu'il était préfet
de police de Paris. Il n'y a pas eu d'attente, de distance critique,
historique, pour mettre en œuvre des procédures de mise en
accusation ou d'écriture des faits.
Enfin, la question du désir de construction d'identité
personnelle, à travers des réappropriations de mémoire, est
importante. La forte présence de la catégorie-mémoire sur la scène
publique est à mettre en rapport avec la crise des idéologies
globales. La mémoire apparaît comme le moyen de se réfugier dans ce
qui peut paraître sûr, dans le vécu personnel, individuel ou
familial. La méfiance est grande à l'égard des tentatives
idéologiques d'explication globale. La peur de perdre son identité
dans un processus d'homogénéisation mondialisé provoque un retour
vers le passé, surtout quand le présent est rempli d'angoisses et de
frustrations.
La recherche mémorielle entend également pouvoir s'inscrire dans
des histoires plus globales, plus générales qui visent à redéfinir
des récits nationaux. A cet égard, l'apparition dans la société
française de nouveaux groupes porteurs de la mémoire algérienne est
fondamentale. Jusqu'à présent, deux grands groupes porteurs des
"années algériennes" ont existé dans l'espace public. Les Européens
d'Algérie, dans les années 1970, à travers une série de récits, de
batailles pour ce qu'on a appelé "l'indemnisation des
rapatriés", se sont fait beaucoup entendre. Un autre groupe,
celui des soldats français, s'est manifesté à travers des
associations, pour la défense de leurs droits. Ces deux groupes,
Européens et soldats, ont fait valoir un certain récit de l'histoire
de la guerre d'Algérie, celui de la "nostalgeria", de la
perte d'une Algérie conviviale et coloniale, par "trahison" des
pouvoirs politiques.
Les enfants ou petits-enfants issus de l'immigration algérienne
en France forment un nouveau groupe qui a surgi dans la société
française, dans les années 1980. Ils ne s'inscrivent pas dans le
récit de la "nostalgeria" voulant se remémorer un passé
perdu. Ils veulent, au contraire, comprendre le présent qu'ils
vivent au quotidien comme exclus, ou stigmatisés. Dans cette
recherche, ils butent sur la question coloniale. A partir de là, ce
nouveau groupe bouscule le récit traditionnel de l'Algérie
coloniale.
Les retrouvailles de mémoire sont tout à fait positives. Elles
permettent de regarder l'histoire en face, de pouvoir l'écrire, mais
elles sont aussi révélatrices de problèmes. Le risque existe d'une
apparition de mémoire communautarisée, où chacun regarde l'histoire
de l'Algérie à travers son vécu, son appartenance familiale. Ce
regard particulier ne permet pas le "métissage" des mémoires pour
éviter que l'histoire ne se rejoue. Un retour problématique répète
le cloisonnement des mémoires où chacun vient disputer une date, un
lieu de commémoration.
Le problème soulevé par la date du 19 mars, comme moment de
commémoration signifiant la fin de la guerre d'Algérie, est
symptomatique. Les Européens d'Algérie considèrent que la guerre ne
s'est pas terminée le 19 mars 1962. Ils invoquent à juste titre
le massacre de la rue d'Isly du 26 mars 1962, où
46 Français d'Algérie ont été tués, et les enlèvements
d'Européens à Oran le 5 juillet. Cette absence de consensus sur
une date signifie qu'il est difficile de se réconcilier, que la
mémoire retrouvée ne suffit pas. Des stratégies communautaires
réapparaissent, empêchant la fabrication d'une mémoire nationale,
unifiée et plurielle. Les mémoires cloisonnées ne parviennent pas à
apaiser les obsessions ou les douleurs liées à la séquence de la
guerre d'Algérie. Mais réinstaurent, quelque part, une sorte de
hiérarchie des communautés liées à l'histoire de l'Algérie
coloniale.
L'important toutefois est que, quarante ans après, la mémoire
"ancienne combattante", celle qui veut toujours vivre avec, rejouer
toujours la guerre, s'épuise. Ceux et celles qui vont devoir faire
et font déjà l'Algérie et la France de demain n'ont aucune
responsabilité dans l'affrontement d'hier. La majorité des jeunes
considèrent l'indépendance de l'Algérie comme un fait inévitable,
nécessaire, normal. Le drame franco-algérien ne devient qu'une page
de leur histoire. Ils veulent lire cette page avec méthode, loin du
bruit et de la fureur longtemps entretenus par leurs aînés, acteurs
de cette histoire. Ils entendent sortir de l'enfermement du
traumatisme colonial, sortir des litanies de l'ancienne victime et
des autojustifications aveugles de l'ancien agresseur, pour forger
des valeurs d'égalité sur les ruines du mépris, de la haine. Le
travail pour retrouver la mémoire de la guerre d'Algérie n'est donc
pas fini.
Benjamin Stora est professeur d'histoire du
Maghreb à l'Institut national des langues et civilisations
orientales (Inalco).